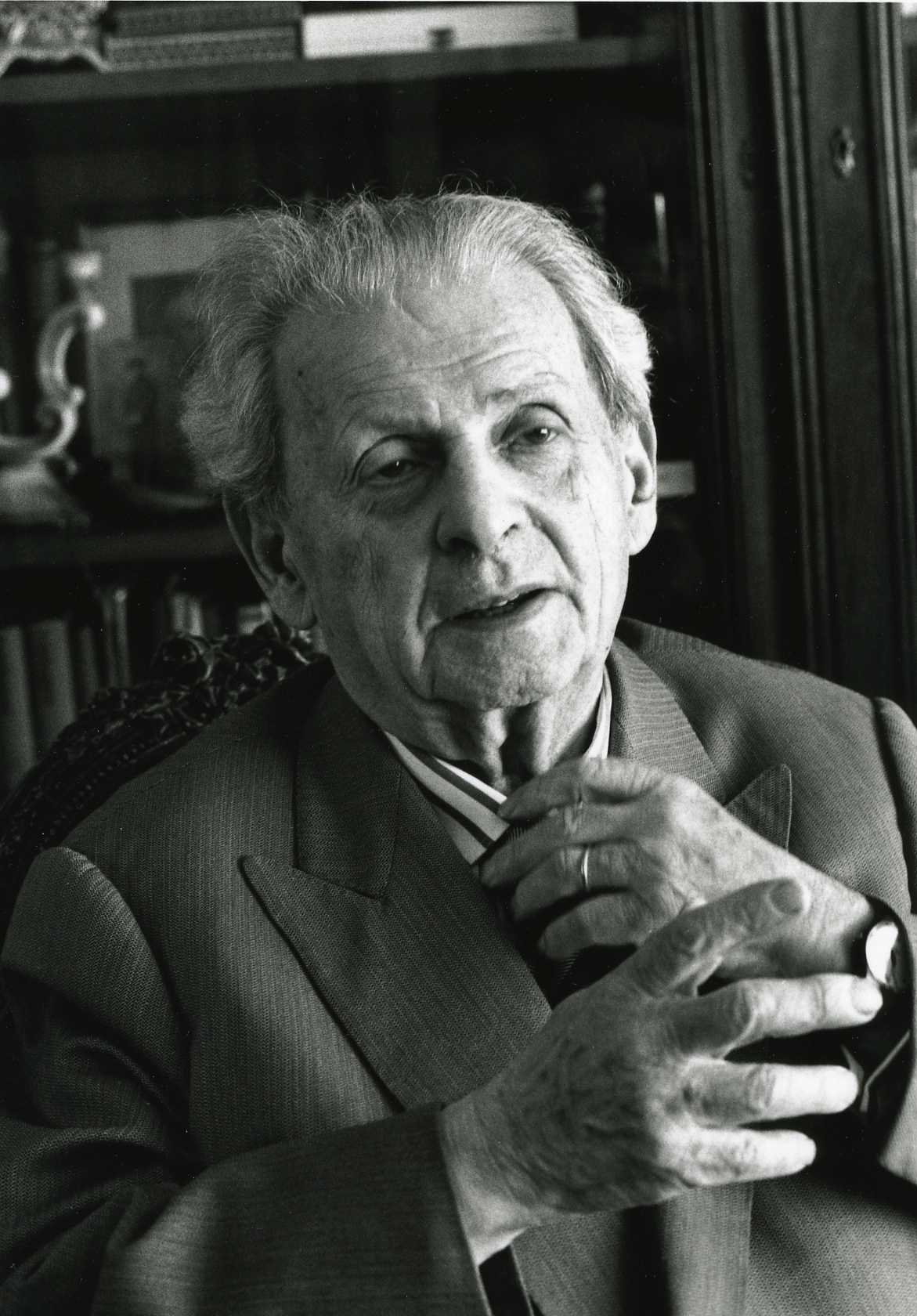Sophie Nordmann enseigne la philosophie à l’école pratique des Hautes Etudes. Elle est membre du Groupe Sociétés Religions Laïcités. Ses travaux portent sur l’histoire de la philosophie juive moderne et contemporaine.
Le présent ouvrage, Levinas et la philosophie judéo-allemande1 traite lui des sources judéo-allemandes de la philosophie de Levinas. Outre Levinas, cinq auteurs y sont étudiés : Herman Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Gershom Scholem et Walter Benjamin. Mais c’est bien une interrogation sur sa pensée qui est à l’origine de ce projet. Plus précisément, indique Sophie Nordmann, sur la manière dont « les commentateurs de l’œuvre de Levinas distinguent couramment deux Levinas : le phénoménologue et le penseur juif ». Son œuvre se compose effectivement de deux corpus distincts que celui-ci, précise Sophie Nordmann, « prend soin de publier chez deux éditeurs différents (p 8) ». Mais l’objectif de ce travail est de montrer que cette distinction ne doit pas s’interpréter comme le signe d’une séparation totale entre deux propos rigoureusement indépendants. Au contraire, selon elle « c’est la jonction de ces deux types de sources qui donne lieu chez Levinas au projet tout à fait singulier d’une phénoménologie de l’autrement qu’être ». Aussi Sophie Nordmann propose-t-elle l’hypothèse suivante : « La frontière, la distinction, ne passe pas entre la philosophie d’un côté et le judaïsme de l’autre mais entre deux manières d’articuler l’une à l’autre. Dans ses lectures talmudiques, Levinas part des sources juives et leur apporte un éclairage philosophique : la philosophie est au service d’une interprétation des textes juifs. Dans ses essais, Levinas part de problèmes philosophiques et les traite en faisant intervenir la référence au judaïsme : la référence aux sources juives est au service d’un projet philosophique d’inspiration phénoménologique (p 9) ». Or, un geste analogue serait commun à tous les auteurs abordés dans ce livre, de sorte que les étudier permet à la fois d’approfondir le sens de cette articulation, mais également d’éclairer les sources et la portée du geste de Levinas dont Sophie Nordmann considère qu’il « prolonge la démarche » de ses prédécesseurs. Plusieurs éléments sont en effet communs à tous ces auteurs, dont par exemple la volonté de renouveler un judaïsme jugé en perte de sens, une critique de la totalité, « une prise de distance critique vis-à-vis des «paradigmes» modernes (p 12) » ; et surtout le projet d’une réorientation éthique de la rationalité philosophique.
Chapitre premier –Herman Cohen et le judaïsme comme monothéisme
Cohen appartient au courant néokantien et il construit son « système de la philosophie » sur la base de trois commentaires d’Emmanuel Kant : « la Logique de la connaissance pure (…), l’Éthique de la volonté pure, (…) et enfin, l’Esthétique du sentiment pur (p 15/16) ». Or, Sophie Nordmann constate que durant toute la première partie de son œuvre Cohen « veille à maintenir une frontière stricte (…), qui place d’un côté les essais philosophiques proprement dits, et de l’autre les articles touchant aux questions juives ». Toutefois, elle montre que ces « deux ordres de préoccupations, à un moment donné, confluent (p16) », notamment à partir de son essai de 1915, Le concept de religion dans le système de la philosophie. Or, son propos tient dans le fait que cette convergence n’est pas fortuite, mais qu’elle s’inscrit au contraire dans la nécessité du projet philosophique de Cohen, visant à poursuivre « l’entreprise critique initiée par Kant (…), en soumettant la religion au « libre et public examen » de la raison, autrement dit à la méthode transcendantale (p 18) ». Ainsi, Cohen poursuit effectivement l’entreprise critique mais il l’oriente dans une direction différente. La « religion de la raison » n’y a pas le même statut que, pour Kant, « une religion dans les limites de la simple raison » (p 19). Elle n’est plus seulement mise en critique, ni même déduite de la raison. Or pourquoi, s’interroge Sophie Nordmann, « une religion de la raison ne serait-elle pas, comme son nom l’indique, tirée de la raison ? Est-ce à dire que la raison ne serait pas suffisante à elle-même (…)? ». Elle en conclut que « le geste même qui consiste à tirer une religion de la raison des sources du judaïsme implique, en creux, une interrogation sur la rationalité philosophique ». Cohen poursuivrait certes le geste kantien mais en le retournant, pour ainsi dire, contre lui-même puisque c’est désormais la rationalité philosophique qui est mise en critique au nom de l’exigence éthique. Or, il discerne une faille au principe même de cette exigence. Définie en termes kantiens, « l’éthique renvoie à la volonté et au champ du raisonnable (p 19) ». Elle relève de l’autonomie de la raison. A ce titre, elle fait « abstraction (…) de l’individualité empirique ». L’individu n’y est appréhendé qu’en tant que « membre de la communauté universelle des sujets raisonnables comprise sous le nom d’humanité (p 21) ». Et c’est précisément ce qui poserait problème : « en se tenant dans l’abstraction elle ne fournit ni mobile ni d’impulsion à agir ». « Si je n’avais pas en vue la souffrance de l’autre, je n’agirais pas éthiquement ». En somme, l’éthique se tiendrait en l’injonction paradoxale d’un principe en lui-même inopérant. Cohen en tire la conclusion suivante : « l’éthique a besoin d’un complément, d’un secours, pour sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouve prise (p 22) ». Et c’est précisément dans les sources juives qu’il trouve ce complément, y discernant : « une conception de l’humanité une et universelle fondée autrement que sur le processus d’abstraction des particularités qui caractérise l’idéalisation éthique (…), et qui permet de tenir ensemble l’idéal d’une humanité une et universelle et la prise en compte des particularités et des situations concrètes dans lesquelles les individus se trouvent pris (ibid.) ».
Sophie Nordmann prend l’exemple d’une controverse talmudique qui permet à Cohen d’illustrer son propos 2. Celle-ci présente deux conceptions qui fondent l’amour du prochain : « Akiba déclare : «Tu dois aimer l’autre (rea), il est comme toi. Voilà une notion de première grandeur dans la Thora. » Ben Asaï dit : « Ce livre est le livre des générations de l’homme (Genèse V, 1). Voilà une notion plus grande que l’autre ». La première conception est celle d’une « commune humanité du moi et de l’autre » et correspondrait à l’idéalisation abstraite de l’éthique. La seconde est celle d’une génération commune, ou filialité. Or, elle permettrait aux yeux de Cohen d’articuler pluralité et universalité puisqu’ « en tant que frères, les hommes sont égaux sans pour autant être « abstraitement semblables (p23) ». L’avantage est double. D’une part cette conception permet la prise en compte d’une souffrance réelle, celle d’un homme incarné. Et telle est la condition requise pour impulser l’action éthique. D’autre part, elle fournit un modèle pour penser des prescriptions concrètes, ainsi qu’une société pluraliste et donc un idéal retrouvant une prise sur le réel. D’où, précise Sophie Nordmann, le recours au Deutéronome qui formule des prescriptions ayant en vue « l’humanité, (…) à partir de la particularité – celle de la veuve, de l’orphelin, de l’indigent (p 23-24) ».
Le reste du développement nous a paru structuré autour de trois éléments : le rôle central de la pitié, l’idée d’une communauté sociale procédant de cette même pitié, et surtout ce projet d’une nouvelle rationalité philosophique rendu possible par le recours au judaïsme. Sur le premier point, Sophie Nordmann distingue le sens de la pitié pour Cohen de son acception rousseauiste (p 29). Chez ce dernier, l’autre serait conçu comme un semblable, un autre moi tandis que Cohen chercherait à penser une véritable altérité, irréductible au moi. C’est en ce sens qu’elle se produit dans l’attention concrète aux souffrances de l’autre. Or, outre ce rôle déjà évoqué de moteur impulsant l’action éthique, la pitié ainsi entendue permet d’élargir ce lien dual vers celui d’une communauté sociale, concrète, pluraliste ; une communauté « qui ne soit plus déduite du « il » impersonnel de l’éthique ». Pour l’auteur, la pitié se mue donc en une « catégorie spécifique », celle de « souffrance sociale », et permettant de penser une communauté politique ne relevant plus de la seule loi abstraite et universelle.
Nous touchons ensuite au cœur du propos de ce livre, puisque cette ouverture sur le concret et la pitié par le biais du livre signe le choix d’une rupture, du moins d’une orientation nouvelle de la rationalité philosophique. Sophie Nordmann insiste donc sur le fait que « le geste de Cohen marque un tournant décisif à l’égard des lumières (p 33) » puisque celles-ci sont construites, à l’instar de l’éthique kantienne, sur l’autonomie de la raison et l’émancipation du politique à l’égard de la religion, des traditions, des mœurs. Mais ce tournant étant rendu nécessaire pour dépasser la contradiction d’une éthique jugée inopérante, l’idée d’une réorientation de la démarche philosophique paraît plus adéquate que celle de rupture. En effet, il ne s’agit en aucun cas d’une fuite hors les murs de la philosophie, d’un retour dogmatique au religieux mais bien, selon Sophie Nordmann, d’une « interprétation philosophique du judaïsme (p 35) ». Aussi, insiste-t-elle sur la compatibilité du recours aux sources religieuses avec l’entreprise philosophique : « la religion n’outrepasse pas pour autant les limites de la simple raison (…). Le texte biblique ne lui sert jamais d’argument d’autorité : la seule autorité qui vaille, c’est celle de la rationalité et de ses exigences (p 38) ». Ce serait précisément l’intérêt du monothéisme aux yeux de Cohen. Celui-ci permettrait de garantir la première exigence de la raison pratique, à savoir l’universalité tout en y ajoutant la possibilité de son inscription concrète par l’idée de filialité précédemment évoquée.
Chapitre II – Franz Rosenzweig et le judaïsme biblique
Pour ce chapitre, Sophie Nordmann s’attache de nouveau à montrer que le recours au judaïsme est motivé par un projet philosophique, et n’est donc pas réductible à une posture confessionnelle. Le développement se construit autour des éléments suivants : la recherche consécutive à ce projet d’un renouveau du judaïsme, la critique de l’hégélianisme et de la totalité, ainsi que la réhabilitation du particulier et du pluralisme par le biais d’une pensée de la mort. L’auteur commence par souligner l’importance du parcours biographique de Rosenzweig, qui passe près d’une conversion au christianisme avant d’y renoncer. Ce projet de conversion aurait en fait été inspiré par « l’hégélianisme du moment », présentant le judaïsme comme une « figure périmée de l’Esprit ». Mais Sophie Nordmann décrit un Rosenzweig décidant de se confronter plus concrètement à la pratique du judaïsme avant d’entériner son projet de conversion. Or, il y découvre « des valeurs propres, irréductibles – irréductibles non seulement au christianisme mais aussi à leur évanescence dans la Totalité et l’Esprit Absolu (p 47) ». Autre aspect fondamental, la première guerre mondiale qui, laissant derrière elle « un champ de ruine », marque la vacuité d’un discours de progrès et de totalité. « À la systématicité hégélienne fait pendant l’époque planétaire qui s’annonce dans le conflit généralisé (p 50) ». Aussi, l’auteur insiste-t-elle sur la corrélation de ces deux événements biographiques que sont « sa décision de rester juif», et l’expérience de la Première Guerre mondiale (p 48), corrélation dont le sens éminemment philosophique prendrait réellement forme dans L’étoile de la rédemption ».
Tout d’abord, le judaïsme fournirait les clés d’une résistance à la totalité tout en évitant l’écueil anomique. Comme pour Cohen, il le permettrait en méditant une universalité strictement dépendante de son incarnation et de sa corrélation au particulier. Sophie Nordmann insiste ensuite sur le rôle que joue chez Rosenzweig une réhabilitation de la pensée de la mort. « Ce qui, pour Rosenzweig, est en jeu dans la question de la mort et de la guerre, ce n’est finalement pas tant la mort elle-même que son revers, l’existence individuelle (p 50) ». Rosenzweig décrit la mort comme « néant déterminé (p 53-54) » qui, en mettant en lumière ce singulier irréductible pourtant voué à disparaitre, permet de résister à l’empire de la totalisation : « La philosophie aimerait bien engloutir [la mort] dans la nuit du néant, mais elle n’a pu lui arracher son dard venimeux, et l’angoisse de l’homme qui tremble devant la piqûre de ce dard inflige un cruel démenti au mensonge compatissant de la philosophie (p 52)» 3. Mais la pensée de la mort fait davantage que réhabiliter le singulier, elle « met en question le présupposé du Tout : elle le fait apparaître, justement, comme un pré – supposé sur lequel repose tout l’édifice de la philosophie systématique (p52) ». Et « la mise au jour » de ce présupposé ouvrirait la voie vers une nouvelle ontologie qualifiée par Sophie Nordmann d’« ontologie du multiple (p 55) ». Celle-ci permettrait à Rosenzweig d’orienter la philosophie dans une nouvelle direction, conduisant de l’éclatement de la totalité « vers l’ouverture d’une nouvelle forme de systématicité (p 50) », chemin qui est celui conduit par les trois parties de L’étoile de la rédemption (p 55-56).
Le première, nous explique l’auteur, est constituée de trois livres – Dieu, le monde, l’homme – qui représentent trois éléments séparés et non totalisables où le judaïsme n’est pas encore présent. Celui-ci devient central dans la seconde partie «et va constituer le point d’appui de la nouvelle forme de systématicité philosophique (…): une systématicité non plus présupposée mais visée. Une visée de la totalité qui part de l’existence singulière et des morceaux de la totalité brisée, une systématicité faite donc de leur mise en relation (p 56) ». En d’autres termes, une totalité qui ne fusionne pas mais préserve « l’irréductibilité mutuelle des éléments». Les trois livres de la deuxième partie expriment ce lien entre universalité et pluralisme, lien noué par trois catégories issues du judaïsme : la création, la révélation, la rédemption. Puis, la pensée de Rosenzweig se précise encore davantage dans la triade : paganisme, idéalisme et judaïsme. Le paganisme renvoie à la séparation des trois éléments Dieu, monde et homme. L’idéalisme correspond à la « dérivation mutuelle des éléments à partir du présupposé du Tout pensable (p 58) ». Enfin, le judaïsme figure cette sortie possible du paganisme qui ne tombe pas dans l’écueil idéaliste visant à « fondre les éléments en un « Tout pensable (ibid.) ». Pour conclure, Sophie Nordmann revient sur le parcours biographique de Rosenzweig qui est tout entier animé par cette recherche spirituelle et le souci de mettre sa pratique en conformité avec l’évolution de sa pensée. C’est en ce sens qu’il choisit de quitter l’université et de fonder une maison d’étude inspirée de son travail : « Il ne choisit cependant pas de se tourner vers le sionisme, il ne choisit pas de développer les études juives à l’Université, il ne choisit pas non plus de revenir à un judaïsme orthodoxe. Il choisit de fonder un nouveau lieu d’études – qui n’est ni une yeshiva, ni une académie universitaire : un nouveau lieu d’étude pour, donc, un nouveau judaïsme (p 65) »
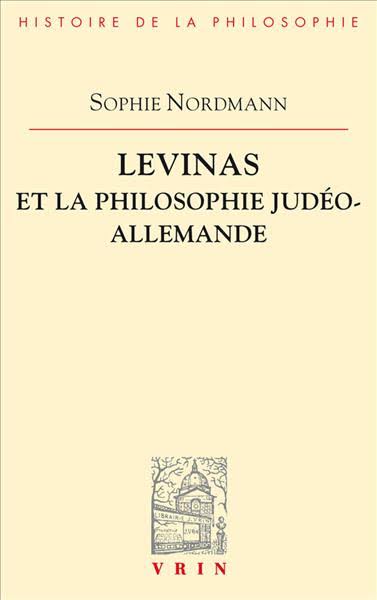
Ch. III – Martin Buber et le judaïsme hassidique
Sophie Nordmann relève chez Buber cette même quête de spiritualité, et ce même désir de renouvellement. « Comme Rosenzweig, comme Scholem également, Buber considère le judaïsme de son temps comme sclérosé : il n’y trouve pas la religiosité vivante qui l’attire (p 68) ». Dans ce contexte Buber se rapproche du sionisme avant de prendre ses distances, le jugeant réduit à des fins strictement politiques. En effet, « pour Buber, (…) l’état juif n’est pas une fin en soi mais un moyen en vue d’un renouvellement du judaïsme ». C’est finalement la découverte et l’approfondissement du courant hassidique, courant mystique né en Ukraine au XIIIème siècle, qui lui permet de satisfaire son objectif. Sophie Nordmann prend soin de préciser qu’il ne s’agit en aucun cas d’un retour à l’orthodoxie, mais plutôt une « rupture avec le judaïsme officiel au sein duquel Buber évolue (p 71) ». Ce que Buber reproche au judaïsme officiel c’est, entre autres, une « intellectualité jugée stérile, livresque », une orthodoxie inflexible, etc. Tout cela étoufferait en quelque sorte la source vivante du judaïsme en la figeant dans une forme conventionnelle, donc arbitraire et dogmatique. Or, à travers le hassidisme Buber découvre que cette source vivante aurait pourtant continué d’exister, de manière souterraine, « dans l’intériorité incandescente des hérétiques et des mystiques (p 71) ». Dès lors, Buber se serait fixé pour tâche de produire l’historiographie non officielle de ce judaïsme souterrain.
Sophie Nordmann montre que le sens de cette opposition entre judaïsme officiel et judaïsme souterrain se révèle dans la distinction qu’établit Buber entre religion et religiosité. Tandis que la religion désigne « la somme des coutumes et des doctrines dans lesquelles la religiosité d’une époque particulière et d’un peuple donné s’articule et s’exprime (p 75) », la religiosité exprime la source de la religion, son « principe créateur ». Cette distinction permet d’approfondir la critique d’une religion officielle « arrêtée dans les formes, fixée dans les prescriptions et les propositions dogmatiques » 4 ». Substituer entièrement la religion à la religiosité revient à faire d’une interprétation possible la vérité une et unique. Au contraire, religiosité et religion doivent mener un dialogue permanent. Buber parle de « complémentarité » et de «dialectique dynamique ». Autrement dit, il s’agit d’une démarche herméneutique qu’approfondira Levinas, et dont l’hassidisme tient lieu de moteur spirituel (p 92). Et comment se noue le lien entre textes consacrés au hassidisme et travail philosophique chez Buber ? Selon Sophie Nordmann, la dimension proprement philosophique de son œuvre s’incarne principalement dans l’ouvrage « qui sera publié en 1923 sous le titre Je et Tu ». Or, elle observe que la référence au judaïsme n’y est pas évidente. « Rien de spécifiquement juif n’y apparaît, aucune référence à la bible, aucune citation de verset (p 76)». Elle affirme toutefois que, « si elle n’est pas thématisée comme telle (…), la référence au judaïsme offre à Buber le point d’appui à partir duquel prend corps, dans l’essai, la critique philosophique du monde moderne, et l’ouverture à une voie alternative, celle d’une manière nouvelle d’envisager le rapport de l’homme au monde et la pluralité humaine (ibid.) ».
La critique du monde moderne se cristallise dans l’opposition que Buber propose entre deux modes de relations : le je-tu et le Je-cela. Le Je-cela exprime la relation au monde de la réduction phénoménologique où l’objet et l’autre se réduisent à des horizons du Je, tandis que le Je-tu exprime une relation à l’autre irréductible au Je. Buber identifie le monde moderne à celui « de l’hégémonie du Cela », un monde où « le mot-principe Je-Tu n’a plus sa place (p 80) ». Autrement dit, un monde niant toute altérité et toute relation véritable. Le mode du Je-Tu lui permet donc de penser une relation réelle, échappant à cet enfermement 5. C’est précisément la fonction du judaïsme que de permettre cette pensée d’une relation non réductible au cogito. « Sortir du cauchemar du monde moderne implique en effet d’avoir déjà mis un pied ailleurs : on ne peut se réveiller du cauchemar depuis l’intérieur du cauchemar lui-même (p 84) ». Le judaïsme figure cet ailleurs, ce réveil permettant de mettre en critique le monde moderne mais également de proposer un contre-modèle utopique, deux fonctions strictement corrélées. Sur ce point, Sophie Nordmann montre ensuite que c’est justement cette conjonction entre critique de la modernité et utopie qui conduit Buber à la défense d’un socialisme communautaire inspiré par le messianisme religieux, distinct de la forme moderne et libérale du socialisme : « La grandeur de l’attitude prophétique réside à ses yeux dans le combat, mené par les prophètes, contre « l’Etat dé-divinisé, dé-spiritualisé » qui a supplanté « une forme de communauté qui se tenait en relation directe avec Dieu (p 88) ». Autrement dit, le socialisme messianique figure aux yeux de Buber une nouvelle anthropologie, distincte de celle d’un sujet/ego moderne construit, pour ainsi dire, de manière axiomatique sur le fondement de la liberté. La société y est ainsi construite sur le principe d’une relation précédant un sujet qui n’en constitue plus à lui seul le fondement ni la fin.
CH IV – Gershom Sholem et le judaïsme kabbalistique
Sur le plan biographique Sophie Nordmann constate, une nouvelle fois, ce chemin d’une prise de distance avec le judaïsme précédant un regain d’intérêt. La distance est induite par le mode de vie assimilationniste de la famille de Scholem de sorte que son retour, selon Sophie Nordmann, « est donc d’abord un geste de rupture vis-à-vis de la maison paternelle et du judaïsme semi-assimilé qui est celui de la génération de son père (p 96) ». Pour autant, cette rupture n’est pas guidée uniquement par cet aspect. Elle relève en premier lieu, à l’instar des auteurs précédents, d’une préoccupation spirituelle : « rupture avec un judaïsme privé de sa substance, vidé de son sens, moribond car réduit à de pauvres vestiges (p 97) ». Scholem aurait éprouvé un sentiment de vacuité face à un judaïsme réduit à ses formes, à des pratiques privées de leur sens et de leur spiritualité : « Du rituel juif, nous n’observions plus que les fêtes considérées comme des fêtes de famille ». C’est ainsi que, comme Rosenzweig, Scholem se tourne dans un premier temps vers le sionisme mais prend également rapidement ses distances. « Le sionisme apparaît en effet à Scholem – en cela proche de Buber – non comme une fin en soi mais plutôt comme une perspective de revivification face au judaïsme moribond qui a résulté de l’émancipation des juifs allemands (p 97) ». Il s’agit donc surtout de redonner un sens à la pratique du judaïsme et à son étude, et c’est cette préoccupation qui le conduit progressivement à s’intéresser à la Kabbale, courant mystique et ésotérique.
Cet intérêt pour la Kabbale est aussi le point de départ de ce qui constitue son point commun avec Buber, à savoir le projet de mettre en relief une « contre histoire » ou histoire souterraine du judaïsme. A l’instar de Buber il s’agit de dégager, derrière les dogmes, des « forces irrationnelles sources de vitalité », une force créatrice, et donc de ne pas réduire le judaïsme à un fait culturel. Sophie Nordmann prend l’exemple d’un rapprochement paradoxal opéré par Scholem entre le mouvement sabatéen, qui est un courant d’orientation mystique et prônant la pratique de ce judaïsme souterrain, avec la Haskala, courant rationaliste fréquemment associé au rationalisme des lumières. En décelant une présence du mysticisme jusqu’au cœur même du mouvement le plus rationaliste du judaïsme, Scholem chercherait à briser l’opposition manichéenne entre les deux courants, de manière à ouvrir la possibilité d’une pensée réunifiant raison et mystique. C’est le messianisme de la Kabbale qui jouerait ce rôle, en inscrivant une visée eschatologique au cœur du rationalisme. Or, pour l’auteur, Scholem voit dans le messianisme le fruit d’une rencontre entre deux courants traditionnels du judaïsme : le courant restaurateur et le courant utopique. Et c’est cette association qui lui permet de conduire, à l’instar de Buber, une critique de la modernité, en ce sens qu’elle est porteuse d’une conception de la temporalité différente. La modernité est guidée par une conception linéaire du temps, le progrès. Le messianisme, quant à lui, accorderait une « importance centrale à l’idée de rupture du tissu historique », ouvrant de cette manière « la possibilité, à chaque instant, du surgissement du nouveau. Au contraire, la conception de l’histoire comme progrès, qui applique le principe de causalité à la temporalité historique, interdit l’irruption de l’absolument neuf et enchaîne (…) l’homme à une causalité qui l’écrase (p 107) ». L’eschatologie messianique se distingue donc d’une théodicée. Elle ne porte pas sur l’accomplissement progressif ou futur d’une cité idéale, mais se joue au coup par coup, à chaque instant, dans un éternel renouveau comme jugement et possibilité de rupture. Sophie Nordmann rappelle que cette « défense d’un temporalité en rupture » est commune à Scholem, Benjamin et Rosenzweig », ainsi qu’à Buber. Tous seraient reliés par cette rupture avec « le modèle hégélien de l’histoire et, plus essentiellement encore, avec le modèle d’une théodicée héritée à la fois des Lumières et de la théologie chrétienne du Salut ».
Puis, sans lui consacrer l’intégralité d’un chapitre, Sophie Nordmann évoque Walter Benjamin dont le travail prolongerait celui de Scholem en se portant plus spécifiquement sur la philosophie de l’histoire. Benjamin structure son travail autour de trois grand paradigmes : théologique, esthétique et politique. Tous permettent de critiquer cette temporalité moderne, et d’ouvrir vers une autre conception. Mais le second paradigme joue un rôle essentiel, notamment dans l’origine du drame baroque allemand. Pour Benjamin, « il n’y a pas de progrès continu dans le développement des œuvres d’art : chaque grande œuvre apparaît comme quelque chose de radicalement nouveau (p 111) ». C’est en ce sens, selon Sophie Nordmann, que « le modèle esthétique de l’histoire remet en question les postulats de base de l’historicisme : continuité du temps historique, causalité régissant l’enchaînement des événements (…), faisant plutôt apparaître une histoire polycentrique faite de la succession discontinue de « zones de temporalité autonomes » qui, comme des œuvres d’art, possèdent leur intelligibilité propre (p 112) ». Or, cela permet à Benjamin de penser le nouveau, le singulier, le discontinu, les accidents et les failles, ce qui le conduit à porter son attention sur l’histoire des vaincus. « L’histoire envisagée comme progrès est, en effet, forcément une « histoire des vainqueurs » puisqu’à son principe on trouve l’idée suivant laquelle toute l’histoire passée convergerait vers un présent qui serait à la fois le seul et le meilleur présent possible (p 112-113) ». La continuité est celle des vainqueurs qui « lisse l’histoire dans le sens du poil ». Benjamin entend lui redonner la parole aux oubliés, aux opprimés, restaurer leur droit en restaurant leur mémoire, d’où la catégorie de remémoration qui « établit entre deux moments du temps un lien qui, sans elle, n’apparaîtrait pas (p 116) ». En outre la remémoration relie, chez Benjamin, philosophie de l’histoire et utopie. D’une part, parce qu’elle restaure la dignité et la mémoire des vaincus mais, d’autre part, parce qu’en brisant la continuité officielle, elle rend possible le changement et donc la « rédemption ». Enfin, cette connexion relierait également Benjamin au messianisme de la Kabbale différenciant ainsi nettement sa philosophie de l’histoire de l’historicisme d’une part, mais également « de l’idée marxiste de la « fin de l’histoire (p117) ». C’est en ce sens que Benjamin a pu être qualifié par des commentateurs de « premier utopiste révolutionnaire », occupant la place tout à fait singulière d’inventeur« d’une nouvelle philosophie de l’histoire, un « matérialisme historique » revu et corrigé par le messianisme juif et par la critique romantique » 6
CH V – Emmanuel Levinas et le judaïsme talmudique
Pour ce dernier chapitre, Sophie Nordmann revient sur son hypothèse de départ : « ce qui se joue entre les essais philosophiques de Levinas et ses lectures talmudiques n’est pas la distinction entre, d’un côté un « Levinas philosophe » et de l’autre un « Levinas penseur juif », mais deux modalités différentes de l’articulation entre philosophie et référence au judaïsme (p 120) ». Elle remarque pourtant que, dans les premières années, la distinction semble clairement établie puisque Levinas publie chez deux éditeurs distincts, d’un côté les écrits phénoménologiques, de l’autre côté les écrits talmudiques. Mais, pour Sophie Nordmann « cette distinction s’accompagne très tôt d’une articulation entre ces deux aspects de l’œuvre ». Pour étayer sa démonstration, elle choisit de s’appuyer sur deux textes parallèles tous deux écrits en 1935 : De l’évasion pour le côté philosophique et L’actualité de Maïmonide pour le versant talmudique. Ces deux textes se situent à l’orée de son œuvre mais ils figurent pourtant, chacun sous un angle propre, la question structurante de « l’impasse philosophique de l’enfermement dans l’être (p 121) ».
Tout d’abord, pour Nordmann « Le besoin d’évasion (…) nous conduit au cœur de la philosophie (p 121) » dont l’objectif annoncé – « renouveler l’antique problème de l’être en tant qu’être » – est une référence évidente à Heidegger mais qui masque en réalité une prise de distance. Levinas considère en effet que celui-ci, en laissant le Dasein rivé à son être propre, ne serait pas allé assez loin. De caractère tautologique l’être serait brutal en son principe, interdisant toute possibilité d’une altérité véritable. Le désir d’évasion répondrait à cet enfermement décrit phénoménologiquement comme nausée : « l’expérience de la nausée est donc à la fois, inséparablement celle d’un enfermement total, et celle d’un effort pour sortir de cet enfermement (p 123) ». Si, à juste titre, Sophie Nordmann prend soin de préciser que ce texte ne développe pas encore le contenu philosophique du désir d’évasion, celui-ci émerge néanmoins au travers de l’énumération des tentatives infructueuses d’évasion. Par exemple le plaisir, qui « ne parvient pas à briser l’enchaînement le plus radical, le plus irrémissible, le fait que le moi est soi-même (p 124) » 7 figure une condamnation à soi d’où affleure l’importance de l’autre. Puis, surtout, Levinas évoque l’idéalisme qui « vise en effet à dépasser l’être » et témoigne ainsi de « la grandeur de la civilisation européenne » en ce sens qu’elle ne se résigne pas à accepter la barbarie de l’être, « le désespoir tragique qu’il comporte et les crimes qu’il justifie (p 125) » 8. Malgré cela, l’idéalisme échouerait en restant « prisonnier de l’ontologie qui demeure son dogme fondamental » 9.
Parallèlement, L’actualité de Maïmonide 10 lie la question du judaïsme avec la montée du nazisme. Sur le plan philosophique, l’article procède à partir de « la proximité de Maimonide avec Aristote » mais se centre essentiellement sur le lien entre foi et raison. Or, ce lien achopperait chez Aristote sur la question problématique de la création, puisque le premier moteur serait par essence inaccessible à un connaître rivé au principe de causalité et sa régression infinie. Maïmonide, en distinguant « l’univers déjà créé, soumis à la logique irréfutable d’Aristote, et la création même de l’univers qui lui échappe », aurait permis d’ouvrir la voie à la conception de deux types distincts de rationalité. Premièrement, celle du monde et de la causalité. Et deuxièmement celle d’une création qui, antérieure au monde, ne pourrait donc pas se penser en termes de causalité mais imposerait le recours à d’autres catégories dont le judaïsme serait porteur. De ce développement, Sophie Nordmann tire un élément clé pour son propos. Le judaïsme « ne renvoie ni à une réalité historique ou sociologique, ni à une théologie : il est une catégorie philosophique (p 131) ». Elle cite cette remarque de Levinas, « partir du J ou partir du Dasein (p 132) », qui montre que le judaïsme réfèrerait d’autant plus à une catégorie qu’il n’est pas adossé à la philosophie de Heidegger dans son ensemble mais, précisément, au Dasein. Levinas viserait en réalité trois catégories : le paganisme (qui recoupe la causalité et le Dasein), l’idéalisme et le judaïsme, faisant ainsi écho avec la même trilogie présente chez Rosenzweig. Tandis que le paganisme rive l’être au monde et à lui-même, l’idéalisme correspond à cette tentative d’élévation incarnée par la philosophie occidentale et dont nous avons évoqué l’échec (restant fondée sur l’autonomie d’un sujet/empire, d’où l’autre demeure forclos). Enfin, le judaïsme porterait lui sur cet ordre créateur antérieur à toute connaissance possible, non rivé à l’être mais « rivé à une filiation, à une tradition, là où l’être occidental est l’être de l’émancipation, de l’autonomie, du non-ancré (p 134) ».
Ce développement permet de mieux comprendre comment le paganisme peut être associé au nazisme. Il peut l’être, aux yeux de Levinas, comme la conséquence sans doute la plus extrême du principe dont est porteuse la loi du monde, « celle de la persévérance dans l’être, celle du conatus, autrement dit, comme le fera apparaître la préface de Totalité et Infini, la loi de la guerre, la loi de l’affrontement des égoïsmes antagonistes qui cherchent, chacun pour son compte, à persévérer dans leur être (p 135) ». Pour l’être, il y va toujours de son être, coûte que coûte et la compatibilité avec l’autre ne peut qu’y être contingente. A contrario, le commandement juif « ne tue pas » sonnerait comme une interruption de cette logique mortifère, et correspondrait avec l’apparition du devoir être. « Si l’éthique se fait commandement, c’est précisément parce qu’elle ouvre un ordre autre que ce qui est : « L’impossibilité de tuer n’est pas réelle, elle est morale (p 136) ». D’où le sens de cet autrement qu’être, « cette voie de sortie de l’être que Levinas cherchait en vain dans De l’évasion et qui « sera donc celle de l’éthique comme philosophie première (p 136-137) ». L’idée de philosophie première signifie chez Levinas que l’exigence éthique précède la rationalité philosophique et surtout qu’elle en constitue le sens, c’est-à-dire son poumon, sa raison et sa conscience, ce qui paraît répondre au projet de Cohen d’une mise en critique de la rationalité par l’exigence éthique. Mais, tandis que Cohen procédait depuis l’exigence abstraite de la raison pratique tout en cherchant un remède à son inefficacité, pour Levinas l’exigence éthique elle-même procède de ce lien antérieur à l’être. Aussi, s’éprouve-t-elle concrètement. « Phénoménologiquement, l’interruption de la loi de l’être par le commandement éthique a, sous la plume de Levinas, un nom : celui de visage (p 138) ». Cependant, s’il s’agit bien d’une expérience phénoménologique, son statut est très spécifique. « La phénoménalité du visage n’est pas de l’ordre de la manifestation de l’apparaître – du phénomène – mais de l’apparition : elle est épiphanie, révélation qui comporte une signifiance propre, indépendante de cette signification reçue du monde (p 139) ». En effet, pour s’assurer d’une transcendance réelle, l’altérité doit percer les murs de l’être et donc ne peut se réduire à un horizon du cogito. Elle le précède en tant qu’elle relève de ce que Levinas définit comme créaturialité, lien filial immémorial précédant l’être, la liberté et toute forme de connaissance possible. Sur ce point, il est aisé de faire un parallèle avec le monothéisme que Cohen opposait à la conception moderne et abstraite de l’humanité. Le lien est d’autant plus notable que, d’une part cette filialité porte l’idée d’une justice sociale et, d’autre part, elle n’a pas non plus vocation à substituer une religion dogmatique à la démarche philosophique. « C’est en phénoménologue et en philosophe que Levinas lit le talmud : il refuse l’accès dogmatique, purement fidéiste ou même théologique, au Talmud (p 141) ». L’on retrouve ainsi cette même volonté de lier universel et particulier, « préoccupations de l’heure » et valeurs immémoriales, ainsi que cette vocation morale d’une démarche philosophique qui ne renonce pas pour autant à son exigence et sa probité : « jamais les textes talmudiques ne sont utilisés comme arguments d’autorité : ils nourrissent l’argumentation philosophique (p 142) ». Chez Levinas, l’articulation non dogmatique entre le talmud et la philosophie se noue dans la notion messianique d’inspiration, porteuse d’une approche herméneutique « vivante » et incessante. Ces développements conduisent ainsi à confirmer l’hypothèse de départ de Sophie Nordmann, à savoir qu’il n’y a effectivement pas deux Levinas mais plutôt deux modalités d’approches, lesquelles ne sont en aucun cas dichotomiques mais complémentaires et portées par un même sens, cette troisième voie distincte du paganisme et de l’idéalisme.
Pour conclure Sophie Nordmann présente une thèse opposée à la sienne, celle de Ytzhak Melamed qui, dans son essai Salomon Maimon et l’échec de la philosophie juive moderne, défend l’idée que le judaïsme doit concilier l’expertise philosophique avec une expertise juive, et requiert donc pour prérequis une bonne connaissance des textes juifs. Or, pour Melamed, aucun des auteurs traités dans ce livre ne satisferaient ces conditions. Ils seraient tous liés par un point commun : l’ignorance du Talmud et de la tradition, ainsi que la déformation du sens initial du judaïsme. Nordmann défend un projet opposé visant à montrer comment le recours aux textes juifs vient s’inscrire dans la raison d’un projet philosophique, projet dont elle ne sous-estime pas la difficulté : « l’expression de philosophie juive est elle-même éminemment problématique (…). Elle est un problème philosophique, à la fois en ce sens qu’elle est une question pour la rationalité philosophique, et qu’elle est une mise en question de la rationalité philosophique. Ce qui fait problème c’est précisément l’accolement des deux termes philosophie juive (p 149) ». Effectivement, tout semble opposer les deux démarches : la philosophie trouve son principe dans un mouvement d’émancipation à l’égard du dogme religieux. Elle se caractérise par l’universalisme et l’autonomie de la raison, tandis que le judaïsme relèverait de la révélation et du particularisme religieux. Or, malgré leur apparente contradiction, Sophie Nordmann défend la thèse d’une fécondité de cette mise en tension de l’une par l’autre. L’on aurait donc bien affaire à « la mise en œuvre d’une rationalité philosophique qui requiert, pour s’exercer, une référence aux sources juives (p 153) ». Aussi insiste-t-elle : « la question n’est plus alors de savoir, comme le veut Melamed, si les philosophes en question sont des experts en judaïsme ou s’ils sont de « bons juifs ». Ce qui importe, c’est de comprendre la portée du geste par lequel ils font intervenir la référence aux sources juives dans le cadre de l’exercice d’une rationalité philosophique (p 154) ». Elle ajoute : « chez tous les auteurs étudiés, c’est toujours un problème philosophique qui justifie le recours au judaïsme, celui de la contradiction performatrice de l’éthique chez Cohen, celui de la négation de l’existence individuelle par le système du « tout pensable » chez Rosenzweig, celui de l’affirmation brute de l’être et de l’impératif de l’évasion chez Levinas ». Enfin, Sophie Nordmann conclut en revenant sur le rôle clé de Levinas qui, selon elle, est à la fois héritier des auteurs évoqués mais également passeur, en ce sens que cette interaction entre philosophie et judaïsme prend chez lui une emprunte philosophique et phénoménologique très forte, notamment dans ses deux œuvres majeures, Totalité et Infini et Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Elle note que « le statut de catégorie philosophique qu’il assigne à l’être juif trouvera (…) un fort écho chez ses contemporains, et en particulier Maurice Blanchot et Jean-François Lyotard (p 155) ». L’idée d’une obligation précédant toute connaissance possible offre effectivement une voie très inspirante pour penser une obligation morale après l’extermination, notamment pour Jean-François Lyotard qui construit son travail dans un contexte post-moderne d’éclatement pluriel de la raison et d’absence de critère de légitimation faisant consensus.
Conclusion
La perspective de cet ouvrage nous a semblé particulièrement intéressante car elle se focalise sur un point nodal de l’œuvre d’Emmanuel Levinas, à savoir le sens de cette articulation entre démarche philosophique et recours aux sources judaïques. Et porter l’attention sur ses prédécesseurs éclaire la genèse d’un projet qui semble trouver une part essentielle de sa signification dans ce dénominateur commun aux six philosophes : le recours aux sources juives inscrit dans la raison d’un projet philosophique. En approfondissant ce dénominateur commun, Sophie Nordmann nous conduit cependant à réaliser qu’aucun des projets examinés ne peut être considéré comme axiologiquement neutre, puisqu’ils ont tous cette caractéristique d’être mus en premier lieu par une exigence éthique. C’est l’autre élément essentiel de ce livre, selon nous. Il met en exergue le sens d’une démarche qui, si elle se veut philosophique, ne peut éluder la dimension problématique du recours aux sources religieuses et de cette non neutralité initiale. Cette question est prégnante chez Levinas. Elle a d’ailleurs donné lieu à plusieurs controverses dont une des plus célèbres dans l’ouvrage de Dominique Janicaud, le tournant théologique de la phénoménologie, évoqué par l’auteur dans son introduction. Le livre n’élude pas cette question et montre en quelle manière ces auteurs cherchent à concilier leur projet avec l’exigence philosophique. Sur ce point, le parallèle entre Cohen, qui insiste sur la compatibilité du recours au livre avec les exigences de la raison pratique et Levinas, dont l’œuvre affronte en permanence ce souci de probité, nous semble très utile. Nous pensons d’ailleurs que davantage de parallèles avec Levinas, par exemple dans le chapitre dédié à Cohen mais pour les autres auteurs également, auraient pu nourrir encore davantage le propos.
Sur le même plan, nous pouvons peut être regretter que le format, voulu court, du chapitre dédié à Levinas ne permette pas de développer encore davantage la manière dont celui-ci s’affronte à cette difficulté. En effet, sa critique du dogmatisme y est menée à la fois dans ses textes philosophiques et ses lectures talmudiques, de manière parallèle mais sous deux angles spécifiques, ce qui renforce cette idée de complémentarité. Pour l’œuvre philosophique nous pensons par exemple au concept de trace marquant une exigence sans contenu et une démarche herméneutique, ainsi bien qu’à l’articulation du Dire et du Dit. De l’autre côté, les lectures talmudiques ne cessent de mettre en garde contre les dangers de l’idolâtrie figeant l’utopie en une forme définitive et dogmatique. De nombreuses pages opposent à cette idolâtrie une éloge répétée de la patience, repoussant à l’infini la réalisation terrestre de l’utopie messianique, et une démarche ouverte et pluraliste d’interprétation qu’incarne la sagesse du talmud. Cependant, ces développements auraient débordé l’objectif fixé à l’ouvrage et n’auraient sans doute pas été compatibles avec son format. Qui plus est, de trop nombreux renvois vers Levinas au sein de chaque chapitre auraient probablement nui à la clarté du propos et à la compréhension d’auteurs qui, le précédant chronologiquement, ne peuvent s’expliquer à partir de lui. Or, c’est précisément l’intérêt de ce livre que d’éclairer sur cette question clé, et d’en faire apparaître les sources.
- Sophie Nordmann, Levinas et la philosophie judéo-allemande, Paris, Vrin, 2017
- controverse relatée au neuvième chapitre du traité Nédarim du Talmud de Jérusalem
- F. Rosenzweig, L’étoile de la rédemption, Paris, la nuit surveillée, les cahiers de la nuit surveillée., p. 20
- Buber, la religiosité juive in judaïsme, trad. Fr. M.J. Jolivet, Paris, Verdier, 1982
- Cette non réductibilité du Tu au Je inspirera beaucoup Levinas, mais celui-ci reprochera à Buber la réciprocité entre le Je et le Tu qu’il jugera incompatible avec l’exigence éthique dont l’efficacité repose précisément sur le caractère asymétrique et hétéronome de l’obligation. Cf. notamment Emmanuel Levinas, Hors sujet, livre de poche, Martin Buber
- Sophie Nordmann cite ici Michael Lôwy, Walter Benjamin, critique de la civilisation », Romantisme et critique de la civilisation, Ed. Paris, Payot, 2010, p. 22.
- De l’évasion, Le livre de Poche, 1998, p 98
- Ibid. p 124
- ibid.
- Article de 1935, publié dans la revue Paix et Droit de l’alliance israélite universelle