En 1962, soit presque vingt ans après la disparition de Simone Weil, les éditions Gallimard publièrent, dans la collection « Espoir » les Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu de la philosophe chrétienne, recueil de textes retrouvés après sa mort dans ses papiers et probablement écrits à Marseille, entre octobre 1940 et mai 1942. La présente édition de poche1 en propose un condensé qui, bien qu’issue de la louable idée de l’illustre maison d’édition de rendre accessible à toutes les bourses quelques textes de philosophie (collection Folio Sagesses), n’en demeure pas moins d’une grande densité, tant les pages qui y sont réunies oscillent entre clarté et répétition. Mais, d’une part, cela n’est pas étonnant pour des papiers retrouvés, et d’autre part, il est possible d’y voir une forme de cohérence avec l’idéal même de l’écriture pour Simone Weil : impitoyable à l’endroit de la boursouflure et de toutes les formes d’insincérité, elle préférait aux phrases ampoulées un style plus clair, presque nu. Pour cette catholique sans Église, les grands textes sont le fruit d’un dépouillement intérieur, les traces d’un chemin mystique menant à la pureté par effacement du moi.
Le renoncement à soi
Cette remarque nous amène au premier grand thème évoqué dans ces pages, qu’est le transport hors de soi comme condition de l’obéissance à Dieu. Thème pour le moins important, car il explique la mise à l’écart du moi au profit d’une quête mystique, quête pourtant fort complexe puisque visant un Dieu inconcevable rationnellement, excédant de beaucoup l’intelligence et la parole humaine. C’est aux fondements de cette quête que les pages choisies de ce petit opuscule introduisent.
Apparemment paradoxale, cette formulation d’une « théologie négative » 2 tient pourtant d’une lecture platonicienne du rapport entre l’Être et le Bien (autre manière, pour Simone Weil, de nommer Dieu) des plus rigoureuses.
Pour elle, Platon était « la père de la mystique occidentale » [in Simone Weil, La source grecque (1936-1942), Paris, Gallimard, coll. « Espoir », p.80[/efn_note], et même s’il ne nous revient pas ici d’en exposer les détails, ce qui fut fait par ailleurs de manière très précise 3, indiquons toutefois que la lecture de La République de Platon permit à Simone Weil de mettre en évidence sa propre conception du cheminement philosophique, que l’on pourrait qualifier de voie dialectique progressive entre un détachement à l’égard de la finitude et la conversion à une vérité dont elle ne cache pas la difficulté de détermination.
Parmi les étapes de cette progression se trouvent la beauté et le malheur qui, tels des points d’ancrages ascensionnels, permettent à Simone Weil de montrer la voie verticale vers la grâce. Ce que nous souhaitons indiquer ainsi d’une manière beaucoup trop rapide, c’est que La République de Platon représente pour Simone Weil le paradigme de la recherche philosophique, qu’elle comprend comme une lente et progressive élucidation du mystère divin, de cet aveuglement qui préside à toute réflexion sur l’existence. Car ce Bien, dont il est question dans La République, est inconnaissable, et place l’esprit humain devant son infinie limite : « […] pour les connaissables aussi, ce n’est pas seulement, disons-le, d’être connus qu’ils doivent au Bien, mais de lui ils reçoivent en outre et l’existence et l’essence, quoique le Bien ne soit pas essence, mais qu’il soit encore au-delà de l’essence, surpassant celle-ci en dignité et en pouvoir ! » 4
Comme pour faire écho à cette idée aux multiples conséquences philosophiques, le verbe « exister » lui-même a pour étymologie un mot emprunté au latin classique ex(s)istere, qui signifie sortir de, être placé en dehors. Exister, c’est être, d’emblée, en-dehors du Bien, qui n’est pas, qui n’existe pas, qui excède toute essence et toute existence.
La Création est un geste de renoncement de la part de Dieu, qui conditionne l’essence tragique de l’existence humaine, car si celui-ci ne nous abandonnait pas – par Amour – au malheur, nous n’existerions pas. Ainsi, le malheur étant le fruit de la volonté divine d’opérer une déchirure entre la grâce et la pesanteur – cet attachement charnel qui gouverne tout ce vers quoi tendent les âmes humaines – cette dernière doit être comprise comme étant la force qui éloigne de la vérité et de l’amour divin. Le regard vers Dieu doit faire taire cette « partie médiocre de nous-mêmes » 5, qui sait fabriquer de « faux dieux qu’on nomme Dieu », nous pousse à de vaines projections et nous soumet aux nombreux faux semblants que la si fragile volonté humaine prend pour fins. La philosophe distingue d’ailleurs entre ces « mauvais objets de l’attention et du désir » 6, subterfuges souterrains (les diverses formes de mensonges intérieurs ; l’évasion dans les faux idéaux comme celui de la possession ; les empiétements imaginaires sur le passé ou l’avenir) visant à nous éloigner de Dieu ; et les bons objets, qui sont de l’ordre de la pureté (les textes sacrés ; les êtres humains en lesquels Dieu habite ; les œuvres d’art d’inspiration divine).
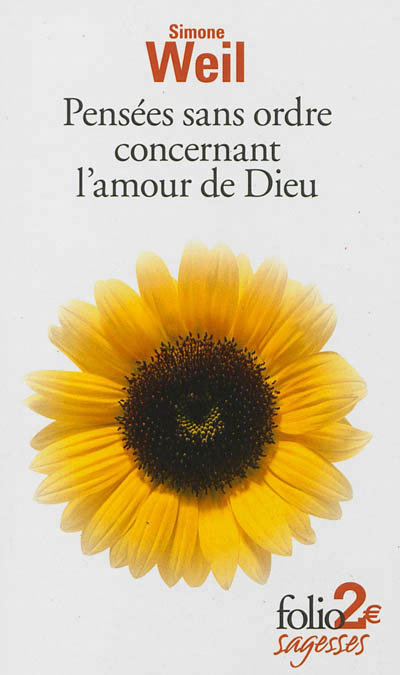
En conséquence, se tourner vers Dieu pour l’aimer nécessite de se « transporter hors de soi »7, il faut que l’âme soit devenue un réceptacle, une matrice fluide à partir de laquelle une nouvelle naissance adviendra. Cela implique un renoncement au « je », une mort du moi, et finalement une détournement de toutes les formes de la volonté humaine, qui n’est que volonté de la chair. En effet, « L’âme incapable de supporter cette présence meurtrière de Dieu, cette brûlure, se réfugie derrière la chair, prend la chair comme écran. » [Ibid., p.29] Cette défiance absolue à l’endroit de la chair est un élément essentiel de la métaphysique religieuse de Simone Weil, et elle ne concerne pas seulement la doctrine de l’Église sur la sexualité, mais tout ce qui touche à ce que Miklos Vetö nomme « la fonction décréatrice du corps ». Toutes les images dont se sert Simone Weil (le corps comme prison, comme levier agissant sur l’âme, etc) montrent très clairement, selon lui, « les lignes maîtresses de l’ontologie de Simone Weil : l’harmonie du bien et de la nécessité qui s’opposent à l’autonomie. » 8 Céder à ces inclinaisons propres à la volonté humaine, engluée dans sa finitude, est une tendance lourde qui n’est pas seulement une simple défaillance, mais une véritable « trahison » 9, car cela revient à se rendre coupable d’indisponibilité à Dieu. Se nier soi-même est la condition nécessaire à qui veut devenir disciple du Christ. Or, la pensée veut toujours se dérober de cette infinie obligation, elle la fuit dans le mensonge, par instinct de conservation. Mais – et là se situe un point radical de la pensée weilienne – telle la matière, notre âme est soumise aux contraintes extérieures, elle est ainsi en quelque sorte déjà morte : « Notre moi est un produit aussi fugitif et aussi automatique des circonstances extérieures que la forme d’une vague de la mer », 10
Une poétique de l’impénétrable
L’écriture de Simone Weil est parsemée de métaphores poétiques, telles que celles de la vague ou de l’œuf 11, lui permettant d’illustrer au plus près la voie qu’elle cherche à tracer vers l’impénétrable, l’invisible. C’est particulièrement le cas dans la lettre qu’elle écrivit à Joë Bousquet (1897-1950), le 12 mai 1942. Lui-même romancier, mais avant tout poète, Bousquet cherchait une parole capable de rendre compte au plus près des courants et tourments qui traversaient son âme, dans une exigence telle qu’elle ne peut que rappeler celle de Simone Weil. La parole poétique ne saurait sans se trahir tomber dans les travers d’une rhétorique convenue, qui chercherait, par exemple, à s’attribuer des pouvoirs magiques, comme celui de se consoler du malheur. Simone Weil dénonce les compromissions de la parole dans la rêverie : « Je crois que chez tous peut-être, mais surtout chez ceux que le malheur a touchés, et surtout si le malheur est biologique, la racine du mal, c’est la rêverie. Elle est l’unique consolation, l’unique richesse des malheureux, l’unique secours pour porter l’affreuse pesanteur du temps (…) Elle n’a qu’un inconvénient, c’est qu’elle n’est pas réelle. » 12 Marqué dans sa chair lors de la Grande Guerre, à vingt-et-un ans, par une blessure qui le laissa paralysé jusqu’à son dernier jour, Joë Bousquet partageait cette aspiration à ne point se réfugier dans une parole uniquement divertissante, dans un souci d’authenticité motivé par l’amour de la vérité. Renoncer à tout divertissement, dépasser Pascal, c’est consentir à demeurer au plus près de sa souffrance, écouter cette « part irréductible du chagrin » 13, car « Un chagrin qui n’est pas ramassé autour d’un tel noyau irréductible est simplement du romantisme, de la littérature. » 14
Cette exigence du renoncement à toute forme de contournement du tragique correspond à la rupture qu’engendre le malheur lui-même dans l’existence de celui qui le vit : ce « déracinement de la vie » 15 pousse le poète non seulement à se méfier de la poésie elle-même, mais encore à s’interroger sur cette sorte de « nuit obscure » (Saint Jean de la Croix) à laquelle, en tant qu’homme et poète, il est confronté. On reconnaîtra ici une certaine proximité avec le projet rimbaldien de travailler sur le « rien ». A rebours de l’idée courante qui considère Rimbaud comme le poète de l’hybris, il existe une quantité non négligeable de ses textes qui considèrent ce « rien » comme essentiel au langage, puisque source d’une harmonie nouvelle. Dès le poème »Sensation » des Poésies (1870), Rimbaud écrit : « Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien:/Mais l’amour infini me montera dans l’âme,/Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,/Par la Nature, – heureux comme avec une femme. ». En liant ainsi le mot « rien » au mot « bohémien », il souligne l’importance donnée à la pensée vagabonde, sans frontières, ouverte sur le surgissement de tous les possibles. Dans Illuminations (1872-1875), on retrouve à plusieurs reprises cette thématique du rien comme force, comme mouvement, comme commencement : « Je créais, écrit-il dans un très beau texte en prose intitulé »Vagabonds », par delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. » De cette force dialectique surgit une exigence éthique, comme chez Simone Weil : l’écrivain n’est pas un héros, son rôle doit être de relater son expérience en dépassant le simple sentiment. La comparaison doit néanmoins en rester là, la poésie rimbaldienne n’étant pas, comme l’esthétique de Simone Weil, une pensée chrétienne de la Révélation. Reste que le renoncement mène chez elle à un point originaire propre à déchirer le voile qui recouvre la vie profonde, et que ce thème peut être retrouvé chez de nombreux auteurs. Rainer Maria Rilke, par exemple, écrit, le 23 avril 1903 , dans une de ses lettres à un jeune poète : « Tout est à mener à terme, puis à mettre au monde. Laisser chaque impression et chaque germe d’une perception s’accomplir en soi, dans l’obscurité, dans l’indicible, l’inconscient, dans ce qui est inatteignable pour l’intelligence, puis attendre avec une profonde humilité et patience l’heure de la mise au monde d’une clarté nouvelle, cela s’appelle vivre en artiste : dans la compréhension autant que dans la création. » 16 Il ne s’agit en rien, chez Rilke, Rimbaud, Simone Weil ou Joë Bousquet, d’un quelconque hermétisme, mais de la recherche propre au geste poétique d’un absolu hors du temps, par un lent travail sur la langue. Cette décision d’accepter sa douleur, sa finitude, implique que rien ne soit sacrifié à la recherche des honneurs d’un quelconque ordre esthétique. Ainsi arrive-t-il à l’homme, écrit Henri Michaux, « (…) de vouloir perdre davantage son Je, d’aspirer à se dépouiller, à grelotter dans le vide (ou le tout). » 17. Voué à une quête solitaire parce qu’abandonnant la posture de l’homme social au risque de paraître grotesque aux yeux d’autrui, refusant la parole masquée, stipendiée, officielle, le poète accepte de sembler disloqué comme peut l’être le corps d’un clown, « Vidé de l’abcès d’être quelqu’un (…) à force d’être nul/et ras…/et risible… » 18 Il y a donc une proximité évidente entre certaines préoccupations de poètes et l’exigence weilienne de renoncement à soi comme recherche d’une certitude intérieure. Ce petit recueil de textes est à de nombreux égards une approche de la poétique de Simone Weil qui est une véritable expérience métaphysique, inséparable de sa conception du malheur, qui tient une place fondamentale dans la cohésion de sa pensée.
L’expérience du malheur : vers une attention à Dieu et une éthique de la compassion
Pour Simone Weil, le malheureux est avant tout une victime. Très souvent condamné, voire accusé d’accepter son sort par paresse, le malheureux en vient même à culpabiliser, à ressentir une répulsion de lui-même, car sa situation tragique le pousse à l’inertie. Il peut ainsi demeurer prisonnier de sa malédiction, d’où le malentendu dont il souffre. Or, Dieu créa par amour, et il a créé la possibilité de penser la distance, le « déchirement suprême, douleur dont aucune autre n’approche, merveille de l’amour, (…) la crucifixion. » 19 Ce déchirement « résonne perpétuellement à travers l’univers, au fond du silence » 20, et tous les hommes frappés de malheur doivent se rendre capable d’entendre ce silence, qui est la Parole de Dieu, dont « La création toute entière n’est que la vibration. » Le malheur met l’homme en face de la distance qui le sépare de Dieu, mais cette distance est aussi lien, par l’entremise de l’obéissance à la nécessité, voulue par Lui. La Providence révèle sa présence, comme au revers de l’existence humaine : la malheur a pour vertu d’être l’indice de la présence divine au travers du « hasard qu’il enferme ». Il faut donc aimer ce mécanisme de la nécessité, tant il nous place presque idéalement aux abords de l’Amour divin, entre le Père et le Fils. Ceux qui sont « persécutés pour leur foi » ne doivent pas l’oublier, sinon à sombrer dans le désespoir. Cette idée n’implique pas, pour autant, qu’il faille désirer le malheur, ce qui relèverait d’une perversion. Au contraire, cela ouvre chez Simone Weil une voie éthique, celle de l’impossibilité de l’indifférence au malheur d’autrui. En effet, les « trois faces de notre être » 21 (la chair fragile, l’âme vulnérable, et a personne sociale livrée au hasard) y étant exposées, il nous revient de bien distinguer entre la reconnaissance que nous devons à Dieu de « la fragilité presque infinie » que constitue notre condition et l’apitoiement sur soi que constituerait un dolorisme, fort éloigné de la compassion véritable, qui est compassion pour autrui. « Porter sa croix » ne signifie pas seulement désigner ses petits tracas quotidiens, car cela reviendrait à soumettre sa pensée à « un abus de langage presque sacrilège » 22. De même, la compassion, qui repose sur une connaissance concrète du malheur, est le contraire de la bonne conscience. Dans l’aumône, le bienfaiteur du Christ « transporte tout son être dans un malheureux » 23, si bien qu’il ne transporte pas seulement son être propre, « mais le Christ lui-même ». Le don prend alors la dimension d’une opération surnaturelle comparable aux sacrements. Si, comme l’écrit S. Weil, le pain devient alors hostie l’aumône, ou « malheur consenti, accepté, aimé » 24, cette compassion véritable dépasse l’acte de transsubstantiation eucharistique en ce qu’elle est don miraculeux, au cours duquel le moi qui s’offre s’efface au profit de la présence du Christ. On comprendra alors aisément l’importance que S. Weil donne à la notion de malheur : « Le malheur est au centre du christianisme. L’accomplissement de l’unique et double commandement »Aime Dieu », »Aime ton prochain », passe par le malheur. » 25 Ce n’est qu’à son aune que le chrétien peut prendre toute le mesure de la transcendance, dans l’unité du Père et du Fils, hors de l’espace et du temps. Le malheur ne peut être éclairé que par la Croix, car « Tout homme qui aime la vérité au point de ne pas courir dans les profondeurs du mensonge pour fuir la face du malheur à part à la Croix du Christ, quelle que soit sa croyance. » 26 Or, nous dit Simone Weil, les chrétiens eux-mêmes n’ont pas toujours conscience de la présence secrète de la Croix en chaque malheur humain. Le problème, c’est le dogme, qui détourne les yeux du croyant, qui « a enlevé le Christ à ses frères criminels. » 27 On comprendra dès lors aisément la raison qui fit que Simone Weil se maintint toute sa courte existence en dehors de l’Église. Elle ne pouvait en effet que se sentir prisonnière d’une organisation ecclésiale ne lui permettant pas d’étendre sa réflexion à tous les domaines de la vie profane.
Or, pensait-elle, jamais plus qu’à son époque le Christ fut absent des sociétés humaines. Jamais le malheureux ne s’est senti plus isolé dans sa quête d’explication au pourquoi de sa condition : « Excepté ceux dont le Christ occupe toute l’âme, tout le monde méprise plus ou moins les malheureux. » 28 Le mépris, la répulsion et la haine de nous-mêmes et des autres est la fruit de cette « coloration » qui envahit, empoisonne « l’univers tout entier »29. C’est qu’il est une chose que l’on ne sait pas accepter : il n’y a aucune finalité dans le monde, uniquement la nécessité, et le bonheur n’est pas, ne peut pas être de ce monde. Il convient alors de se rendre capables d’entendre le silence assourdissant de Dieu, car il est « la Parole de Dieu » 30. Comprendre la nécessité comme « la vibration du silence de Dieu », c’est s’ouvrir tel « un fruit qui se sépare en deux » 31, à la pénétration en l’âme du silence divin. Job lui-même, dans le livre de la Bible qu’elle qualifie de « pure merveille » 32, « une fois le voile de chair déchiré par le malheur, voit-il à nu la beauté du monde. » 33
En guise de conclusion, notons que ce petit recueil n’est certainement pas celui que nous conseillerions à qui souhaiterait comprendre l’œuvre à la fois foisonnante et complexe de Simone Weil. Il existe dans une autre collection de poche un autre petit ouvrage, recensé ici, qui sera un bien meilleur outil de d’approche et de compréhension d’une pensée qui, comme beaucoup d’autres, n’a de la simplicité que l’apparence.
- Simone Weil, Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu et autres textes, Gallimard, coll. folio-sagesses, 2013
- Nous reprenons ici la formule de Maurice Blanchot, qui consacra à l’œuvre de Simone Weil des pages absolument admirables dans sa somme L’Entretien infini (1969). Les conditions du rapprochement entre ces deux auteurs ne peuvent être expliquées ici, notons seulement que Blanchot se montra attentif et admiratif de ce que Simone Weil s’assigna pour tâche de formuler l’informulable, de tenter de dire tout ce qui échappe au discours.
- voir l’article de Michel Narcy, « Limites et signification du platonisme de Simone Weil, in Chantal Delsol (dir.), Simone Weil., Cerf, coll. Les cahiers d’histoire de la philosophie, 2009, ouvrage [ici recensé
- cf. Platon, La République, 509b, Gallimard, Paris, Coll. NRF, « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, p.1098
- S. Weil, Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu, p.27
- Ibid, p.13
- Ibid., p.26
- cf Miklos Vetö, La Métaphysique religieuse de Simone Weil, L’Harmattan, 1999, p.70
- ibid. p.29
- ibid. p.89
- L’œuf, c’est ce monde visible. Le poussin, c’est l’Amour, l’Amour qui est Dieu même et qui habite au fond de tout homme, d’abord comme germe invisible. Quand la coquille est percée, quand l’être est sorti, il a encore pour objet ce même monde. Mais il n’est plus dedans. L’espace s’est ouvert et déchiré (…) Tout l’espace est empli, même s’il y a des bruits qui se font entendre, par un silence dense, qui n’est pas une absence de son, qui est un objet positif de sensation, plus positif qu’un son, qui est la parole secrète, la parole d’Amour qui depuis l’origine nous a dans ses bras.,Ibid. p. 40-41
- Ibid., p. 45
- Ibid., p.55-56
- Ibid, p.56
- Ibid.
- in Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, éd. Seuil, Coll. L’école des lettres, p.30
- « L’éther, introduction », in La nuit remue (1935), Gallimard, NRF, Poésie, p .65
- Henri Michaux, « Peintures » (1939) in L’espace du dedans(1966), Gallimard, Poésie , p.249
- PSO, p.63
- Ibid., p64
- Ibid. , p.81
- Ibid., p.83
- Ibid., p.93
- Ibid., p.95
- Ibid., p.96
- Ibid., p.99
- Ibid, p.101
- Ibid, p.61
- Ibid, p.62
- Ibid., p.105
- Ibid, p.106
- Ibid., p.59
- Ibid., p.86








