Cet essai, rédigé par Sébastien Roman, est une reprise de sa thèse, intitulée « Conflit civil et imaginaire social : une approche néo-machiavélienne de la démocratie par l’espace public dissensuel », réalisée sous la direction de Michel Senellart et soutenue avec succès en 2011. Roman y prend pour point de départ explicite l’idée de Claude Lefort selon laquelle Machiavel, en théorisant la nécessité politique d’institutionnaliser l’opposition entre les grands et le peuple, donne des outils pour penser le rôle fondamental du dissensus dans l’espace public démocratique aujourd’hui1. Dans sa tentative d’élaboration d’un nouveau modèle d’espace public, qui fasse « du conflit civil le principe de la vie politique »2, l’auteur s’appuie ainsi, comme Lefort, sur le quatrième chapitre du livre I du Discours sur la première décade de Tite-Live, où Machiavel affirme qu’il
existe dans chaque gouvernement deux sources d’opposition, les intérêts du peuple et ceux des grands ; que toutes les lois que l’on fait au profit de la liberté naissent de leur désunion3.
Le but de l’ouvrage est alors d’insister sur la dimension conflictuelle de la pensée machiavélienne, sans pour autant l’aborder dans une perspective néo-marxiste. Au cours d’une réflexion stimulante, articulée autour du concept d’imaginaire social, Roman conduit son lecteur vers une réinterprétation de l’espace public informel et extra-institutionnel comme espace de l’utopie. En débarrassant le concept d’idéologie de ses connotations intrinsèquement négatives, il parvient à saisir la dimension transcendantale de l’imaginaire, qu’il définit alors comme la condition de possibilité de la politique. Cette prise en vue éclairante, qui est selon nous le principal mérite du livre, exige cependant de surmonter l’obstacle que constitue l’excès de références – excès qui ne manque pas d’obscurcir un propos par ailleurs assez subtil. Ainsi, l’honnêteté intellectuelle dont l’auteur fait preuve en renvoyant systématiquement à un voire plusieurs ouvrages des auteurs dont il s’inspire, et qu’on ne peut que saluer, fait malheureusement perdre, à certains endroits, le fil du propos, tant certaines digressions en viennent à porter davantage sur la justesse historique des thèses hétérogènes qu’il emploie pour penser, que sur les conséquences qu’on peut en tirer pour le raisonnement. Vue la qualité des analyses, ce défaut est regrettable.
1 – Analyse conceptuelle ou doxographie ? Nous, Machiavel et les autres
Sébastien Roman part de la distinction élaborée par Claude Lefort entre la démocratie, « seul régime politique qui accepterait et se nourrirait de divisions sociales »4, et le totalitarisme. Selon lui, seule la démocratie serait capable de faire féconder l’union entre un imaginaire social commun, sans lequel des individus différents ne peuvent faire société, et le conflit civil, impossible à résorber, entre faibles et puissants. C’est cette articulation que Machiavel, se frayant habilement la voie entre le consensualisme excessif de Habermas et des républicains, et la trop grande valorisation du conflit et du différend des approches néomarxistes et postmodernes, offrirait à penser. Dès lors, la nature du projet oscille entre deux types de questionnement. D’un côté, la dimension historiographique pose la question de la vérité historique : est-il pertinent d’appliquer le couple conflit civil/ imaginaire social à la pensée machiavélienne, et, si oui, en quel sens faut-il entendre les deux expressions ? D’un autre côté, une visée plus générale, tendant à élucider des éléments fondamentaux de la nature de la démocratie, interroge l’intérêt philosophique : est-il fécond pour la pensée d’utiliser un tel couple de concepts pour penser le dissensus en démocratie, et quelles en sont les conséquences ?
Seulement, au cours de ses analyses, l’auteur laisse bien souvent le lecteur dans le doute quant au rapport qu’il entretient avec la multitude des thèses qu’il invoque : les envisage-t-il comme des matériaux pour penser un problème réel, ou comme les éléments d’une recherche historiographique ? Malgré la volonté affichée d’isoler les deux champs en leur consacrant des parties différentes, son parti-pris est loin d’être clairement défini. En témoigne le début de la deuxième partie du livre, qui part d’un examen de la pertinence de l’interprétation de Habermas par Ricoeur : le problème n’est plus de forger une théorie de l’espace public dissensuel, mais de mettre au jour le rôle historique joué par la théorie habermasienne dans la formation du concept d’imaginaire social chez Ricoeur. Le chapitre consiste alors à se demander s’il y a réellement chez Habermas quelque chose comme un imaginaire social – autrement dit, s’il était justifié que Ricoeur utilise Habermas, ce qui, à vrai dire, aurait pu être l’objet d’un autre ouvrage. Même au moment où le propos de Roman quitte les questions historiographiques pour mener un raisonnement plus personnel, il tend à se fourvoyer dans des digressions qui font perdre le sens global de l’argumentation et à masquer la pertinence de ses analyses pour la thèse générale.
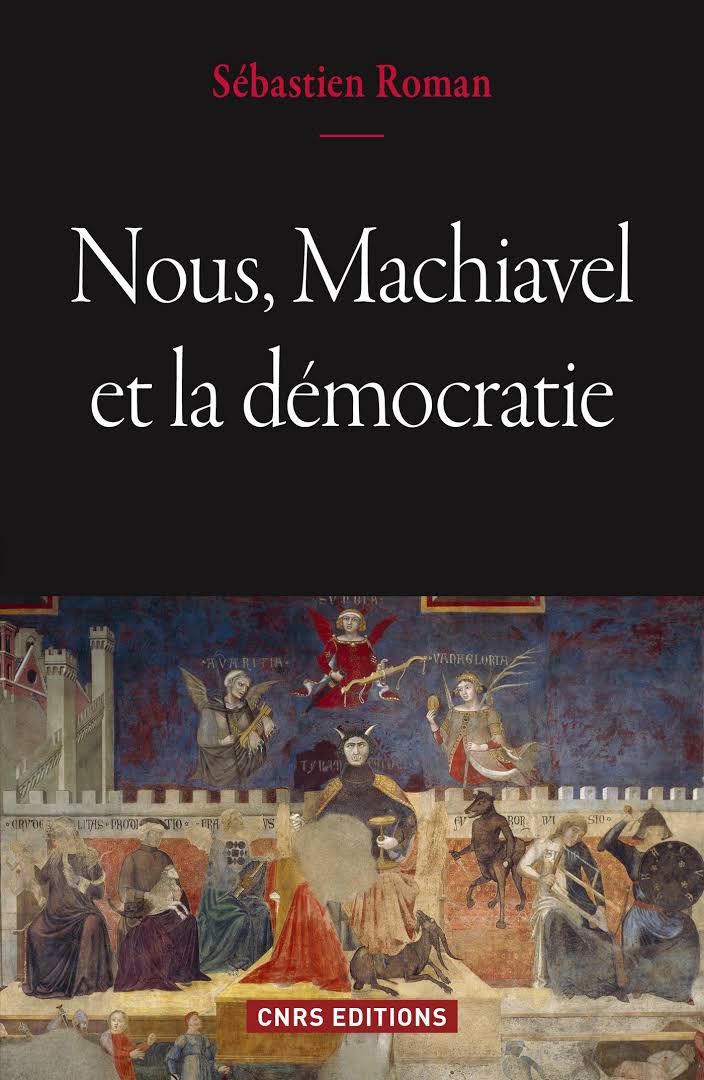
Une telle confusion est renforcée par la rareté des références directes aux textes de Machiavel – références qu’on peut compter sur les doigts d’une seule main. On peut chercher la cause de cette parcimonie dans le fait que le problème traité a déjà fait l’objet de nombreux ouvrages philosophiques, et que, pour qui a lu Le travail de l’oeuvre Machiavel, riche d’une explication linéaire du Discours, toute citation ne peut être que redondante. D’ailleurs, la quasi totalité des notes d’introduction renvoient aux différents livres de Claude Lefort. Faisant jouer Serge Audier et Gérald Sfez contre Antonio Gramsci et Miguel Abensour, Claude Lefort contre l’école de Cambridge, Roman s’avère ainsi bien moins préoccupé par la fidélité à l’œuvre que par la nécessité de se situer dans le champ critique – il semble en cela saisi par le vertige que Raymond Aron disait propre à tout commentateur de Machiavel mis face à la tâche de l’explication5. Ce vertige, connu de tout chercheur, est compréhensible, mais il ne facilite pas l’entrée dans la logique du texte, et brouille les enjeux proprement philosophiques du propos.
2 – Conflit inévitable, union nécessaire : à la recherche des conditions transcendantales du pouvoir
En prenant pour point de départ le quatrième chapitre du livre I du Discours, Roman s’inscrit, nous l’avons dit, dans la lignée des commentateurs qui considèrent, avec Claude Lefort, que
c’est l’antagonisme des désirs de classe, des Grands et du Peuple, la relation nécessaire qu’ils entretiennent en tant que désir de commander, d’opprimer – de ne pas être commandé, opprimé – qui sont au centre de la réflexion6.
Pourtant, malgré son penchant pour les références nombreuses, Roman s’efforce, au cours du livre, de dépasser l’historiographie et d’aller vers une analyse plus universelle. Il se distingue en cela de Serge Audier, qui s’intéressait surtout à la mise en lumière du « moment machiavélien »7, qu’il définissait comme la réapparition du Discours sur la première décade de Tite-Live sur la scène intellectuelle française, appelé à la rescousse de philosophes tels que Raymond Aron, Merleau-Ponty, ou Claude Lefort, comme remède aux impasses du marxisme. Notre auteur, lui, tente de justifier, pour son compte, la nécessité d’envisager la question en tenant ensemble, et c’est là tout le problème, le conflit et l’union : car c’est dans cette ambivalence que réside l’accomplissement de la liberté. C’est en passant en revue les penseurs du différend sans issue, d’une part, et les philosophes épris de consensus, d’autre part, qu’il retient les éléments d’une subtile dialectique entre l’un et le multiple, entre la concurrence des désirs contradictoires et la condition de leur compossibilité.
Pour cela, Roman procède de façon systématique : il commence par résumer un pan de la théorie d’un auteur, en critique ensuite certains aspects et en retient d’autres, puis complète et précise son propos à partir des acquis de l’analyse. Des théories du conflit – du différend chez Lyotard à la mésentente chez Rancière –, il retient à la fois l’existence de fait d’un antagonisme social fondamental, sa contingence, et son caractère indépassable. Mais contre le premier, dont la trop large conception du conflit empêche de penser la spécificité du politique8, et contre le second, qui distingue la police comme la « distribution des places et des fonctions » au sein de l’organisation étatique, de la politique comme rupture de cet ordre9, l’auteur insiste sur la nécessité, en démocratie, d’institutionnaliser les contradictions sociales, afin d’éviter un retour à la violence pure. D’un autre côté, prenant ses distances vis-à-vis des approches consensualistes – de l’humanisme civique, qui voit dans la tradition le ciment de la cité, aux théories de la démocratie délibérative –, il en conclut que, en plus d’être impossible à éradiquer, le conflit est nécessaire à la liberté, car toute pensée excluant la contradiction en politique est condamnée à sombrer dans le totalitarisme. Pour comprendre ce paradoxe apparent, Roman s’efforce d’abord de résoudre l’antinomie, constitutive de la philosophie politique, entre divergences des intérêts et participation de tous à la société civile.
Dans cette perspective, l’auteur recourt au concept d’imaginaire social. Reprenant comme une « hypothèse stimulante » l’analyse de Loraux, qui constate au sein de la politique grecque dans l’Antiquité le « déni constant d’une réalité sociale conflictuelle » 10, l’auteur affirme qu’une société est constamment en train de se mentir sur elle-même (par exemple, en affirmant que la France est le pays des droits de l’homme) ; ces mensonges sont indispensables à la vie en commun. Cela conduit Roman à soutenir la thèse, déjà défendue par Claude Lefort, selon laquelle l’imagination aurait un statut transcendantal : si le Prince est forcé pour se maintenir au pouvoir d’exercer un art du paraître, ce n’est pas par machiavélisme (au sens courant de manipulation secrète et cynique pour parvenir à des fins), mais bien en raison de la nature du pouvoir. En effet,
l’imaginaire social n’est pas un instrument que le pouvoir pourrait décider ou non d’utiliser – comme s’il y avait entre eux un rapport d’extériorité – mais sa condition transcendantale11.
C’est à partir de cette affirmation que l’on peut comprendre comment une société, malgré des contradictions internes très fortes, est capable de conserver son unité : l’existence même du pouvoir dépend de sa capacité à générer et pérenniser l’image virtuelle de l’unité de la cité. La définition de la politique inclut la capacité à renforcer l’entente dans le conflit, en entretenant par exemple les figures du commun et de l’homogène grâce à un certain usage du passé ou des grands principes de justice. On retrouve ici l’idée de Paul Ricoeur selon laquelle l’imagination sociale opère « à la fois de manière constructrice et de manière destructrice »12, au sens où elle permet aussi bien de contester la situation présente que d’assurer sa stabilité.
La théorie de Machiavel exige donc de nous deux gestes théoriques. D’une part, accepter que l’imaginaire soit constamment renouvelé et nourri par le conflit, faute de quoi la société s’expose au totalitarisme. D’autre part, penser un conflit civil sans cesse fécondé par un imaginaire un, afin que l’existence du désordre ne signe pas la disparition de toute politique dans des dissensions insolubles, minant les libertés individuelles. C’est l’imaginaire politique un, en rendant effectives les parties qui s’affrontent, qui génère le conflit civil ; autrement, loin de s’opposer, ces classes risquent de s’effondrer sur elles-mêmes dans un pur chaos. La dialectique entre conflit civil et imaginaire social s’élabore donc sur le terrain de la liberté, comprise comme non domination : c’est pourquoi elle tient une place si importante dans l’entreprise de Roman de repenser la démocratie.
3 – Machiavel au prisme de l’espace public dissensuel : le véritable apport du livre
Sur quelle conception politique cette volonté de tenir ensemble l’un et le multiple, sans privilégier aucun de ces extrêmes, aboutit-elle ? Alors que Serge Audier, dans la conclusion de son livre Machiavel – Conflit et Liberté, tire du moment machiavélien français, et donc d’une interprétation particulière de Machiavel, une certaine conception de la démocratie libérale, à mi-chemin entre la démocratie multiculturelle, valorisant trop les différences, et la « démocratie » néo-libérale, « entretenant le mythe d’une société délivrée des conflits »13, Roman tourne son regard, et ce dès le corps de son argumentaire, vers la démocratie délibérative. Penser, à partir d’outils habermasiens et de Machiavel, un espace public dissensuel : c’est là sans doute que réside la véritable originalité de l’auteur.
Ce parti-pris peut apparaître à première vue comme un recul par rapport aux acquis de sa réflexion, dans la mesure où il pose de nouveau la question des risques du dissensus insoluble. Sans l’horizon de l’entente décrit par Habermas, en effet, une démocratie exclusivement fondée sur la délibération entre des citoyens aux valeurs et aux jugements divergents, semble condamnée à s’effondrer sur elle-même, faute d’unité pour la retenir. Mais l’œuvre habermasienne ne se contente pas de reposer une question ancienne, affirme Roman : elle donne les moyens de surmonter ce problème à nouveaux frais. Cette hypothèse est l’occasion d’une analyse assez subtile : après avoir disqualifié le modèle du consensus dans la prise de décision, au motif qu’il nuirait à la liberté, l’auteur conserve du philosophe allemand deux idées nodales. La première, à laquelle est consacrée le chapitre 8, répond à l’exigence d’institutionnalisation du conflit civil : il s’agit de penser des institutions parlementaires respectant des règles de proportionnalité, ainsi que la possibilité de réviser la Constitution par des voies juridiques. Roman reprend ici des analyses assez classiques trouvant dans la loi le principe de la liberté.
La seconde idée, la plus intéressante, répond à la nécessité de pouvoir contester l’ordre établi : c’est l’idée, défendue dans le chapitre 10, selon laquelle, pour protéger la société civile des risques de dissension qui la menacent, il est nécessaire que la population soit « habituée à exercer la liberté politique »14. Les pratiques démocratiques informelles sont ainsi censées favoriser l’expression des dissensus entre citoyens, grâce à la genèse d’une culture politique commune forgée, et ici Roman reprend l’analyse d’Osiel, sur le modèle de procès donnant « la parole aux accusés pour éviter de les cantonner au rôle classique de figurants », et dont l’issue est incertaine15. Dans une véritable démocratie, ce qui fédère les différences n’est pas de l’ordre de la culture ou des mœurs, comme dans la tradition républicaine, mais de l’ordre de capacités argumentatives et critiques. L’imaginaire social n’y est pas fait d’images, mais de concepts :
le premier rapport au monde est symbolique, mais le symbolisme en question désigne le symbolisme inhérent au langage, qui s’inscrit d’emblée dans la raison communicationnelle16,
c’est pourquoi la rationalité politique relève tout entière d’un imaginaire. C’est cette seconde assertion qui permet à Roman de penser à nouveaux frais l’espace public, car, en interprétant l’ethos démocratique en termes d’imaginaire social, tout en débarrassant ce dernier à la fois de son contenu culturel et traditionnel, et de sa visée consensuelle, seul importe, pour faire tenir ensemble les différences sociales, l’existence d’un noyau intersubjectif. Pour que la liberté politique émane du conflit, il suffit que le symbolique qui unit les individus ne soit plus lié à une idéologie précise, mais à la nécessité d’une critique de toute les idéologies dogmatiques.
Seule la subsistance du conflit, à la fois dans la sphère institutionnelle et dans la sphère des interactions informelles, est donc à même de préserver les individus des différentes formes de domination, qu’elle soit étatique ou privée. Mais, à l’endroit de l’explicitation des modalités par lesquelles, du conflit civil, émerge l’émancipation, force est de constater que le raisonnement de Roman perd un peu de sa puissance. En effet, dans le Discours sur la première décade de Tite-Live, la liberté politique est décrite comme non domination – et Roman met bien l’accent sur le caractère relatif de la liberté du peuple, qui ne doit pas être comprise comme un bien en soi, mais comme une valeur dépendant de la contingence des faits et d’une relation à. Or, dans cette perspective, cette interprétation aurait dû l’amener à mieux mettre au jour le rôle du rapport de force dans l’institution de la liberté, le peuple voulant obtenir une loi émancipatrice étant poussé à « se livrer à des extrémités » ou à « refuser d’inscrire son nom pour la guerre », pour forcer les grands à le satisfaire sur quelque point17. La façon dont le peuple est censé empêcher « les grands de profiter des lois positives pour dominer davantage »18 et, par-là, favoriser la liberté, ne sont pas suffisamment traitées : on retrouve ici l’ambiguïté entretenue par l’auteur entre justesse historique de l’interprétation (la liberté dépend d’un rapport de forces) et visée générale (reprise des analyses habermasiennes).
Malgré tout, les développements de Roman sont loin d’être dénués d’intérêt. En particulier, les passages consacrés aux liens existant entre démocratie et utopie sont très percutants. En insistant sur la capacité de l’espace public dissensuel « à produire de l’hétérotopie, comme expression de la créativité de l’imagination collective »19, l’auteur fait de l’utopie le principal outil de la contestation. Ainsi, bien que le pouvoir soit toujours en mesure de les confisquer, les créer, ou les faire mourir, en fonction de ses intérêts – comme l’a fait le capitalisme, par exemple, en nourrissant l’utopie de la société du travail pour se donner une certaine légitimité –, les utopies ont pour fonction de s’opposer à l’idéologie dominante, et sont donc en mesure d’offrir des alternatives au pouvoir en place. Par ailleurs, parce qu’elle relève de la fonction productrice de l’imagination, et qu’elle « insiste sur les possibles non actualisés pour mieux critiquer l’ordre social établi »20, l’utopie « doit éduquer au désir »21. Cette affirmation est d’autant plus intéressante qu’elle entre en résonance avec la théorie de Machiavel, chez qui Grands et Peuple se distinguent par des désirs contradictoires, les premiers voulant dominer, et les seconds, être libres.
En insistant sur le concept d’utopie, Roman révèle en outre la véritable origine de son livre, à savoir la critique du consensualisme actuel de la démocratie, dont il nous dit qu’elle est « victime de son évidence »22. Ce qui est le plus difficile pour nous, nous dit l’auteur, ce n’est pas tant de donner à la pluralité une unité (comme chez Machiavel), mais de maintenir un véritable pluralisme, dans un monde où capitalisme et démocratie représentative ne sont plus remis en cause. Cette idée, que beaucoup d’intellectuels de gauche s’emploient ces temps-ci à démontrer, Roman en fait son point de départ, et c’est sans doute ce qui rend sa démarche si intéressante : en prenant la technocratie pour prémisse, il franchit la porte ouverte au lieu de l’enfoncer, et tente d’aller jusqu’au bout de ses conséquences. C’est cela qui fait de Nous, Machiavel et la Démocratie, en dépit de certaines faiblesses d’analyse et du recouvrement régulier de la réflexion par les doctrines, un livre riche et stimulant, d’où surgissent d’authentiques fulgurances.
- Claude Lefort, Le travail de l’oeuvre Machiavel, Paris, Gallimard, 1972, 778 pages
- Sébastien Roman, Nous, Machiavel et la Démocratie, Paris, CNRS Editions, 2017, p132
- Nicolas Machiavel, Discours sur la Première Décade de Tite-Live, I, 4, Paris, Flammarion, 1985
- S. Roman, op. cit., p. 8
- Dans son ouvrage Machiavel et les Tyrannies Modernes, Raymond Aron décrivait ainsi cette angoisse : « l’interprétation qu’il proposera, quelle qu’elle soit, ne lui appartient pas en propre. […] Quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse, il appartient à une des familles de machiavéliens, de machiavéliques ou de lecteurs de Machiavel – et il vient trop tard pour fonder une nouvelle famille », in Machiavel et les Tyrannies Modernes, Paris, Editions de Fallois, 1993, pp. 244-245
- Claude Lefort, Préface au Discours sur la Première Décade de Tite-Live, Paris, Flammarion, 1985, p.10
- Serge Audier, Machiavel, conflit et liberté, Paris, Vrin/EHESS, 2005, 311 pages
- Jean-François Lyotard, Le Différend, Paris, Minuit, 1983, 280 pages
- Jacques Rancière, La Mésentente, Paris, Galilée, 1995, p. 52
- S. Roman, op. cit., p. 27
- Ibid, p. 96
- Paul Ricoeur, L’idéologie et l’utopie (1986), Paris, Seuil, 1997, p. 19
- S. Audier, op. cit., pp. 289-290
- S. Roman, op. cit., p. 190
- Ibid, p. 358
- Ibid, p. 193
- N. Machiavel, op. cit., I, 4
- S. Roman, op. cit., p. 68
- Ibid, p. 314
- Ibid, p. 113
- Ibid, p. 322
- Ibid, p. 361








