A l’instar de nombre de philosophes et intellectuels de l’Europe centrale, Ryszard Legutko ne jouit guère d’une confortable notoriété au sein de l’Europe occidentale, ses écrits n’ayant jamais été traduits en français jusqu’à ce que l’Artilleur publie en 2021 une traduction de son Demon in Democracy : Totalitarian Temptations in free Societies[1] dont l’édition anglaise avait vu le jour en 2016. Ancien ministre de l’éduction en Pologne, député européen, l’auteur y livre une sorte de constat désabusé au sein d’un livre difficile à classer, à mi-chemin entre l’essai et l’analyse philosophique, visant à établir les similitudes entre le système soviétique ou socialiste et ce qu’il est convenu d’appeler les démocraties libérales, celles-ci devenant de plus en plus indistinctes de celui-là au moins sur le plan idéologique. C’est donc à une désillusion que convie l’auteur, en ceci que, après avoir connu de l’intérieur les ravages du socialisme en Pologne, il se trouve confronté depuis les années 1990 à la réalité de ce qui apparaissait jadis comme « le monde libre » dont les méthodes et les principes idéologiques rejoignent en grande partie ceux qu’il avait subis à travers le communisme polonais.
Avant d’analyser le contenu précis de l’ouvrage, peut-être convient-il de formuler quelques précisions.
La première tient à ceci que la méconnaissance profonde de la pensée de l’Europe centrale ou orientale de la part de l’Europe occidentale n’est pas exempte de mépris voire de rejet à l’endroit de ces penseurs qui, ayant connu de l’intérieur le socialisme et l’ayant combattu, ne semblent pas les bienvenus dans l’intelligentsia occidentale[2]. Ainsi, lire les auteurs de l’Europe centrale suppose de dépasser un certain nombre de réticences, voire de préjugés, et d’être prêt à rencontrer la défense de principes autres que ceux que développe le monde occidental depuis une cinquantaine d’années.
La seconde précision que l’on peut apporter concerne la nature du constat dressé par l’auteur : la parenté entre le socialisme et les démocraties libérales est pour ainsi dire sinon un lieu commun de la pensée de l’Europe centrale, à tout le moins une thèse fortement répandue, alors que c’est un scandale pour l’Europe occidentale qui peine à comprendre l’enjeu d’un tel constat pourtant au cœur de nombre d’ouvrages écrits par ceux qui ont connu socialisme réel et démocratie libérale, et qui ont été en mesure de les comparer. Pensons par exemple à l’analyse de Stanko Cerovic qui, comparant les modes d’action socialistes et « libéraux » dans l’usage de la propagande lors de la guerre en Yougoslavie, avait été frappé par leur grande similarité :
« Dans les années trente, Ossip Mendelstam avait dit, à propos de la rhétorique humanitaire dont été chargé – au moins c’était honnête ! – le chef de la police : « je ne savais pas que nous vivions dans les griffes des humanistes ». La répression stalinienne battait alors son plein et Mandelstam lui-même allait bientôt disparaître dans les camps. (…).
Je reconnaissais les gestes et les mots jusqu’à l’intonation de la voix. (…). L’Union soviétique a disparu, mais l’Occident reprend mot pour mot la même propagande, en faisant valoir les mêmes arguments pour justifier la domination de l’OTAN[3]. »
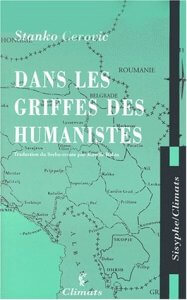
Bien sûr, il ne s’agit pas de dire que les démocraties libérales envoient les opposants au goulag ni n’organisent sciemment une misère de masse ; mais il s’agit de sonder sur le plan idéologique les similitudes et parentés, et de prolonger la comparaison par la description des types de propagande (conçue au sens propre comme propagation de l’idéologie) mis en œuvre dans les deux systèmes.
A : Le constat : des démocraties libérales sans liberté
1°) Thèse générale de l’ouvrage
Ainsi que nous le précisions dans les lignes précédentes, l’ouvrage n’est ni véritablement un essai ni un traité, ni un livre pleinement philosophique : il examine en effet une situation présente, quoiqu’initiée dès les années 60, propose quelques pistes explicatives, mais ne théorise ni le problème rencontré ni les solutions suggérées et ne propose pas par ailleurs de conceptualité nouvelle pour rendre compte du constat. De ce fait, la valeur de l’ouvrage réside essentiellement dans la clarté du constat d’une parenté entre les démocraties « libérales » et le socialisme réel et se poursuit dans la suggestion d’une privation de libertés au sein des démocraties libérales dont la structure idéologique s’apparenterait à celle des régimes socialistes :
« Ce livre entend exposer les points communs entre le communisme et la démocratie libérale. L’idée que de telles similarités puissent exister a germé d’abord timidement dans mon esprit dès les années soixante-dix du siècle dernier, lorsque pour la première fois j’ai eu l’occasion de sortir de la Pologne communiste afin de voyager dans ce que l’on appelait alors l’Occident. A mon grand déplaisir, j’ai découvert que bon nombre de mes amis qui se considéraient comme des partisans fervents de la démocratie libérale – ou d’un système multipartite, des Droits de l’Homme, du pluralisme et de toutes les choses qu’un démocrate libéral affichait fièrement dans ses actes de foi – faisaient preuve d’un esprit de conciliation et d’empathie étonnant à l’endroit du communisme. Cette surprise fut pour moi déplaisante parce qu’il me semblait que la réponse viscérale et naturelle de chaque démocrate libéral au communisme aurait dû être une vigoureuse condamnation[4]. »
Au fond, toute l’énigme que rencontre l’auteur et qui l’étreint presqu’affectivement tient à la dernière phrase : qu’est-ce qui a empêché et empêche encore les démocrates libéraux d’être farouchement anti-communistes au point que, à la chute de l’URSS, les apparatchiks soviétiques aient pu être aisément recyclés au sommet de la nouvelle hiérarchie politique ? De cette question en découle une seconde au sein de l’ouvrage : qu’est-ce qui explique l’absence de goût des démocraties libérales pour la liberté politique ? Quelle est cette parenté plus ou moins explicite qui crée une forme de loyauté des démocraties libérales à l’endroit même du communisme, et qui n’est paradoxalement perceptible que pour des peuples qui ont vécu des régimes communistes ? A cette question séminale, l’auteur dresse de manière empirique une liste de rencontres idéologiques entre démocratie libérale et communisme, depuis l’idée de modernisation forcée jusqu’au rejet envers les formes du passé jugées ignobles, en passant par l’idée d’émancipation systématique :
« Les deux régimes prennent ostensiblement leurs distances avec le passé. Ils acceptent l’idée du progrès dont les conséquences découlent naturellement du pouvoir de la technê[5]. »
Et l’auteur d’ajouter :
« En devenant membre d’une société communiste ou démocratique libérale, l’homme rejette une foule de loyautés et d’engagements qui l’asservissaient encore récemment. Cela vaut particulièrement pour ceux qui lui étaient imposés par la religion, la moralité sociale et la tradition. (…). Mais il ne peut être exempté d’une obligation : pour un communiste, le communisme, et pour un démocrate libéral, la démocratie libérale[6]. »
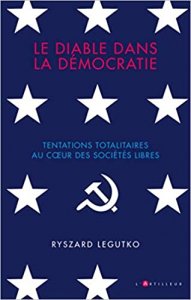
On comprend ainsi que le constat de la parenté est d’abord constat de rejets communs : traditions, enracinement historique, détermination religieuse, rôle de la paysannerie, etc. Ce rejet, voilà l’élément premier qui autorise l’auteur à effectuer de nombreux rapprochements entre les deux systèmes qui s’apparentent d’abord à partir de ce qu’ils jugent obsolète, périmé, inactuel, bref illégitime parce que ancestral. Remarquons ensuite que cette négation du passé, donc de la conservation, véhicule en creux le fait que la position conservatrice est une position intenable au sein des systèmes démocratiques libéraux accomplis et que le « sinistrisme[7] » tel que théorisé par Thibaudet constitue le moteur intrinsèque de ces derniers.
2°) Limites de cette position
Nous devons néanmoins marquer notre étonnement : au moins depuis Tocqueville, la démocratie en tant que processus a été analysée non comme une série d’institutions mais bien comme un rouleau compresseur transformant en permanence les sociétés, donc annihilant chaque jour davantage les vestiges de la tradition et de l’ordre ancien, en les faisant tendre vers une égalisation des conditions dont l’extension paraît sans fin. Dans un passage retiré de l’édition définitive de La Démocratie en Amérique, Tocqueville compare le processus démocratique aux eaux du Déluge qui, envahissant tout, détruisent tout rivage – c’est-à-dire tout ordre ancien sauf du mouvement démocratique :
« Marche fatale de la démocratie. La démocratie ! N’apercevez-vous pas que ce sont les eaux du Déluge ? Ne les voyez-vous pas s’avancer par un lent et irrésistible effort ? Déjà elles couvrent les campagnes et les villes, elles roulent sur les créneaux détruits des châteaux forts, et viennent baigner jusqu’aux marches des trônes. Vous reculez, le flot poursuit sa marche, vous fuyez, il court derrière vous. Vous voici enfin dans votre dernier asile et à peine êtres-vous assis pour reprendre haleine qu’il a déjà couvert l’espace qui vous séparait encore de lui. Sachons donc envisager l’avenir d’un œil ferme et ouvert. Au lieu de vouloir élever d’impuissantes digues cherchons plutôt à bâtir l’arche tutélaire qui doit porter le genre humain sur cet océan sans rivages. Quelles seront les conséquences probables de cette immense révolution sociale ? Quel ordre nouveau sortira des débris de celui qui le tombe ? Qui peut le dire ?[8] »
Ainsi, tant par la transformation sociale permanente qu’induit la démocratie prise en son sens tocquevillien que par l’uniformisation qu’elle véhicule au point de devenir cet « océan sans rivage », se développent dès les années 1835 des analyses qui comprennent le fondement révolutionnaire du mouvement démocratique ou, plus exactement, de la démocratie comme mouvement permanent par lequel se dissout le passé. Dès lors, le constat de R. Legutko qui reprend aussi bien la destruction systématique de l’ordre ancien que l’uniformisation[9] devrait ouvrir une discussion avec Tocqueville et se demander si la racine commune ne serait pas la démocratie au sens tocquevillien dont deux fruits somme toute assez proches ne seraient pas d’une part la démocratie libérale et d’autre part le communisme ou le socialisme réel. Certes, Tocqueville se trouve convoqué dans l’ouvrage mais moins pour ses analyses que pour le type de libéralisme qu’il appelait de ses vœux ; cela restreint malheureusement la portée conceptuelle du constat car, du point de vue tocquevillien, ce que constate l’auteur et qu’il attribue au devenir libéral de la démocratie n’est rien d’autre que l’inéluctable développement du processus démocratique qui n’est pas une déviation de la démocratie mais sa stricte réalisation.
Dans le même ordre d’idées, il nous apparaît étrange que ne soit pas mentionnée au sein de l’ouvrage l’analyse d’Albert Thibaudet résumée sous le concept de « sinistrisme », visant à décrire le glissement systématique depuis deux siècles de l’idéologie politique vers le progressisme, les positions conservatrices n’étant jamais que d’anciennes idées progressistes ayant glissé « à droite » à la faveur du devenir progressiste de l’ensemble des positions. Précisons à cet effet que, loin d’être soluble dans la seule position révolutionnaire, le progressisme a toujours fait l’objet de discussions quant aux moyens de s’accomplir, et qu’il serait sophistique d’induire de la décrue de l’idéal révolutionnaire celle du progressisme[10]. En effet, au regard de la voie réformiste qui, depuis au moins 1830, et plus encore dans les années 1880 et 1890, fut l’objet d’une théorisation aboutie – songeons à celle accomplie par les penseurs de la Fabian Society dont sortit le Labour –, on comprend aisément que le progressisme ne saurait se résumer à la posture léniniste pourtant implicitement présupposée dans de nombreuses analyses contemporaines.
Enfin, nous disons notre étonnement dans ce cadre comparatif face à la quasi-absence de la question fiscale et de la propriété privée. La question de l’existence même d’un impôt sur le revenu, de la progressivité de cet impôt mais aussi de la multiplication du domaine imposable dans les sociétés occidentales n’est presque pas traitée, tandis que les écrits programmatiques de plus en plus fréquents appelant à limiter voire à confisquer la propriété privée – songeons parmi cent autres aux écrits de Jeremy Rifkin, conseiller de nombreux dirigeants européens – dans les démocraties libérales ne sont pas mentionnés. C’est là un manque flagrant dans les comparaisons effectuées par l’auteur, lequel aurait sans doute gagné à analyser les écrits théoriques de la Fabian Society, écrits qui avaient conceptualisé dans le cadre socialiste, et dès la fin du XIXème siècle, une manière non violente de confisquer la propriété privée et de démembrer les héritages, notamment par l’arme fiscale.
B : L’Histoire et le Progrès
1°) Être à l’heure du Progrès : le lexique progressiste du changement
Le cœur analytique de l’ouvrage, au-delà du constat voulant que démocratie libérale et communisme « sont issus des mêmes racines[11] », porte sur l’historicisme ou, plus exactement, sur l’idée d’un mouvement historique porteur de progrès. C’est dans le premier chapitre consacré à l’histoire que l’ouvrage développe ses meilleures analyses et touche sans doute à la croyance la plus fondamentale des démocraties libérales et du communisme, à savoir à cette croyance commune voulant qu’il y ait un mouvement constant d’amélioration, qu’aujourd’hui devrait être meilleur qu’hier et, par voie de conséquence, que ceux qui entravent la marche de l’Histoire sont suspects – pour ne pas dire plus. Le fait d’être aujourd’hui rendrait impossibles, voire criminelles, les croyances d’hier, péremption n’ayant de sens qu’au prix d’une croyance dans l’Histoire comme marche du progrès. Aujourd’hui n’est donc pas l’indication neutre d’une contemporanéité, mais bel et bien une exigence autant qu’une croyance, celles de ne plus pouvoir accepter ce qui se passait hier. On pressent ainsi la nuance qu’il entretient à l’endroit de Tocqueville, ce dernier analysant le mouvement d’égalisation des conditions alors que Legutko décrit plus volontiers la manière dont l’égalisation est présentée comme le sens et le contenu mêmes du Progrès. Cela étant, il eût été intéressant de mieux articuler les rapports entre égalisation et Progrès dans la perspective progressiste.
C’est assurément sur ce point précis que l’ouvrage de Legutko concentre néanmoins ses pages les plus intéressantes. La croyance dans le progrès et donc dans un mouvement de l’Histoire vers une amélioration nécessaire impliquant une correction systématique des pensées et des croyances anciennes, se trouve fort bien décrite, aussi bien dans les systèmes socialistes que dans les démocraties libérales. A vrai dire, ces pages valent moins par la distance prise à l’endroit du dogme progressiste, bien plus profondément analysé par un auteur comme Christopher Lasch[12] sur le plan conceptuel, ou par l’analyse de l’historicisme que Leo Strauss avait déjà fort bien menée dans Droit naturel et histoire, que par la description des conséquences induites par le progressisme sur la vie quotidienne.
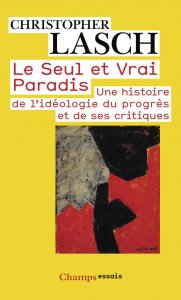
En somme, le mérite de Legutko consiste à poser une question simple : où le Progrès doit-il faire sentir ses effets ? Partout, répond ce dernier, et plus particulièrement dans la vie privée. Les rapports familiaux, la parenté, le rapport à son propre corps, l’amitié même, bref tout ce qui concerne l’intimité de l’individu et qui avait fait l’objet d’une conquête à travers l’idée de vie privée, se trouve soumis au Progrès, c’est-à-dire à une sorte de bascule dans de nouveaux impératifs sociaux d’affranchissement à l’endroit de l’ordre ancien et d’émancipation injonctive. Chaque jour qui passe présente son lot de rééducation de la vie privée, aussi bien sous forme éditoriale qu’audio-visuelle, la seconde promouvant la première, nul domaine de la sphère individuelle ne semblant plus pouvoir échapper à la nécessité d’une rectification idéologique fondée sur l’idée que ce qui a eu lieu jusqu’à présent relève d’une espèce d’aberration historique à proscrire rapidement ; ainsi, le très médiatique Thomas Messias peut-il publier une rééducation de la vie amicale sous le titre de A l’écart de la meute. Sortir de l’amitié masculine[13], relayée sur le service public et les bons offices de France Inter[14].
Cela crée tout un lexique idéologique portant sur le cadre intime et privé passé au crible de ce que tolère et ne tolère pas le Progressisme, lequel impose de nommer le monde selon une catégorisation qui procède d’une évaluation temporelle de la situation des pays au regard dudit Progrès : les changements progressistes ne seront pas des changements mais des « avancées » (dont on ne donne jamais le génitif) au sein de pays qui seront soit à l’heure, soit « en retard » – en retard par rapport au Progrès, cela s’entend. Ainsi se développe une sémantique mobilisant régulièrement l’adverbe « enfin » quand advient une mesure sociétale progressiste, ou des locutions comme « toujours pas » lorsque les mesures n’adviennent pas, le lexique présupposant l’évidence et la nécessité du Progrès et se désolant de son éventuelle lenteur.
2°) Trois limites essentielles de l’approche descriptive
Nous devons ici émettre à nouveau trois réserves.
La première tient à l’indétermination de la nature de l’ouvrage qui demeure en-deçà d’une analyse pleinement philosophique en ceci que la description de la comparaison l’emporte sur l’analyse de cette même description. A ce titre, nous avons bien davantage l’impression de lire un essai décrivant un état de fait qu’une authentique réflexion philosophique qui viserait à conceptualiser ce qui est en jeu. Décrire n’est pas comprendre, et s’il est vrai que le progressisme fait l’objet d’une comparaison stimulante au sein de l’ouvrage entre les démocraties libérales et le socialisme réel, il est également vrai qu’une analyse plus poussée eût été nécessaire, et ce d’autant plus que les approches descriptives sont ambivalentes : si, d’un côté, elles font voir un certain nombre de choses, elles sombrent aisément d’un autre côté dans une série de présupposés fort pénibles, voulant que ce que l’on fait voir serait évidemment à combattre. Montrer ce qui se passe dans les temps présents ou objectiver la non-évidence d’un lexique ne suffit pas, conceptuellement parlant, à rendre compte d’une telle situation, à moins de présupposer l’évidence de son illégitimité, ce en quoi le propos ne ferait jamais qu’admettre l’inverse du progressisme, à savoir l’illégitimité structurelle du présent.
La seconde réserve tient à ce que l’auteur appelle « idéologie ». De manière explicite se trouve affirmé le fait selon lequel la famille, la sexualité, l’intimité même, seraient devenus le cadre d’un embrigadement idéologique. Cette affirmation se trouve maintenue dans un entretien donné à Atlantico :
« Il y a très peu d’espace – voire aucun – qui puisse rester non-libéral et non-démocratique aujourd’hui. À la suite de la révolution sexuelle et des mouvements féministes et homosexuels, la dichotomie privé / public a été abolie. Tout est devenu politique et idéologique : la famille, le mariage, le sexe, même la question des toilettes. Les lieux de refuge disparaissent rapidement[15]. »
Or, une telle affirmation résisterait fort mal à une argumentation (marxiste ou historiciste) voulant que les questions familiales et sexuelles aient toujours été de nature idéologique ; la distinction entre le cadre public et le cadre privé est elle-même le produit d’une évolution historique qui n’est pas dénuée d’idéologie. Restituer la portée idéologique des mouvements sociétaux actuels est une chose ; prétendre qu’ils sont les seuls à idéologiser la famille ou la sexualité en est une autre.
En outre, se trouve sous-estimée la relation complexe entre le développement d’une idéologie et les moyens de sa propagande, et il faudrait à cet égard se demander si la parenté profonde entre démocratie libérale et communisme ne résiderait pas davantage dans l’intensité de la propagande que dans le fait de disposer d’une idéologie imposée. Mais se demander cela, c’est en réalité revenir au problème des moyens techniques de la diffusion de la propagande et, de ce fait, remonter à une racine non-politique de la diffusion – de la propagation – de l’idéologie. C’est du reste ce que vient de réaliser David Colon dans son remarquable ouvrage consacré à la propagande en démocratie[16].
3°) Droits humains et dignité
Enfin, nous nourrissons une certaine réserve face à la très grande ambivalence que déploie l’auteur à l’endroit des fictions modernes de l’état de nature et du contrat social. D’un côté se trouve fustigée la dimension anhistorique de l’état de nature qui théorise le politique en faisant d’emblée abstraction de l’inscription historique – et donc traditionnelle – des hommes, abstraction qui se retrouve dans le contrat fondé sur la seule question du consentement individuel, et qui favorise donc un oubli structurel des formes originellement collectives de la vie humaine. Cet aspect est fort bien résumé dans un entretien donné à l’occasion de la traduction française de l’ouvrage :
« J’explique dans le livre que le libéralisme, dès l’origine, veut instaurer une transformation sociale. Si vous lisez Hobbes ou Locke, figures de la philosophie libérale, ils commencent toujours par une situation hypothétique, prépolitique sur l’état de nature. Cela a des conséquences, car il résulte de cette perspective que toute institution a la charge de la faute. Le libéralisme a de ce point de vue privé les gens du respect de l’expérience et des institutions de longue durée. Prenez l’exemple de la famille. Elle a toujours été suspecte pour les libéraux. Ceux qui défendent la famille sont a priori dans une position plus faible, car c’est à eux de prouver qu’elle est importante. Le libéralisme de ce point de vue affaiblit les conservateurs, il invite au radicalisme et sans avoir d’arme théorique pour le contrer. Les libéraux finissent donc toujours par rendre les armes face aux radicaux[17]. »
D’un autre côté, le même auteur semble regretter que les mouvements progressistes aient fini par abandonner les fondements de la dignité humaine, c’est-à-dire aient rejeté l’idée d’une nature humaine porteuse d’un droit naturel qui constituerait les raisons profondes du respect et de la considération dus aux hommes, lesquels hommes auraient à systématiquement se hisser à la hauteur de l’exigence de leur nature. A cet égard, les Déclarations de droits humains non enracinées dans l’affirmation d’une nature humaine, à la hauteur de laquelle il s’agirait de se hisser, feraient perdre de vue le fait que la dignité se mérite et travestissent la dignité humaine en une affirmation gratuite et immédiate que rien ne saurait véritablement justifier, affadissant donc la notion même de dignité.
Une fois encore, il nous semble que plusieurs éléments mériteraient d’être bien plus clairement distingués. Que l’état de nature soit anhistorique et invite à penser une racine au fond non politique du politique, cela est une évidence ; qu’il faille en déduire que l’institution historique soit ipso facto porteuse de la faute est en revanche profondément discutable, au moins chez Hobbes, dans la mesure où l’institution protège les hommes contre certaines tendances de leur propre nature porteuse de désirs illimités et d’une certaine violence. Par ailleurs, la plupart des théoriciens de l’état de nature – en particulier Hobbes et même Locke – ne théorisent pas un individu seul mais théorisent au contraire une relation complexe entre Dieu et les individus, à telle enseigne que les fameuses « lois » de préservation de soi dont parle Hobbes dans le Léviathan se trouvent inintelligibles en-dehors des commandements divins qui sont le véritable fondement du pacte social. Il en va de même pour Locke dont toute la théorie de l’état de nature et du contrat présuppose une relation à Dieu par laquelle ce dernier donne la Terre aux hommes, les enjoint de la faire fructifier, et nécessite indirectement l’appropriation privative pour parvenir à de telles fins. Il n’est donc pas vrai que les théories contractualistes convoquées par l’auteur affranchissent l’individu de toute autorité, de toute verticalité et inscrivent l’homme dans un devenir athée où la faute serait portée par les seules institutions politiques.
Enfin, concernant la question de la dignité se joue quelque chose de déroutant, l’auteur regrettant que la dignité soit devenue une forme de dû immédiat et non plus quelque chose qui se construit et qui se mérite, la logique contemporaine des « droits » expliquant selon lui une telle mutation. Mais dans l’optique religieuse catholique que défend l’auteur, le fait est que la dignité n’est justement pas construite : elle est donnée par l’humanité même de l’homme et exprimée par sa personne, et s’oppose précisément à la vision gréco latine d’une dignité qui serait liée aux mérites et qui serait donc pleinement différenciée selon les actes de chacun. La vision d’une dignité procédant d’un droit-créance se révèle à cet égard bien plus fidèle au christianisme qu’à la définition qu’en donne l’auteur, bien que nous concéderons volontiers à ce dernier que le soubassement chrétien d’une telle approche se soit effacé au profit de ses seuls effets.
C : La « Lumpen-Intelligentsia » et la nature coopérative des démocraties libérales
Nonobstant les réserves antérieures, nous reconnaissons que sont développés ici et là certains concepts pertinents : celui de Lumpen-intelligentsia en fait assurément partie. Celui-ci désigne les chiens de garde du Progrès qui, inféodés à l’idéologie dominante du temps présent, répètent avec servilité et mimétisme les mots d’ordre de transformation du corps social. Volontiers sycophante, cette « classe » d’intellectuels sans envergure mais puissante par son mimétisme, investit les lieux institutionnels, notamment l’université et l’éducation, pour imposer le progressisme sur le plan idéologique tout en croyant faire œuvre de courageuse subversion :
« En démocratie libérale comme sous le communisme, un rôle significatif dans la traque est attribué aux intellectuels qui, étant les plus savants et les plus éclairés, sont les plus aptes à accomplir cette tâche, laquelle commence par l’identification d’une pensée criminelle pour continuer par une mise en garde contre la pente glissante qui conduit de cette pensée à la domination politique[18]. »
L’originalité de l’auteur ne consiste évidemment pas à avoir repéré la subversion factice des serviteurs de l’idéologie progressiste, que Philippe Muray appelait déjà les « mutins de panurge », mais à relier l’existence de ces intellectuels institutionnels à la nature même de la démocratie libérale comme système « coopératif » interprété comme un système coercitif. En effet, l’auteur remarque non sans pertinence que si les démocraties se vivent comme des systèmes de coopération entre tous les membres, alors le respect et le dialogue deviennent des impératifs quasi-coercitifs, et plus rien ne saurait être mineur en ceci que tout ce qui introduit un grain de sable dans le rouage de la coopération devient criminel. Autrement dit, la démocratie libérale est bien moins un cadre où l’on sélectionne librement ceux avec qui on coopère qu’un cadre où s’impose une coopération potentiellement universelle dont toute restriction paraît criminelle. La notion d’inclusivité chère aux démocraties contemporaines n’est rien d’autre que le nom de cette coopération forcée sur laquelle veille l’Etat et en faveur de laquelle sont instituées des lois répressives.
Les conséquences d’une coopération si étendue sont incalculables. Si tout est pensé à partir du respect et du dialogue, alors tout devient politique et rien ne peut plus être mineur ni trivial. Une dramatisation de l’anecdotique se met en marche et la traque du banal devient vertu.
« Une remarque légèrement blessante doit toujours y être considérée comme la manifestation d’un péché mortel. Ce léger remous en surface cache en réalité des tourbillons de haine, d’intolérance, de racisme et de volonté de domination[19]. »
L’Etat faisant respecter les règles de coopération n’est plus l’arbitre neutre des relations sociales mais devient au contraire la force coercitive qui impose une coopération étendue, revêtant pour cela une forme de plus en plus tyrannique.
C’est donc de cette extension sans fin de la coopération que l’auteur fait naître le rôle de la Lumpen-intelligentsia dont la mission implicite consiste à théoriser l’extension croissante de la coopération – la fameuse « inclusivité ». Pour le dire autrement, le rôle idéologique de l’intellectuel « lumpenisé » consiste à théoriser l’inclusivité universelle et à attaquer comme « domination » illégitime toute forme de relation humaine qui y échapperait, avec le corollaire de dénonciation qui lui est naturellement attaché :
« En démocratie libérale comme sous le communisme, un rôle significatif dans la traque est attribué aux intellectuels qui, étant les plus savants et les plus éclairés, sont les plus aptes à accomplir cette tâche, laquelle commence par l’identification d’une pensée criminelle pour continuer par une mise en garde contre la pente glissante qui conduit de cette pensée à la domination politique[20]. »
De là découle un portrait assez amusant et fort bien croqué de l’intellectuel progressiste, à la fois figure du proue du Bien en marche et révolté perpétuel face à une Histoire dont le cours est toujours trop lent face à l’ « Urgence » du Progrès. Malentendu permanent, le Lumpen-intellectuel se croit en marge en vertu de sa révolte, alors même qu’il ne se révolte que contre le fait que le monde tel qu’il advient advienne trop lentement. D’où l’ambivalence structurelle de cet intellectuel institutionnel – appelons-le « l’intellectuel critique » – traquant avec vigilance les restes illégitimes du passé, mais confiant dans une forme de purification sociale dont l’Histoire serait porteuse :
« L’idéologie est une structure mentale qui permet de concilier des tendances contradictoires : une méfiance extrême des idées et un dogmatisme aveugle. L’homme idéologique est par conséquent suspicieux et enthousiaste de manière absolue. Il ne semble pas exister une idée en ce monde qu’il ne souhaiterait pas remettre en question, transformer en objet de dérision, de scepticisme ou de mépris. (…). En conséquence, il aura tendance à mépriser la raison en tant que faculté autonome, à rabaisser les nobles idéaux et à déconstruire le passé, voyant partout la même mystification idéologique. Mais dans le même temps il vit dans un état constant de mobilisation pour un monde meilleur. Sa bouche est remplie de slogans nobles sur la fraternité, la liberté, la justice, et dans chacune de ces paroles il fait comprendre qu’il sait quel côté est dans le vrai et qu’il est prêt à sacrifier l’ensemble de son existence pour lui assurer la victoire[21]. »
Redisons-le : une telle description vaut moins par l’identification de la figure factice de la subversion que par la causalité rendant compte de la production d’une telle figure ; en plaçant le curseur sur la portée coercitive de la coopération, et en faisant de cette coopération une nécessité universelle, alors se trouve mécaniquement produite une classe d’intellectuels théorisant la nécessité de la coopération – de l’inclusion – et de la traque des vestiges de formes non coopératives des relations humaines.
D : L’ingénierie sociale et la fabrication de l’homme nouveau
Le dernier point qui mérite d’être relevé dans cet ouvrage porte sur la notion d’ingénierie sociale. La notion est mentionnée dès l’introduction et réapparaît à intervalle régulier tout au long de l’ouvrage. Transversale, elle constitue une sorte de corrélat opérationnel du progressisme : faire advenir le Progrès suppose de l’organiser et donc d’organiser le corps social selon les normes du Progrès.
Dans son entretien récent, l’auteur synthétise ainsi son approche :
« Tout le mainstream est obsédé par ce que j’appelle « l’ingénierie sociale », un projet de restructuration de la société qui vise à la création d’une nouvelle nation européenne, d’une nouvelle identité plus ou moins homogène, d’un nouveau type humain en fait, affaiblissant les nations et leurs particularismes. Il y a une forme d’hubris de la transformation qui se déploie à Bruxelles. C’est ce que voulaient faire les communistes : créer un homme nouveau[22]. »
Par cette mention d’ingénierie sociale se comprend le fait que l’auteur ne convoque pas davantage Tocqueville dont les analyses semblent attribuer au processus démocratique une quasi-autonomie à l’égard des intentions et donc des finalités humaines. On se rappelle que celui-là transcende tellement celles-ci que Tocqueville le compara à la Providence pour exprimer son implacable accomplissement, indépendamment de la maîtrise humaine de son développement. Or, Legutko maintient l’idée d’une intention, d’une orientation volontaire des relations humaines vers des normes progressistes, dont l’ingénierie sociale assure la réalisation en vue de la construction artificielle d’un « homme nouveau », affranchi de ses anciennes attaches et de ses anciennes allégeances. A l’instar du Que faire de Lénine, l’auteur ne croit pas en la spontanéité du devenir social et décrit les formes par lesquelles sont conçues et organisées les relations sociales.
Cela signifie que les entreprises déconstructionnistes, trouvant désormais un relai institutionnel, ne visent évidemment pas à seulement exhiber la non-naturalité des normes historiques mais bien aussi à produire et imposer de nouvelles normes d’où sont radicalement exclus un ensemble de comportements, voire de types humains, pourtant banals dans les siècles passés ; la reconfiguration autoritaire du corps social sur la base d’une propagande quotidienne, tant conceptuelle que visuelle – songeons parmi mille autres aux affiches de Grüne Xhain, à Berlin – établit une série normative de comportements intimes qui, au nom de la coopération, exclut mécaniquement l’essentiel de ce que les siècles antérieurs ont jugé souhaitable. Autrement dit, l’inclusivité forme une formidable machine à exclure, notamment à exclure les ultimes produits du passé, le tout sur fond d’une fabrique à marche forcée d’un nouveau type de comportements humains – pour ne pas dire d’un homme nouveau.

Mais là encore nous devons émettre certaines réserves car l’ouvrage ne nous paraît pas à la hauteur des notions qu’il convoque. D’abord et avant tout brille par son absence l’analyse d’une telle ingénierie sociale : que les institutions européennes développent des formes d’expérimentation coercitive sur les peuples est une chose, qu’on soit quitte de l’explication en est une autre. Par ailleurs, l’auteur ne dit jamais en quoi l’ingénierie sociale est un problème : est-elle un problème parce qu’elle présuppose que les peuples auraient à être organisés et donc qu’elle présuppose par hybris l’existence d’une introuvable élite connaissant les fins optimales des sociétés et les moyens de les accomplir, auquel cas l’auteur rejoindrait une critique célèbre et forte d’Hayek contre les sociétés auxquelles est imposé un ordre artificiellement organisé ? ou est-elle un problème parce que l’organisation vise le progrès et détruit ainsi l’ordre ancien ? Est-ce donc un problème de forme ou de contenu de la structure organisationnelle – au sens de « dirigée », – des sociétés contemporaines ? Cela manque profondément de clarté mais aussi de corrélation avec les formes organisationnelles qui ont émergé avec le management et l’organisation artificielle de la vie professionnelle et administrative.
En outre, aucune généalogie de cette ingénierie ne se trouve menée, ni même évoquée, pas plus que ne se trouve mentionnée la question de la contradiction structurelle d’une telle ingénierie avec les principes libéraux qui, fondant la distinction entre la société civile et l’Etat, confèrent à la première une autonomie inédite qui aurait dû la prémunir contre les formes d’ingénierie sociale qui sont toutes, dans les faits, le produit d’actions étatiques. A cet égard, on eût aimé que l’auteur décortiquât le rapport entre le développement de l’ingénierie sociale et le libéralisme pris en ses principes. Enfin, il manque à cette approche toute la question de la postérité darwinienne, et donc l’articulation entre l’émergence au sein du socialisme anglais du XIXème siècle de l’ingénierie sociale à partir d’une réflexion sur l’ « amélioration » biologique de l’humanité, et son accomplissement effectif dans les institutions occidentales et sans doute désormais également dans les institutions extrême orientales.
E : Le problème du titre et du sous-titre
De ces réserves découle un certain scepticisme à l’endroit du titre et du sous-titre : qui est le Diable dont parle l’auteur ? Les tentations totalitaires sont-elles des tentations ou des nécessités structurelles ?
Il nous semble que la comparaison entre démocratie libérale et socialisme réel tend à signifier pour l’auteur que le Diable est le socialisme réel et que la tentation est le devenir-libéral des démocraties par lequel elles se rapprocheraient dangereusement du socialisme réel. On voit bien que soutenir de telles thèses supposerait une discussion bien plus approfondie avec les grands analystes de la démocratie comme Tocqueville afin de montrer que ce ne serait pas le processus démocratique comme tel qui conduirait à un résultat jugé néfaste, mais un devenir-libéral de la démocratie qui pourrait être autre – quel serait-il alors ?
Un tel propos supposerait également une discussion plus historique et plus conceptuelle à la fois de la notion même d’organisation : la pensée organisationnelle est une pensée à part entière, et l’ingénierie sociale possède des fondements intellectuels qui ne sont pas libéraux, quel que soit le sens du mot « libéralisme » que l’on décide de retenir ; de ce fait, on ne voit pas du tout pourquoi une démocratie qui succombe à l’ingénierie sociale peut être qualifiée de « libérale » : le terme employé est impropre à nommer une situation où une oligarchie économique, technocratique et idéologique pense savoir dans quelle direction doit être orientée et reconfigurée la société. En d’autres termes, aucun sens de l’adjectif « libéral » ne désigne un pouvoir coercitif d’une oligarchie, pouvoir exercé sur le devenir d’une société selon des finalités pré-établies.
Il y a donc dans ce livre une certaine paresse intellectuelle consistant à ne pas conceptualiser à nouveaux frais la situation étrange dans laquelle cohabitent individualisme, affranchissement à l’égard des normes antérieures, règne du marché et pouvoir oligarchique exercé par ingénierie sociale. Le terme de « communisme de marché » qu’avait forgé Flora de Montcorbier[23] n’est peut-être pas le plus impropre à combler la lacune lexicale que rencontre l’époque pour se nommer elle-même et que ne comble malheureusement pas l’auteur.
Conclusion
Intéressant à plus d’un titre, cet ouvrage l’est tant par le constat qu’il dresse – celui de la profonde parenté idéologique entre les démocraties libérales et le socialisme réel – que par la question qu’il pose : comment rendre compte d’une telle proximité ? Nourri d’une connaissance intime du système socialiste polonais, mais aussi du fonctionnement des institutions européennes, il décrit un état de fait qui apparaît souvent comme une évidence à l’Est et comme une absurdité à l’Ouest, et il y a fort à parier que ce livre sera jugé illisible et odieux par nombre de lecteurs occidentaux.
Les conséquences de cette parenté ont le mérite d’être à la fois logiquement élucidées et concrètement décrites. Qu’il s’agisse de la langue de bois, des tabous, des fausses évidences auxquelles chacun est pourtant sommé de croire, bref du rétrécissement considérable de la pensée et de la liberté, l’auteur fait mouche à chaque fois.
« La caractéristique commune des deux sociétés – communiste et démocratique libérale – demeure le fait que de nombreuses choses ne peuvent y être discutées parce qu’elles sont forcément mauvaises ou incontestablement bonnes. Les évoquer revient à émettre des doutes sur quelque chose dont la valeur a été déterminée de manière indiscutable[24]. »
Que cela soit fondé sur un historicisme progressiste où s’effectue une traque contre tout ce qui pourrait retarder le Progrès est fort bien rendu en vertu de la sidération qui a saisi l’auteur lorsque se sont révélées à lui les pratiques réelles de l’Occident, si proches de celles qu’il avait connues en Pologne.
En revanche, nous redisons nos réserves à l’endroit de la nature même de l’ouvrage, dont la forme est indéterminée, mais aussi à l’endroit de sa conceptualité hésitante et de l’approche superficielle de l’articulation entre les différents aspects qui y sont abordés. La description s’épuise souvent en elle-même, remonte rarement vers l’analyse, tandis que l’articulation entre « libéralisme », ingénierie sociale, droits humains et progressisme n’est pas menée à son terme.
Enfin, il nous semble que cet ouvrage, du fait même qu’il dresse un constat stimulant, soulève un problème qui n’est pourtant pas thématisé comme tel. Si l’historicisme progressiste constitue la vérité de la démocratie « libérale », alors se lamenter sur le caractère inaudible des positions « conservatrices » n’a pas de sens puisque la justesse même du constat implique de comprendre aussitôt que le conservatisme est mort-né en démocratie « libérale ». Lorsque Geoffroy de Lagasnerie affirme qu’il n’y a pas d’intellectuel de droite, il est difficile de lui donner tort du point de vue démocratique puisque l’intellectuel conservateur est, d’une part, celui qui ne conceptualise rien puisque ce qui est légitime a déjà eu lieu et est déjà donné par l’épaisseur des temps, et est d’autre part celui qui défend une position que sa propre théorie juge pourtant inaudible ; bref, l’intellectuel conservateur n’est pas un producteur de concepts pas plus qu’il n’est en mesure de proposer une solution cohérente avec sa propre pensée.
Pour être cohérent, le conservateur n’aurait en effet que deux options qui constituent en réalité un dilemme ruineux : soit il concède pleinement sa défaite et il devient ainsi cohérent avec ses constats ; soit il construit une théorie et une stratégie pour un système tout à fait différent de celui qu’il déplore, mais il se trouve ainsi condamné à penser et construire une ingénierie sociale selon des voies artificielles qui heurtent de plein fouet la supposée naturalité de ce qu’il voulait conserver. En somme, l’intellectuel conservateur a toujours déjà perdu en démocratie : c’est peut-être cela qui structure à son corps défendant le propos de Legutko.
[1] Ryszard Legutko, Le Diable dans la démocratie. Tentations totalitaires au cœur des sociétés libres, Traduction Julien Funnaro, Paris, L’Artilleur, 2021.
[2] La traduction du livre de Legutko s’est ainsi faite dans un quasi-silence médiatique, seuls Atlantico et Le Figaro ayant relayé et chroniqué cette publication.
[3] Stanko Cerovic, Dans les griffes des humanistes, Traduction Mireille Robin, Paris, Climats, 2001, p. 218.
[4] Le Diable dans la démocratie, op. cit., p. 17.
[5] Ibid., p. 31.
[6] Ibid., p. 32.
[7] Défini comme « ce mouvement vers la gauche » dans Les idées politiques de la France, le sinistrisme joue un double rôle dans les écrits de Thibaudet : d’abord descriptif, il vise à nommer le glissement à gauche des institutions françaises depuis le XVIIIème siècle ayant rendu possible la Révolution ; il permet ensuite de déterminer le contenu de ce contre quoi réagit la Réaction qui réagit ainsi moins contre une idée précise que contre une dynamique ou un mouvement, le jeu des idées étant une sorte de troisième loi newtonienne du mouvement où s’opposent action – sinistrisme – et réaction – défense de la tradition.
[8] Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Introduction, in Tocqueville, Œuvres, Tome II, Gallimard, coll. Pléiade, 1992, note a., pp. 937-938.
[9] Cf. Le diable dans la démocratie, op. cit. : « La démocratie libérale est un mécanisme unificateur puissant, effaçant les différences entre les peuples et imposant une uniformité des vues, des comportements et du langage. », p. 22
[10] Ce type de sophismes structure l’ouvrage de Gaëtan Gorce, Histoire de la droite. Pour ceux qui n’aiment pas ça, Paris, Fayard, 2013.
[11] Le diable dans la démocratie…, op. cit., p. 355.
[12] Cf. Christopher Lasch, Le seul et vrai Paradis. Une histoire de l’idéologie du progrès et de ses critiques, Paris, Flammarion, coll. Champs, 2002.
[13] Thomas Messias, A l’écart de la meute. Sortir de l’amitié masculine, Paris, Marabout, 2021.
[14] https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/unique-en-son-genre-du-vendredi-10-septembre-2021
[15] https://atlantico.fr/article/decryptage/ryszard-legutko—les-democraties-liberales-occidentales-sont-loin-d-etre-le-modele-de-vertu-qu-elles-s-imaginent-etre-le-diable-dans-la-democratie-ideologie-communisme
[16] David Colon, Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain, Paris, Flammarion, coll. Champs, 2021.
[17] Ryszard Legutko, « En Europe, les conservateurs ont totalement capitulé », Le Figaro, 4 mars 2021.
[18] Le Diable dans la démocratie…, op. cit., p. 213.
[19] Ibid., p. 208.
[20] Ibid., p. 213.
[21] Ibid., p. 238.
[22] Ryszard Legutko, « En Europe, les conservateurs ont totalement capitulé », Le Figaro, 4 mars 2021.
[23] Cf. Flora de Montcorbier, Le communisme de marché. De l’utopie marxiste à l’utopie mondialiste, L’âge d’Homme, 2000.
[24] Le Diable dans la démocratie…, op. cit., p. 264.








