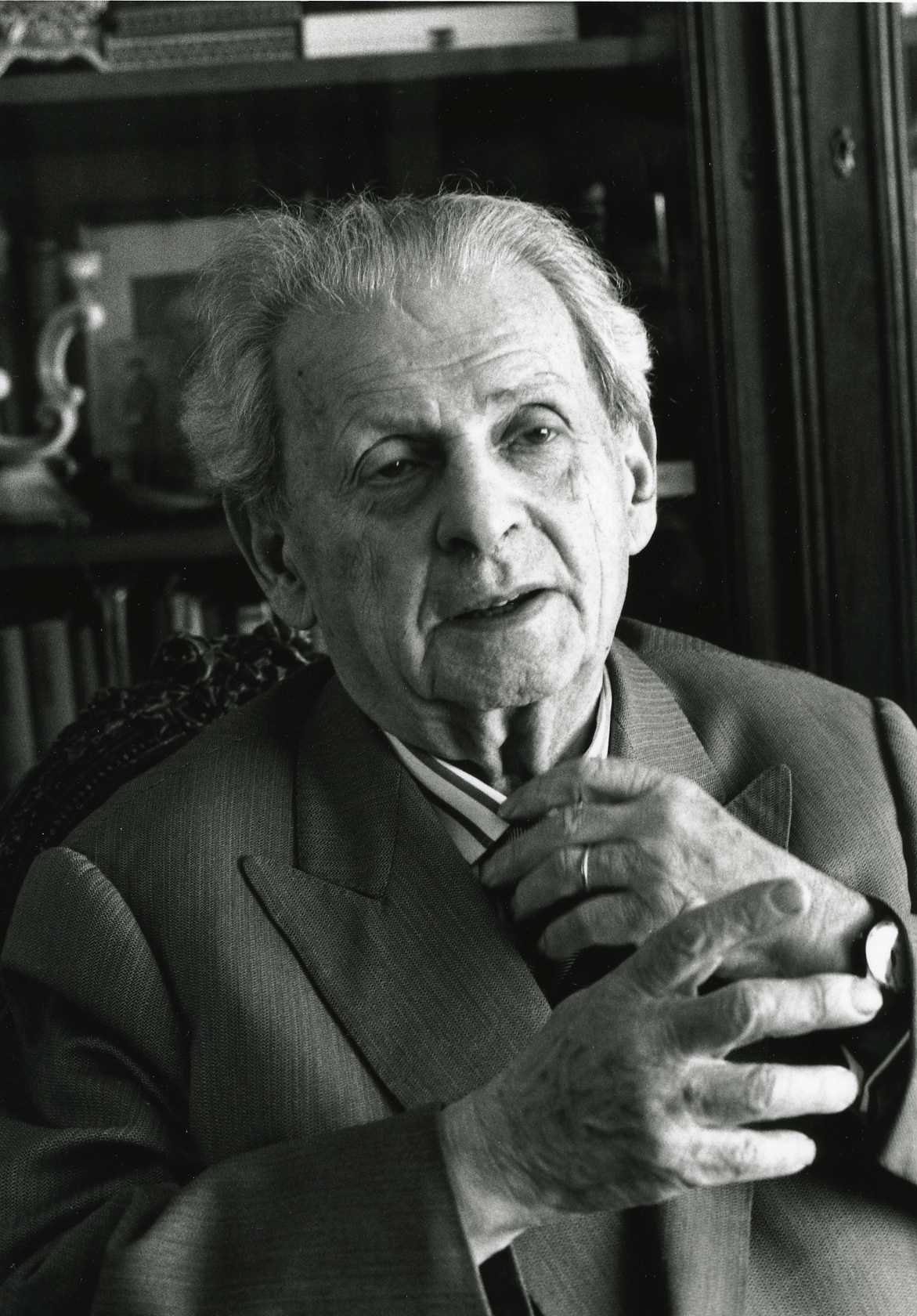Figures de l’altérité est un recueil d’articles publiés sous la direction de Roger-Pol Droit1. Les six textes rassemblés abordent, chacun à leur manière, la notion d’étrangeté, dressant ainsi un panorama des images de l’autre. La diversité des cas envisagés, ainsi que des contextes culturels dans lesquels ils s’ancrent, est particulièrement intéressante à cet égard. Les articles de Frédérique Ildefonse, Luc Brisson et Roger-Pol Droit explorent l’Antiquité grecque et tardive. Ceux de Paul Audi et Michel Meyer portent, quant à eux, sur l’Occident Moderne. Enfin, Christian Jambet aborde le statut de l’étranger dans la tradition islamique.
Si les généralistes risquent de regretter le caractère très circonscrit de certaines analyses, elles sont judicieusement mises en perspective par la préface de Pierre Caye qui les rassemble autour d’une problématique commune. Celle-ci porte sur le rapport ambigu qu’entretient la métaphysique avec la notion d’altérité. D’un côté, la catégorie de l’Autre permet la circulation entre les formes et donne à la métaphysique le dynamisme sans lequel elle ne serait que « cette pyramide égyptienne qu’avait dressée le poème de Parménide » 2. Mettant en mouvement le système d’identités conceptuelles, elle lui permet de comprendre la diversité et la complexité du monde. Pour désigner cette puissance de compréhension en marche, Pierre Caye emploie la métaphore de la machine : « l’altérité, à travers même son travail de systématisation et de mobilisation de l’être, transforme la métaphysique en machine » 3. Cependant, en tant que machine justement, la métaphysique est d’ores et déjà un processus de réduction de l’altérité. La machine est une totalité fonctionnelle. Elle agit sur l’extériorité et l’intègre à son propre mouvement, lui ôtant par là son caractère étranger. D’où la position fondamentalement problématique de la notion d’altérité, qui fait entrer la machine métaphysique en contradiction avec elle-même. Comprendre l’altérité en tant que telle implique de remettre en question le fonctionnement même de la métaphysique : « il s’agirait alors de penser comment accéder à une altérité non machinique, une altérité qui ne vaudrait que pour elle-même, qui n’entraînerait pas l’identité dans une Odyssée folle » 4.
On reconnaît dans cette formulation l’une des grandes problématiques de la philosophie d’Emmanuel Levinas qui s’efforcer de penser l’ « absolument autre », « l’Autre, dépassant l’idée de l’Autre en moi » 5. Il est d’ailleurs étonnant que Pierre Caye ne prenne pas davantage au sérieux la proposition de ce dernier, qu’il balaye à notre avis un peu hâtivement. Selon lui, l’« absolument autre » levinassien n’échapperait pas à la métaphysique machinique. En effet, la machine ne se définit pas uniquement comme une totalité fonctionnelle, mais aussi par le surplus qu’elle engendre. Or, l’Autre levinassien, s’il se situe bien en dehors de la totalité, pourrait par contre être compris comme surplus. Il serait donc un produit du fonctionnement de la machine et in fine intégré à son système économique. Certes, Levinas emploie parfois le terme de « surplus » : « un surplus toujours extérieur à la totalité » 6. Cependant, ce terme n’est en aucun cas à entendre au sens de production surnuméraire. Le « surplus » n’est pas, chez Levinas, un produit de la totalité. Il désigne au contraire un ordre qui rompt avec l’économie de l’être, une altérité qui signifie « Non pas être autrement, mais autrement qu’être » 7. La philosophie d’Emmanuel Levinas nous semble donc bien pouvoir être comprise comme une réelle tentative pour rompre avec la métaphysique classique. Il s’agit de rendre à l’Autre son absoluité, là où cette dernière le réduit inévitablement à n’être qu’un produit du Même. Et le style du philosophe, parfois déroutant, témoigne de la nécessité de forger une langue nouvelle, capable de dire cet Autre, sans le prendre dans un système de signifiants qui en neutraliserait par avance la portée.
Les six articles qui suivent sont divisés en deux grandes parties : « figures » et « notions ». L’altérité n’y est précisément pas abordée en tant que concept. Ces « figures » et « notions » relèvent elles aussi d’un effort de décalage par rapport au traitement métaphysique et se donnent ainsi comme autant de pistes pour penser l’Autre en dehors de la « machine ».
I) Les figures
« Identité et altérité à partir des Bacchantes d’Euripide », par Frédérique Ildefonse
Frédérique Ildefonse dresse un portrait de Dionysos en tant que figure de l’ altérité radicale. Dionysos incarne une altérité qui n’est pas relative au Même. L’étude des Bacchantes lui permet de dégager les conditions de cette absoluité : si l’altérité du dieu ne s’achève dans aucune identité, c’est que Dionysos est d’abord autre par rapport à lui-même.
Dans les Bacchantes d’Euripide, Dionysos est un dieu itinérant qui se présente comme étranger partout où il va. Il porte également en lui une seconde étrangeté : tour à tour taureau, dragon à mille têtes, lion crachant du feu, il est sans cesse changeant et reste insaisissable. Par sa plasticité, il se dérobe à toutes les formes et n’est nulle part reconnu. En témoigne la formule, récurrente dans le texte : « ce dieu, quel qu’il soit ». Dionysos s’oppose d’ailleurs lui-même à toute forme de lien : « Je défend qu’on me lie » 8.

Or, cette puissance de subversion de l’identité ne s’avère possible que parce que Dionysos possède une altérité intérieure : il est différence par rapport à soi. En ce sens, l’altérité du dieu doit être comprise à partir de la catégorie de l’Autre telle que la définit Platon dans le Sophiste. Contrairement à Aristote, qui ne conçoit l’autre que relativement au même, le Sophiste en fait une catégorie première rendant possible la prédication : « l’Autre dans le Sophiste, fondant le mélange des genres, permet que chaque chose ne soit pas seulement ce qu’elle est, mais une multiplicité d’autres choses » 9. L’étude de la figure de Dionysos vient donc finalement remettre en question la primauté de l’identité sur l’altérité : « l’identité, si elle se définit par la permanence, doit trouver un garant de celle-ci hors d’elle-même. C’est la manière dont Dionysos inquiète fondamentalement, ébranle l’identité qui en retour la garantit » 10.
« Rousseau et le tribunal de la représentation », par Paul Audi
A partir d’une lecture originale des œuvres dites « autobiographiques » de Rousseau, Paul Audi montre que la différence fondamentale du Moi par rapport à lui-même rend impossible sa juste représentation. Toute catégorisation est d’ores et déjà assignation et jugement.
Paul Audi aborde trois œuvres de l’auteur : Les Confessions (1765-1769), les Dialogues, Rousseau juge de Jean-Jacques (1772-1775) et Les rêveries du promeneur solitaire (1778). Il propose de les considérer, non pas comme des écrits autobiographiques, mais comme un « exercice d’éthique appliquée » 11. En effet, leur objet n’est pas tant de décrire un Soi particulier que de comprendre la manière dont existe un Moi en général. Ils dépeignent moins une singularité qu’un processus universel de singularisation.
Dans les Confessions, si Rousseau étudie les altérations de sa propre âme, c’est en tant que celle-ci possède une valeur exemplaire. Il en dégage une proposition générale : le Moi n’est pas substantiel, mais vit dans une différence constante de soi à soi. Il cherche ensuite à dégager les causes de ces fluctuations. Dans les Rêveries, Rousseau paraît toutefois renoncer à cette volonté de représentation et d’analyse. Il décrit la succession des affects et les modifications de son âme comme elles viennent. Il ne s’agit plus de se présenter aux autres comme un cas exemplaire, mais de jouir soi-même à nouveau des états rappelés par le récit. Comment expliquer ce changement de perspective ?
Paul Audi en voit la clé dans la troisième œuvre étudiée : les Dialogues. Rousseau y découvre que toute représentation est d’ores et déjà un procès. Le dispositif narratif original cherche à rendre compte de « l’incessante dissemblance à soi-même qui empêche un être (Jean-Jacques en l’occurrence) de se maintenir comme tel sous l’énoncé qu’il désigne » 12. Les deux autres protagonistes en proposent chacun des représentations partielles et partiales, si bien que JJ se trouve acculé par une alternative au sein de laquelle il est nécessairement coupable : ou bien JJ est l’auteur véritable de livres immoraux, ou bien il est l’auteur faux de bons livres. Les Dialogues instituent ainsi un « procès du procès » : « le sujet que l’on juge échappe nécessairement, et heureusement, à tout jugement ayant la valeur illocutoire de produire un verdict, de sorte que c’est sur ce jugement lui-même, et non sur le sujet qui lui sert d’objet référent, que devrait porter le jugement, dans la mesure où je jugement prétend – selon sa signification (Sinn) – se prononcer sur ce qui, de toute façon, se dérobe à la capture signifiante, ce qui échappe à toute identification » 13.
« Quand un étranger parle des étrangers. L’exemple de Lucien de Samosate », par Luc Brisson
Luc Brisson retrace de parcours de Lucien de Samosate. Né vers 125 à Samosate, région incorprée à l’Empire romain en 72, il n’est pas un barbare par ses origines. Il est cependant étranger à l’empire par sa langue maternelle (l’araméen) et sa culture sémitique.
La première partie de l’article s’intéresse aux choix qui conduisent Lucien à se forger une identité particulière, celle d’étranger intégré à l’empire : choix de la scholè contre le travail manuel, d’une part ; passage de la rhétorique à la philosophie, d’autre part. Lucien commence sa carrière en exerçant la fonction d’avocat et devient un célèbre orateur. A quarante an, il décide de quitter « l’art du mensonge pour se mettre au service de la philosophie » 14. Il rédige alors des dialogues, à la manière Platon. Dans un style satyrique, il s’en prend notamment aux pédants, aux charlatans, à ceux qui se mettent au service des puissants ainsi qu’aux pratiques religieuses. Sa renommée le conduit, sous Marc-Aurèle, à occuper de hautes fonctions dans l’Empire. Il écrit alors une Apologie pour ceux qui sont au service des grands, amendant la critique formulée à leur égard dans ses précédents écrits.
La seconde partie de l’article décrit la manière dont Lucien, étranger, envisage lui-même les étrangers. Ses jugements sont en grande partie négatifs et relèvent de lieux communs de l’époque : les Mèdes, les Perses et les Arméniens font preuve de mollesse ; les Libyens volent leurs maîtres ; les Paphlagoniens sont superstitieux, etc. Cependant, il n’adhère pas non plus absolument à la culture romaine qu’il s’est choisie et conserve un regard distant sur son peuple d’origine. Le parcours de Lucien révèle alors toute la complexité de l’identité de l’étranger. Malgré une intégration sociale réussi dans l’Empire, l’identité de Lucien ne se construit ni en référence à un groupe d’arrivée, ni par valorisation de l’origine. Au contraire, sa situation le pousse à se concevoir dans la différence avec tout groupe social : « Seules échappent à sa critique la langue grecque et la culture dans son ensemble […] On comprend dès lors que le noyau dur de son identité se situe là précisément, dans la langue et la culture grecque » (143).
II) Les notions
« Chez soi ou chez les autres. Variations autour de l’oïkos », par Roger-Pol Droit
A travers une étude de quelques termes du grec ancien, dérivés de oïkos, Roger-Pol Droit montre comment l’altérité peut être pensée comme intérieure et positive : « l’oïkos marque, dans le chez soi, l’ancrage d’une pluralité reliée, d’une organisation d’éléments fondatrice, sous-jacente aux idées même d’appartenance, d’identité, de soi » 15.
Le terme d’oïkos possède le triple sens de maison, propriété, et famille. Il désigne un lieu clos, l’enceinte de la maison, mais aussi un lieu d’échange. C’est un espace ouvert, dont l’intériorité est plurielle : s’y regroupent tous ceux qui vivent sous le même toit (famille, esclaves, hôtes) et entretiennent entre eux des relations d’ordre divers (éducatives, sexuelles, économiques).
Le terme oîkeiôtès, quant à lui, désigne d’abord l’apparentement ou la relation de parenté. Par extension, il peut s’appliquer à l’humanité entière pour nommer le genre humain. Il a été rapproché du terme technique d’oïkeiôsis qui désigne, en particulier dans le vocabulaire stoïcien, l’appropriation, le fait d’attacher à soi ou l’attachement que l’on porte à soi-même. La conjonction des deux termes suggère que l’attachement à soi produit un attachement aux proches, qui peut s’étendre jusqu’à l’humanité. L’oïkouménè représente cette extension maximale de l’oïkos : la « terre habitée » par la langue, la culture, l’aire dans laquelle on comprend le grec. Pour les romains il s’agit de l’Empire. Mais l’oïkouménè reçoit aussi une extension universelle. Chez Strabon, par exemple, le terme désigne la totalité de l’espace terrestre.
L ‘étude des termes grecs permet alors de renouveler la question du rapport entre le « chez soi » et le « chez les autres ». L’oïkos et ses dérivés nous confronte à une altérité présente au sein du même. L’identité ne serait pas originaire, mais construite à partir du divers et toujours en tension : « « Chez soi ou chez les autres » ne serait donc pas à entendre comme une disjonction. Il y aurait toujours « des autres » chez soi, et « de soi » chez les autres » 16.
« La morale ou la question de l’Autre », par Michel Meyer
Michel Meyer distingue différents types de morales en fonction de la manière dont l’altérité y est conçue. Avec cette partition, il cherche à montrer le rôle fondamental de la distance dans notre rapport à autrui.
La philosophie occidentale appréhende l’autre sous trois formes distinctes. Celui-ci peut être considéré comme un individu qui me menace ou me met en question, un potentiel ennemi. L’altérité peut aussi être saisie au sein du Moi, comme une partie de moi-même à laquelle je suis sans cesse confronté : le corps, la passion, etc. Enfin, on peut comprendre l’altérité au sens d’un Soi universel : l’Homme en tant qu’essence questionne mon être particulier. La philosophie classique est traversée par ces trois visions de l’altérité, renvoyant chacune à trois problèmes, ainsi qu’à trois dimensions de l’existence : au logos correspond le problème de l’essence pour l’existence ; au pathos, celui du corps pour l’esprit ; à l’ethos, celui de l’individu devant coexister avec d’autres. Cette distinction permet ensuite à Michel Meyer de classifier les morales occidentales. La morale du droit naturel prend sa source dans l’ethos. Les morales fondées sur la maîtrise des passions s’inscrivent dans le pathos. La prise en considération du logos, quant à elle, donne naissance aux morales fondées sur l’intérêt général.
Michel Meyer considère que, si chacune de ces morales échoue dans sa prétention à l’universalité, elles possèdent pourtant toutes un espace de validité. Celui-ci s’établirait en fonction de la distance qui nous sépare de l’autre : le pathos jouerait davantage dans les situations de proximité, alors que le logos orienterait nos actes envers le lointain. Il serait ainsi possible de nuancer les prétentions à l’universalité des différentes morales, sans toutefois tomber dans le relativisme : « tout le monde est d’accord sur ce qui est bien ou mal à une distance donnée » 17. Michel Meyer peut alors proposer une nouvelle définition de la morale : « la morale est la gestion de la distance entre les individus selon les catégories du bien et du mal » 18. L’article se clôt sur un graphique représentant l’espace de validité des théories éthiques en fonction de la distance.
« Heureux les étrangers ! Variations sur une tradition islamique », par Christian Jambet
L’article s’interroge sur l’interprétation d’un propos attribué à Ja ‘far al-Sadiq (m. 148h./765) : « L’islam a commencé étranger et il redeviendra étranger, heureux soient les étrangers ». Comment entendre ici le mot «étranger » (gharib) ?
Henri Corbin en propose une paraphrase : « L’islam a commencé expatrié et redeviendra expatrié comme il était au commencement. Bienheureux ceux d’entre la communauté de Muhammad qui s’expatrient » 19. Mais de quel exil s’agit-il ? Il pourrait s’agir d’un exil dans ce bas-monde. Le monde est vain et constitue pour l’islam une terre étrangère. Sa vraie place est ailleurs, dans la vie future. Ja ‘far al-Sadiq chercherait alors à nous faire prendre conscience du caractère inhospitalier du monde. A la manière des gnostiques il nous livrerait un message d’arrachement. Cette première interprétation pose cependant une difficulté. Elle fait de l’islam un religion du salut et non une religion de la Loi. Bien que cette conception corresponde à celle de certaines traditions islamiques, elle semble difficile à soutenir dans le contexte de la citation.
Christian Jambet se tourne alors vers une autre hypothèse de lecture. Gharib peut aussi signifier « ce qui est difficile à comprendre ». Et M.-A Amir-Moezzi traduit : « L’islam était à l’origine méconnu et redeviendra méconnu ; heureux soient les méconnus » 20. Cette interprétation ôte à l’islam son aspect gnostique pour en faire un ésotérisme. L’islam est par essence caché, il ne se réduit pas à la manière dont il apparaît. Le terme d’« islam » ne désigne alors pas la religion officielle et instituée, mais quelque chose qui est caché sous celle-ci et méconnu du plus grand nombre. Il faut alors comprendre que l’islam véritable est une religion intérieure, qui ne se réduit pas à l’enseignement de la loi exotérique (shari’a). Le propos de Ja ‘far al-Sadiq dessine non pas un partage entre le bas monde et le lieu de la vie authentique, mais un partage entre les hommes : ceux qui vivent le véritable islam et les faux adeptes.
Conclusion
Au terme de ces six articles, certaines propositions se dégagent qui viennent enrichir notre compréhension de l’altérité. Cependant, on s’aperçoit que leur enjeu réel porte paradoxalement toujours sur la question de l’identité :
L’altérité travaille l’identité de l’intérieure, faisant du même un étranger à soi.
Par conséquent, l’identité est insaisissable, toute représentation en constitue d’emblée une réduction et un enfermement.
Cette perpétuelle différence du même par rapport à lui-même l’empêche de s’identifier intégralement à un groupe social ou à un corpus de lois écrites.
Finalement, eut égard au problème posé par Pierre Caye dans la préface (« comment accéder à une altérité non machinique » 21), se pose la question de la langue employée dans ces articles. Si l’altérité n’est pas abordée en tant que concept, mais bien à partir de «notions » et de « figures » particulières, le propos n’en reste pas moins énoncé dans les termes de la métaphysique la plus classique. Prendre au sérieux les conclusions précédentes n’impliquerait-t-il pas, au contraire, de remettre en question l’usage même de la langue philosophique et de ses oppositions conceptuelles ? Peut-être est-il inévitable que l’on ne puisse, pour s’extraire de la « machine », qu’employer les rouages de celle-ci. Mais alors, c’est la métaphore même de la « machine » qui s’avère trop caricaturale pour désigner une métaphysique possédant en elle les ressorts qui la rendent plastique.
- Roger-Pol Droit (dir.), Figures de l’altérité, Paris, PUF, 2014
- Figures de l’altérité, Paris, PUF, 2014, p 8
- Ibid
- Ibid, p 10
- Emmanuel Levinas, Totalité et infini, le Livre de poche, 1990, p 43
- Ibid, p 10
- Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, le Livre de Poche, 2004, p 13
- Euripide, les Bacchantes, v. 504, trad. H. Grégoire, Paris, Les Belles Lettres, 1961
- Figures de l’altérité, p 56
- Ibid, p 63
- Ibid, p 70
- Ibid, p 96
- Ibid, p 117
- Ibid, p130
- Ibid, p 159
- Ibid, p170
- Ibid, p190
- Ibid, p192
- Ibid, p 206
- Ibid, p217
- Ibid, p 10