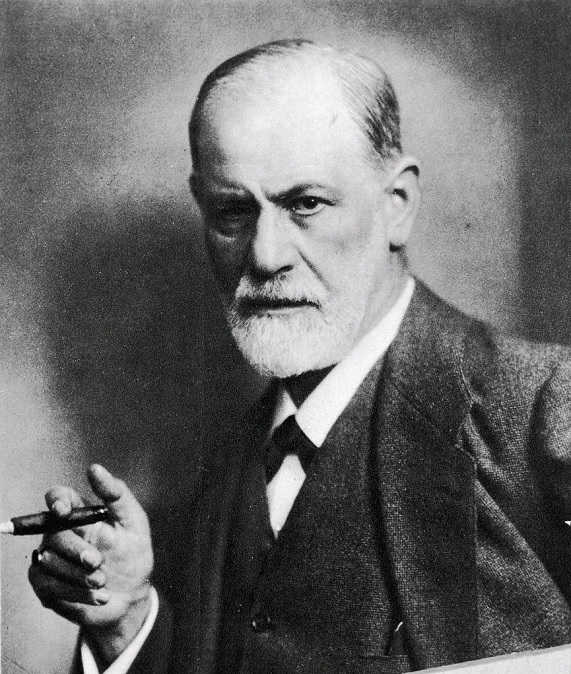« Un sot savant est plus sot qu’un sot ignorant »
Molière, Les Femmes savantes, IV, 2
« Envoyé c’est pesé ! s’écria le renard.
Ne sois pas si jobard.
Méfie-toi des p’tits mecs qui te la font à l’estome
Et qui t’envoient par le bide des bobards à la gomme. »
Le Corbac et le Renard, d’après Jean de la Fontaine
Verbiage et charabia
René Pommier est professeur émérite de littérature française, spécialiste du XVIIème siècle et de Racine en particulier. Il est l’auteur d’une oeuvre originale de critique littéraire aujourd’hui très peu reconnue. A côté d’essais et de recueils d’explications de textes tirés de son enseignement à la Sorbonne, qui sont des modèles du genre – à la fois exhaustifs, élégants et fins – René Pommier s’est signalé depuis la fin des années 70 par plusieurs livres polémiques, dirigés contre des gloires du monde intellectuel français, au premier rang desquels Roland Barthes, ou encore René Girard, cet « allumé qui se prend pour un phare ». Rationaliste et sceptique, René Pommier n’a eu de cesse de dénoncer ceux qu’il considère comme des imposteurs, et c’est avec constance et acharnement qu’il a tenu à démontrer l’ampleur de leurs erreurs, pire : de leur sottise. Il a surtout dénoncé les tenants de la « nouvelle critique », qui prétendaient apporter des méthodes d’analyse scientifique dans l’explication littéraire.
Or, loin d’éclairer les auteurs qu’ils commentent, un Roland Barthes, un Lucien Goldmann, un René Girard ne font que « plaquer » des grilles de lectures toutes faites sur les textes, preuve qu’ils sont totalement incapables de comprendre les oeuvres dont ils traitent. Déficientes, inutiles et même nuisibles à la compréhension, leurs méthodes de lecture ne font, selon René Pommier, qu’exprimer l’outrecuidance du critique pour qui l’oeuvre de l’écrivain n’est, au sens littéral du terme, qu’un prétexte à dissertations : Verlaine ne faisait des sonnets que pour être commenté par Jean-Pierre Richard ; la Comédie Humaine n’a été écrite que pour permettre à Charles Mauron d’étudier les « métaphores obsédantes » de Balzac etc.
« Si les philosophes sont persuadés que jamais personne n’a su penser avant eux, la coterie des critiques de choc est profondément convaincue que jamais personne n’a su lire avant eux. Cela n’empêche pas qu’ils ne cessent de se contester réciproquement les résultats de leurs diverses “lectures” et qu’ils ne sont guère d’accord au total que sur deux points : tous considèrent les écrivains comme des crétins (aucun d’eux n’a jamais vraiment compris la signification profonde de ce qu’il avait écrit) et tous estiment que les critiques (mais seulement ceux qui partagent ce point de vue) doivent être considérés comme de véritables écrivains. Qu’il est dommage que nous ne puissions leur accorder le premier point ! Combien volontiers alors leur eussions-nous concédé le second ! » 1
Faute de vouloir comprendre ce qu’a voulu dire l’auteur, les critiques dénoncés par Pommier se permettent toutes les élucubrations et tous les délires interprétatifs, préférant sans vergogne lire les textes classiques à partir de leurs marottes personnelles. Or, le fond n’étant pas si séparé de la forme que ne leur croient les tenants de la littérature pure, le style des mauvais critiques est souvent le reflet de leurs faiblesses théoriques. A ce sujet, on pourra lire les pages savoureuses que René Pommier consacre aux pages invraisemblables de ces critiques qui voient des symboles phalliques dans le clocher de Combray décrit par Proust, ou des allusions au coït dans le fameux sonnet adressé par Trissotin à la princesse Uranie. Et pour les plus difficiles à dérider, on ne pourra que recommander la charge menée contre George Molinié, professeur de stylistique, solennellement proclamé « plus abominable cacographe que la terre ait jamais porté » ! 2
C’est avec une verve réjouissante, souvent hilarante, que René Pommier s’attaque à ces auteurs, pour en démontrer point par point l’inanité. Il faut bien dire que rarement auteur aura fait preuve d’une telle abnégation dans l’étude scrupuleuse de cette créature polymorphe (ou informe) qu’est le charabia. Et rarement la description de la bêtise aura été l’occasion d’une telle fête pour l’esprit ! Derrière la colère et la consternation, il y a aussi, je n’en doute pas, la jubilation de donner le meilleur de soi-même pour déchirer tous ces tissus d’inepties. René Pommier n’a souvent pas de qualificatifs assez fleuris pour décrire l’accumulation d’âneries et de non-sens dont sont capables ses cibles favorites, ni de mots assez forts pour dire quelle gigantesque consternation est la sienne face aux outrances sans cesse renouvelées des pires « déjantés » des études littéraires. Plus ses ennemis sont bêtes, meilleur il est :
« Mais Mme Rey-Debove ne se préoccupe guère de satisfaire les esprits logiques : elle ne songe qu’à la joie des jobards qu’il faut gaver de galimatias barbare, qu’il faut gorger d’extravagances gratinées et qui, si celles-ci sont tout à fait contradictoires, se sentiront encore plus gâtés. Qu’importe qu’elle se contredise pourvu qu’elle ne dise que des sottises ! Si donc elle commence par affirmer, non pas que les Femmes savantes, insatisfaites sur le plan sexuel, cherchent une compensation dans la littérature, non pas qu’elles y trouvent un plaisir aussi intense que le plaisir sexuel, mais bien que le langage (non érotique) leur procure un plaisir proprement sexuel, c’est qu’une telle affirmation est bien de nature à faire tomber à genoux tous les jobards. Quant à nous, nous attendrons pour l’accepter que Mme Rey-Debove veuille bien nous citer au moins un exemple précis d’un cas aussi cocasse. Rien ne devrait lui être plus facile. Il suffit, en effet, d’avoir lu quelques pages d’elle pour être convaincu que des mots ou expressions comme « métalinguistique » ou « connotation autonymique » lui procurent un très vif plaisir. Mais de là à conclure qu’ils suscitent en elle un véritable émoi sexuel, il y a un pas que nous ne franchirons que lorsqu’elle nous y aura elle-même invité » 3.
Extravagances et délires
En critiquant ces figures célèbres et célébrées, René Pommier conteste radicalement l’ensemble des « méthodologies » à prétentions scientifiques, à commencer par le structuralisme et la psychanalyse, qui ont régné depuis une cinquante d’années en France et qui n’ont selon lui rien apporté aux études littéraires. En le lisant, on pourra se convaincre aisément que l’obscurité de la forme cache toujours la faiblesse du fond, et que moins on a à dire, plus on le dit à l’aide d’un langage indéchiffrable, l’effet de profondeur n’étant là que pour masquer la misère du propos. Etrangement, plus la notion d’interprétation a pris d’importance, plus le sens des textes a été sacrifié sur l’autel des chapelles d’herméneutes. L’interprétation est largement devenue une fin en soi, indépendamment de toute norme de vérité permettant de départager des lectures concurrentes. Et cela vaudrait, ô combien, pour nombre de philosophes qui, depuis une quarantaine d’années, ont tout fait pour obscurcir les auteurs classiques, et avoir tout simplement renoncé à parler un langage intelligible.
L’affirmation de Nietzsche, « il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations » a cessé depuis des lustres d’être un paradoxe : c’est une vérité largement admise et même, osons le dire, un fait établi. Or, ce desséchement de certaines branches de la philosophie s’expliquerait, à mon avis, en bonne partie par une décision tacite et irrévocable, celle de rompre avec tout sens commun : on peut tout dire, on peut interpréter à plaisir, donc n’importe quelle lecture sera valable, pour peu qu’elle paraisse inédite. Dira-t-on que si on n’autorise pas une liberté d’interprétation des textes, on brime le lecteur, on l’oblige à respecter servilement ce que les autres ont dit, donc on encourage le dogmatisme et qu’on en reste de toute façon à des platitudes ?… Pour défendre les droits de la recherche, on peut certes s’appuyer sur la célèbre assertion de Bachelard « l’opinion, en droit, a toujours tort » 4, mais c’est au risque, rarement aperçu, d’ouvrir la porte à toutes les extravagances et tous les délires de l’esprit de système. De ce que la science et la philosophie doivent assumer d’être paradoxales, on tire trop souvent la certitude que tout paradoxe est bon et que, pourvu qu’on aille contre les idées reçues, tout paralogisme est valable. Bachelard n’avait bien évidemment pas une telle absurdité en tête, mais on peut toutefois lui objecter que toute opinion n’est pas par nature anti-scientifique, si on admet par exemple qu’il y a des « opinions saines » (Pascal), ce que Bachelard n’envisage pas. Or, ce sont les gens qui ont l’esprit de système qui se rendent toujours les premiers coupables de dogmatisme, d’intolérance, par fermeture d’esprit, parce qu’ils sont obnubilés par une ou deux idées fixes, et qu’ils veulent empêcher les idées concurrentes, ou même seulement différentes, de prospérer. C’est cette mentalité systématique qui encourage si souvent le conformisme intellectuel, et qui produit à la chaîne ces ouvrages interchangeables et ennuyeux d’histoire de la philosophie, où le spécialiste doit faire assaut d’analyses pointilleuses de son auteur de référence, pour mieux cacher qu’il n’a rien à de consistant à en dire et qu’il n’en pense en fait rien.
René Pommier a décrit par le menu cette dérive, dans le champ qui est le sien, celui des études littéraires, et pour faire rempart aux élucubrations, il a toujours maintenu le lien avec l’expérience ordinaire et le sens commun. Et je crois que sans cela, il ne peut y avoir de santé de l’esprit, de vivacité, d’esprit critique, ni même de plaisir à penser. C’est un grand tort de rompre avec le sens commun, et ceux qui le font risquent fort de défendre des idées aussi massives qu’injustifiables. Par exemple, contre la psychocritique de Charles Mauron, René Pommier écrit : « Une image n’est pas nécessairement un fantasme obsédant du seul fait qu’elle se répète. Chez tous les poètes, et plus généralement chez tous les écrivains, les images ont tendance à se répéter et, si elles ont tendance à se répéter, c’est d’abord tout simplement parce que, quand on a trouvé une image et qu’on en est content, il est naturel d’essayer de s’en resservir, en la présentant, bien sûr, sous une forme un peu différente. Ce qui est vrai des images l’est d’ailleurs de tous les procédés de style et, plus généralement, de tous les schémas, de toutes les formules, de toutes les structures que les écrivains utilisent : on pourrait dire la même chose notamment pour les types d’intrigue de la comédie ou de la tragédie. Et ce phénomène n’est évidemment pas propre à la création littéraire : un musicien réutilise volontiers les mêmes cadences harmoniques, comme un peintre les mêmes combinaisons de couleurs. C’est là ce qu’oublie continuellement la psychocritique de Charles Mauron et plus généralement toute la critique qui s’inspire de la psychanalyse ou du structuralisme. On prétend expliquer par des pulsions ou des hantises, le plus souvent inconscientes, ce qui est l’effet voulu et conscient du travail créateur lui-même […] Avant de se livrer à des supputations plus ou moins aventureuses sur la psychologie profonde d’un auteur, il vaut toujours mieux commencer par essayer de se mettre sa place en tant qu’auteur, c’est-à-dire se demander ce qu’il a voulu faire et comment il s’y est pris pour le faire » 5.
Le bon sens n’est pas à lui seul la raison, mais la raison sans le bon sens ne vaut plus grand’chose. L’opinion, en droit, a peut-être tort, mais la raison philosophique, dans les faits, est très souvent bien plus folle, tant certains auteurs sont capables de défendre des théories ahurissantes, après avoir jeté tout bon sens à la poubelle, quand ce n’est pas toute décence ! On va répétant, depuis Cicéron, Montaigne et Descartes, qu’il n’ait pas une idée aberrante qui n’ait été défendue par un philosophe ; mais c’est encore trop peu dire, car il semblerait que toutes les âneries aient déjà été dites, que l’histoire ne soit qu’un éternel et stupide recommencement. Mais non ! On en invente d’autres ! Des nouvelles, des inédites, des post-modernes, des monstruosités à côté desquelles celles des opinions de tous temps passeraient pour de légers égarements : foucaultlâtries, lacanophèmes, blanchoteries, deleuzomanies, zizekations… L’attrait pour la nouveauté et les révolutions théoriques permanentes est devenu si fort, il faut si souvent fournir une nouvelle ration de sens au public, il faut si fréquemment renverser toutes les certitudes les mieux établies, qu’il faut produire à cadence accélérée des affabulations pour rassasier les consommateurs voraces de théories hermétiques.
Le héros d‘Interstellar, récent film de science-fiction de Christopher Nolan, explorera, au terme de son périple galactique, un trou noir nommé Gargantua où il plongera au coeur des quatrième et cinquième dimensions. Mais pour les explorateurs interstellaires de la pensée post-moderne (ou bien post-post-moderne…) quatre ou cinq dimensions ne suffiraient pas. Six ou sept seraient un bon début. En attendant, à cause de leurs appétits gargantuesques de concepts abscons, ils ont formé un trou noir dont l’infinie densité engloutit l’esprit de leurs lecteurs.
Sottises et fariboles
Comme l’art du médecin selon Aristote, qui peut soigner tout aussi bien qu’empoisonner, l’interprétation des textes peut donner à penser ou bien plonger l’esprit dans la confusion la plus complète, et dégoûter des auteurs, puis de la littérature en général. « Fort heureusement, écrit René Pommier, on peut tout à fait se passer de lire les fariboles rébarbatives de tous les barbacoles abscons dont se nourrit la jobardise snobinarde de notre époque. S’il n’est pas mauvais de les parcourir à l’occasion, c’est seulement parce qu’il est souhaitable de ne pas ignorer complètement les grande sornettes de notre temps. Comme celles des théologiens, leur lecture nous permet de mieux mesurer l’ingéniosité quasi infinie de la sottise humaine et parfois de nous dilater la rate avec une ânerie bien gratinée ; mais il ne faut surtout pas leur demander de nous apprendre à lire. Comment pourraient-ils nous apprendre ce qu’ils ont désappris ? » (Explications I, avant-propos).
L’erreur est sans doute inévitable : il y en a mêmes dans les meilleurs livres. Mais écrire des ouvrages qui reposent tout entier sur des hallucinations et qui ne contiennent qu’une suite d’élucubrations toutes plus invraisemblables les unes que les autres, voilà une performance d’un tout autre niveau ! René Pommier a pu consacrer toute sa thèse au Sur Racine de Roland Barthes, pour reprendre, quasiment ligne à ligne, l’ensemble des erreurs qui se trouvent dans ce livre.
Mais quel orgueil, objectera-t-on, quelle prétention faut-il pour traiter tous les autres d’imbéciles ! Mais même si cela était vrai, si René Pommier était extrêmement prétentieux, cela n’invaliderait pas nécessairement ses propos, puisqu’on peut tout à fait être vaniteux et avoir raison. On peut dire vrai sans être quelqu’un d’aimable, ou au contraire être sympathique et se tromper. Toutefois, je ne crois pas du tout que René Pommier soit le moins du monde orgueilleux (ni jaloux, reproche qu’on pourrait aussi lui faire, pour expliquer son acharnement contre des intellectuels reconnus). Il se pourrait même qu’il y ait une grande modestie derrière ces attaques contre de prétendus grands penseurs.
Lorsqu’il conteste les méthodes structuralistes, René Pommier ne souhaite pas revenir aux vieilles méthodes psychologisantes de comparaison entre l’oeuvre et l’auteur, mais il le fait car il pense qu’elles sont radicalement défaillantes. On devrait donc accueillir avec une certaine méfiance, ou au moins une certaine prudence, toute nouvelle méthode prétendant dévoiler la vérité des grands auteurs, comme si jusque là, on n’y avait rien compris. Comment l’essentiel aurait-il pu échapper aux lecteurs et commentateurs de Racine qui se sont succédé depuis plus de trois siècles ? Si le désir mimétique théorisé par René Girard était la clef de toute l’oeuvre de Shakespeare, et si la présence de ce thème était si évidente, pourquoi aurait-il échappé jusque là aux connaisseurs les plus qualifiés ? Si on n’a pas l’orgueil de croire que tout le monde s’est trompé depuis des siècles, on doit admettre qu’il est probablement impossible de dire sur un grand auteur quoi que ce soit qui n’ait déjà été dit.
« Ne craignons donc pas d’enfoncer des portes ouvertes puisque tant d’autres prétendent les condamner : expliquer un texte consiste à essayer de se mettre à la place de l’auteur, à se demander ce qu’il a voulu dire et comment il s’y est pris pour le dire, à tenter de reconstituer son travail. C’est une activité qui a nécessairement quelque chose, sinon d’ingrat, du moins de subalterne. Il ne s’agit pas de rivaliser avec une œuvre, mais de la mettre en valeur ; il ne s’agit pas de s’en servir, mais de la servir, en sachant bien que tout ce qu’on peut faire pour elle est bien peu de chose par rapport à ce que l’auteur lui-même a fait. Car un écrivain digne de ce nom ne compte que sur lui-même pour se faire comprendre. Il n’écrit pas pour être décrypté par les critiques, mais s’adresse directement à ses lecteurs » 6.
Opposé à cette croyance académique dans la richesse infinie des oeuvres, qui devraient sans limite donner matière à interprétations, René Pommier soutient donc qu’on peut épuiser le sens d’un texte, et que les plus célèbres le sont déjà certainement. En effet, un auteur n’a pas écrit pour alimenter le mouvement perpétuel de la machine à gloses, mais pour être compris des lecteurs honnêtes. Il serait donc illusoire de soutenir qu’une oeuvre n’est géniale qu’à condition d’être inépuisable. (Il n’y a peut-être que le « livre à venir » sur lequel fantasmait Blanchot qui serait indéfiniment interprétable, mais ce livre, qui seul sauverait les adeptes de la profondeur et de l’absence, ne viendra jamais car personne ne l’écrira).
L’interprétation ne peut pas être infinie, ni même indéfinie. Après s’être ouvert à la richesse du sens des textes, le critique doit résister à y voir une profondeur insondable, et parvenir à cloturer sa recherche, faute de quoi elle ne fera plus qu’obscurcir les textes. Après avoir laissé toute sa chance à l’herméneutique, il faut réduire les sens possibles et parvenir à une lecture la plus vraisemblable possible. Pour le dire simplement, il n’y a pas cent façons possibles de lire Proust. Même le génie, loin d’être « abyssal », peut être compris et c’est le travail du critique de nous y aider -mais sans se substituer ni à l’auteur ni au lecteur. Son rôle n’est pas de proposer des idées nouvelles mais des lectures justes, et c’est pourquoi son travail consiste au bout du compte en une paraphrase bien faite du texte. D’où la modestie de sa tâche. Or, cette connaissance des auteurs lui donne aussi la légitimité pour combattre les délires interprétatifs. Et certes, René Pommier n’est pas philosophe, et n’a aucune prétention à l’être, lui qui se refuse totalement à avoir des idées, mais son rationalisme sceptique est toutefois assez recommandable aux philosophes.
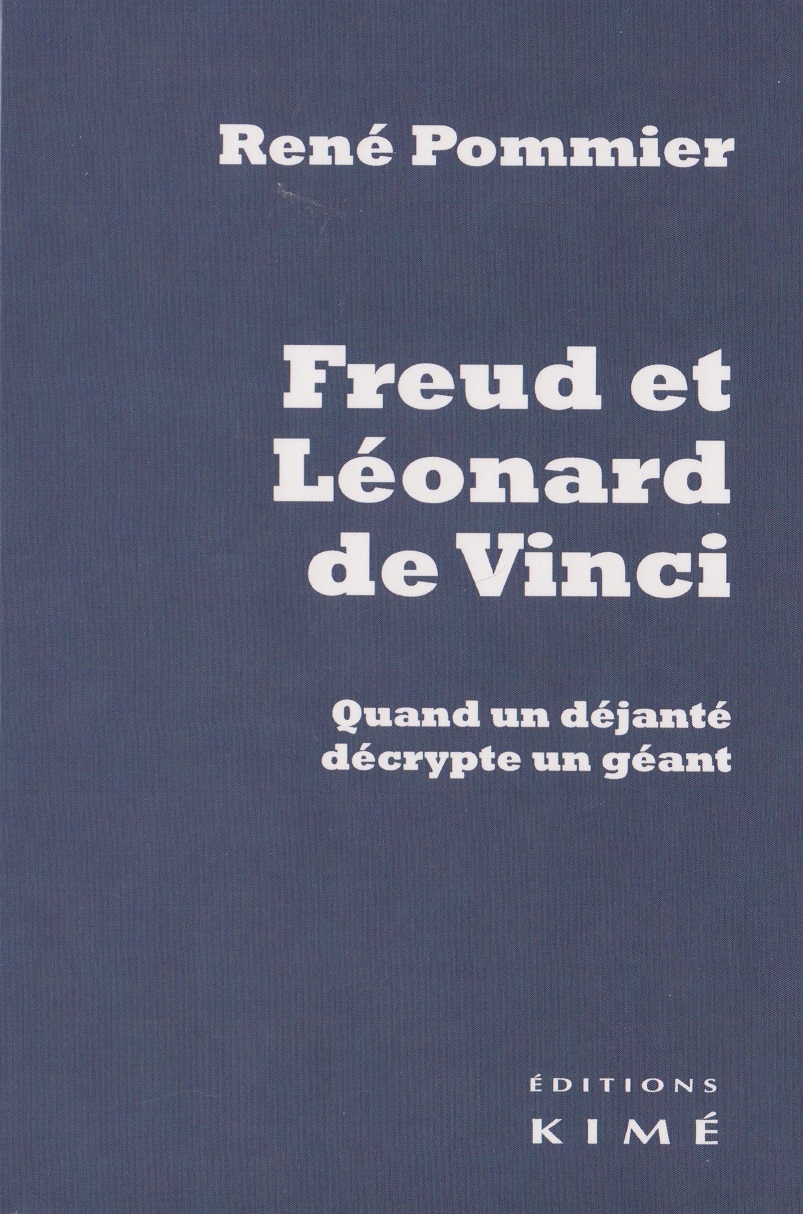
Salades et salmingondis
Cette tradition, trop peu prestigieuse, de déboulonnage des idoles, avait retrouvé toute sa vigueur en 2010 avec l’ouvrage de Michel Onfray, Le crépuscule d’une idole. L’affabulation freudienne et la bouillante polémique qu’il avait provoquée ; mais c’est pourtant René Pommier qui avait ouvert le bal (tragique !) deux ans plus tôt, avec un ouvrage intitulé Sigmund est fou et Freud a tout faux, consacré à l’étude des rêves en psychanalyse. En 2014, l’auteur remet le couvert, avec Freud et Léonard de Vinci. Quand un déjanté décrypte un géant 7 (ouvrage d’ailleurs dédié à Michel Onfray). René Pommier y mène une lecture linéaire de Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci et on peut dire qu’après ce livre, il ne reste pas pierre sur pierre de la grande théorie élaborée par Freud sur l’origine du génie de Léonard. Que ce soit les hypothèses ou les faits rapportés, René Pommier montre que tout est faux.
« L’insistance avec laquelle Freud souligne chez Léonard la quasi-absence de vie sexuelle ne laisse pas d’être a posteriori bien déroutante. Pour expliquer un de ses souvenirs d’enfance, il va s’ingénier, en effet, à échafauder une interprétation très complexe qui fait continuellement appel à des hypothèses de naturelle sexuelle. Mais, si Freud ne craint pas de relever et même de souligner le fait que Léonard de Vinci semble n’avoir quasi jamais eu de véritable vie sexuelle, c’est parce qu’il est persuadé d’avoir trouvé l’explication de cette apparente anomalie. Certes, il aurait pu se dire qu’il n’y avait pas lieu de chercher une explication ; il aurait pu se dire que, de même qu’il y a des hommes qui sont grands, d’autres qui sont de taille moyenne et d’autres qui sont petits, de même il y a des hommes qui ont de grands besoins sexuels, d’autres qui n’en ont que de modérés, et d’autres enfin qui en ont peu. Ils sont très peu nombreux, mais il y a même des gens qui n’ont pas du tout ou pratiquement pas de désirs sexuels. Léonard de Vinci en faisait apparemment partie. Mais Freud ne pouvait l’admettre : il lui aurait fallu renoncer à un dogme aussi fondamental dans sa théorie que celui du péché originel dans la théologie chrétienne, l’absolue primauté de la vie sexuelle chez l’animal humain.
Heureusement, Freud n’est jamais à court d’explications lorsqu’il se trouve en face d’un fait qui ne cadre pas avec sa théorie ou lorsque, au contraire, le fait qui devrait se produire ne se produit pas. Il a, en effet, mis au point des outils conceptuels d’une admirable simplicité et d’une merveilleuse efficacité qui lui permettent d’expliquer à chaque fois que ce qui est et qui ne devrait pas être, en réalité, n’est pas et que ce qui devrait être et qui n’est pas, ne laisse pourtant pas d’être. Le premier de ces outils mirobolants est, bien sûr, le refoulement si commode pour expliquer à un patient qui prétend n’avoir jamais ressenti les pulsions qui sont, selon Freud, à l’origine de tous ses problèmes, qu’il les a tout simplement refoulées dans le fond de son inconscient et qu’il les a d’autant plus refoulées qu’elles étaient plus fortes » 8.
De même, factuellement, Freud a tout faux. L’étude des sources montre d’abord que le fameux vautour mis en avant par le psychanalyste était en réalité un milan, et que Freud a tout fait pour le cacher, afin de faire passer en force ses idées. Il fallait à tout prix que le rapace qu’il voyait dans la robe de la vierge fût un souvenir d’enfance inconscient, et que cette découverte livrât la clef du génie de Léonard. Toujours en ce qui concerne les faits, Léonard n’a pas non plus été excessivement soumis à sa mère, contrairement à ce qu’affirme Freud, puisque celle-ci l’a vraisemblablement abandonné très tôt à son père. Tout le reste est à l’avenant : en parlant de Léonard, Freud ne propose qu’une suite d’élucubrations et d’inventions personnelles, étayées par des sottises encore plus énormes et des associations d’idées parfaitement farfelues. « Quelle salade, quel salmigondis ! » 9, s’exclame René Pommier. En prêtant aux enfants une sexualité complexe et toutes sortes de désirs inconscients, Freud projette ses propres fantasmes sur de jeunes êtres qui n’en demandaient pas tant. Et plus ses propositions sont faibles, plus il doit les enrober dans un vocabulaire d’apparence technique, propre à égarer le lecteur ignorant, et à épater ceux que René Pommier appelle volontiers les jobards.
C’est toute la grande idée de Freud qui s’écroule : le génie artistique n’est pas nécessairement une sublimation réussie des pulsions sexuelles. La théorie, si cohérente au premier abord, n’était qu’une construction de l’esprit : elle serait brillante si elle concernait un tant soit peu Léonard. Mais en l’état, elle ne nous apprendra rien sur l’auteur de la Joconde, ni même sans doute – et c’est plus grave –sur la sexualité ni l’inconscient. Cet essai sur Léonard a pour seul intérêt, selon Pommier, d’être un condensé de toutes les aberrations freudiennes : « Il y a donné toute la mesure de ses immenses déficiences intellectuelles ; son génie de l’ineptie s’y déploie pleinement ; on peut y admirer toutes les principales facettes de sa folie ; on y trouve un très riche concentré de ses sornettes les plus chères. Les mensonges, les falsifications, les erreurs, les extrapolations les plus extravagantes, les hypothèses les plus dénuées de fondement, les absurdités les plus aberrantes s’y succèdent sans discontinuer. A la différence de Léonard de Vinci, Freud n’est pas un génie, encore moins un géant : c’est un déjanté et la psychanalyse, dont il est le père, est une monstrueuse construction intellectuelle, totalement arbitraire et parfaitement absurde, qui ne peut séduire que des esprits tordus » 10.
Il faut lire ce livre car, en une bonne centaine de pages, l’auteur a su dire l’essentiel sur cette sottise savante qui outrepasse toutes les extravagances du sens commun.
- Préface de Assez décodé !, Roblot, 1978 ; Nouvelle édition Eurédit 2005
- Je dois dire que j’ai moi-même eu recours, dans mes premières années d’enseignement de français, à ce fatras de notions pseudo-scientifiques, tels que le champ lexical ou le champ sémantique. Néanmoins, pas complètement intoxiqué par les « jobarthises » et autres genetteries, qui dès l’hypokhâgne m’avaient horripilé, j’ai su épargner à mes élèves les plus aberrantes d’entre elles, comme ces subtiles distinctions entre narrateur interne, focalisation zéro, narrateur hétérodiégétique et autres joyeusetés sorties de l’imagination des pires jargonneurs universitaires. Il me paraissait évident que les bénéfices – presque inexistants – retirés de l’usage de ces notions ne vaudraient jamais les efforts – sisyphiens – à fournir pour les comprendre.
Outre que ces concepts brouillent la compréhension des textes, ils ne permettent en rien d’en apprécier la qualité. Ils font partie de cette tendance au rejet de la littérature, qui passe par un nivellement de tous les textes : un éditorial de journal comme un sermon de Bossuet peuvent par exemple être rangés dans la même case, celle des « discours argumentatifs ». La neutralité de ces classements est évidemment catastrophique, car elle ne prend aucunement en compte la valeur intrinsèque de l’oeuvre : à la limite, tout se vaut. Une recette de cuisine ou une page de Zola sur les vendeuses des grands magasins sont « des discours explicatifs ». Mais j’imagine que c’est parce que toute discrimination est une abomination, que toute idée de hiérarchiser les oeuvres selon qu’elles sont nulles, mauvaises, talentueuses ou géniales est profondément anti-démocratique… Chacun a en effet bien le droit d’aimer ce qu’il veut, et ce serait lui faire une violence intolérable que d’oser mettre en question ses (mauvais) goûts. Tandis que l’emploi d’un jargon structuraliste permet de se dispenser presque complètement d’étudier les oeuvres et de les apprécier à leur juste mesure. Il n’y a qu’à plaquer les bons mots-clefs et le travail est fait.
A ce sujet, je me souviens de la mine déconfite de certains formateurs de l’IUFM, le jour de la sortie des nouveaux programmes de 4e : on réintroduisait l’étude obligatoire de Molière et Perrault ! On citait nommément des classiques ! On n’avait plus le droit de passer l’année à faire de la littérature de jeunesse !… Pire : on ignorait superbement les notions mises au point par les experts en science de l’éducation ! C’était une victoire de la « bande à Brighelli »… Pour ma part, j’avais déjà commencé à jeter par-dessus bord tout ce bagage « théorique », après m’être aperçu que je n’y comprenais décidément rien, et que je n’avais pas le droit d’infliger cela aux oeuvres de Flaubert ou Zola. Et de ce jour, les élèves, étrangement, ont beaucoup mieux compris… Je crains néanmoins que de nombreux collègues de lettres ne continuent, aujourd’hui encore, à se passionner pour les « champs sémantiques » et les discours « ancrés dans la situation d’énonciation ». Ce sont eux qui gagneraient le plus à lire René Pommier. Ils comprendraient grâce à lui à quel point tous ces infatigables bavards qui dissertent à plaisir sur la littérarité des textes ne comprennent littéralement rien à la littérature, sans doute parce que dans le fond, ils ne l’aiment pas, quoi qu’ils passent leur carrière à « théoriser » à son sujet, sous le coup d’une passion aussi puissante qu’inexplicable. - Assez décodé, chapitre 2, « Sur le sonnet d’un sot les sornettes des doctes ».
- Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, page 14.
- « Phantasme, où es-tu ? (sur deux vers d’Apollinaire) », in Mélanges en l’honneur de Jean-Paul de Nola, Edizioni Mazzotta, 2004, pp. 63-69
- Explications I, avant-propos
- Freud et Léonard de Vinci. Quand un déjanté décrypte un géant, Kimé, 2014.
- Pages 11-12.
- Page 17.
- Pages 116-117.