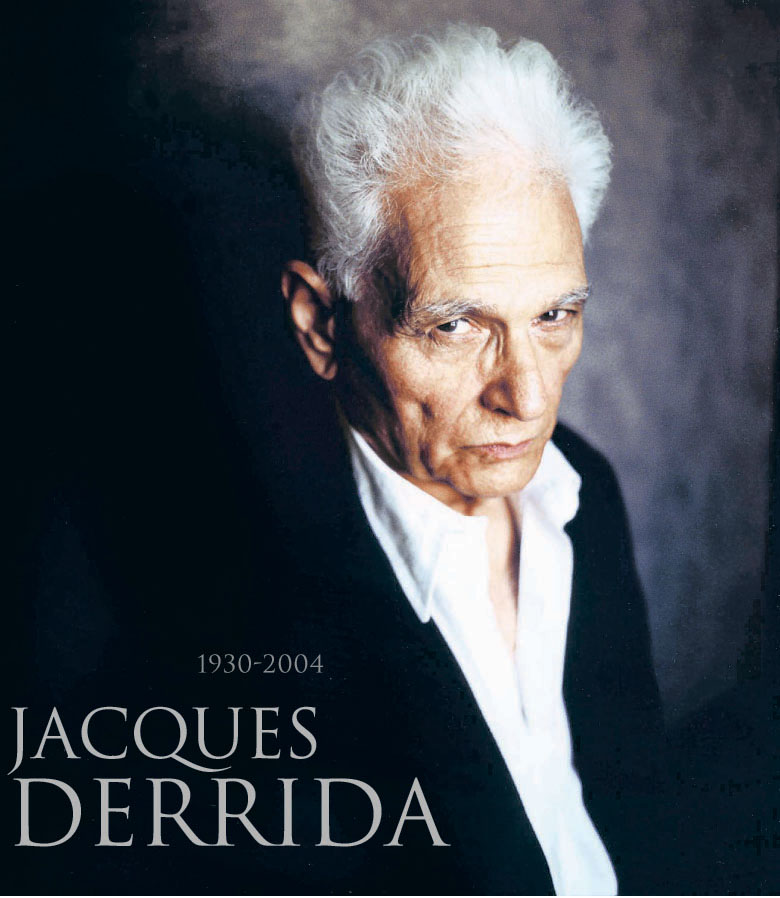Raoul Moati, collaborateur régulier de notre site, a récemment fait paraître aux PUF une analyse serrée du débat qui eut lieu entre Derrida et Searle, autour du problème de la communication, et dans les années 70 ; mais ce débat entre ces deux géants de la philosophie contemporaine s’organise en réalité dans le cadre d’une relation triangulaire, où Austin apparaît comme l’objet même du débat, et c’est au fond le problème de la production du sens, à partir des travaux d’Austin, qui se trouve interrogée. Toutefois, bien que le débat entre Derrida et Searle ait été effectif par la matérialité des textes qui furent édités, Raoul Moati s’interroge dès son introduction sur la possibilité d’un tel débat qui revêt l’apparence d’un « dialogue de sourds, tant les outils d’analyse mobilisés par chacun des protagonistes s’enracinent dans des héritages conceptuels – phénoménologie et psychanalyse pour Derrida, philosophie de la logique et pragmatique de l’ordinaire pour Searle. »1 En d’autres termes, le choc tant attendu entre les représentants de chacune des deux traditions philosophiques semble à la fois inévitable et irréalisable : inévitable, parce que les incompréhensions de chacun à l’égard de l’autre sont immenses ; mais irréalisable parce que les paradigmes dans lesquels Searle et Derrida ne semblent pas pouvoir se rejoindre, de sorte que la possibilité de parler d’un même objet n’est en rien assurée. Raoul Moati remarque d’ailleurs que Derrida et Searle ont eux-mêmes constaté « l’insurmontable incompatibilité de leur démarche philosophique respective. »2 Devant ce constat d’impossibilité, surgit aussitôt une question : est-ce qu’Austin ne pourrait pas, malgré tout, constituer quelque chose comme un terrain commun sur lequel pourraient s’affronter les deux philosophes ? D’une certaine manière, Raoul Moati consacre son livre à cette question, et apporte une réponse nuancée, où se croisent tout à la fois les mécompréhensions réciproques de Derrida et Searle et leurs fulgurances philosophiques rappelant que nous avons affaire, malgré leurs limites dans le cadre de ce présent débat, à deux très grands penseurs.
I : L’écriture derridienne comme spécificité communicationnelle
1°) La thèse austinienne et sa simplification derridienne
La première partie du livre, que Raoul Moati intitule « l’envers itératif du performatif », est essentiellement consacrée à Derrida ; il s’agit pour Moati de comprendre comment Derrida a réinterprété la pensée de la communication présente chez Austin, et surtout de faire jouer l’intelligibilité derridienne de ce phénomène de manière différentielle avec la saisie de Searle de cette même communication ; ainsi, Derrida et Searle proposent « deux conceptions divergentes d’un même phénomène : la communication. »3 Avant de décrire la pensée de Derrida, Raoul Moati procède toutefois à un fort opportun rappel de la pensée d’Austin, ce qui d’ailleurs confère à cet ouvrage le statut d’une précieuse initiation au langage ordinaire : il est en effet inutile de connaître quoi que ce soit de la pensée d’Austin ou de Grice pour comprendre les thèses que développe Raoul Moati, tant ce dernier restitue avec patience et talent ces deux pensées, et permet d’en comprendre la réarticulation qu’en proposent Searle et Derrida ; je ne saurais donc trop insister sur ce point : l’ouvrage de Raoul Moati ne s’adresse pas – uniquement – aux spécialistes d’Austin, il constitue bien plutôt une initiation à cette philosophie, et la clarté des analyses qui y sont menées permet à tout un chacun de comprendre la visée de l’ouvrage. La thèse d’Austin, donc, pour la résumer, pourrait être ainsi énoncée : il n’y a pas de sens en soi, le sens ne prend son sens, si l’on peut dire, qu’en fonction du contexte, de l’usage, et des circonstances. « Il n’y a donc pas, explique Raoul Moati, dans la perspective du langage ordinaire d’univocité acquise des énoncés ni de leurs termes (…). »4 Comprendre un énoncé, ce n’est pas chercher à comprendre le sens en soi d’un mot, mais comprendre les usages qui en sont faits, et revenir aux circonstances effectives de production de l’énonciation qui orientent la production du sens vers les « forces pragmatiques » thématisées par Austin.

La première question qui vient alors à l’esprit est la suivante : est-ce que ces forces pragmatiques ne concernent que les circonstances volitives de celui qui produit l’énoncé, ou doivent-elles aussi intégrer un domaine conventionnel, extérieur à la volonté du sujet ? Cette question est cruciale car si la production de l’énoncé demeure exclusivement tributaire de la volonté subjective, alors la thématisation austinienne de la communication se verrait aussitôt ramenée, à juste titre, à une métaphysique de la présence, où l’énoncé exprimerait un « vouloir dire ». Cette idée d’une réduction exclusive des forces pragmatiques à la volonté subjective, c’est celle que défend Derrida dans son interprétation d’Austin. Or, ce dernier, comme le remarque Raoul Moati, n’opère pas une pareille réduction, dans l’exacte mesure où les forces pragmatiques se déploient tant sur le plan volitif que conventionnaliste ; en oubliant ce dernier aspect, Derrida écrase les différences internes aux forces pragmatiques et Searle aura beau jeu de lui montrer le lieu de sa mécompréhension d’Austin. Ainsi, l’oubli des différents étagements des forces pragmatiques par Derrida constitue le point aveugle de son analyse et offre à Searle une force de frappe tout aussi efficace que facile.
2°) Quelle est la spécificité de l’écriture chez Derrida ?
Après avoir montré cette erreur de lecture opérée par Derrida, Moati s’attarde sur le problème de l’écriture : qu’en est-il de l’écriture dans la perspective communicationnelle ? Y a-t-il une spécificité de l’écriture ? Cette question de l’écriture, rattachée à la problématique austinienne de la communication, constitue en fait l’occasion pour Raoul Moati de présenter et d’analyser d’une manière remarquablement claire, la façon dont Derrida a pensée l’écriture en sa spécificité, et c’est finalement à un parcours du premier Derrida que nous convie l’auteur avec un bonheur certain. L’écriture, nous le savons, à la différence de la parole, impose un temps différé entre la production du texte et sa réception ; mieux que cela, la lecture, à la différence de l’oralité, ne suppose pas une production de sens qui lui soit contemporaine, de sorte que se trouve brisée la coïncidence de la production de sens et sa réception. Dans ces conditions, la question devient très simple : l’écriture n’est-elle qu’un mode dérive de l’oralité, ou, en vertu de cette réception différée, constitue-t-elle quelque chose d’absolument spécifique ? La réponse de Derrida est célèbre : l’écriture désigne une spécificité qui ne saurait en rien être pensée à partir de l’oralité, ce que Raoul Moati exprime ainsi : « Cette non-contemporanéité de l’intention par rapport aux signes restant autrefois mobilisés dans la présence, représente la spécificité de l’écriture. Or cette spécificité reste impensée par la théorie communicationnelle de l’écriture, qui conçoit illusoirement la communication écrite comme le prolongement de la communication orale. »5 Ainsi Derrida nous invite-t-il à cesser de penser l’oralité comme le mode privilégié de production du sens, et propose-t-il de penser l’écriture dans sa spécificité même, c’est-à-dire comme perte ou comme absence de la présence d’un vouloir-dire contemporain à la réception qui en est faite dans la lecture. « Par la prise en compte d’une textualité mortifiante en amont de la parole, il va s’agir de déconstruire la centralité phonologique de la métaphysique, réprimant le motif de l’écriture comme absence, et perte irréversible de la présence continuée du vouloir-dire. La démarche déconstructrice propose ainsi de déstabiliser de l’intérieur le dispositif « logocentrique » propre à la métaphysique, comme métaphysique de la présence, et à la conception aseptisée de l’écriture qui en découle. »6
Mais à quoi servent ces réflexions derridiennes dans le cadre du débat qui est le nôtre, à savoir celui de la communication ? Il me semble que le problème est très clair et pourrait ainsi s’énoncer : est-ce que la spécificité de l’écriture, c’est-à-dire cette absence du vouloir-dire, perturbe ou, plus simplement, influe sur la question de la communication ? Autrement demandé, la communication est-elle affectée par la forme même de l’écriture, comme absence du locuteur ? Derrida affirme que l’essentiel de la tradition philosophique n’a pas accepté la dimension perturbatrice de l’écriture dans le cadre communicationnel, et il s’appuie pour le justifier sur un texte de Condillac, pour lequel l’écriture n’a aucune incidence sur la transmission de l’information que constitue la communication. Inversement, aux yeux de Derrida, il convient au contraire de penser cette perturbation dans le cadre communicationnel, c’est-à-dire penser l’absence du locuteur et ses incidences dans la communication elle-même. Penser réellement l’écriture, c’est donc penser la scission entre le signe et la présence, c’est penser ce signe qui ne présente pas celui qui le produit, « c’est accepter la dissémination du signe dans son débordement sur la maîtrise présente. »7 Que pouvons-nous alors en conclure quant à la visée communicationnelle d’un texte ? Que signifie le fait qu’un texte soit lisible, alors même que l’auteur de ce texte est mort, et que le destinataire contingent du texte n’est pas celui visé par l’auteur ? Cela signifie, aux yeux de Derrida, que la lisibilité du texte ne saurait être ramenée à sa fonction communicationnelle ; qu’un texte puisse encore être lu par quelqu’un qui n’en est pas le destinataire, et sans que l’auteur soit encore en vie ou tout simplement présent, cela est la marque même d’une lisibilité extérieure à la visée communicationnelle du texte, de sorte que ce ne soit pas l’intention de l’écrivain qui préside à la lisibilité, mais bien plutôt l’itération elle-même qui définisse la lisibilité du texte. « La lisibilité du texte se définit moins par le message qu’il aurait à transmettre initialement, donc par l’intention qui l’anime, que par une itérabilité constitutive. »8 Pour le dire clairement, l’écriture ne repose pas sur l’intention mais sur l’itérabilité. « L’écriture pèse sur le fonctionnement du langage, de sorte que la parole intentionnelle dérive de la textualité et non plus l’inverse. »9
Ce à quoi invite Derrida, c’est donc à une pensée du signe détaché de son origine locutoire, et ramené à sa trace graphique : le lecteur a face à lui non pas une intention, mais bien plutôt un signe graphique, ce graphe étant une trace d’un vouloir-dire différé, et cette trace se réitère indéfiniment, sans qu’il ne soit possible d’assigner à celle-ci un commencement, ni une fin. L’écriture charrie en elle-même la disparition des bornes de sa communication ; la trace écrite ne permet pas de dire quelle fut l’origine ni quelle sera la fin de son itérabilité, de sorte que l’itérabilité constitue bien cela même qui décide du mouvement de l’écriture, et ce au détriment du primat du vouloir-dire. « Il ne faut donc pas penser la répétition comme dérivée de la présence, mais plutôt penser la présence comme un effet de la répétition. »10
3°) La thématisation derridienne de l’écriture porte-t-elle contre la pensée austinienne de la communication ?
La question qui se pose alors me semble être la suivante ; cette critique de la communication écrite que propose Derrida, atteint-elle la thématisation austinienne de la communication ? Elle ne pourrait l’atteindre que si Austin avait fait de la force pragmatique un phénomène exclusivement volitif et avait donc introduit, de manière exclusive, le vouloir-dire dans l’acte communicationnel ; or, ainsi que Raoul Moati le rappelle clairement, Austin convoque également, et de manière très nette, la dimension conventionnelle du sens, ou pour le dire avec Moati, « l’adéquation de l’usage des mots aux circonstances requises par les conventions. »11 L’oubli de cette deuxième dimension du sens par Derrida affaiblit considérablement la portée de la dimension polémique des analyses de ce dernier, lorsqu’il s’agit de commenter Austin. En d’autres termes, la critique derridienne ne porterait pleinement contre Austin que si ce dernier avait réduit les forces pragmatiques à l’œuvre dans la communication aux circonstances subjectives de la production du sens ; or, en les élargissant aux conventions, Austin échappe par avance à la critique derridienne et condamne celle-ci à demeurer inopérante à sa propre encontre. L’acte, chez Austin, peur ainsi se réaliser même si mon intention ne l’accompagne pas puisque ce sont les circonstances extérieures qui en permettent la réalisation, ce qui signifie clairement que l’intention austinienne ne se présente pas comme transcendantale.
Au fond, ce que révèle cette lecture, c’est que Derrida ne pense pas la différence entre deux types de productions d’énoncés : le perlocutoire et l’illocutoire. Pour le dire clairement, Derrida fait comme si Austin s’était contenté d’une pensée perlocutoire qui désignerait l’intention de provoquer des effets chez le destinataire ; et ce faisant, Derrida manque la dimension illocutoire et conventionnelle de la communication, ce qui permettrait à celui-ci de ramener Austin à une pensée subjectiviste afin de le faire tomber sous le coup de la critique d’une métaphysique de la présence. On peut donc dire que Derrida naturalise l’illocutoire austinien afin de le ramener en terrain connu et de le subsumer sous sa propre analyse de l’écriture.
Cette première partie propose donc une restitution remarquable de la pensée derridienne de l’écriture, et des subtilités de la communication austinienne ; or, ainsi que cela apparaît clairement, Searle est relativement peu présent dans cette première partie, de sorte que l’on s’attend à ce que la seconde lui soit entièrement consacrée, tout comme la première était centrée sur Derrida ; ce n’est pas pourtant pas exactement ce qui va se produire car, même si Searle sera certes plus présent qu’il ne l’était dans la première partie, ce sera toujours à travers le prisme derridien que seront pensées les analyses de Searle, de sorte que, à mon sens, tout l’ouvrage de Raoul Moati demeure une analyse de Derrida, dont les critiques de Searle constituent un moyen de cerner avec davantage d’acuité la pensée de l’auteur de l’Ecriture et la différence.
II : Le débat Searle-Derrida comme révélateur des impensés derridiens
Searle rassemble les arguments derridiens en deux grandes thèses : d’une part l’écriture fonctionne en l’absence du locuteur, et rompt avec la logique du vouloir-dire ; et d’autre part, l’écriture représente la modalité privilégiée du fonctionnement du langage. La simple manière dont Raoul Moati présente ce problème montre bien qu’il s’agit pour lui de penser Derrida à travers Searle. C’est moins un débat Searle / Derrida qui va nous être présenté qu’une question que l’on pourrait ainsi énoncer : en quoi Searle aide-t-il à mieux comprendre Derrida ? Cela me semble assez clair, compte tenu de l’omniprésence de ce dernier dans la partie consacrée à Searle, alors que celui-ci était pratiquement absent dans celle consacrée à celui-là. Ainsi, il me semble que Raoul Moati se demande comment Searle pense Derrida, plus qu’il n’interroge ce que pense Searle de manière générale.
Searle commence par réfuter l’idée selon laquelle l’itérabilité soit constitutive de l’écriture ; elle constitue bien plutôt à ses yeux, la marque même de tout langage. Toute procédure linguistique conventionnelle est structurellement itérable, sans quoi il n’y aurait plus de règles d’usage du langage. L’itérabilité ne s’applique donc pas en particulier à l’écriture. Puis, Searle propose une distinction entre type et occurrence : le type est un usage réglé qui s’applique à des occurrences nouvelles. Mais cette distinction proposée par Searle apparaît aux yeux de Moati comme la marque même de l’impossibilité du débat entre Searle et Derrida : Searle cherche à penser l’écriture comme phénomène courant, tandis que Derrida thématise celle-ci dans une perspective très singulière. « Searle cherche à montrer de quelle manière Derrida généralise les traits spécifiques de l’écriture à tout langage, sans que les critères qu’il mobilise ne puisse former un ensemble de prédicats spécifiques à l’écriture. Le problème, c’est ce que nous comprenons au fur et à mesure de la lecture de Sec, reste que Derrida généralise un concept d’écriture qui n’a rien de directement commun avec le concept philosophique classique d’écriture que mobilise Searle d’où la mécompréhension de ce dernier. »12 Encore une fois, ce que Moati pointe ici, c’est la mécompréhension de Searle à l’égard de Derrida, ce qui me semble témoigner du fait que Derrida demeure le personnage principal de l’ouvrage, malgré les nuances qu’il faudra apporter à ce jugement. Toutefois, ces critiques de Searle donnent l’occasion de préciser un point concernant l’absence inhérente à l’écriture : Searle refuse que cette absence soit constitutive de l’écriture ; mais encore faut-il se mettre d’accord sur la modalité de cette absence ; Searle croit qu’il s’agit d’une absence nécessaire, alors que Derrida, selon Moati, pose qu’il y va d’une possibilité, c’est-à-dire que tout acte d’écriture contient constitutivement, la possibilité de porter une absence, mais cela ne signifie pas qu’il soit nécessaire que cette absence soit effective dans le texte. Ainsi, « cette possibilité affecte de l’intérieur toute marque, de sorte qu’une marque émise même en présence du locuteur demeure soumise à cette possibilité d’en être détachée. La possibilité de l’absence ne saurait être écartée (…). »13
Une autre critique de Searle porte sur la confusion qu’opèrerait Derrida entre itérabilité et permanence ; c’est la permanence pour Searle qui explique le détachement de l’énonciation par rapport à son origine productrice, pas son itérabilité. Mais là encore, Raoul Moati va montrer que Searle mésinterprète Derrida, ce qui revient une fois de plus à faire de ce dernier l’objet premier de ses propres analyses et donc à poser la question suivante : comment Searle a-t-il compris Derrida ? Pas nécessairement de la meilleure des manières car il se trouve que nulle part, Derrida ne parle de la permanence, et que Searle introduit par conséquent un concept extérieur à la pensée derridienne ; de ce fait, il ne semble pas probant que sur ce terrain non plus, ait lieu un débat réel.
Le nerf du problème semble atteint avec le problème du graphe ; Derrida appelle « graphématique » tout ce qui fait irruption dans le langage comme non-présence et comme différence. Naturellement, pour admettre cette définition, il faut admettre en amont toute l’analyse derridienne du langage comme étant doué d’une prétention téléologique et apophantique ; or il se trouve que Searle refuse une telle réduction du langage à la téléologie apophantique de sorte que les critiques de ce dernier à l’encontre du graphe portent non pas sur le graphe mais sur les présupposés ultimes de la pensée derridienne ; d’une certaine manière, Searle s’en prend à la conception même de l’écriture de Derrida par le biais d’une critique de sa lecture d’Austin. Austin devient ainsi le prétexte d’un désaccord plus profond, dont les racines courent jusqu’aux plus ultimes fondements de la pensée derridienne. « C’est pourquoi lorsque Searle affirme que Derrida confond itérabilité et écriture, cet argument pourrait fonctionner aussi contre la définition derridienne de l’écriture (…). »14 On ne peut donc pas dire, remarque Moati, que Searle commet un contresens sur la pensée derridienne, il ne fait qu’en refuser les fondements ou les présupposés. Ainsi, ce que Searle refuse très clairement chez Derrida, c’est l’idée même d’une absence irréversible : en droit, il est toujours possible de remonter à l’intention, ce qui revient à dire qu’une telle absence « ne menace en rien le procès de l’intentionnalité qui pourra toujours reprendre le dessus dans une reformulation adéquate systématiquement possible (…). »15 Il ne peut pas y avoir d’indétermination intentionnelle de l’énoncé et c’est là au fond que les deux auteurs divergent. La force des analyses de Raoul Moati consiste ainsi à restituer l’origine même de la mécompréhension entre ces deux auteurs, et de la divulguer par de remarquables reconstructions du débat, qui clarifient avec brio certains points parfois obscurs de la pensée derridienne – et, dans une moindre mesure, de la pensée de Searle.
Là où le débat devient passionnant, c’est lorsque Raoul Moati explique le sens de la démarche de Searle : ce dernier détache l’intention du contexte et donc sépare l’intention de la présence, intention que Derrida identifie évidemment à la présence. Aux yeux de Moati, donc, le véritable drame se joue ici : peut-on, oui ou non, détacher l’intention de la présence ? Il est clair que si tel est bien le cas, alors l’essentiel des analyses de Derrida, que ce soient celles de La voix et le phénomène, celles de Marges, ou de De la grammatologie, reçoivent un coup qui pourrait leur être fatal. Mais encore une fois, il convient de remarquer que le problème est tout entier derridien : il s’agit moins, comme je l’ai dit, de penser Searle pour lui-même, que de se demander ce que Searle apporte à la lecture de Derrida ; le drame que restitue ici Moati avec talent est clairement orienté vers une problématique qui pose Derrida comme principal protagoniste de son ouvrage. Quelle peut être alors la solution de ce dernier pour immuniser sa propre pensée ? Il va lui falloir montrer que Searle, en pratiquant pareil découpage, est insuffisamment austinien et que la séparation de l’intention et du contexte constitue une trahison à l’égard d’Austin. Cela est amusant, car dans Signature, événement, contexte16, Derrida avait justement tout fait pour montrer les insuffisances d’Austin ; mais acculé par Searle, Derrida se voit dans l’obligation de jouer Austin contre Searle pour se sortir d’un mauvais pas. « C’est pourquoi Derrida ici joue l’austinien orthodoxe indigné ; défendre Austin contre Searle devient un ultime recours pour maintenir sa propre interprétation. »17
Suivent quelques débats de moindre importance, notamment autour de la distinction entre un discours sérieux et un discours non sérieux ou sur l’inconscient ; mais le nerf du problème, me semble-t-il, c’est cette possibilité de détacher la présence de l’intention que soulève Searle et qui, si elle est avérée, pourrait terrasser un grand nombre d’analyses derridiennes. Le livre de Raoul Moati est donc brillant, clair et extrêmement instructif quant aux présupposés de ce débat entre ces deux auteurs. Certes, il s’agit d’un livre « derridacentrique », au sens où il me semble que Raoul Moati conserve comme protagoniste essentiel du débat Derrida, dont Searle n’est finalement que celui qui vient révéler la profondeurs et les limites de son adversaire ; en d’autres termes, Searle sert de moyen à une meilleure compréhension de Derrida, et là pourrait être l’éventuelle limite du livre de Raoul Moati, en ce qu’il présenterait moins un débat pour lui-même qu’il n’utiliserait Searle pour présenter la pensée d’un autre auteur ; pour autant, les analyses demeurent extrêmement brillantes, et il serait parfaitement illusoire d’exposer en si peu de pages et la pensée de Derrida et celle de Searle ; par conséquent, il est probable que l’ouvrage gagne en clarté en se concentrant sur l’un des deux protagonistes, et ce d’autant plus que l’honnêteté de Raoul Moati est totale : aucun des problèmes derridiens soulevés par Searle n’est passé sous silence, et même si Derrida incarne le « héros » du livre, il apparaît avec toutes ses faiblesses, voire même avec une pointe de mauvaise foi lorsqu’il lui faut rejouer Austin contre Searle pour se sortir des critiques de ce dernier. Seul petit bémol à ce très bel ouvrage : il manque une bibliographie finale, qui permettrait d’embrasser d’un coup d’œil les références utilisées au cours du livre, et qui permettrait d’en constater la grande richesse tout en offrant au profane une piste de recherches synthétique.
- Raoul Moati, Derrida / Searle, Déconstruction et langage ordinaire, PUF, coll. Philosophies, 2009
- Ibid. p. 7
- Ibid. p. 20
- Ibid. p. 24
- Ibid. p. 33
- Ibid. p. 38
- Ibid. p. 42
- Ibid. p. 44
- Ibid. p. 49
- Ibid. p. 53
- Ibid. p. 55
- Ibid. p. 96
- Ibid. p. 98
- Ibid. p. 105
- Ibid. p. 109
- cf. Jacques Derrida, Marges, Minuit, 1972
- Ibid. p. 119