Quinn Slobodian : Les Globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme (partie 1)
Acheter La Route de la servitude.
Acheter Au-delà de l’offre et de la demande.
C : L’ordoglobalisme comme cadre juridique global du marché
- Le globalisme comme tel : protéger le dominium contre l’imperium
Une fois établie la nature du néolibéralisme, et prise en compte l’ambiguïté du rapport à l’organisation qui, somme toute, va s’étendre partout à l’exception du cadre économique, le marché nécessitant une organisation des institutions pour préserver sa spontanéité, l’analyse de Q. Slobodian peut s’emparer de la question proprement dite du globalisme et ainsi justifier son titre. Ce n’est pas là le moindre des mérites de l’ouvrage que de montrer comment va naître une analyse à l’échelle mondiale du droit et des institutions destinée à penser les conditions de protection d’un marché spontané, toute la difficulté étant de comprendre que la spontanéité du marché suppose paradoxalement des conditions extra-marchandes drastiques, nécessitant une organisation globale et devant prendre la forme d’Organisations concertées. Le chapitre VII, d’une grande subtilité, démontre le rôle qu’a pu jouer le lexique et la logique cybernétiques dans la résolution de ce qui pourrait être une contradiction car il pourrait paraître contradictoire que la non-organisation du marché suppose l’organisation d’un cadre juridique. C’est peut-être en cela que les réflexions de Q. Slobodian s’avèrent les plus précieuses.
Dès l’introduction, Q. Slobodian reprend une distinction cruciale qui servira de fil directeur à l’intelligibilité du globalisme, et sans laquelle bien des éléments demeureraient incompréhensibles. Partant de l’idée fondamentale selon laquelle « la main visible du droit » doit compléter « la main invisible du marché », l’auteur montre pourquoi cela appelle une isonomie, une même loi pour tous et donc un contournement du caractère national de la loi. Pour ce faire, affirme Q. Slobodian, les néolibéraux de Genève se seraient appuyés sur une géographie spéciale, celle de Carl Schmitt qui distingue deux mondes : celui des Etats délimités, avec l’imperium qui désigne la dimension spécifiquement politique du territoire ou, plus exactement, ce que Schmitt appelle dans le Nomos de la Terre le « territoire de l’Etat », et celui du dominium par lequel s’établit une propriété non nationale des biens. Si l’on peut douter que la distinction entre imperium et dominium soit à ce point référable à Carl Schmitt tant elle est classique et habituelle depuis le droit romain, on peut en revanche utiliser cette dichotomie pour penser la question que soulève une certaine approche néolibérale, à savoir : comment protéger le dominium contre les intrusions de l’imperium ? Cela revient à faire de la propriété un absolu, qui n’a pas à être relativisé par les cadres nationaux et politiques qui peuvent même être envisagés comme des vecteurs de déstabilisation de la propriété aussi bien par le haut que par le bas : en effet, non seulement ce qui peut être un fleuron industriel privé, qui relève donc du dominium, a tendance à être amalgamé à un fleuron de la nation troublant ainsi l’identité du propriétaire réel du groupe, mais en plus à l’échelle globale l’imperium étatique a tendance à s’approprier ce qui relève du dominium par les interventions répétées sur les marchés.
On voit donc que la distinction même du dominium et de l’imperium peut être interprétée de deux manières parfaitement antagonistes : on peut soit considérer que l’existence du dominium constitue une menace pour la souveraineté des Etats et donc pour l’imperium, et c’est l’approche « souverainiste » qui vise à préserver le politique qui s’impose ; soit à l’inverse envisager la primauté de la propriété et de ce fait juger nuisible le pouvoir de l’imperium sur le dominium. Partisans de la seconde option, les néolibéraux vont être amenés à penser un cadre institutionnel qui, au fond, destitue la puissance de l’imperium.
Ainsi, à partir du chapitre III, et ce jusqu’à la fin de l’ouvrage, Q. Slobodian analyse en détail la manière dont vont être conçues des institutions internationales, globales, visant à défendre une certaine spontanéité du marché contre les intrusions du politique et conduisant donc à une « démocratie limitée » à travers un cadre institutionnel faisant l’objet de toutes les attentions.

- Une limite de l’approche de Quinn Slobodian : le double contresens au sujet de La route de la servitude
Pour étayer ses thèses, l’auteur va devoir procéder à une approche parfois incomplète des textes convoqués. Un exemple particulièrement significatif nous semble être celui de l’usage qui est mené de la Route de la servitude d’Hayek publié en 1944. Q. Slobodian prend appui sur le dernier chapitre intitulé « les perspectives d’un ordre international » pour montrer que, au moins dans les années 40, des penseurs comme Hayek jugent nécessaire d’établir un cadre fédératif international pour penser l’extension mondiale du marché. Mais, ce faisant, il réduit à l’unité – économique – la réflexion d’Hayek qui est bien plus vaste et qui, en réalité, est structurée en son cœur par le problème de la paix et de la guerre. Tout le chapitre XV de la Route de la servitude conduit à montrer que les planifications nationales sont vectrices de conflits guerriers, si bien que la finalité même du propos de l’ouvrage consiste d’abord et avant tout à penser les conditions par lesquelles sont favorisées les guerres afin de les rendre inopérantes. Ecrit durant la Seconde Guerre Mondiale, cet essai de 1944 n’est donc pas un traité théorique de protection des marchés mais une réflexion sur le lien entre l’interventionnisme et la guerre, et les moyens d’éviter cette dernière. Or, dans l’approche que propose Quinn Slobodian, l’aspect contextuel, très paradoxalement, est escamoté : alors même que tout l’ouvrage essaie de restituer les questions historiques dans lesquelles émergent les réflexions néolibérales, le problème de la guerre et de la paix devient quantité négligeable quand il est question de La route de la servitude si bien que l’ensemble du chapitre XV, si décisif à bien des égards, nous semble procéder d’un contresens. L’enjeu évident de la RS est de montrer que les planifications portent en puissance la guerre et qu’un monde voulant véritablement la paix devrait commencer par mettre fin à de telles entreprises planificatrices. Rappelons à cet effet comment s’ouvre le chapitre :
« La partie de la leçon fournie par le passé récent qu’on a fini par comprendre, est celle-ci : toutes les variantes du planisme, conçues séparément ou sur une échelle nationale, produisent nécessairement, dans leur ensemble, des effets désastreux même sur le plan purement économique, outre les conflits internationaux qu’elles provoquent. Il n’est guère nécessaire de souligner qu’il y a peu de chances de créer un ordre international ou une paix durable aussi longtemps que chaque pays se juge libre d’employer tous les moyens qu’il estime utiles à ses intérêts, sans considérer le tort causé par ces procédés à d’autres pays[1]. »
Or, le dessein d’Hayek consiste à montrer que si la planification à l’échelle nationale est riche de conflits potentiels en raison de la défense féroce d’intérêts autarciques, elle est encore plus dangereuse à l’échelle globale, et bien plus belliqueuse en son principe même. Autrement dit, plus l’échelle de la planification est vaste, plus le danger de relations belliqueuses croît, et ce pour les raisons suivantes :
« Mais, à mesure que l’échelle grandit, l’accord sur les fins diminue, et il est de plus en plus nécessaire de recourir à la force, à la contrainte. Dans une communauté relativement petite, on obtiendra facilement une concordance des opinions sur l’importance des tâches principales, sur une échelle de valeurs commune. Mais plus le nombre de sujets sur lesquels il faut s’entendre s’accroît, plus l’accord devient difficile et plus la nécessité de recourir à la coercition augmente. (…). Imaginer que la direction planifiée de la vie économique d’une vaste région habitée par des peuples différents pourrait s’effectuer par des procédés démocratiques, c’est ignorer complètement les problèmes que pareil plan soulève. Le planisme, à l’échelle internationale plus encore qu’à l’échelle nationale, n’est que l’application de la force brute : un petit groupe impose à tous les autres un standard de vie et un plan de travail qu’il estime juste[2]. »
On perçoit ainsi une limite de l’ouvrage de Q. Slobodian, à savoir qu’il force la question économique et occulte la réflexion sur la paix et la guerre alors même qu’il prétend contextualiser. La planification est certes désastreuse sur le plan économique aux yeux d’Hayek mais elle est d’abord et avant tout belliqueuse, et c’est cela qu’il convient d’éviter. Ainsi, la lecture qui est faite de La route de la servitude et de la fédération internationale proposée par Hayek nous semble-t-elle fautive car ramenée à une sorte de contournement des nations en vue de protéger le seul marché alors même que l’enjeu explicite est celui de la paix, par une fédération déjà amplement ancrée dans les traditions européennes :
« Il vaut la peine de rappeler que l’idée selon laquelle le monde ne trouvera la paix qu’en réunissant des Etats séparés en groupes de fédérations ou peut-être en une seule vaste fédération, n’est pas neuve ; elle fut en réalité l’idéal de presque tous les philosophes libéraux du XIXè siècle[3]. »
Ainsi, lorsque Q. Slobodian interprète de manière exclusivement économique l’aspect fédératif, il surdétermine l’opposition imperium / dominium, sous-détermine les questions réellement historiques qui, pour le coup, se posent pleinement, et mésinterprète ce qui relève des buts et ce qui relève des moyens, les buts explicites de l’ouvrage étant la sauvegarde des petites nations et l’élaboration des conditions de la paix. Une fois encore, l’absence de convocation du problème fabien est préjudiciable car la vision du monde issue du fabianisme, en tant que planification protectionniste par les moyens prodigieux que confère l’étendue du Commonwealth, menace directement aux yeux d’Hayek autant la liberté des agents économiques que la paix et la survie des petites nations. Les Fabiens constituent une question clé pour comprendre ces enjeux, et l’absence de leur thématisation dans l’ouvrage introduit une fois de plus un point aveugle et ce alors même qu’Hayek les attaque nommément :
« Il est caractéristique que les partisans les plus fervents d’un ordre nouveau de l’économie dirigée en Europe manifestent, comme les Fabiens et leurs prototypes allemands, le plus complet mépris pour l’individualité et les droits des petites nations[4]. »
Par conséquent, la lecture qu’en propose Q. Slobodian est doublement égarante, d’une part parce qu’elle surdétermine la perspective économique et d’autre part parce qu’elle semble attribuer à Hayek une pensée « globaliste » qui viserait à écraser le pouvoir de nuisance des nations au regard du marché alors même que l’enjeu est celui de la préservation de la paix et des petites nations. La fédération dont parle Hayek n’est pas mondiale mais régionale, et la forme qu’elle doit prendre est pensée sur le plan politique : « ni un super-Etat tout puissant, ni une association lâche de « nations libres », mais une véritable communauté de nations composées d’hommes libres[5]. » Et Hayek d’ajouter quelques lignes plus bas, prouvant par-là son refus de tout globalisme, le propos suivant :
« Il y aura probablement une forte tendance en faveur d’une organisation universelle, englobant le monde entier. (…). Tout en cherchant à empêcher les guerres futures, nous ne devons pas nous imaginer pouvoir créer d’un coup une organisation permanente capable de prévenir tout conflit dans toutes les parties du monde. Non seulement nous n’y arriverions pas, mais nous perdrions probablement nos chances d’y parvenir dans des régions plus limitées[6]. »
Ainsi, lorsque Q. Slobodian rappelle qu’Hayek avait déclaré en 1983 être totalement opposé à un gouvernement mondial, il rend les choses confuses en y voyant une évolution d’Hayek, lequel a toujours été hostile au globalisme. Il est vrai que l’auteur souligne à plusieurs reprises que le néolibéralisme n’est pas strictement identique à ce qu’il appelle l’ordo-globalisme, qui est l’objet réel de son livre et qui correspond à une branche très spécifique et juridique du néolibéralisme de Genève. « Contrairement aux ordolibéraux qui préconisaient une « constitution économique » au niveau de la nation, les néolibéraux de l’école de Genève la préconisaient pour le monde. Leur proposition peut ainsi être considérée comme une reformulation à l’échelle du monde de l’ordolibéralisme : nous pourrions l’appeler ordoglobalisme[7]. » Mais il n’en demeure pas moins que les inspirateurs d’un tel projet sont difficiles à cerner, Hayek lui-même étant réservé voire hostile à l’extension mondiale d’une organisation régulatrice.

- Les organisations internationales
Est-ce alors à dire que Q. Slobodian s’engage dans la voie unilatérale d’une réduction économiste du néolibéralisme, à rebours de sa volonté de dissocier le néolibéralisme du « fondamentalisme de marché », prenant le contrepied de Polanyi dont il juge les travaux trompeurs[8] ? Assurément non. Il faut ici rappeler que l’auteur est historien et qu’il envisage à ce titre de penser le néolibéralisme depuis la réalité historique dans laquelle s’inscrivent les textes étudiés. Cette approche est fondamentale car elle conduit à dialectiser les grands textes théoriques d’Hayek, Mises, Röpke et autres par les interventions ponctuelles liées aux grandes organisations mondiales du commerce. Ainsi l’auteur prête-t-il une attention plus que soutenue à la Chambre de Commerce internationale (CCI) fondée en 1919 et destinée à ouvrir les marchés par-delà les frontières nationales après la Première Guerre mondiale, à l’Organisation Internationale du Commerce (OIC) fondée en 1948 et au GATT de 1947 dont naîtra l’Organisation Mondiale du Commerce. Tout l’enjeu est alors de déterminer comment les grands penseurs de l’école de Genève se situent par rapport à ces Organisations mondiales et quel usage ils peuvent faire pour défendre leurs principes.
La conclusion de l’ouvrage permet de cerner au mieux l’interprétation que donne l’ouvrage de ces phénomènes organisationnels :
« Mon point de vue est que le recours à la loi a constitué le tournant majeur du néolibéralisme de langue allemande après la Seconde Guerre mondiale. Ce que j’ai nommé « ordoglobalisme » permet de comprendre la Communauté économique européenne (CEE) et plus tard l’Organisation mondiale du commerce (OMC) comme étant des systèmes des pouvoir fondés sur le droit, inscrivant les marchés dans un cadre qui se situe au-delà de tout contrôle démocratique tout en cherchant à se créer une légitimité en offrant aux citoyens des droits individuels, par-delà la nation. Il est à noter que, dans cette transposition de l’ordolibéralisme du cadre national à l’échelle mondiale ou internationale, disparaît l’inclusion tant vantée d’aspects de l’Etat redistributif[9]. »
La question des organisations internationales est extrêmement complexe et si l’ouvrage présente l’immense mérite de penser le lien entre les approches théoriques et les démarches concrètes auxquelles prennent part les auteurs, il n’est pas toujours parfaitement clair lorsqu’il s’agit de rendre compte du problème politique que pose la démocratie au regard du marché. Certes, l’introduction soulève deux problèmes : « L’ordoglobalisme a été hanté par deux dilemmes majeurs au cours du XXè siècle : comment s’appuyer sur la démocratie étant donné la capacité de celle-ci à s’autodétruire ; comment s’appuyer sur les nations, étant donné la capacité du nationalisme à « désintégrer le monde » ?[10] » Mais la manière de traiter ces deux questions est parfois très difficile à suivre car elle se révèle éclatée : est en effet en jeu le problème de la défense d’intérêts particuliers qui, par des phénomènes de regroupements, crée des blocs revendicatifs et déstabilisateurs, si bien qu’apparaît quelque chose qui n’est nullement thématisé dans l’ouvrage, à savoir la raison pour laquelle une approche libérale pourrait être hostile à la défense d’intérêts. Conceptuellement, quelque chose demeure particulièrement obscur dans toute l’analyse des organisations internationales en ceci que le néolibéralisme semble se retourner contre la légitimité de la défense des intérêts, qui est pourtant au cœur de la démarche libérale. En réalité, le problème initial est à nouveau celui de la connaissance et de l’information : une défense d’intérêt supposerait que la raison fût capable d’identifier les véritables intérêts, aussi bien des individus que des nations ; or, dans un monde complexe, dont la nature des échanges est telle qu’il est impossible de les comprendre et de les anticiper, la défense des intérêts – individuels ou nationaux – s’apparente en réalité à des revendications de groupes de pression qui, ayant pris la domination par des logiques de regroupement, organisent le marché à leur profit et génèrent tout autant un désordre économique qu’une société liberticide. Ce qu’il eût donc fallu thématiser de manière fort claire, c’est que le néolibéralisme rompt avec l’idée libérale de la défense d’intérêts ; même à l’échelle individuelle, il est quasiment impossible de déterminer dans un monde complexe un intérêt objectif, raison pour laquelle l’optimum n’est pas tant atteint par la défense féroce d’intérêts personnels que par le respect de règles communes, ne profitant pas à un groupe de pressions particulier. En revanche, il est parfaitement légitime que les individus visent des fins par un comportement intentionnel dont rien ne permet de dire qu’ils correspondent aux intérêts de ces derniers.
Mais justement : cela soulève la difficulté de savoir comment il est possible de mettre en place des règles communes qui ne soient pas l’expression d’intérêts catégoriels et organisés. A cette question, l’auteur apporte plusieurs réponses de nature différente.
- Un premier élément consiste à penser la différence entre des décisions collectives de type négatif – abolir des barrières douanières – et des décisions collectives visant à défendre quelque chose de positif – une industrie nationale.
- Un second élément aborde le problème des votes dans les organisations internationales qui sont représentées par des nations : chaque nation a-t-elle droit à un vote ? Si oui, comment éviter que des nations se regroupent en formant des syndicats d’intérêts, obtenant par des phénomènes d’agglomération un avantage exorbitant ?
- Enfin, le troisième élément concerne les marchés communs dont la CEE est un exemple paradigmatique, dont la nature est trouble : est-ce une perturbation du marché mondial par un ensemble intégré se mettant hors-jeu des règles universelles ou est-ce le marche-pied vers une intégration universelle ? Dans le premier cas, on aurait un regroupement d’intérêts contre l’économie mondiale, tandis que dans le second il s’agirait bien plutôt de faciliter l’intégration d’un bloc dans un marché mondial.
Ces trois étages de réflexion permettent de suivre les méandres d’une démarche qui, assumant l’aspect historique du propos, se fait sinueuse à mesure qu’elle épouse les péripéties et les revirements des auteurs. Prenons par exemple le cas de la CCI : émanation explicite de réflexions néolibérales visant à reconstruire un marché après la Première Guerre sur la base de destruction des barrières douanières, elle devient au tournant des années 30 un moyen pour certains pays de défendre des industries nationales. Il en va de même pour l’OIC qui, harmonisant les politiques économiques internationales, finit par devenir un outil de pression de certaines nations pour bloquer des capitaux ou subventionner certaines productions sur la base d’intérêts nationaux. En somme, dès qu’une nation croit savoir ce qu’il faut faire positivement pour défendre ses intérêts, elle s’illusionne quant à un savoir dont elle ne dispose pas, et dérègle tout le système, raison pour laquelle des auteurs comme Michael Heilperin s’éloignent de l’OIC y voyant la reconduction des tares démocratiques, au sens de l’illusion quant à la connaissance des intérêts réels. Ce dernier fera même de la CCI un outil de lutte contre l’OIC, et c’est là que l’on comprend un point décisif de l’ouvrage : une organisation internationale peut se retourner contre une autre, dès lors que des visées positives se trouvent formulées, et qu’un dessein délibéré émerge depuis des coalitions d’intérêt.
- Le traumatisme de 1929 et la décolonisation
Tout cela serait incompréhensible sans la crise de 1929 : cette crise favorise des politiques extrêmement interventionnistes et donnent l’impression que de super-organisateurs – les fameux managers si bien identifiés par James Burnham – seraient capables à la fois de disposer d’une vision macroéconomique et en même temps d’anticiper les effets d’une décision à l’échelle macroéconomique. Les politiques dites keynésiennes qui ont été adoptées dans les années 1930 et qui, par des groupes de pression très bien organisés, ont été présentées comme des succès en dépit des ravages qu’elles ont pu causer aux Etats-Unis, changent la donne : les organisations internationales, plébiscitées par l’école de Genève au début parce qu’ils y voyaient un moyen de fluidifier les échanges et de lever les barrières tarifaires se trouvent mises au service d’objectifs conscients, quantifiés, et donc délibérés. Fondées sur de pseudo-savoirs, de telles finalités font muter la nature même des organisations et imposent aux néolibéraux de changer leur regard. Une organisation internationale n’est légitime à leurs yeux que si elle suspend tout dessein délibéré et se contente d’harmoniser les cadres institutionnels des échanges ; elle devient dangereuse dès lors qu’elle fixe des objectifs précis aux échanges et défend des intérêts catégoriels à grande échelle.
Mais à la crise de 1929 s’ajoute un phénomène majeur qu’est la décolonisation et donc l’apparition de nouvelles nations cherchant à défendre ce qu’elles pensent être leurs intérêts. Q. Slobodian présente l’immense mérite de souligner l’importance de la décolonisation et du problème que pose pour des auteurs comme Röpke l’apparition de pays qui, coalisés, défendent des intérêts catégoriels agglomérés, perturbant le système mondial et tirant à leur profit l’idée démocratique d’un pays, un vote. Tout le chapitre V analyse ainsi le malaise que suscite la décolonisation – et le cas si spécifique de l’Afrique du Sud – chez les néolibéraux, à vrai dire divisés sur la question en raison du problème de la « race » et des appréciations divergentes sur le sujet.
D : La CEE pour comprendre le GATT
Un autre élément d’une grande richesse que propose l’auteur est son analyse particulièrement fine du rapport entre la CEE et le GATT dans la perspective néolibérale. Nous lui consacrons une partie entière car le propos est complexe et les enjeux ne le sont pas moins. « L’Europe, écrit à juste titre Q. Slobodian, est l’une des énigmes du siècle néolibéral[11]. » Si l’ensemble de l’école de Genève lui est explicitement hostile, ce n’est pas par souverainisme mais pour deux autres raisons assez éloignées l’une de l’autre, à savoir la crainte de la constitution d’une bureaucratie tyrannique, mais aussi la crainte d’une perturbation du jeu mondial de l’économie menée par la construction d’un marché dans le marché. La CEE et l’UE apparaissent ainsi comme des monstres collectivistes et dirigistes menés par une batterie de technocrates illusionnés par leur pseudo-savoir au nom duquel ils menacent à la fois la propriété privée, les libertés humaines et accomplissent l’idéal saint-simonien d’anéantissement de l’initiative individuelle. Mais d’un autre côté, une branche néolibérale d’inspiration « constitutionnaliste » serait moins farouchement hostile à la CEE et y verrait la possibilité de limiter l’emprise des Etats sur la vie économique par un système de règles juridiques communes. Toutefois, le déséquilibre entre les positions est patent et il ne serait pas hardi d’affirmer que l’immense majorité des penseurs néolibéraux est vent debout contre la construction européenne et qu’il est quasiment impossible de voir dans cette dernière une entreprise « néolibérale ».
- Un cas paradigmatique du refus de la CEE et de l’UE : Wilhelm Röpke
Un auteur méconnu quoique central dans la question libérale est Wilhelm Röpke, que l’on ne connaît en France que grâce aux travaux de Patricia Commun. Nous souhaitons donner ici un large extrait de son maître-ouvrage, Au-delà de l’offre et de la demande (1958), qui nous semble exprimer avec le plus de clarté le refus clair et net de la plupart des néolibéraux de la bureaucratie dirigiste qu’est l’UE et que préfigurait à leurs yeux la CEE :
« Sous la fausse bannière de la communauté internationale on a vu surgir dans ce domaine un appareil de la concentration industrielle, de l’agglomération, de l’uniformité et de l’économie dirigée qui (aussi bien dans le cadre de l’ONU et de ses organisations annexes qu’à l’intérieur de créations continentales du genre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier) s’octroie de plus en plus de pouvoir et assure, à une bureaucratie toujours plus nombreuse, privilèges, influence et revenus nets de tout impôt. A part quelques exceptions dignes d’éloges, l’utilité de cette centralisation internationale est extraordinairement disproportionnée avec son coût. Mais peu de gens sont capables, derrière le paravent des « idéaux élevés », de reconnaître la réalité ; ils ont moins encore le courage de l’exprimer franchement, et, s’ils le font, ils se voient placés devant une conjuration ouverte de tous les « bien-pensants ».
Seule une minorité, et qui va s’amenuisant, aperçoit le caractère perfide et dangereux de cette concentration ; elle éprouve d’ailleurs, devant la bureaucratie disposant de moyens puissants, pour peser sur l’opinion publique, des difficultés de plus en plus grandes à faire entendre sa voix. Il y a pire ; cette centralisation internationale (au nom de l’ « Europe », de la « souveraineté supranationale », de l’ « harmonisation internationale », du « combat contre le communisme », ou de quelque autre mot d’ordre séduisant), menace de donner le coup de grâce à ce qui reste de saine décentralisation nationale et de saine diversité internationale. Le sommet qui brille au loin est cet « Etat-Providence international » (…).
Sur cette voie, l’étape la plus récente est le projet de Marché commun, tandis qu’un caractère moins centralisateur s’attache au plan de la Zone de libre-échange. L’économiste a de nombreuses critiques à exprimer à ce sujet, hors de notre propos actuel. Dans le cadre des considérations présentes, il est significatif que ce projet, par l’étendue alarmante qui est donnée au dirigisme économique, et par la perspective d’une concentration et d’une organisation croissante de la vie économique, donnera une nouvelle et forte impulsion au centralisme international. La dépendance des individus et des petits groupes vis-à-vis des grandes centrales croîtra démesurément, de même que s’amenuiseront considérablement les possibilités de rapports humains et personnels, et cela au nom de l’Europe et de ses obligations traditionnelles à l’égard de la liberté, de la diversité et de la personnalité. Le danger, qui était à l’affût dans tant de plans et de documents de l’intégration économique européenne, s’est précisé et nous menace dans l’immédiat : l’économocratie, dont nous avons si souvent parlé dans ces lignes, est transférée de façon décisive de l’échelon national à l’échelon international et, avec elle, la domination toujours plus rigoureuse et plus inévitable des planificateurs, des statisticiens et des « économétriciens », le pouvoir centralisateur d’un dirigisme accompagné de son bureaucratisme international, de plans d’économie internationale, de subventions de pays à pays, et tout le reste. Si certains pays européens avaient pu jusqu’à ce jour limiter en quelque sorte à leurs propres frontières l’esprit du saint-simonisme, celui-ci, fidèle aux visions du fondateur de l’économie dirigée, s’impose maintenant sous la forme d’un saint-simonisme européen[12]. »
A cet égard, la CEE, loin d’être une étape du marché mondial libre, lui apparaît comme une avancée socialiste, c’est-à-dire coercitive et bureaucratique avec illusion saint-simonienne d’un savoir économique chiffré légitimant planification et anticipation, et ne saurait en rien être assimilée à un marché libre. « En ce qui me concerne, précise Röpke, je combats au fond dans le socialisme une philosophie qui, en dépit d’une phraséologie « libérale », accorde trop peu à l’homme, à sa nature et à sa personnalité, tout en prenant trop à la légère, dans son enthousiasme pour tout ce qui s’appelle organisation, concentration, direction et appareil, le risque qu’ainsi la liberté se voie tout simplement sacrifiée[13]. »
Mais quel est alors le rapport avec le GATT ? La thèse de Q. Slobodian consiste à soutenir que les néolibéraux de Genève, dont Röpke constitue le chef de file, vont jouer le GATT contre la CEE, jouer l’abolition mondiale des barrières tarifaires contre la bureaucratie dirigiste européenne, jouant donc une organisation contre une autre. Ce sera la position d’Heilperin mais aussi du grand disciple de Röpke, à savoir Ludwig Erhard.

Mais justement, quelque chose détonne dans la reconstruction que propose Q. Slobodian de ce délicat débat, à savoir une double minoration. D’abord, la question de l’obésité bureaucratique est écrasée sous la question économique ; or, le cœur de la critique de Röpke est le dirigisme bureaucratique, en cela parfaitement paradigmatique des craintes néolibérales ; par ailleurs, parmi les néolibéraux acquis à l’ordo-libéralisme, l’unité n’est pas de mise concernant la CEE et l’UE ; on observe donc une seconde minoration, qui est celle du rôle de Müller-Armack, certes mentionné çà et là mais insuffisamment restitué comme contrepoids de Röpke sur le plan monétaire. Si, en effet, ce dernier était focalisé sur le problème dirigiste et bureaucratique ainsi que sur la volonté de réduire les barrières douanières, Alfred Müller-Armack, lui, était spécialiste de la monnaie et favorable à l’organisation délibérée d’une harmonisation monétaire. « Les crises, analyse Patricia Commun, étaient des phénomènes liés de manière inhérente au mouvement d’expansion du capitalisme. Il importait d’être en mesure non de les contenir ou de les éviter, mais de les prévoir pour les amoindrir. On faisait l’erreur de se focaliser sur la question des barrières douanières pour tenter de régler leur problème d’équilibre des balances de paiements et leurs problèmes monétaires. C’est sur ces problèmes-là qu’il convenait de se pencher. Ce qu’il fallait, à terme, en Europe, c’était donc une politique monétaire commune, mais qui semblait prématurée pour l’heure[14]. » Ainsi, celui que Erhard avait appelé pour diriger le département de politique économique générale allemande afin de contrebalancer le poids des fonctionnaires dirigistes nommés par Adenauer, jugeait-il possible la prédiction des crises mais aussi l’organisation d’un cadre monétaire délibéré à long terme, sans prêter grande attention au problème des barrières douanières…
- Le « constitutionnalisme » a-t-il joué un rôle dans la construction européenne ?
Si donc Q. Slobodian restitue la vive hostilité de la plupart des universalistes de Genève à l’endroit de la construction européenne – minorant l’ambiguïté ordo-libérale à ce sujet –, il contrebalance son propos par le constitutionnalisme hayékien qui aurait favorisé la construction européenne au nom de la construction d’un cadre juridique commun contraignant les Etats et limitant donc leur pouvoir de nuisance. Nous confessons être peu convaincu par cet aspect du livre, et ce pour deux raisons : d’une part l’auteur joue sur une ambiguïté entre Hayek et ses héritiers, de sorte que l’on peine à comprendre en quel sens Hayek aurait été spécifiquement favorable à la construction européenne. S’il est vrai que dans les années 70, Hayek se lance dans des projets de constitutions, il n’est pas pour autant exact que le cas européen fasse l’objet d’une approche favorable explicite de la part d’Hayek sous forme d’une constitution visant à faire primer le droit et l’Etat de droit sur les décisions politiques. D’autre part, il nous semble que cela entre de toute façon en contradiction avec un article[15] – excellent au demeurant – du même Q. Slobodian examinant l’hostilité explicite d’Hayek aux fédérations de peuples différents, et ce dans les mêmes années que celles où il accorde son attention aux constitutions. Q. Slobodian lui-même reconnaît qu’Hayek avait jugé nécessaire l’homogénéité des peuples sur le plan culturel et ethnique pour le bon fonctionnement du marché, trouvant à ce titre un vif écho chez les conservateurs britanniques particulièrement hostiles à la CEE puis à l’UE.
A vrai dire, il semble que deux choses sont quelque peu mélangées : en droit, il est vrai qu’Hayek n’est pas hostile à un primat du cadre juridique permettant de construire une série de règles communes permettant au marché de fonctionner ; mais dans les faits la CEE et l’Union européenne ne correspondent pas à ce qui aurait été souhaité en droit, puisque non seulement des peuples aux traditions différentes pour former un marché commun se trouvent réunis tandis que se développe une bureaucratie dirigiste contribuant à ce qu’Hayek avait appelé la « route de la servitude ».
- La grande absente : l’économie sociale de marché
A vrai dire, si Q. Slobodian ne nous semble pas convaincant en opposant universalistes de Genève et constitutionnalistes dans leur rapport à l’UE, c’est sans doute parce qu’il passe sous silence ou presque une dimension fondamentale du problème qu’est l’ordo-libéralisme. Ce dernier, dont procèdent des auteurs comme Röpke, Eucken ou Erhard, a une spécificité : s’il pense les conditions extra-économiques du fonctionnement de marché, il promeut sur le plan politique une économie sociale de marché. Comme le rappelle Patricia Commun, il marche sur deux jambes, une institutionnelle et un « pôle plus social, favorable non seulement à la mise en place d’un Etat-providence, mais aussi à des mécanismes particuliers de gouvernance des entreprises et de dialogue avec les partenaires sociaux[16]. » En ne mentionnant pas cette dimension sociale de l’ordo-libéralisme, Q. Slobodian se fait aveugle aux enjeux internes de ce courant et n’évalue pas ce que signifie l’acceptation par l’ordo-libéralisme de l’Etat providence : plus exactement, il ne restitue pas les débats autour du curseur plaçant la légitimité des interventions d’un tel Etat. Pour cette raison, le rapport à la CEE et à l’UE n’est pensé par Q. Slobodian qu’à partir d’une seule perspective, qui est celle du marché.
En réalité, l’ordo-libéralisme brise en partie un interdit néolibéral et juge possible que l’Etat corrige des inégalités ou des dysfonctionnements, le tout étant de déterminer jusqu’à quel point il peut le faire et jusqu’à quel point l’organisation est possible et souhaitable. Or, au fondement de cette discussion, se trouve à nouveau l’enjeu du connaissable : savoir jusqu’où peut intervenir l’Etat engage en réalité la nature même de la connaissance sur laquelle s’appuie ce dernier, et son périmètre. Et il en va de même pour l’intervention des institutions européennes : il va de soi que construire une politique européenne monétaire présuppose le caractère connaissable d’un certain nombre de variables, dont l’appréciation varie selon les auteurs. Par conséquent, les désaccords que l’on peut observer entre Röpke et Müller-Armack, pourtant proches sur le papier, s’expliquent en grande partie par une appréciation différenciée du connaissable et, partant, du domaine d’intervention légitime des Etats. Röpke, rappelons-le, ne croit pas à la science économique, au calcul, et aux prédictions ; Müller-Armack y croit bien davantage, peut-être parce qu’il fut entre autres formé à la London School of Economics. Röpke est enfant de Mises[17], pas Müller-Armack.

Conclusion : un grand livre aux perspectives limitées
L’ouvrage de Quinn Slobodian est un grand livre de philosophie politique mais aussi un grand livre d’histoire intellectuelle. Prenant à bras-le-corps le va-et-vient entre les événements historiques, les organisations effectives et la pensée théorique, il restitue dans une fresque remarquable près de cinquante années de réflexion néolibérale dans le double versant théorique et pratique. A bien des égards, la lecture du livre constitue même une humiliation pour certains historiens des idées, un historien de l’Allemagne ayant infiniment mieux compris Hayek, Mises ou Röpke que bien des spécialistes de philosophie politique.
Ce faisant, trois vertus cardinales se dégagent de l’ouvrage.
La première consiste, contre bien des approches fautives, à prouver à quel point le néolibéralisme se situe aux antipodes de l’économétrie et de l’homo oeconomicus. La raison génère une illusion en ses propres pouvoirs et c’est de ces derniers que le néolibéralisme apprend à se méfier, conduisant à une économie non pas pensée comme prescriptions positives mais comme marché libre où émergent des « signaux » permettant de s’orienter. Cela signifie que le néolibéralisme conduisant à l’ordoglobalisme ne peut pas être classé dans la même catégorie que les écrits monétaristes d’un Milton Friedman. « Hayek, note Q. Slobodian, avait le plus grand mépris pour l’usage des mathématiques en macroéconomie utilisées dans le but d’ « impressionner les hommes politiques » ; « réellement, ce qui est le plus proche de la pratique de la magie au sein de l’activité des économistes professionnels ». Il affirmait qu’il avait toujours pensé qu’il aurait dû écrire un texte critique du livre de Milton Friedman, Essais d’économie positive, selon lui « tout aussi dangereux que celui de Keynes »[18]. » Ainsi se comprend que, derrière Friedman ou Keynes, se situe le même hybris et la même incompréhension de la limitation de la connaissance humaine, maquillées derrière de fausses mises en équation de la réalité économique.
La seconde vertu tient au souci constant d’établir une continuité entre la réflexion théorique et les réalisations pratiques, sans que celles-ci ne soient pour autant absorbées dans le cadre théorique. Un exemple particulièrement significatif est celui de la transformation du GATT en OMC. En apparence, le triomphe néolibéral est réel ; en réalité, bien que les principes de l’OMC fondés sur des « signaux » s’apparentent à des principes néolibéraux tels que définis dans l’ouvrage, les motivations de la création de l’OMC ne sont pas libérales, il s’en faudrait de beaucoup. Il s’agit au contraire d’une défense féroce d’intérêts d’une nation en particulier, imposant au monde des règles qui lui sont de fait favorables. De ce fait, l’ordoglobalisme est entré en crise au moment de sa victoire la plus importante, lorsque le GATT est devenu OMC ; cela n’a pas marqué le triomphe de leur vision intellectuelle mais « celui des intérêts purement économiques de la première puissance mondiale, les Etats-Unis[19]. »
Enfin, et ce n’est pas la moindre des vertus, on sent tout au long de l’ouvrage que le néolibéralisme est comme embarrassé du politique : sans vouloir mettre fin aux Nations et aux frontières – il doit rester « des portes de sortie », donc des frontières –, la souveraineté des Etats modernes s’avère problématique à deux niveaux : d’une part parce que la puissance souveraine empiète sur le terrain économique et brise la liberté des acteurs, et d’autre part parce que l’action publique sur la base de sa souveraineté agit au nom de connaissances qu’elle ne possède en réalité pas. De ce point de vue, la souveraineté soulève une double série de problèmes : un niveau spécifiquement politique par l’usage de la puissance et un niveau saint-simonien, interventionniste, qui croit légitimer l’action publique sur la base d’un savoir positif. Le néolibéralisme porte en lui une volonté de dépolitisation de l’économie, et de juridicisation du cadre extra-économique, limitant donc le danger étatique par le droit, en vue de protéger le marché.
Pour toutes ces raisons, l’ouvrage de Quinn Slobodian est bel et bien un grand livre, indispensable et éclairant.
Mais, nonobstant ces qualités, il nous semble rencontrer un certain nombre de limites dont nous voudrions évoquer les trois principales.
La première est que, paradoxalement, il nous semble verser dans l’économisme. Plus exactement, alors même qu’il ambitionne de montrer que le néolibéralisme n’est pas une théorie exclusivement économique, il ramène tout à des questions économiques à partir de la distinction dominium / imperium. Si, en effet, l’enjeu constant du néolibéralisme consiste à protéger le dominium, la propriété privée, alors tout devient par nature une question économique, et, de fait, toutes les questions que traite l’auteur sont traitées sous le seul angle économique, le moment consacré à l’Union européenne étant la caricature de cela, tandis que les passages consacrés à la fédération hayékienne brillent par leur interprétation économiste de la question au détriment du vrai sujet qu’est celui de la guerre.
La seconde découle de la précédente ; adoptant un économisme paradoxal, l’ouvrage est aveugle à l’anthropologie néolibérale, pourtant au cœur de ses réflexions. Plus exactement, l’économie néolibérale n’est pas une théorie économique mais une anthropologie : c’est l’ensemble des conséquences institutionnelles et politiques tirées d’un principe voulant que l’homme réel soit incapable d’agir rationnellement, quoi qu’il croie par ailleurs. Mises le dit fort bien :
« L’économie traite des actions réelles d’hommes réels. Ses théorèmes ne se réfèrent ni à des hommes parfaits ou idéaux ni au fantôme mythique de l’homme économique (homo oeconomicus) ni à la notion statistique de l’homme moyen. L’homme avec toutes ses faiblesses et ses limitations, chaque homme comme il vit et agit, voilà le sujet de la catallactique[20]. » De ce fait, contrairement aux impressions que peut donner l’ouvrage à de très nombreuses reprises, la protection du marché ne constitue pas le but de toute l’entreprise organisationnelle des institutions ; le but, c’est de protéger le seul cadre conforme à un homme imparfait, et donc d’objectiver un terrain anthropologique présupposant l’imperfection et la faiblesse humaines. A cet égard, l’hybris saint-simonien et ses prolongements technocratiques constitue la plus grave mécompréhension anthropologique qui se puisse concevoir.
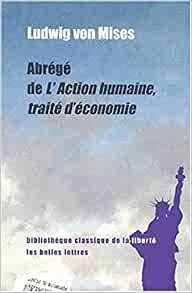
Enfin, si l’auteur dans l’ultime chapitre propose une brillante analyse de la dimension cybernétique de l’œuvre d’Hayek, et comprend un point essentiel à savoir que c’est finalement le système tout entier qui devient le sujet central de ses écrits, il nous semble minorer le problème de la genèse organisationnelle : la rencontre avec Lippmann, venu d’un horizon fort différent, les discussions avec Wells dans les cercles autrichiens des années 30, le poids de Graham Wallas, dessinent un cadre cohérent qu’est celui des fabiens. Il est vrai que Q. Slobodian mentionne brièvement le sujet et note qu’en 1947 Hayek « suggère de suivre l’exemple des socialistes. Des gens de gauche comme les Fabians, dont certains avec lesquels il avait coopéré au sein de la Federal Union et en tant que professeur à la London School of Economics, fondée par eux, avaient réussi à faire évoluer les débats au fil du temps, gagnant ainsi les faveurs de l’opinion publique et du pouvoir et parvenant à transformer leur vision en réalité[21]. » Mais pourquoi dans ces conditions ne pas penser la porosité entre les Fabiens et le néolibéralisme concernant la question organisationnelle ? Pourquoi au fond ne pas sonder l’hypothèse voulant que la nécessité d’organiser la vie humaine, inhérente à la pensée saint-simonienne et fabienne ait trouvé un écho chez les néo-libéraux, non pas pour organiser le marché et la vie économique mais pour organiser à l’échelle mondiale les règles de droit et les institutions encadrant le marché ? Des institutions comme l’OMC sont d’abord et avant tout des organisations ; à ce titre, qu’elles aient pu être promues par des néolibéraux montre que quelque chose dans le néolibéralisme n’est pas hostile à la pensée organisationnelle, fût-elle exclue d’une application au marché lui-même ; de ce point de vue, une genèse fabienne de cette dernière, au regard des contacts affectifs et avérés ne serait-ce qu’à la faveur du colloque Lippmann devrait être investiguée.
[1] Friedrich von Hayek, La route de la servitude, chap. XV, Traduction G. Blumberg, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2002, p. 158.
[2] Ibid., p. 160.
[3] Ibid., p. 167.
[4] Ibid., p. 165.
[5] Ibid., p. 168.
[6] Ibid., p. 168-169.
[7] Ibid., p. 22.
[8] « L’un des obstacles à la compréhension des néolibéraux tels qu’ils se définissent eux-mêmes, écrit Q. Slobodian, a été le recours excessif à un ensemble d’idées empruntées à Karl Polanyi (…). » (page 15) La grande transformation a eu une influence très rétroactive et a plaqué la catégorie de « fondamentalisme de marché » sur des pensées qui lui étaient extérieures, le marché n’étant ni auto-suffisant ni apte à s’auto-réguler sur le plan institutionnel. La pensée néolibérale n’est pas soluble dans l’idée de marché autorégulé libéré de l’Etat. Hayek, rappelle l’auteur, a développé une idée singulière de marchés encastrés. « A trop se focaliser sur la notion de fondamentalisme de marché, le risque est de ne pas voir que ce qui se trouve réellement au cœur des propositions néolibérales n’est pas le marché en soi, mais la refonte des Etats, du droit et des autres institutions pour le protéger. Les spécialistes du droit ont clairement montré le développement de la juridicisation du commerce international. » (page 16)
[9] Ibid., p. 290.
[10] Ibid., p. 24.
[11] Ibid., p. 201.
[12] Wilhelm Röpke, Au-delà de l’offre et de la demande, Payot, 1961, rééd. Les Belles Lettres, 2009, p. 334-335.
[13] Ibid., p. 29.
[14] Patricia Commun, Les ordolibéraux. Histoire d’un libéralisme à l’allemande, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 335.
[15] Cf. Quinn Slobodian, « Les enfants bâtards de Friedrich Hayek », 5 septembre 2021, article traduit en ligne : https://lvsl.fr/les-enfants-batards-de-friedrich-hayek/
[16] Patricia Commun, op. cit., p. 10.
[17] Mises avait développé les conséquences de son refus de la science économique jusqu’à la délégitimation de l’existence des économistes : « Le développement d’une profession d’économistes est une conséquence de l’interventionnisme. L’économiste professionnel est le spécialiste qui contribue à concevoir diverses mesures d’intervention du gouvernement dans les affaires. », Ludwig von Mises, Abrégé de l’action humaine, Paris, Les Belles Lettres, 2004, p. 58.
[18] Quinn Slobodian, Les Globalistes, op. cit., p. 293.
[19] Ibid., p. 298.
[20] Ludvig von Mises, op. cit., p. 61.
[21] Les Globalistes, op. cit., p. 140.








