Introduction : Un livre d’ores et déjà classique
Avec Les globalistes, traduit en français aux éditions du Seuil[1], l’historien Quinn Slobodian propose un grand voire un très grand livre quant à la genèse du néolibéralisme, et manifeste une maîtrise des enjeux de ce courant hors du commun, ne cédant jamais au contresens à la fois grave et courant voulant que le néolibéralisme soit une théorie économique de nature prescriptive. Historien de l’Allemagne moderne, l’auteur aborde le néolibéralisme selon le contexte historique de son émergence et en explicite les principes depuis les événements liés à la dislocation de l’Empire austro-hongrois. A cet effet, l’ouvrage s’écarte de deux approches fréquentes : 1) il s’écarte d’une histoire des idées qui ne quitterait jamais le terrain philosophique, et ne restitue pas la genèse « écossaise » du néolibéralisme, Hume ou Smith occupant dans Les globalistes une place négligeable. 2) il ne fait pas du néolibéralisme une grille de lecture explicative du monde contemporain, grille de lecture qui, bien souvent, se dispense de donner une définition claire de ce courant, et ne juge pas évident que la nature de la réalité se laisse nommer par un courant intellectuel.
Là contre se trouve développée une sorte de triple ancrage historique, commençant avec la fin de la Première Guerre Mondiale et l’effondrement de l’Empire austro-hongrois, se poursuivant avec la crise de 1929, et s’achevant avec la Seconde Guerre mondiale et la fragilisation de l’Europe dont découle la décolonisation. C’est donc à un néolibéralisme situé, réactif au regard des problèmes sans cesse mouvants que soulève la réalité historique que l’auteur prête son attention. Cela lui permet de comprendre et de prouver – mais quel poids auront ses preuves au regard des préjugés en la matière ? – que le néolibéralisme ne constitue pas une réflexion exclusive ni et encore moins prescriptive sur l’économie mais tout au contraire une réflexion sur le droit et les institutions auxquels sont consacrées les analyses des grands auteurs ici convoqués – Hayek, Mises, Röpke, Eucken, etc. En somme, le livre réfute l’idée absolument fausse et textuellement non étayable selon laquelle le néolibéralisme croirait à une auto-régulation du marché qui pourrait être pensée indépendamment de tout cadre institutionnel. Comme l’explique l’auteur dès l’introduction – remarquable –, c’est l’inverse qui est vrai : une pensée du marché est d’abord et avant tout une pensée des institutions, saisies comme condition de possibilité du fonctionnement optimal du marché :
« Le récit proposé dans ce livre s’inscrit en faux par rapport à cette histoire. Il montre que ceux qui les premiers se sont autoproclamés néolibéraux ne croyaient pas à l’autorégulation des marchés en tant qu’entités autonomes. Pour eux, démocratie et capitalisme n’étaient pas synonymes. Ils ne pensaient pas que les humains étaient uniquement motivés par la rationalité économique. Ils ne souhaitaient ni la disparition de l’Etat, ni celle des frontières. Et ils n’abordaient pas le monde uniquement au prisme de l’individu. En fait, ils partageaient avec John Maynard Keynes et Karl Polanyi l’idée fondamentale selon laquelle le marché ne se suffit pas à lui-même. « Les conditions méta-économiques ou extra-économiques qui permettent de protéger le capitalisme à l’échelle du monde » : voilà, pour reprendre leurs termes, ce qui a constitué le cœur de la théorie des néolibéraux du XXè siècle. Ce livre entend montrer que leur projet visait à concevoir des institutions, non pour libérer les marchés, mais pour les encadrer, ou plus précisément les « engainer », pour inoculer le capitalisme contre la menace de la démocratie, en créant un cadre permettant de contenir les comportements humains souvent irrationnels, et réorganiser le monde d’après l’empire comme un espace composé d’Etats en concurrence, où les frontières rempliraient une fonction essentielle[2]. »
Cette approche présente l’immense mérite de rappeler que le néolibéralisme ne croit pas à la rationalité de l’agent et ne croit pas à la possibilité d’une information parfaite ; rien que pour cela, l’ouvrage congédie un nombre considérable d’erreurs que l’on trouve dans énormément de présentations et de discours, et constitue une précieuse explicitation de l’approche néolibérale des comportements humains.
En revanche, nous émettrons de nombreuses réserves quant à la signification de la non-autonomie du marché : si ce dernier suppose en effet des institutions, c’est en vue de le protéger, de sorte que les institutions ne sont pensées qu’à partir d’une protection du marché, la réorganisation des Etats sous la forme de la concurrence étant pensée depuis la protection de certains marchés. De ce fait, il nous semble que l’ouvrage a tendance à commettre un sophisme lorsqu’il avance que le néolibéralisme n’est pas une théorie du marché dans la mesure où le domaine « méta-économique » demeure conditionné par ce que doit être un marché et se trouve décrit selon une téléologie qui est celle de la protection des marchés. Autrement dit, tout le paradoxe tient à ceci : le marché ne peut être libre (non organisé) qu’au prix d’une surorganisation des institutions dont la finalité est de préserver la non-organisation du marché. De surcroît, c’est parce que le marché a un sens mondial que la réflexion sur les institutions adopte elle-même une échelle mondiale, bien au-delà du cadre national. La non-autonomie de marché ne peut donc pas signifier que ce dernier ne constituerait pas le cœur téléologique de la réflexion juridique et institutionnel de la pensée néolibérale.
Certes, l’auteur insiste sur l’idée voulant que les institutions soient orientées vers la protection du marché ; cela est flagrant dès l’introduction :
« A trop se focaliser sur la notion de fondamentalisme de marché, le risque est de ne pas voir que ce qui se trouve réellement au cœur des propositions néolibérales n’est pas le marché en soi, mais la refonte des Etats, du droit et des autres institutions pour le protéger. Les spécialistes du droit ont clairement montré le développement de la juridicisation [sic] du commerce international[3]. »
Mais encore faut-il expliciter le fait que cette « protection » du marché est la protection de son auto-régulation, si bien que l’ouvrage, aussi précis soit-il sur le plan historique, peut parfois jouer sur les mots : il s’agit de réguler une auto-régulation, de sorte que l’auto-régulation du marché n’est pas niée, mais elle est pensée depuis les conditions qui la rendent possible et donc depuis la nécessité d’éviter les perturbations d’une intrusion sur le marché, c’est-à-dire depuis les perturbations que les Etats et les bureaucraties risquent d’introduire au nom d’un prétendu savoir économique.

A : Une compréhension juste et rectifiée du néolibéralisme
- L’épistémologie néolibérale et le refus de la scientificité de l’économie
Le point le plus fondamental de l’ouvrage, nous semble-t-il, tient au fait que l’auteur dissipe toutes les erreurs qui peuvent être faites au sujet de la nature du néolibéralisme à tort associé à une série de prescriptions en matière économique. Quoique non historien des idées, l’auteur semble bien mieux comprendre ce que disent les auteurs néolibéraux que de nombreux spécialistes de ces derniers. L’anthropologie néolibérale – cela se comprend aisément si l’on remonte aux Lumières écossaises – ne repose absolument pas sur un être pleinement rationnel, ni sur un homo economicus dont le concept est à tort attribué à Adam Smith aussi bien dans certaines études « savantes » que dans la presse grand public[4]. Introduit par John Stuart Mill pour critiquer l’économisme, le concept d’homo economicus possède intrinsèquement une dimension critique et péjorative, puisque réductionniste et aveugle à la complexité des hommes et des choses, et ne peut être revendiqué par les néolibéraux. Une fois encore, à l’instar du concept de « capitalisme » créé par Marx et confondu avec une revendication libérale, le vocabulaire s’avère tellement piégé qu’il convient dans un premier temps de dissiper les erreurs qu’il véhicule et qui obstruent la claire intelligibilité du sujet.
A cet égard, c’est le chapitre II qui est essentiel. Intitulé « un monde de chiffres », il prend acte de la crise de 1929 et reconstruit depuis une série d’épisodes empiriques une nécessité inscrite au cœur du néolibéralisme, à savoir l’impossibilité de disposer d’une science économique, et donc de proposer des prédictions quantifiables du champ économique. Autrement dit, contrairement à une série de croyances dont on peine à comprendre comment elles ont pu à ce point se répandre, l’auteur montre et prouve une évidence, à savoir que l’économétrie et la croyance dans une science prédictive au sujet du marché ne peuvent en aucun cas être référées au néolibéralisme. S’il est vrai qu’avant 1929, certains néolibéraux adoptent une certaine dilection pour les statistiques et les « baromètres », le fait est que la Crise met fin à leurs espoirs et crée un scepticisme radical quant à la possibilité de mener une approche quantitative des questions économiques, qu’ils associent de surcroît à un alibi interventionniste : en effet, sur la base d’une fausse compréhension par les nombres des phénomènes économiques, le politique devenu organisateur se croit habilité à déterminer les fins et les moyens de l’action économique. A cet égard, la croyance dans la scientificité de l’économie, après 1929, se voit pleinement combattue par le néolibéralisme aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique.
« Le néolibéralisme, rappelle Q. Slobodian, est né de projets d’observation du monde, de la collecte de statistiques mondiales et d’enquêtes internationales sur les cycles économiques. Pourquoi l’historiographie ignore-t-elle si souvent cette réalité ? En partie parce que les néolibéraux tireront comme conclusion de la crise de 1929 et de ses conséquences que les chiffres, à eux seuls, ne suffisent pas. Alors même que les techniques de planifications gagnent du terrain à la fois à Genève et auprès des économistes du courant dominant à la fin des années 1930, les néolibéraux acquièrent la conviction que ni les statistiques, ni les mathématiques, ni la science naissante de l’économétrie ne suffiront à prévoir ou à éviter les crises futures. La sophistication croissante de ces approches pourrait même, de manière contre-intuitive, en entretenant la croyance en une science qui protégerait l’économie mondiale, augmenter la probabilité d’une nouvelle crise[5]. »
On comprend ici un enjeu essentiel à double entrée : sur le plan épistémologique s’impose le refus de traiter l’économie de manière positiviste. Les statistiques ou les fameux « baromètres » ne donnent pas de véritables faits et ne rendent en aucun cas possible la détermination de lois dont pourraient être tirées de prédictions. Ainsi, toute la visée saint-simonienne d’une organisation du monde économique depuis un prétendu savoir prédictif en la matière se trouve violemment contestée d’abord et avant tout pour des raisons épistémologiques : un tel savoir n’existe pas. Mais il est également contesté pour des raisons pratiques : agir sur la base d’un savoir faux, c’est-à-dire viser délibérément des objectifs en matière économique à l’échelle globale à partir de fausses lois, c’est prendre le risque de perturber gravement les précaires équilibres du marché. Ainsi donc, la formation de l’économétrie – de la mesure de l’économie en tableaux et statistiques – et de la croyance de la dimension pleinement scientifique de l’économie, ne correspond pas à l’approche néolibérale, en tout cas après 1929, et Q. Slobodian a parfaitement raison de rappeler ce fait :
« A la fin des années 1930, les néolibéraux de l’école de Genève s’accordent sur l’idée que la représentation ou la compréhension des principaux fondements de l’intégration économique ne passent pas par des graphiques, des tableaux, des cartes ou des formules. Ils redirigent leur attention vers les liens culturels et sociaux, mais aussi vers les cadres de la tradition de l’Etat de droit, qu’ils perçoivent comme sur le point de se désintégrer[6]. »
- Le discours de réception du Prix Nobel et l’introuvable « gouvernance par les nombres »
Fondamental, ce point l’est d’autant plus que, chez de nombreux auteurs contemporains, peut être observée une sorte d’incompréhension du refus néolibéral de l’acteur rationnel, conduisant à d’étranges remarques quant à l’influence néolibérale dans le développement de l’économétrie.
Mais, de manière plus insidieuse, on peut également trouver des suggestions qui, tout à la fois, ne disent pas explicitement que les néolibéraux adoptent une approche quantitative et prédictive du monde économique, et en même temps opèrent des rapprochements plus que tendancieux – et même trompeurs. Un cas particulièrement significatif est celui d’Alain Supiot qui, dans la Gouvernance par les nombres, rappelle opportunément qu’Hayek, « ne croyant pas à l’ « acteur rationnel » en économie, (…) se fiait à la sélection naturelle des systèmes juridiques, par la mise en concurrence des droits et des cultures à l’échelle internationale[7]. » Mais, voulant réhabiliter le concept même de « justice sociale », A. Supiot fait des néolibéraux en général et d’Hayek en particulier un adversaire, ce qui l’amène à suggérer qu’il y aurait un lien entre « gouvernance par les nombres », néolibéralisme et restriction du champ démocratique, ainsi qu’en témoignent des passages de ce type :
« Contrairement à l’optimisme de ceux qui identifient démocratie et quantification, l’emprise de la gouvernance par les nombres s’accompagne d’une restriction du périmètre de la démocratie. Ce point est essentiel dans la pensée de Hayek qui, après Lénine, appelait à son tour à « détrôner la politique »[8]. »

Le passage est remarquablement ambigu, et nous passerons rapidement sur le rapprochement plus qu’insidieux entre Lénine et Hayek qui vise essentiellement à produire des effets s’écartant ainsi d’une approche véritablement rigoureuse. Plus fondamentalement, A. Supiot, dans la même phrase, associe l’emprise de la gouvernance par les nombres et la volonté de réduire le périmètre de la décision politique et démocratique. Certes, il a l’habileté de ne prêter explicitement à Hayek que la volonté de réduire l’extension de la démocratie mais la construction générale du paragraphe donne l’impression que c’est parce qu’il y a défense d’une approche quantitative de l’économie qu’il y a réduction du champ politique. Ainsi, par la suggestion, A. Supiot fait d’Hayek un sectateur de la réduction du monde au nombre faisant advenir le triomphe de la gouvernance sur le politique. Or, si A. Supiot a parfaitement raison de pointer à quel point se trouve chez Hayek une volonté de préserver le champ économique de l’interventionnisme des Etats et donc de réduire la puissance du politique, il suggère en revanche par les associations quelque chose de trompeur, à savoir qu’Hayek serait lié à une forme de réduction quantitative de l’économie, ce qui n’est pas écrit de manière explicite mais qui est insidieusement suggéré par les rapprochements de concepts et de noms propres.
On comprend ici un biais considérable de nombreuses études, à savoir que dans beaucoup d’ouvrages le néolibéralisme n’est pas tant un courant intellectuel qu’un ennemi à combattre ; à cet égard, nombre d’auteurs s’autorisent bien des approximations, bien des suggestions et contribuent ainsi à créer une espèce de confusion conceptuelle autour d’une pensée qui est tout à la fois censée être explicative du cours du monde depuis une quarantaine d’années et en même temps coupable de ses dysfonctionnements.
Pourtant, une attention aux écrits et aux discours d’Hayek, certes doublée d’une probité minimale, révèlerait que ce dernier n’a cessé de condamner le pseudo-savoir fondé sur les nombres, et a même fait de cette condamnation le cœur de son discours de réception du prix Nobel d’économie en 1974. Tout entier fondé sur une dichotomie entre savoir de la physique et savoir de l’économie, Hayek y avait opposé la légitimité de la réduction de la physique à la mesure de quantité à l’illégitimité d’une saisie de la vie économique depuis les nombres et la mesure. Condamnant la plupart de ses confrères, il s’était laissé aller à de sévères critiques contre le tournant quantitatif qu’avait pris l’économie :
« Or, tandis que dans les sciences physiques le chercheur sera capable de mesurer ce qui, sur la base d’une théorie à première vue, il estime important, dans les sciences sociales ce que l’on traite comme important est souvent ce qui se trouve à être accessible à la mesure. On pousse parfois ce parti pris à tel un point que l’on exige que nos théories soient formulées en des termes tels que celles-ci se réfèrent uniquement à des grandeurs mesurables. On peut difficilement nier qu’une telle exigence limite tout à fait arbitrairement les faits qu’il y a lieu d’admettre comme des causes possibles pour les événements qui se produisent dans le monde réel.
Cette opinion, dont on admet souvent très naïvement qu’elle serait voulue par la procédure scientifique, a des conséquences plutôt paradoxales. Nous connaissons, bien sûr, à propos du marché et autres formations sociales similaires, un très grand nombre de faits que nous ne pouvons pas mesurer et à propos desquels nous n’avons qu’une information très imprécise et générale. Et comme, dans n’importe quelle situation particulière, les effets de ces réalités-là ne peuvent pas être confirmés par des observations quantitatives, ils sont tout simplement méconnus par ceux qui ont juré de n’admettre que ce qu’ils considèrent comme des preuves scientifiques : ceux-ci poursuivent alors joyeusement à partir de la fiction selon laquelle les facteurs qu’ils peuvent mesurer seraient les seuls qui seraient pertinents[9]. »
La simple lecture de ce discours dissiperait de fort nombreuses erreurs au sujet du néolibéralisme et permettrait de comprendre que le refus de la pleine scientificité de l’économie et donc d’une « gouvernance par les nombres » se trouve au cœur du projet néolibéral.
B : Le colloque Lippmann
- Enjeu du colloque
Un des points marquants de l’ouvrage de S. Quinn est également celui de son analyse du colloque Lippmann. Le public français, grâce aux écrits de Serge Audier qui en a réédité les actes[10], est sans doute familier de cet événement parisien de 1938 où se sont retrouvés des auteurs d’inspiration libérale aux aspirations toutefois fort contrastées. Or, si une étude comme celle de Serge Audier vise à déterminer l’origine d’un courant – le néolibéralisme – celle de Q. Slobodian vise bien plutôt à inscrire ce colloque dans la recherche d’une formulation unifiée des conséquences de l’épistémologie néolibérale. Autrement dit, en 1938, et notamment en raison de la crise de 1929, tous ceux qui deviendront les néolibéraux ont pris acte de la non-scientificité de l’économie, et cherchent à en tirer les conséquences, aussi bien sur la nature des marchés que sur le type d’interventions dont les Etats sont dépositaires.
Or, il faut reconnaître à Q. Slobodian une pénétration des enjeux de ce colloque très largement supérieure à celle des autres auteurs que l’on peut habituellement lire sur le sujet. En vertu de sa thèse générale, Q. Slobodian comprend d’emblée que l’enjeu central du colloque n’est pas spécifiquement économique puisque le néolibéralisme n’est pas une théorie exclusive du marché ni et encore moins une théorie économique, mais est une réflexion sur les limites de la connaissance, de l’information et de l’irrationalité humaine, conduisant à une réflexion sur les institutions.
Cela est patent quand on lit l’introduction du colloque par Louis Rougier dont le vocabulaire et la conceptualité ne font aucun doute. Célébrant La cité libre de Lippmann[11] auquel est consacré le colloque, le conférencier situe d’emblée l’enjeu de la discussion : celle-ci n’est pas tant économique que spirituelle :
« Ce livre n’est pas seulement un très beau livre, lucide et courageux : c’est un maître-livre, un livre clé, parce qu’il contient la meilleure explication des maux de notre temps. Ces maux sont avant tout d’ordre spirituel[12]. »
Rougier évoque ainsi un « drame moral[13] » et indique les enjeux fondamentaux du livre de Lippmann qui concernent le cadre juridique et institutionnel dans lequel les Etats peuvent intervenir. Et Rougier d’ajouter :
« On peut reconnaître un troisième mérite au livre de Walter Lippmann : c’est de réintégrer les problèmes économiques dans leur contexte politique, sociologique et psychologique, en vertu de l’indépendance de tous les aspects de la vie sociale. L’économie pure raisonne sur des modèles théoriques, qui impliquent des hypothèses simplificatrices, toujours éloignées de la réalité confuse et complexe. La science (ne doit pas oublier que l’analyse n’est faite qu’en vue de la synthèse ; elle doit, en compliquant les hypothèses, en réintroduisant les connexions entre les différents groupes de phénomènes sociaux, retrouver la réalité dans son illogisme et sa profusion[14]. » Et suit aussitôt une critique sévère de l’homo economicus qui, là aussi, devrait ruiner toute attribution de ce concept aux auteurs néolibéraux :
« En partant de l’homo economicus, qui agit de façon purement rationnelle au mieux de ses intérêts, elle doit retrouver l’homme de chair, de passion et d’esprit borné qui subit des entraînements grégaires, obéit à des croyances mystiques et ne sait jamais calculer les incidences de ses actes[15]. »
Ainsi se découvre dès l’ouverture du colloque la nature fondamentale du néolibéralisme : un refus de l’économisme, une prise en compte de la complexité humaine strictement irréductible à l’homo economicus et la nécessité d’une réflexion institutionnelle sur les cadres de l’intervention de l’Etat, mais aussi sur la psychologie des individus.

- L’intervention d’Hayek
De ce cadre où apparaît une inquiétude « spirituelle » selon le mot de Rougier, nous pouvons en réalité mieux cerner la nature des inquiétudes néolibérales qui ont quelque chose d’anthropologique, et qu’Hayek dans son intervention au colloque permet de parfaitement comprendre. S’appuyant sur une épistémologie rappelant l’imperfection de la connaissance et de l’information, et l’irrationalité des agents, Hayek en tire les conséquences, à savoir d’une part que la prétendue « concurrence pure et parfaite » n’existe pas, et d’autre part que les marchés sont extrêmement vulnérables en raison d’un problème central qu’est la vanité humaine. Autrement dit, le néolibéralisme est d’abord et avant tout une inquiétude face à la vanité humaine qui, n’acceptant pas de ne pas savoir, croit détenir un savoir positif et prédictif quant à ce qu’il faudrait faire économiquement à l’échelle macro-économique. Il y a donc ce que l’on pourrait appeler une dimension moraliste du néolibéralisme qui amène une inquiétude face aux comportements vaniteux d’élites qui placent leur orgueil dans un savoir introuvable depuis lequel elles prétendent régir de manière organisationnelle la vie économique à très grande échelle. Le fameux article consacré à l’orgueil scientiste des polytechniciens[16] présente ainsi des résonances de moralistes du Grand Siècle : il y a de la vanité et du ridicule à croire que l’on détient un savoir inexistant et que l’on est habilité à diriger la vie des hommes sur la base de ce pseudo-savoir. La vanité est ici tout autant épistémologique que morale.
A cet égard, nous arrivons au point fondamental du problème, à savoir celui de l’utilité de l’ignorance selon une formule désormais célèbre. Un marché est un lieu où se rencontrent des ignorants – en matière économique – dont on ne peut prédire l’issue des transactions, et dont toute prétention en la matière relève la fraude intellectuelle.
« Pour Hayek, dans la réalité, les marchés parfaits n’existent pas. Ils ne peuvent pas exister parce que la connaissance parfaite n’existe pas. Au lieu de cela, il faut partir de ce que, citant Mises, il appelle la « division de la connaissance », par analogie avec la division du travail. Il rejette l’idée des économistes que « seule (…) la connaissance des prix » serait nécessaire. Il se démarque nettement de la vision barométrique et du rôle pédagogique dévolu initialement à l’institut de recherche viennois, et aussi de l’idée même du cycle comme objet central de recherche. En 1937, Hayek commence à développer une idée qu’un spécialiste de sa pensée a qualifiée de caractéristique essentielle de sa philosophie : l’utilité de l’ignorance. Pour lui l’équilibre est possible uniquement « parce que certaines personnes n’ont aucune chance d’apprendre des faits qui, s’ils les connaissaient, les inciteraient à modifier leurs plans. » Il conclut non seulement que l’idée de connaissance parfaite est une conception tautologique inapplicable à la réalité, mais aussi qu’elle passe à côté de l’élément fondamental, à savoir que c’est l’imperfection de la connaissance, non sa perfection, qui crée l’équilibre sous la forme d’un ordre économique[17]. »
Il faut ici distinguer deux choses, à savoir d’un côté la croyance d’Hayek dans la possibilité d’un équilibre du marché – croyance qui peut être contestée – et de l’autre la reconstitution de la pensée d’Hayek, à savoir que tout part de l’incertitude et de l’ignorance, incertitude et ignorance qui s’avèrent irréductibles. Et tout commentateur d’Hayek se devrait de partir de ce principe pour le comprendre afin de ne pas lui attribuer des idées qui ne sont pas les siennes.
Que devient alors l’économie si elle perd ses vertus prédictives et si sa scientificité est mise en doute ? La fonction fondamentale de l’économie est de comprendre comment des individus s’adaptent à des données sur lesquelles ils n’ont pas d’informations ; de ce fait, l’économiste ne peut pas éclairer le public : au mieux on peut enregistrer une activité autonome mais certainement pas comprendre le système pensant et ainsi anticiper les résultats des interactions. Tout est en somme tourné contre l’illusion du contrôle que nous interpréterions volontiers comme une critique moraliste de la vanité des « organisateurs » et qu’Hayek symbolise par la figure du polytechnicien croyant que toute réalité est à organiser sur la base d’un savoir prédictif. En matière économique, un tel savoir n’existe pas et constitue une illusion que seule la vanité humaine permet d’expliquer.
Mais il manque un point, à savoir que le marché ne saurait être omni-englobant. Pour le dire autrement, nul n’est plus conscient qu’un néo-libéral de l’existence de zones hors-marché, où donc se jouent des besoins que la rencontre marchande ne saurait satisfaire. C’est là l’un des enjeux centraux du Colloque Lippmann de 1938 comme le rappelle Q. Slobodian :
« C’est ainsi que le colloque Lippmann de 1938 débouche sur une vision normative du monde dans laquelle le mode d’intervention le plus pertinent ne réside pas dans la mesure, l’observation ou la surveillance, mais dans l’établissement d’une loi commune et applicable et d’un moyen de prendre en compte les besoins vitaux de l’humanité non couverts par le marché. En plaçant l’économie au-delà de l’espace de la représentation (et, pour Hayek, au-delà même de la raison), le néolibéralisme naît à la fin des années 1930 comme un projet de synthèse des sciences sociales dans laquelle, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’économie est la moins importante des disciplines.
Bien que né de projets de collectes de données et de statistiques mondiales, le néolibéralisme de l’école de Genève ne consiste pas à visualiser l’économie mondiale, mais à déclarer son invisibilité (…). Le néolibéralisme de Genève se constitue ainsi en tant que théologie négative. Son programme consiste à concevoir les bonnes institutions pour engainer l’économie mondiale sans pour autant la décrire[18]. »
- Une limite de l’analyse : le problème fabien
Un des points les plus complexes du colloque Lippmann est la pensée de Lippmann et sa compatibilité avec le libéralisme. En toute rigueur, pour qui connaît Hayek et Mises, le lien intellectuel avec Lippmann paraît particulièrement difficile à établir. A cet égard, Q. Slobodian présente le mérite de mettre en évidence l’incongruité totale de la rencontre de 1938 puisque Lippmann est un penseur de l’organisation coercitive, depuis l’eugénisme en passant par les travaux publics, jusqu’aux espaces de loisirs urbains, le tout financé par des taxes sur les riches.
« Le plus surprenant dans le livre de Lippmann et le colloque organisé pour en discuter est l’enthousiasme qu’ils rencontrèrent de la part de penseurs comme Röpke et Hayek, par ailleurs sceptiques à l’égard de ce type d’intervention et de redistribution[19]. »
Il faut en effet comprendre qui est Walter Lippmann et de quelle mouvance il est issu. Lecteur assidu d’auteurs fabiens, c’est-à-dire socialistes favorables à la suppression de la propriété privée par des « réformes » sur le temps long et non par une révolution subite et violente, disciple à Harvard de Graham Wallas, économiste socialiste d’inspiration fabienne, il créa le Harvard Socialist Club en 1908 dont il devint par la suite président. Journaliste, il contribue à créer le journal New Republic qui est un journal de gauche, encore marqué par l’influence socialiste des Fabiens. De ce fait, Walter Lippmann est un penseur de l’organisation, et donc de l’interventionnisme. Mieux encore : quand il introduit le concept de « grande association », il le reprend à son maître fabien, c’est-à-dire à Graham Wallas qui fut un temps le maître à penser économique des fabiens.
Mais justement : nous touchons là une limite fondamentale de l’ouvrage de Q. Slobodian à savoir sa cécité à l’égard du problème fabien. Enormément d’auteurs qu’il mentionne, depuis Wells jusqu’à Lippmann, en passant par Wallas, sont des socialistes, voire des léninistes comme Wells. Tous ces auteurs ne sont pas nécessairement restés pleinement fidèles au fabianisme qui avait ceci de particulier qu’il était protectionniste, mais tous ont conservé une visée socialiste à l’échelle mondiale que la création de la London School of Economics avait pour mission de favoriser. N’oublions pas que Wells, outre ses livres de science-fiction, fut l’auteur de nombreux essais politiques, dont les deux plus connus sont The New World Order de 1940 défendant une planification socialiste fondée sur la un savoir scientifique de l’économie mondiale, et The Open Conspiracy de 1928 défendant un contrôle de la vie humaine en vue de son organisation optimale.
Par conséquent, en ne nommant pas l’origine ou l’appartenance fabienne d’un grand nombre d’interlocuteurs, Q. Slobodian passe à côté d’un enjeu central, à savoir du caractère en partie socialiste et organisationnel du colloque de 1938. Certes, Q. Slobodian comprend que Lippmann et Hayek n’ont, sur le papier, rien à voir et à ce titre il fait preuve de bien plus de lucidité que Serge Audier qui s’étonne des réserves d’Hayek à l’endroit du colloque Lippmann dans son autobiographie. Très curieusement, S. Audier semble en effet étonné par les réticences de l’auteur de La route de la servitude à l’endroit de l’événement de 1938 :
« Pour réfléchir à la postérité du colloque Lippmann, on ne peut faire l’impasse sur un fait hautement significatif : longtemps, très longtemps, Hayek a occulté l’importance du colloque Lippmann, ainsi que l’apport de Rougier et Lippmann. Ainsi, dans ses textes autobiographiques, lorsqu’il évoque la création de la Société du Mont Pèlerin, il omet fort curieusement de mentionner le Colloque Lippmann ainsi que le nom de Rougier. Même étrange « oubli » lors de « l’allocation d’ouverture d’un colloque à Mont Pèlerin. (…). Non moins incroyable est l’absence de mention du Colloque Lippmann dans la première version d’un article de 1951 en hommage à son maître Mises, consacré précisément à la « transmission des idéaux de la liberté économique »[20]. »
Mais justement, il n’y a rien là d’ « incroyable » : Lippmann, en dépit de son tournant libéral, a conservé quelque chose du collectivisme fabien et a toujours pensé le monde selon une nécessité organisationnelle reposant elle-même sur un prétendu savoir scientifique ; de même, Louis Rougier, très proche du positivisme du cercle de Vienne, a toujours développé de nettes dilections saint-simoniennes de type organisationnel, faisant de lui un penseur protectionniste et nationaliste parfaitement compatible avec le fabianisme. A cet égard, des auteurs comme Hayek et Mises ne peuvent qu’être gênés par le compagnonnage de ce type de penseurs qui se situent aux antipodes de leurs idées quant aux principes fondamentaux. Ne pas évoquer le colloque Lippmann, pour Hayek, ne constitue donc pas une occultation des moments fondateurs mais signale bien plutôt un embarras à l’endroit d’une genèse trouble du néolibéralisme, ce que comprend fort bien Q. Slobodian bien que ce dernier n’identifie pas le point commun d’un grand nombre d’auteurs qui gravitent autour des néolibéraux et qui, peut-être même, déterminent une genèse organisationnelle de ce courant.
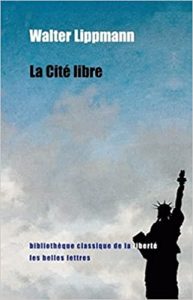
C’est pourquoi, alors même que sont mentionnés par Q. Slobodian des penseurs comme Wallas, Wells et Lippmann, et que n’est pas évoquée leur appartenance fabienne – au moins initiale – nous émettons une vive réserve : tout l’ouvrage vise à montrer que si le marché pour un néolibéral ne doit pas être organisé, les institutions, elles, doivent l’être et ce à l’échelle mondiale. Mais précisément : pourquoi ne pas évaluer ce que cette pensée de l’organisation institutionnelle à l’échelle mondiale doit à des penseurs socialistes formés dans les cercles fabiens favorables à une pensée organisationnelle ? Pourquoi ne pas sonder le poids de la pensée organisationnelle fabienne dans la détermination de la pensée néolibérale ? Il faut ici se rappeler que lorsque des gens comme Lippmann prennent leurs distances à l’endroit de la pensée fabienne, ce n’est pas pour s’éloigner du socialisme organisationnel, mais c’est pour s’éloigner du nationalisme et du protectionnisme qui se trouvaient au cœur du projet fabien, à rebours des autres courants socialistes de l’époque. Il y a donc, dès 1938, d’évidentes marques de la pensée organisationnelle en plein cœur d’un néolibéralisme en devenir, et cela devrait conduire à une réflexion sur les rapports réels entre le néolibéralisme et le fabianisme et, plus généralement, le saint-simonisme. Nous regrettons que cet aspect-là ne soit pas mentionné par l’auteur.
Néanmoins, si la question fabienne n’est pas thématisée comme telle, la dimension problématique d’un lien entre Hayek et Mises d’un côté, et Lippmann ou Rougier de l’autre est clairement mise en avant. S’ils ne partagent pas un socle de principes communs, sans doute se rencontrent-ils sur un adversaire commun. Cet adversaire c’est assurément l’Etat démocratique, qui dans toutes les nuances saint-simoniennes constitue un problème sans fin : en effet, dans une perspective pour laquelle la science permettrait d’organiser de manière optimale les rapports humains et la vie économique, la libre décision du vote introduit un élément de perturbation de l’organisation du monde. C’est pourquoi le saint-simonisme, dans ses développements, constitue une démarche de neutralisation des effets du vote, voire de neutralisation du vote lui-même. C’est dans ce sillage que Lippmann forge l’idée d’un Manufacturing Consent dans les années 1920 permettant de limiter la spontanéité des opinions et des votes ; en revanche, Hayek ou Mises, éloignés au possible du saint-simonisme, ne craignent pas tant la désorganisation issue du vote que la confiscation de la propriété privée par le vote[21]. C’est pourquoi, des auteurs aux principes fort différents se retrouvent dans la volonté de réduire la puissance même du politique en général, et du vote en particulier, formant une alliance objective contre ceux-ci, et qui fera l’objet de l’analyse de la prochaine partie.
Quinn Slobodian : Les globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme (partie 2)
[1] Quinn Slobodian, Les globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme, Traduction Cyril le Roy, Paris, Seuil, 2022
[2] Ibid., p. 12.
[3] Ibid., p. 16.
[4] Parmi mille autres références, mentionnons celle-ci : https://www.challenges.fr/magazine/le-nouvel-homo-economicus-leur-theorie_342349
[5] Ibid., p. 71-72.
[6] Ibid., p. 72.
[7] Alain Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France, 2012-2014, Paris, Fayard, 2015, p. 207.
[8] Ibid., p. 263.
[9] Friedrich Hayek, The Pretence of Knowledge, le texte est traduit en ligne https://fr.liberpedia.org/The_Pretence_of_Knowledge et se trouve aussi dans Friedrich A. Hayek, Nouveaux essais de philosophie de science politique, d’économie et d’histoire des idées, Traduction Christophe Piton, Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. 53-68. Le texte cité se trouve p. 54-55.
[10] Serge Audier, Le colloque Lippmann. Aux origines du « néolibéralisme », Lormont, Poch’BDL, 2012.
[11] Cf. Walter Lippmann, La Cité libre, Traduction Georges Blumberg, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
[12] « Allocution du professeur Louis Rougier », in Serge Audier, op. cit., p. 413.
[13] Ibid., p. 414.
[14] Ibid., p. 416.
[15] Ibid.
[16] Cf. Hayek, The Counter-Revolution of Science, Liberty Fund, 1952, chap. XI, traduction française ici : https://www.catallaxia.org/wiki/Friedrich_A._Hayek:La_source_de_l%27orgueil_scientiste
[17] Q. Slobodian, op. cit., p. 97.
[18] Ibid., p. 101.
[19] Ibid., p. 93.
[20] Audier, op. cit., p. 378-379.
[21] C’est sur ce point qu’insiste avec raison A. Supiot lorsqu’il met en avant le concept de « démocratie limitée » cher à Hayek. Cf. entre autres La gouvernance par les nombres, op. cit., p. 312.








