Le dernier ouvrage de Pierre Guénancia consacré à Descartes, Descartes, chemin faisant1 rassemble plusieurs articles de l’auteur en vue de penser le cartésianisme sous l’angle de la raison et de ses aspects les plus divers, soit de comprendre comment la raison cartésienne désigne cette aptitude plastique, apte à s’adapter à toutes les situations. « Le fil conducteur de toutes ces études, écrit Guénancia, est l’idée d’une application différenciée de la raison à des questions qui ne peuvent pas être comprises ni étudiées comme celles de la métaphysique. »2 Trois parties structurent l’ouvrage, une première consacrée à la connaissance et à l’imagination, une deuxième dévolue à la subjectivité et une troisième plus éclatée où se retrouvent à la fois des études portant sur le rapport de certains contemporains (Elisabeth) ou écrivains (Paul Valéry) à Descartes, ainsi que sur la place de Descartes dans la métaphysique. Il ne serait pas exagéré de dire que chacun de ces articles constitue une petite pépite, claire et modeste, contribuant avec bonheur à l’intelligibilité de la pensée cartésienne, sur des points que la doxa commentariste a souvent recouverts d’un voile trompeur d’évidence.
A : Connaître
Le premier aspect de la pensée cartésienne auquel se consacre Pierre Guénancia est, sans aucun doute, la manière dont l’esprit connaît et par laquelle il va induire un renversement sémantique et conceptuel d’un certain nombre de termes, au premier rang desquels figurent la nature et l’expérience. La science ne se contente plus, au XVIIème siècle, d’identifier des causes, elle cherche à les reproduire ; elle devient, pour le dire simplement, une technique. Dès lors, l’opposition entre le naturel et l’artificiel perd de sa pertinence puisque ce qui est naturel désigne précisément ce qui peut faire l’objet d’une reproduction artificielle. « La thèse désormais admise sans difficulté de la réversibilité de l’art et de la nature, de l’artificiel et du naturel, est le résultat de la réduction des quatre causes aristotéliciennes à la seule cause qui soit pleinement cause, celle qui produit un effet différent d’elle et lui confère, outre l’existence, la capacité ou la puissance de s’y maintenir. »3 Le mécanisme sera le nom d’une telle science, capable de reproduire ce qui a été compris de la nature.
Mais à peine avons-nous dit cela qu’émerge la redoutable question de l’homme : connaît-on l’homme comme l’on connaît la nature ? L’homme constitue-t-il un être naturel soumis à la force désormais technicienne de la science mécanique ? Cela revient à se demander si l’on peut rendre intégralement compte de l’homme par la simple nature ; à cette question, la réponse de Guénancia est claire et sans équivoque : l’homme ne se laisse pas réduire à la nature, le naturalisme ne guette nullement le mécanisme cartésien. « L’homme ne peut pas être pour Descartes cette partie de la nature qu’il est chez ontologiquement chez Spinoza. Il n’est pas relié par une grande chaîne à l’ensemble des êtres de la nature avec lesquels il ne formerait qu’un seul tout. Aucune teinture de naturalisme ne colore l’idée cartésienne de l’homme. »4 Si donc la nature échoue à rendre intégralement compte de l’homme, il faut introduire un deuxième principe à l’origine de ce dernier, principe qui ne saurait être autre que Dieu. De manière très classique, mais également très juste, P. Guénancia peut donc attribuer le fonctionnement des corps à la nature et le fonctionnement de l’âme à Dieu, dont il résume ainsi l’enchaînement : « Schématiquement, nous dirons que Dieu impute plutôt à la nature la production et le fonctionnement des choses corporelles – tout ce qui peut et doit s’expliquer mécaniquement, par figures et mouvements, et plutôt à Dieu ce qui a trait à l’âme humaine, seul être « naturel » capable d’entendre et de vouloir. L’âme est expressément créée par Dieu, elle ne procède pas, comme les choses matérielles, de la puissance de la nature (ou de la matière). »5
Moins classique en revanche me semble être la mise au point qu’effectue l’auteur autour des animaux : il serait tentant en effet, dans une perspective maintes et maintes fois assénée, de poser entre l’homme doté d’une âme et l’animal, entièrement réductible au mécanisme naturel, une sorte de région de dissemblance, qui établirait entre eux un infranchissable fossé. Beaucoup plus subtile est la thèse de Guénancia, remarquant avec raison que rien ne permet de dire que Descartes refuse aux animaux l’âme ou la pensée mais que, bien plutôt, il ne voit aucune raison de la leur attribuer, ce qui constitue une nuance de grande importance. En d’autres termes, la différence entre l’homme et l’animal tient moins à une péremptoire affirmation ontologique qu’à une hésitation épistémologique : en l’absence de preuves – en fait, le langage – rien ne permet de dire qu’un animal pense, ni qu’il a une âme ; mais il s’agit là d’une prudence ou d’une hésitation bien plus que d’une affirmation instaurant un fossé ontologique. Une telle lecture est largement corroborée par un certain nombre de lettres, dont celle du 5 février 1649 adressée à Morus dans laquelle Descartes écrit clairement : « quoique je regarde comme une chose démontrée qu’on ne saurait prouver qu’il y ait des pensées dans les bêtes, je ne crois pas qu’on puisse démontrer que le contraire ne soit pas, parce que l’esprit humain ne peut pénétrer dans leur cœur (illorum corda) pour savoir ce qui s’y passe. Mais en examinant ce qu’il y a de plus probable là-dessus, je ne vois aucune raison qui prouve que les bêtes pensent, si ce n’est qu’ayant des yeux, des oreilles, une langue, et les autres organes des sens tels que nous, il est vraisemblable qu’elles ont du sentiment comme nous, et que comme la pensée est enfermée dans le sentiment que nous avons, il faut attribuer au leur une pareille pensée. »6
Toutefois, si l’on accepte l’hypothèse cartésienne – qui n’est qu’une hypothèse – il faut encore comprendre comment une machine corporelle dénuée d’âme, pourrait sentir, agir, voire pâtir. En d’autres termes, il faut comprendre comment une machine purement mécanique fonctionne. La solution de Guénancia est séduisante, elle consiste à remarquer qu’une bête peut sentir ou agir sans âme, ce que Descartes affirme du reste dans la lettre du 5 février 1649 : « dans le corps des animaux, ainsi que dans les nôtres, il y a des os, des nerfs, des muscles, du sang, des esprits animaux, et autres organes disposés de telle sorte qu’ils peuvent produire par eux-mêmes, sans le secours d’aucune pensée, tous les mouvements que nous observons dans les animaux. »7 En d’autres termes, l’animal peut agir et sentir comme l’homme, même s’il ne dispose pas d’une pensée, ce qui signifie alors que l’âme humaine sert moins à sentir et agir qu’à penser que l’on sent et que l’on agit. Cette distinction entre l’homme et l’animal réside donc dans la capacité réflexive de l’homme, dans cette faculté à réfléchir le sentir, l’action et la passion, par un examen de l’esprit dont l’animal est, selon toute probabilité, dénué.
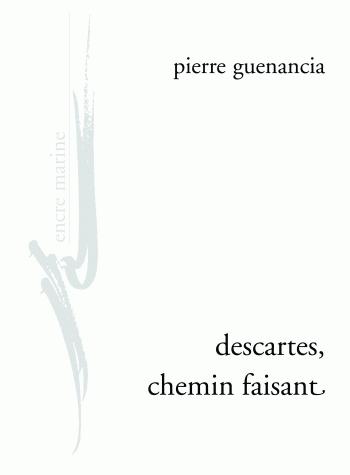
Connaître peut donc être conçu comme le corrélat de cette capacité à se tourner vers soi, par laquelle l’esprit découvrira les idées contenues en lui. L’idée peut ainsi désigner tout ce qui se trouve dans notre esprit, tout ce à quoi pense ce dernier. L’explication que fournit alors l’auteur quant aux idées s’avère être une des plus limpides que l’on puisse lire sur le sujet, d’une part grâce à son insistance sur le mode d’être des idées dont il rappelle qu’elles ne sont en rien des copies du monde sensible à partir desquelles nous connaîtrions, et d’autre part grâce à la description de celles-ci comme d’êtres spirituels dont l’existence en dehors de la pensée est nulle. L’idée d’une chose n’est donc pas le redoublement mental d’une chose, ni la duplication de celle-ci dans l’esprit, mais bien plutôt un mode de la pensée elle-même, à telle enseigne que P. Guénancia appréhende la réalité objective non comme une propriété des idées mais comme leur définition. A cet égard, l’idée, en tant qu’elle représente la réalité, peut parfaitement se substituer à elle, en dépit de ses insuffisances, et constituer pour l’entendement cela même qui le guidera vers la connaissance indubitable. « L’important, écrit alors Guénancia, c’est que l’idée soit non seulement la seule donnée indubitablement présente dans l’entendement, mais qu’elle soit reconnue comme « nature » et qu’à ce titre elle puisse faire office de règle, et de seule règle, pour l’entendement. »8
B : Le sujet plutôt que la subjectivité
La deuxième partie de l’ouvrage va s’attaquer à la redoutable question de la subjectivité, à partir de textes de Foucault dont il s’agira moins d’évaluer la pertinence quant à leur application à la pensée cartésienne que d’en jauger la fécondité philosophique. D’emblée, Guénancia évacue la question du bien-fondé des analyses foucaldiennes pour annoncer l’évaluation de leur profondeur : « Il me paraît donc stérile et vain de se demander (ou de feindre de se demander) si la lecture que Foucault fait de Descartes est une lecture fidèle ou exacte comme si l’on ignorait que son projet n’est pas d’expliquer Descartes mais de faire une estimation de la portée de la pensée cartésienne dans la perspective, propre à Foucault, d’une histoire de la subjectivité. »9 La critique de Foucault à l’encontre de Descartes est connue, elle consiste à regretter l’abstraction du cogito, délaissant toute interrogation sur le soi au profit d’un questionnement quelque peu asséché sur la connaissance, elle-même objet de la philosophie. Cela revient à dire que la pensée cartésienne anéantirait toutes les formes d’exercice spirituel incitant à la transformation de soi, et ce précisément par oubli du soi. C’est sur ce point très précis que va porter la réponse de Guénancia, là encore parfaitement convaincante : « La méthode cartésienne s’apparente bien plus à un exercice ou une ascèse, à une discipline de la volonté, à une culture prolongée de l’attention qu’à un mode d’emploi de règles objectives. En tant qu’elle est discipline de l’esprit, la méthode (comme la science) est l’institution par le sujet d’un rapport à lui-même, qui n’est pas précisément de l’ordre de la connaissance de soi mais plutôt de l’ordre de la maîtrise, du pouvoir sur soi, de l’exercice entendu aussi bien comme pratique quotidienne et même comme jeu que comme ascèse. »10
Mais là n’est pas le plus intéressant ; c’est la distinction qu’introduit l’auteur à partir de la générosité qui constitue, à mes yeux, l’outil spéculatif le plus efficient : Guénancia distingue en effet la subjectivité du sujet, en ceci que la générosité permettrait de dépasser la subjectivité par le sujet et de réduire nettement la force du souci de soi : la générosité « se situe selon nous très au-delà du souci ou de l’amour de soi. Elle réalise la synthèse de la force de la passion ou de l’émotion et de la légitimité de l’objet de cette passion. »11 Au lieu d’entretenir un rapport immédiat à soi, la générosité permettrait de se rapporter à soi mais avec distance, avec médiation, et la préservation d’une telle distance de soi à soi serait la condition de la vraie justice. Cela revient à dire que Foucault a écrasé le soi sur la subjectivité, sans jamais parvenir à libérer le sujet, faute d’une conceptualisation suffisante de cette distance de soi à soi dont Descartes nous donne déjà les clés. D’où cette conclusion à la fois subtile et pertinente : « En ce sens, la mort de l’homme pourrait bien être la condition de possibilité d’une expérience de la subjectivité comme telle, c’est-à-dire libérée de la forme, encombrante et ennuyeuse pour Foucault, du sujet. Il faut que le visage de l’Homme disparaisse pour que se dessinent et s’animent les figures multiples et changeantes de la subjectivité. »12
De ce fait, à bien suivre Guénancia, la philosophie cartésienne instaurerait davantage une philosophie du sujet que de la subjectivité – la critique est tout autant orientée contre Foucault que contre Heidegger – et il faudrait réévaluer à la baisse – sans toutefois aller jusqu’à le nier – le moment inaugural de la subjectivité présent chez Descartes. On peut donc parler de subjectivité en un sens faible, le terme étant légitime « parce qu’il désigne l’immanence d’un certain nombre de phénomènes à l’âme qu’il serait absurde de vouloir situer en dehors d’elle, comme s’il s’agissait de choses pouvant être décrites en termes de grandeurs, de figures et de mouvements »13 La subjectivité désignerait donc pour l’âme une aperception immédiate par soi de ses propres pensées, là où le sujet désignerait cette distance médiate de soi à soi. Et là encore la générosité s’avère fort utile : mettre le sujet à distance de lui-même, c’est au fond rendre possible l’abstraction de la personne particulière au profit d’une prise de conscience de l’humain : être généreux, c’est être capable de mettre à distance sa particularité pour découvrir la couche d’humanité qui m’incite à me traiter moi-même avec égards, non pas en tant que moi mais bien en tant qu’humain. De ce fait, il s’agit moins de rendre légitimes les passions personnelles (subjectivité) que de découvrir, dans la distance à soi, cette irréductible constituante humaine. La force du sujet cartésien, écrit fort logiquement l’auteur, est de parvenir à la « neutralisation du pathos de la subjectivité. »14
C : Lire sans a priori
La troisième partie de l’ouvrage, quoique moins décisive que les deux précédentes, présente toutefois d’intéressantes remarques. Un éclaircissement quant aux rapports de Descartes et Machiavel – dont Guénancia établit remarquablement que le différend philosophique est purement pratique – s’avère particulièrement précieux.
Le plus intéressant néanmoins, en tout cas du point de vue des présupposés généraux de l’auteur, me semble être la manière dont se trouve traitée la métaphysique, fort significativement ramenée aux deux derniers chapitres. Depuis une vingtaine d’années, sous l’influence de la pensée heideggérienne, l’examen de l’inscription de la pensée cartésienne dans la métaphysique et, partant, dans la prétendue onto-théo-logie, a retenu l’attention de nombreux commentateurs, au point de délaisser complètement l’évaluation de la pertinence des textes cartésiens pour en seulement étudier la nature et la conformité au schéma heideggérien. La force des analyses de Guénancia réside précisément dans le fait qu’elles sont des analyses de la pensée cartésienne, et non un examen de passage heideggérien, ramenant ainsi la question métaphysique à sa juste place, et évacuant la surcharge onto-théo-logique dont l’intérêt philosophique ne saurait être visible au-delà des cercles déjà convaincus. Guénancia rappelle ainsi fort opportunément que la métaphysique, aux yeux de Descartes, ne saurait être pratiquée que quelques heures par an, et que son rôle essentiel est celui d’un « redresseur de l’esprit »15. Etre métaphysique, en outre, cela signifie être compris par l’entendement seul, sans le secours de l’imagination.
Toutefois, et c’est sans doute ce que manquent les lectures heideggériennes, même lorsqu’elles se veulent critiques, les sujets métaphysiques nécessitent eux-mêmes un débouché pratique, ce que Guénancia – mais aussi Denis Kambouchner – ne cesse de rappeler. Dans le cas de l’union, par exemple, seule la pratique permet de réaliser l’action d’une substance sur une autre. En d’autres termes, la métaphysique seule ou, pour le dire autrement, l’entendement seul, dès lors que l’on veut donner un sens réel à la pensée cartésienne et ne pas se contenter d’y voir un simple exercice intellectuel, n’a de sens que dans l’issue d’une compréhension pratique. La métaphysique constitue donc un domaine limité, indispensable mais nettement insuffisant, donnant les fondements vrais et essentiels, dont le sens ne saurait être trouvé que dans la pratique.
Conclusion
Ce recueil est donc, comme la totalité des ouvrages de Guénancia consacrés à Descartes, d’une très grande qualité, tant par la rigueur que par la clarté des analyses ici déployées. En outre, le souci de toujours se demander quel est le sens de la pensée étudiée, quelle est son inscription dans la réalité, permet de rompre avec les lectures désormais dominantes, aussi bien historiques – il ne faudrait lire Descartes que pour comprendre comment la modernité est influencée par le monde médiéval – qu’idéologiques – la pensée cartésienne comme moment inaugural d’une subjectivité onto-théo-logique – afin de retrouver l’essentiel de la philosophie, c’est-à-dire la proposition rationnelle d’envisager le réel et la manière de s’y rapporter, au point que cela ait une incidence sur la manière de vivre du lecteur. L’insistance sur les passions – domaine parfaitement ignoré par bien des lectures contemporaines – ne doit pas être vue comme la volonté d’investir un terrain délaissé mais bien plutôt comme la conséquence logique d’une pensée qui nous invite à vivre d’une certaine manière. Ce n’est pas le moindre mérite de P. Guénancia que de nous le rappeler.








