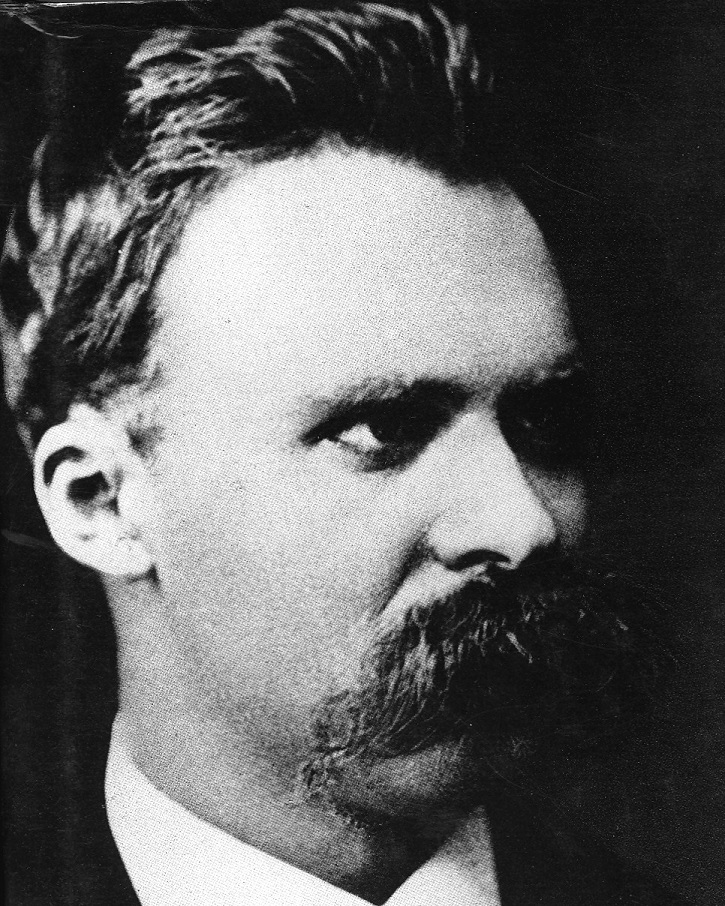Pierre-André Taguieff a fait paraître récemment Les nietzschéens et leurs ennemis aux éditions du Cerf[1]. Dédié à deux prestigieux maîtres de l’esthétique française, Mikel Dufrenne et Louis Marin, l’ouvrage tente d’établir une « relation sereine avec Nietzsche », qui ne serait « ni nietzschéenne ni anti-nietzschéenne », « hors de tout dogmatisme », libre et située par-delà l’éloge et le blâme (p. 385-386). Une position résumée dans le sous-titre : « pour, avec et contre Nietzsche ». « Bousculant quelque peu les canons académiques » (p. 354), le livre explore librement certains écrits de Nietzsche et leurs multiples interprétations, invocations ou instrumentalisations. S’il se veut une « esquisse » (p. 22) accessible et brève, il est néanmoins long (presque 500 pages) et il y a peu de chance qu’il séduise beaucoup d’autres lecteurs que les « seuls spécialistes de la pensée nietzschéenne » (p. 13). Il accomplit néanmoins son objectif d’éviter la criminalisation rétrospective autant que la vénération aveugle, de « lire et comprendre Nietzsche par-delà l’éloge et le blâme, tout en analysant les raisons de le célébrer et de le rejeter » (p. 25). Il contribue ainsi à éclairer la singularité de la pensée nietzschéenne ou à « identifier les raisons de son incomparabilité » (p. 11). C’est que Nietzsche incarne la figure de l’artiste-philosophe et, son écriture étant aphoristique, sa pensée peut faire l’objet d’interprétations diverses et contradictoires. Le fil conducteur de l’ouvrage est ainsi « la permanence et l’intensité des conflits d’interprétation et d’évaluation » de l’œuvre de Nietzsche et de ses héritages (p. 12).
Les nietzschéens et leurs ennemis explique comment les partisans comme les ennemis de Nietzsche produisent chacun un Nietzsche à leur image et il interroge notre perception de cet autofaçonnement, par lequel le philosophe est produit par ceux qu’il influence. L’ouvrage raconte l’histoire des « « échos » de nietzschéisme et d’anti-nietzschéisme depuis la fin du XIXe siècle » (p. 22), dans les champs culturels et politiques, en interrogeant les significations de ces traces. Taguieff ne cache pas la dimension personnelle de ce projet : « je me suis efforcé de comprendre à la fois ma propre compréhension de Nietzsche et ma perplexité à son égard » (p. 354). L’ouvrage rend en effet palpable l’embarras d’un auteur qui tente de se rendre intelligible pour lui-même, en tentant de faire la part de ce qu’il a cru comprendre de Nietzsche et de ce qui résiste à sa compréhension. Après un bref avertissement au lecteur, indiquant la nature et l’objectif de l’ouvrage, ainsi qu’une introduction précisant les rapports de notre époque à la pensée nietzschéenne, l’ouvrage est composé de quatre parties de tailles très inégales. Le tout est suivi d’une bibliographie singulièrement longue (90 pages) et d’un index des noms.
Difficile de préciser le plan plus avant, car l’unité de chacune des parties est peu évidente. La démarche de l’auteur consiste essentiellement en un relevé d’opinions sur Nietzsche et en une juxtaposition de citations, recueillies chemin faisant, au gré d’une histoire des idées longue et sinueuse. L’ouvrage suit en grande partie l’ordre chronologique de la réception et de l’héritage de Nietzsche, « dans telle ou telle culture nationale » (p. 41). C’est souvent au lecteur de deviner, selon l’identité de l’écrivain ou du commentateur cité, si Taguieff s’approprie le propos tenu ou s’il se contente de s’y référer comme à un document historique. Si les transitions sont rares, les retours en arrière sont plus fréquents, certaines phrases pouvant même être répétées mots pour mots, par inadvertance.[2] L’enquête sur l’incomparabilité de Nietzsche se limite la plupart du temps aux « conflits de lectures et d’usages politiques, en [s]’efforçant de les contextualiser et de discerner leurs présuppositions » (p. 12). L’ensemble donne l’impression d’un mélange, curieux et inégal, de simplicité et d’érudition, de clarté et de perplexité, de pédagogie et de considérations longues, complexes, parfois délicieusement cyniques, sur l’histoire des idéologies politiques, la real politique et l’éthique de notre temps.
Une époque nietzschéenne
Parmi les points qui méritent d’être relevés figure le caractère nietzschéen de notre époque. Taguieff soutient que « le XXe siècle a été un siècle nietzschéen », Nietzsche ayant prédit que ce siècle apporterait « la lutte pour la domination de la terre – l’obligation d’une grande politique » (Par-delà bien et mal, § 208). Ce siècle a été celui « de la lutte pour la puissance, en vue de la domination du monde » (p. 17), « l’âge des convictions absolues et de l’affrontement des extrêmes dont il a fallu payer le prix ». De plus un culte effréné des « idoles » en tous genres (chefs charismatiques, guides suprêmes, stars, etc.) est apparu dans le champ politique comme dans toutes les sphères de la vie sociale, conséquence de la « mort de Dieu ». Des tyrans suprêmes ont été « adorés comme de nouveaux dieux » et le XXè s’est déployé sous le signe « d’un nihilisme actif, voire activiste » (p. 18). Nous ne sommes pas sortis de cette époque qui peut être qualifiée de nietzschéenne, parce qu’elle a été « prévue ou prédite par Nietzsche » et « présente de nombreux aspects qu’on peut qualifier de « nietzschéens » » (p. 19). Notre époque est aussi celle d’un progressisme effacé, éclipsé, « vague » et « résigné » (p. 16), « diffus, banalisé », sans triomphe du décadentisme ou du pessimisme, une sorte de « conservatisme frileux ».[4] Notre époque sécuritaire, consumériste, individualiste, hédoniste, capitaliste, se caractérise par un « présentisme modérément optimiste, coloré d’inquiétude, sans croyances fortes, avec un imaginaire limité, appauvri », des revendications dérisoires, de la « jalousie sociale » et du ressentiment. Dans la nouvelle « guerre des visions du monde », l’Occident est condamné pour son impérialisme par « ses ennemis et rivaux, imitateurs jaloux », mais ce qui est nouveau est qu’« une partie du monde musulman » désigne l’Occident judéo-chrétien comme ennemi absolu. Nietzsche influence même ses ennemis déclarés (marxistes, libertaires) et « les phénomènes politiques, intellectuels ou artistiques les plus étrangers » à sa pensée (p. 21). Le XXIè siècle révèle pleinement la revanche de Nietzsche « contre les prophètes de bonheur de son siècle globalement progressiste » (Saint-Simon, Comte, Mill et Spencer). Le postmodernisme a valorisé le relativisme historique et culturel, et désormais les « antimodernes » sont reconnus comme tels, le progressisme est critiqué et il se redéfinit comme « contre-réactionnaire ».
Nietzsche et les postmodernes
Nietzsche a influencé les penseurs français postmodernes, poststructuralistes ou déconstructionnistes, soutient Taguieff. Le « nietzschéisme politique d’extrême gauche des années 60 et 70 » veut en effet tuer le sujet ou la conscience, ainsi que le réel et la vérité (p. 329). Les théoriciens de la déconstruction, postmodernes ou poststructuralistes, éprouvent une « nouvelle fascination pour le subversif » et apprécient « l’autodestruction de la raison », ce qui prolonge la façon dont Nietzsche associe l’utilité des croyances à leur fausseté (« pragmatisme nominaliste »), comme le soutient Karl-Otto Apel.

Dans cette perspective, « si l’on juge qu’il y a décadence, il faudrait accélérer le mouvement de décadence » (p. 330), à gauche comme à droite. Parfois le déclin ou la décadence sont esthétisés, comme chez Cioran, Ernst Jünger, Jean-François Lyotard, ou Theodor W. Adorno, ce qui prolonge le nihilisme actif de Nietzsche, qui visait à préparer la formation d’un type supérieur. Un Nietzsche inventé a été le « prophète des mouvements contestataires contemporains à visage gauchiste » (p. 334) ou autres révoltes et rébellion de toutes sortes, notamment internationalistes (chez les « insurgés socialistes, communistes ou libertaires »). Alors même que Nietzsche est antihumaniste, au sens où il se soucie peu de la « libération de l’humanité » et ne se préoccupe que de la surhumanité, au moins à partir de Zarathoustra ! Si « Nietzsche peut être accusé d’avoir inspiré […] les théoriciens postmodernes et poststructuralistes » (p. 355), via Heidegger et Bataille, c’est notamment dans la mesure où il a radicalisé la critique de la raison, en excluant cette critique de l’horizon de la raison, si l’on en croit Habermas.
Le Nietzsche de Deleuze et Foucault
Au cours des années 1960, le Nietzsche réinventé par Deleuze et Foucault s’impose dans le champ intellectuel français, et le nietzschéisme se fait consensuel. Un Nietzsche alors sans identité politique bien définie devient « académiquement acceptable, objet de thèses universitaires » et « reconnu comme l’un des plus grands philosophes ». Considéré comme maître du soupçon par Foucault, Nietzsche est alors à la mode et obtient la reconnaissance académique. A en croire Clément Rosset, la « philosophie généalogique » apparue au XIXè siècle s’est effectivement « « imposée progressivement à la réflexion contemporaine, au point de se confondre presque, aujourd’hui, avec la philosophie tout court » » (p. 312). Le retour à Nietzsche souhaité par Deleuze et Foucault a pris la forme « d’une « gauchisation » de la réputation de Nietzsche » (p. 314). La gauche progressiste accuse alors les antinietzschéens d’être « archaïques », « réactionnaires », « dépassés », etc. Taguieff parle d’un véritable « franco-nietzschéisme des années 1960-2010 », Nietzsche étant sans cesse à la mode depuis 1890, « dans la plupart des pays européens comme en Amérique du Nord » (p. 320). L’auteur s’attarde sur le « nietzschéisme de gauche, voire d’extrême gauche » (p. 323), réinventé après 68 et qui, dans le sillage de Deleuze et Foucault, a fait de Nietzsche un « penseur de la libération ou de l’émancipation […] de la libre création, de la quête d’une vie intense, de l’affirmation joyeuse, de l’épanouissement de soi », bref le chantre des « libérations » du XXe siècle. Interprété arbitrairement, angélisé, Nietzsche est devenu voltairien, individualiste, libertaire, anticapitaliste, puis postmoderne, alors même qu’un nietzschéen ne peut tout bonnement pas être de gauche, que Nietzsche loue la hiérarchie ou l’inégalité, et qu’il peut aussi bien être considéré comme anarchiste de droite, ou comme antimoderne. Il est peu nietzschéen de « s’efforcer à tout prix de présenter un Nietzsche aimable, voire admirable pour tous ». Taguieff va jusqu’à considérer que « le phénomène politico-culturel le plus significatif de la deuxième moitié du XXe siècle aura été la « nietzschéisation » de la gauche et de l’extrême gauche » (p. 327). Mais c’est seulement dans un interview récent qu’il explique l’origine, l’histoire et la nature du déconstructionnisme.
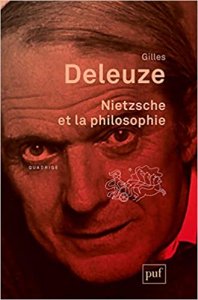
La fin du XXè siècle célèbre chez Nietzsche une puissance démystificatrice et iconoclaste, pourtant responsable des pires atrocités de ce siècle. Les théoriciens du postmodernisme ou du relativisme culturel ne visent plus l’idée universelle et veulent la ruine d’une raison valant pour tous et s’imposant à tous. Néanmoins l’ouvrage ne s’attache pas à ce que la déconstruction est devenue depuis les années 1980 : une critique de « la civilisation européenne ou occidentale, réduite à une production de la « race blanche » supposée hétéro-patriarcale, impérialiste et raciste […]. La pratique de la déconstruction a pris un sens idéologico-politique en devenant le rite d’initiation du « décolonialisme » comme nouvelle vision révolutionnaire du monde ». Ce qui est très éloigné de la pensée de Nietzsche. Mais n’est-ce pas parce que Nietzsche a effectivement critiqué radicalement la rationalité et la notion de vérité que les déconstructionnistes l’ont autant apprécié ? Pour Taguieff, certains textes de Nietzsche sont en contradiction avec cette réduction de la vérité à une somme d’erreurs utiles ou d’illusions nuisibles. La philosophie de Nietzsche rechercherait une vérité qui n’est pas la conformité mais l’authenticité, « la stylisation d’expériences de pensée vécues par le philosophe », ce qui est moins une question d’adéquation que d’expression de soi et de construction de soi, la philosophie étant une manière de devenir ce qu’on est (p. 40-41). Mais Nietzsche se contredirait en affirmant qu’il n’y a pas de vérité : il commettrait une « faute de logique », « emporté par sa passion déconstructrice » (p. 116). La vérité serait alors une erreur vitale, une croyance utile et donc fausse.[5] Néanmoins il ne faudrait pas « vouloir à tout prix effacer les éventuelles contradictions qu’on rencontre dans les écrits de Nietzsche », la contradiction étant liée à la fécondité et à la force, chez celui qui en est riche et qui la supporte. Nietzsche valoriserait les croyances, au lieu de toutes les critiquer, parce qu’il jugerait le besoin de croire propre à l’homme et indispensable à la conservation de l’espèce humaine.
Nietzsche responsable du relativisme occidental contemporain ?
Faire de la vérité l’expression de soi, une erreur irréfutable, ou une valeur et l’objet d’un besoin ne suffit certes pas à être responsable du décolonialisme, mais à en croire Taguieff, Nietzsche serait de toute façon un subjectiviste, « prisonnier du cercle des évidences fondamentales de la modernité » (p. 338-339). Le problème des valeurs serait en effet celui du sujet qui évalue – sujet qui incarne ce qui a le plus de valeur, comme le veut « le subjectivisme des Modernes ». Sur le même ton heideggérisant, mais d’une façon moins convaincante, Taguieff assimile le perspectivisme de Nietzsche à un « pluralisme ontologique », pour lequel « l’Être a pour essence de se montrer […] selon une infinité de points de vue », et présente un « dévoilement » pluriel. Nietzsche définirait l’Etre comme texte, dont le dévoilement est équivoque. Bref, sans être erreur ou fausseté, le monde serait chaotique et dépourvu de totalité, d’unité et d’absolu. Quoi qu’il en soit de la probité de ces analyses, elles ne prouvent pas que le perspectivisme de Nietzsche est un relativisme, mais n’ôtent pas non plus le sentiment que la redéfinition de la vérité par Nietzsche était trop ambigüe pour éviter les contresens à son sujet, voire qu’elle portait en elle les germes du déconstructionnisme. La difficulté est évidemment qu’il y a des interprétations divergentes d’un perspectivisme que Nietzsche semble avoir conçu comme autoréflexif, à la façon d’une interprétation pour laquelle tout est interprétation, y compris elle-même. Reste qu’en accusant Nietzsche d’être subjectiviste, Taguieff semble lui aussi reprendre à son compte l’interprétation foucaldienne de Nietzsche et, plus généralement, s’inscrire lui-même dans le champ des postmodernes et des déconstructionnistes.
Les analyses de Taguieff distinguent les lectures probes de Nietzsche des lectures infidèles, mais elles auraient gagné à éclairer davantage la notion d’interprétation et l’herméneutique de Nietzsche, en pointant la façon dont le commentarisme peut aujourd’hui avoir tendance à surprivilégier ces éléments. Il est peu nietzschéen de ne pas proposer sa propre interprétation des textes de Nietzsche consacrés à l’interprétation et à la lecture. Il pourrait par contre être utile de s’interroger davantage sur ce que serait aujourd’hui un nietzschéisme constructif, en tout cas un nietzschéisme qui permettrait de surmonter le nihilisme, qui ne verserait pas dans un obscurantisme cynique, ni dans un nihilisme jubilatoire, et qui ne nous enfermerait pas dans l’univers des interprétations, dans le subjectivisme ou le monde des signes, voire qui réinterpréterait positivement la notion de vérité et ne renoncerait pas à dissiper l’énigme du monde, mais y chercherait un ordre intelligible. La question mérite d’être affrontée directement : à défaut d’avoir pu empêcher l’apparition du nihilisme réactif des postmodernes, la pensée de Nietzsche peut-elle contribuer à le mettre en échec, à déjouer l’irrationalisme des relativistes, à contrecarrer le militantisme dont la cause se réduit au projet de « détruire tous les héritages de la pensée européenne, à commencer par la recherche de la vérité à travers la connaissance rationnelle » ? Tenter de sortir du nihilisme grâce à l’art, comme l’a fait Nietzsche, n’était-ce pas offrir la fiction comme solution à un problème réel et, en cela, proposer un remède inapproprié, voué à se révéler insuffisant ? A supposer que le monde soit justifié comme phénomène esthétique, ne doit-il pas aussi et surtout être justifié comme phénomène érotique, être aimé d’un amour qui ne se réduit pas à la pensée, au connu ou à la continuité élaborée par la mémoire, contrairement à l’amor fati considéré comme « interprétation », « spiritualisation », ou résultat d’un long travail de désillusion et de démystification ? Pour Nietzsche, la fausseté du monde et la mort de Dieu ne rendent pas tout possible, ni permis ; de plus un monde sans transcendance peut avoir un sens et une valeur ; enfin nous ne sommes pas voués au nihilisme. Mais si des nietzschéens eux-mêmes peuvent aussi facilement juger le nihilisme indépassable et s’y complaire, c’est vraisemblablement d’abord parce que Nietzsche fait reposer ces déclarations sur des notions équivoques (surhomme, éternel retour et volonté de puissance), voire parce qu’il a sous-estimé le risque que comporte le choix de l’équivocité.
Par-delà gauche et droite
Taguieff achève son ouvrage en soulignant la singularité et le caractère atopique de Nietzsche. Il juge la modernité décadente, progressiste, optimiste et note que le postmodernisme et le poststructuralisme ont contribué à rendre internationale la mode d’un auteur pourtant antimode, inactuel. « La pensée de Nietzsche est politiquement inclassable », étrangère « au monde politique tel qu’il s’est constitué dans la modernité démocratique […]. Nietzsche n’appartient à aucun « camp » politique […], il n’exprime ni n’indique aucune orientation politique bien définie » (p. 379). L’esprit libre n’est pas un militant politique, ni le philosophe un prosélyte, un individu politiquement engagé. La philosophie de Nietzsche est fondamentalement indéterminée d’un point de vue politique, soutient Taguieff, ce qui n’est pas sans rappeler les conclusions de Granarolo sur l’anarchisme de Nietzsche, ou celles de Dorian Astor sur la grande politique comme exercice spirituel.
Taguieff continue néanmoins de soutenir, comme dans son article sur « Le paradigme traditionaliste » publié dans Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens[6] (1991) – que, sans être réactionnaire, ni traditionnaliste à proprement parler, Nietzsche esquisse « un traditionalisme inédit, insistant sur la longue durée et l’importance des héritages, et définissant le « sens historique » en un sens non progressiste » (p. 92-93).
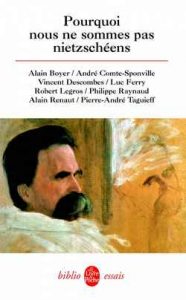
Les nietzschéens et leurs ennemis précise que la philosophie de Nietzsche est opposée à la révolution, au progrès, à l’égalité et à la démocratie, et qu’elle est également eugéniste, favorable à l’exploitation, à l’inégalité et à l’esclavage. Nietzsche ne rêve-t-il pas d’ailleurs d’un « impérialisme antique ou napoléonien », comme le note Dorian Astor ? S’attarder davantage sur les notions d’élitisme et d’aristocratie aurait peut-être permis de déterminer plus avant la philosophie de Nietzsche d’un point de vue politique. Il est vrai qu’en la matière, ce qui peut être exposé clairement est ce que Nietzsche rejette, « non ce qu’il espère, envisage ou préconise » (p. 384). Il n’y a donc pas à proprement parler d’hommes politiques nietzschéens.
[1] Pierre-André Taguieff, Les nietzschéens et leurs ennemis. Avec, pour et contre Nietzsche, Paris, Cerf, 2021.
[3] Ainsi lit-on p. 89 : « Aussi la pensée de Nietzsche était-elle vouée au conflit interminable des interprétations et des évaluations, souvent sans qu’on puisse trancher. À toute interprétation d’ensemble l’on pouvait objecter un aphorisme ou un fragment posthume ». Cette phrase est entièrement répétée à la page 91.
[4] « Si tout ne va pas bien, tout a été pire naguère et pourrait être pire aujourd’hui ou dans un futur proche » (p. 15).
[5] Il s’agirait de nos erreurs irréfutables et, puisque Dieu n’existe pas, d’une valeur, donc d’une question d’interprétation. L’homme aurait en propre de croire, même ce qui est réfuté, mais la vérité serait confondue à tort avec le bien. L’erreur étant vitale, l’impératif de la connaissance contredirait celui de la vie. La vérité ne serait ni le bien, ni ce qui favorise la vie, mais une forme d’erreur, « utile ou nuisible à la vie selon les situations » (p. 118).
[6] Alain Boyer et alii, Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens, Paris, Grasset, réed. LGF, 2002.