Après une éclipse de plusieurs mois – explicable seulement par une flemme blâmable – voici une nouvelle chronique de la philosophie médiatique. Il y sera question d’un honnête homme naïf qui a cru possible de parler philosophie dans l’antre de l’ « esprit Canal » – Il y sera question aussi d’une tonitruante Fête de la philo, sortez les cotillons ! – Nous ouvrirons ensuite un hors-série de Libé consacré à Jean-Paul Sartre – Nous nous gausserons généreusement d’un éloge à BHL paru dans la presse – Nous nous pâmerons, pour finir, devant la photographie du mois… celle du repos du guerrier. De quel guerrier ? Notre mascotte : Béchamel bien-sûr…
Ollivier Pourriol, philosophe des Lumières… ? Non, des spotlights !1
La durée de vie de l’homme de télévision se réduit d’année en année. Fini le temps où les mêmes visages traversaient les générations dans le petit écran. Fini le temps des Léon Zitrone, des Pierre Bellemare, des Guy Lux ou des Jacques Martin. Fini ce temps lointain où l’on pouvait se voir vieillir dans le regard, lui-même vieillissant, des gens de télévision. Les animateurs, journalistes, chroniqueurs sont soumis aux diktats des modes, à l’impitoyable religion de l’audimat, et à la versatilité de téléspectateurs qui se lassant très vite. Ainsi, la durée de vie de l’homme de télévision peut ne pas excéder une saison, quelques mois, voire quelques semaines. Ce fut le cas d’Ollivier Pourriol, qui n’a été chroniqueur au « Grand Journal » de Canal+ qu’une poignée de mois seulement, en 2011-2012… et n’a pas été reconduit pour la saison suivante. Un passage éclair douloureux que Pourriol, philosophe médiatique de son état, a raconté dans un ouvrage assez amusant On/Off2– à mi-chemin entre le règlement de compte acerbe et la description minutieuse d’un milieu qui lui était sans surprise radicalement étranger, celui de la télévision commerciale. La télévision, dans sa voracité, n’est pas sans faire songer à la figure de Cronos dévorant ses enfants. Mais dans la vision de Goya, le dernier Goya, celui dit de « la maison du fou ». La télévision se nourrit des malheureux naïfs qui s’y égarent… La télé se sustente en particulier des philosophes. Nous ne sommes plus à l’époque de la philosophie des Lumières, mais à l’heure de la philosophie des spotlights…

Le magazine féminin Grazia informe ses gentilles lectrices du « martyr » (Brrrr….) du télégénique Ollivier Pourriol)
Ollivier Pourriol nait en 1971. Normalien, agrégé de philosophie, il enseigne un peu puis commence une carrière de romancier, d’essayiste et de conférencier. Il se fait notamment connaître pour son travail autour du cinéma, et ses conférences « Ciné Philo ». En 2010, saisissant la balle au bond, il signe l’essai espiègle (et totalement inutile) Eloge du mauvais geste – consacré au football, et plus particulièrement à la « main » coupable de Thierry Henry commise en novembre 2009, lors du match France-Irlande (qualificatif pour le Mondial 2010 au cours duquel la France a été éliminée dès le premier tour, mais c’est une autre histoire)…
Canal+ naît en 1984. Dans un paysage télévisuel totalement public, la chaîne privée à péage – dont le lancement est piloté par l’ami intime du président Mitterrand, André Rousselet – bénéficie des fonds du groupe Havas. Avec une grille des programmes très centrée sur le cinéma, et la diffusion exclusive de films récents, Canal+ vise en premier lieu un public CSP++ (classes socioprofessionnelles supérieures dans le jargon mercatique) ; et propose des plages de diffusion dites « en clair », vitrines de la chaîne, durant lesquelles des programmes de divertissement sont diffusés, dont certains resteront dans les annales de la télévision, de par la qualité de leur réalisation et l’originalité de leur esprit… « Coluche 1 Faux », « Les Nuls »… Un programme en clair réalise des audiences singulièrement importantes, au fil des ans : « Nulle part ailleurs », co-présenté par le vétéran du PAF Philippe Gildas et l’amuseur Antoine de Caunes. En 2004, le groupe modifie la formule, et confie au dinosaure Michel Denisot (figure historique de Canal…) un « Grand journal », devenu navire amiral de la chaîne privée – et émission prescriptrice par excellence. Il faut dire aussi que depuis 1984 Canal+ a changé. Et ses abonnés aussi. La chaîne diffuse de plus en plus de sport, s’adresse aux classes moyennes, se diversifie avec le câble, le satellite, l’Adsl, tente de survivre dans un contexte singulièrement difficile pour les médias, et une crise endémique du marché publicitaire. Bref, Canal se paupérise. Comment Ollivier Pourriol a-t-il pu croiser le chemin de Canal+ ? Comment la chaîne a-t-elle pu songer à recruter l’intellectuel pour jouer au philosophe-de-service de son programme phare ? En le voyant passer sur son antenne, évidemment… L’invité télégénique soudainement métamorphosé en chroniqueur télévisuel.
Le livre d’Ollivier Pourriol présente plusieurs intérêts : il donne (trop prudemment…) des éléments factuels sur le fonctionnement du « système Canal+ » et de la machine industrielle à produire de l’ « esprit Canal » ; il propose une réflexion (trop modeste…) sur la place des philosophes à la télévision ; et finalement, offre un petit panorama tragi-comique de l’époque à travers le récit de rencontres avec les « stars » du moment, invitées au « Grand Journal ». Depuis les actrices éphémères jusqu’aux hommes politiques inamovibles, en passant par les écrivains de télévision et les pitres à durée déterminée.
La feuille de route est claire : Pourriol est là pour « poser des questions ». Dès les premiers échanges avec la chaîne on le teste à ce sujet « – Pour l’émission d’hier, tu aurais fais quoi avec Ségolène Royal ? – Je ne sais pas, c’était très bien hier. Je lui aurais demandé ce qu’elle pensait du texte de Philippe Muray sur son sourire… »3 Les producteurs semblent enthousiastes, et veulent faire de Pourriol une sorte de chroniqueur poil à gratter. L’intéressé : « – Je trouve ça intéressant de se tenir au carrefour et de pouvoir dialoguer avec tout le monde. – Comme Socrate ?, répond le producteur – Socrate entre deux pubs quand même »4… Le philosophe fera partie d’un dispositif télévisuel assez simple, composé d’une Miss météo, d’une chroniqueuse musicale, d’un Jean-Michel Apathie, d’une Ariane Massenet, et d’un Michel Denisot ; petite troupe recevant quotidiennement des individus en transhumance promotionnelle. La fonction de Pourriol sera de ponctuer les interviews de remarques personnelles et de questions informées… Le producteur lui affirme, au début de l’aventure : « Ce qu’on veut, c’est quelqu’un qui donne son point de vue sans compromis sur les choses. Capable d’articuler une pensée, de développer une idée, mais en restant accessible. »5 Il fallait être bien naïf… Le rédacteur en chef, quelques jours plus tard, est déjà plus trivial quand il explique au philosophe pour quelle raison il est là… « Pour donner de la hauteur à l’émission. Les rôles sont simples. Moi je passe les plats. La blonde, les questions de blonde. Le chauve les questions de chauve, la politique, la dette, tout ça. Et toi, tu es encore jeune mais tu as des cheveux blancs, il faut que tu donnes de la hauteur. Un éclairage différent. »6 Il fallait être bien naïf…
Pourriol s’intègre vaille que vaille dans l’univers open space, dans la trivialité de la vie de bureau, dans la vulgarité inhérente à toute conversation entre collègues devant une machine à café. L’auteur décrit en ces termes, à un ami, le fonctionnement de la conférence de rédaction : « Une grande table avec quelques places assises et beaucoup de monde debout dans une toute petite pièce. Ceux qui sont assis ont le droit de parler. Enfin, il y en a qui parlent, et les autres qui acquiescent ou modulent. Ceux qui sont debout ferment leur gueule et prennent des notes. J’y suis allé deux fois. – Et ? – Je suis resté debout. »7 Mais au-delà de cette réalité assez peu glamour des coulisses de la préparation d’une émission de télévision, Pourriol est frappé par le sort qui est réservé aux livres. Le livre est pourtant au centre du Grand Journal. La plupart des invités viennent faire la promotion d’un bien culturel de grande consommation, tel qu’un disque, un film ou un livre. Le terme livre est à prendre, ici, dans une acception très large, allant de la véritable œuvre romanesque, au document journalistique, en passant par le vil bouquin de circonstance écrit par un nègre pour la dernière starlette de la téléréalité à obsolescence programmée. Un chroniqueur régulier de l’émission avoue à Pourriol sa propre pratique de la lecture : « Je lis la première page, la dernière page et la page 100. Comme ça, je connais le début, la fin et si on parle du livre je parle de la page 100. Quelqu’un qui arrive à la page 100, c’est qu’il a lu le livre. »8 Quand on ne lit pas les livres en diagonale, on les dépèce littéralement. « – C’est quoi ces livres en morceaux ? demande Pourriol en visitant la rédaction – Quand on n’a pas le temps de lire un livre en entier, on le partage, chacun fait une partie. »9 Tout au long de son expérience télévisuelle, l’auteur est confronté au mépris du livre. Suite à un changement de dernière minute le rédacteur en chef demande à Pourriol de lire, en 24 heures, l’ouvrage de 600 pages du nouvel invité. Enfin, lire, non… « respirer ». L’auteur décrit la scène à un ami : « – C’est surtout le geste qui était incroyable. Il a pris le livre, il l’a feuilleté sans le regarder, comme si le vent qu’il faisait avec les pages était chargé de sens, diffusait le parfum du livre. – Putain, mec. Tu es entré dans la Quatrième Dimension. Tu bosses avec des mutants. »10 L’homme de télévision ne lit pas, il sniffe les livres…
Pourriol prend aussi de plein fouet, dans son innocence, le dispositif même de l’émission. La distribution des rôles. La distribution de la parole. Il perçoit peu à peu qu’il n’est pas sur un plan différent de la Miss Météo (à qui on a dit, à son arrivée : « On va te brander girly pour que les gamines t’adorent »…) On ne cherche certes pas à « brander » Pourriol, mais il doit tenir son rôle de philosophe, ou plutôt son second rôle. Il ne parvient pas à obtenir réellement de chronique régulière, et doit se contenter de prises de paroles à la volée, un peu pirates, durant les interviews des invités. Autant dire qu’il doit se battre, s’imposer face aux autres (la blonde, le chauve, etc.) et qu’il est plus que jamais entré dans le domaine de la lutte. Un jour, en régie, on lui révèle le secret : « Ce qui compte, ce n’est pas vraiment la brièveté, mais plutôt la vitesse. D’abord pour piquer la parole. Il faut avoir le réflexe de commencer à parler avant d’avoir quelque chose à dire »11… Pourriol prend aussi conscience, avec une naïveté qui étonne un peu (il a écrit plusieurs livres sur le cinéma…), de l’importance du montage et des questions pratiques de réalisation : difficile de s’exprimer quand le micro est coupé, et quand le réalisateur ne fait pas un plan sur vous… Il s’agit donc de ruser, de prendre les autres chroniqueurs de court, et de s’imposer dans une compétition dont le maître de cérémonie (Michel Denisot, le mâle alpha…) n’est pas uniquement l’arbitre, mais aussi un des compétiteurs dans la course ultime au cool, propre à l’esprit Canal.
Mais la grande révélation de Pourriol, lors de cette expérience télévisuelle désastreuse est l’aversion de ses patrons pour les citations. Pourtant il adore faire des citations. Et il a bien raison. Son livre en est gorgé, depuis Deleuze en exergue jusqu’à des chansons de Michel Bergé (chacun sa came…) Dès qu’il cherchera à citer des auteurs à l’antenne on l’en dissuadera, on le coupera au montage ou on le contraindra à changer l’angle de son papier… Lorsqu’il cherche à placer une citation de Michel Serres son rédacteur en chef lui rétorque : «On ne fait pas de citations. C’est excluant. Dis la même chose avec tes mots ! »12 L’argument de Pourriol selon lequel Serres est un écrivain archi-connu, habitué des plateaux de télé, et apprécié d’un large public ne porte pas. « Les citations, c’est pas nous ! » tranche l’homme de télévision, certain de connaître ce qu’il convient ou non de donner à manger aux cochons. La chaîne cryptée ne vise plus un public CSP++ snob et cultivé, comme à ses débuts, mais élargit sa base aux classes moyennes. Et Canal+ estime – on se demande où elle a prit ça ?! – que les classes moyennes se sentiraient exclues de son univers si les chroniqueurs faisaient un peu étalage – même avec élégance – de leur science… Quand Pourriol propose de parler d’un spectacle de Jean-Louis Trintignant (une lecture de poèmes de Prévert et Vian) son rédacteur en chef lui adresse une fin de non-recevoir : « On ne parle pas de poètes morts ! »13. On sent le désarroi s’installer peu à peu dans l’état d’esprit du philosophe de télévision. Il se détache du jeu. Il n’y croit plus. Il devient de jour en jour un simple figurant… A mi-saison un chroniqueur de l’émission lui donne ce tuyau : « Le seul conseil que je puisse te donner, c’est d’être plus avec nous. Plus dans l’humeur. Sois moins cérébral. Essaye d’être un peu moins intelligent, voilà »14. Le message est clair.

Le quotidien régional Sud-Ouest s’intéresse au seul chroniqueur de Canal+ qui a quelque chose entre les oreillettes
Au fil des pages défilent également des choses vues assez amusantes sur les invités du « Grand Journal ». BHL qui prend ses aises dans un environnement familier. Les candidats Sarkozy et Hollande (en pleine campagne pour la présidentielle) qui badinent dans les loges. Le show business. Hollywood. Nicole Kidman (veinard… quoi ?!) …
On perçoit aussi une évidente autocritique de la part de Pourriol, qui semble s’en vouloir d’être tombé dans le panneau, et d’avoir cru pouvoir faire de la philosophie à la télévision. Un ami lui reproche de s’être fait « canaliser » (de Canal, vous avez compris ?) par la machine médiatique, et il en convient volontiers. Jusqu’à la nausée. Il est conscient qu’il a contribué à son propre auto-formatage. A sa mutation. Il est au bord de la honte. Il est sur le point de respirer les livres… La question de l’argent n’est pas évacuée. On comprend à demi-mot qu’il touchait un peu plus de 10.000 euros par mois pour sa participation à l’émission. Pourriol sait ce que cette manne signifie en termes d’indépendance future et de liberté créatrice. Il sait aussi ce que cela veut dire en termes d’aliénation quotidienne…
Philosophe, Pourriol fait le bilan, en fin de saison, dans le bureau d’un des patrons de la chaîne : « Pourquoi ne pas se dire franchement les choses ? A chacun son métier. Moi c’est les bouquins, la philo, le cinéma. Vous c’est la télé. C’est pas un drame de reconnaître ses différences »15 Fin de l’histoire. Et fin de la fable du philosophe-de-télévision, qui pensait possible de faire de la philosophie-à-la-télévision…
Fête de la philo
Il existe une fête des mères, des pères, des parents 1, des parents 2, une Journée des gauchers, une fête des voisins, une Journée internationale des câlins (c’est vrai : vérifiez…), une Journée mondiale de la marionnette… il ne manquait donc plus qu’une « Fête de la philo ». Il n’y avait absolument aucune raison que la philosophie échappe au grand déferlement festiviste quotidien et à la frénésie de l’évènementiel. C’est la lettre d’information de l’hebdomadaire Stratégies, dédié à la publicité et la communication, qui m’a mis la puce à l’oreille… car oui, il s’agit simplement de marketing : « Sonic Blue, créateur et réalisateur de contenus animés, a réalisé un spot télé pour célébrer la Fête de la philo qui se déroulera du 25 mai au 17 juin. Cette fête populaire et gratuite sera programmée dans différents lieux institutionnels et espaces publics (écoles, librairies, universités, cafés, restaurants, actions sur les réseaux sociaux, etc.) avec pour ambition de rendre la philo décomplexée et accessible à tous. »
Le film publicitaire, le voici…
Couleurs vives. Ambiance Shadocks qui pompent, qui pompent, qui pompent. Petite blague pas drôle pour dédramatiser le sujet. Bref, l’agence de pub a fait le job. Mais comment « rendre la philo décomplexée et accessible à tous » comme l’exige la feuille de route de l’évènement ? Comment réussir « Un rendez-vous inédit de portée nationale pour renouer avec une philosophie vivante, jouer sur un désir de philo », tout en étant « participatif et citoyen » comme le dit le dossier de presse ?
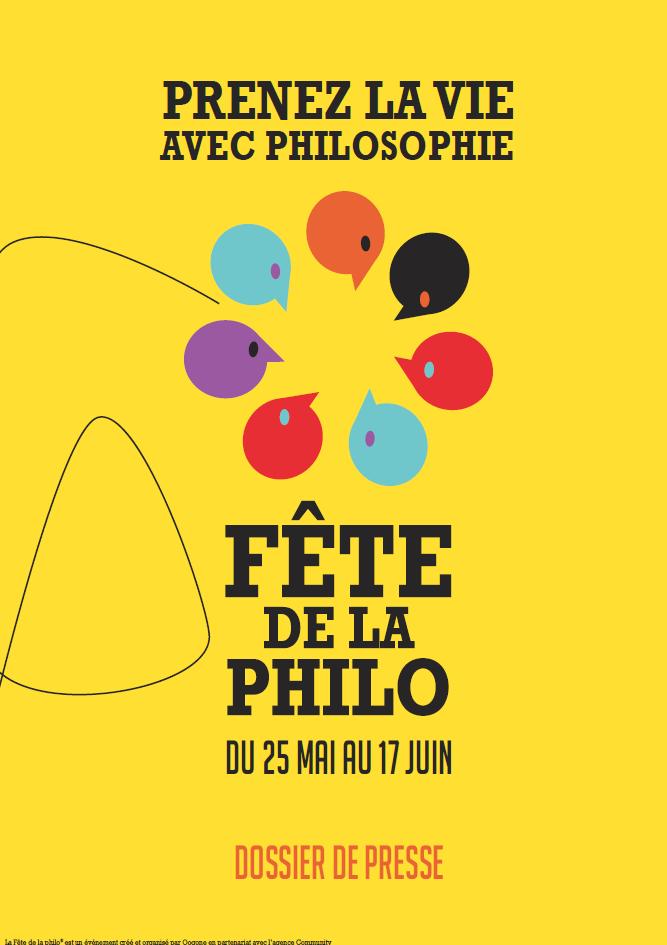
Dossier de presse Fête de la philo
Et bien c’est très simple : d’abord s’assurer des partenariats solides avec des entreprises qui ont tout à voir avec la philosophie, comme La Poste, la Caisse d’Epargne, la RATP ou le pourvoyeur des Velib JC Decaux… Ensuite, solliciter des parrains prestigieux dont la gloire immortelle rejaillira sur l’évènement, comme les colossaux philosophes Jacques Attali et Luc Ferry – dont on étudiera encore les œuvres en Sorbonne dans six-cent ans. Enfin, il faut construire un planning implacable, ne laissant aucune place à l’imprévu ou à l’improvisation. Et dans l’évènementiel on ne parle pas de planning ou d’agenda, mais de programmation. Car une Fête de la philo ça se « programme » comme un festival de cinéma : il y a un temps pour les projections, un temps pour la montée des marches, un temps pour le business, un temps pour le glamour, etc. La programmation comporte donc des conférences, des cafés-philo, des expositions… Plus étonnant un « philo-concert » est annoncé sur le thème du désir, et présenté en ces termes : « 50% rock 50% philo, le philoconcert de Francis Métivier est une performance qui alterne reprises rock interprétées en live et explications philosophiques des morceaux. » Dans un registre plus éprouvant, une « Nuit Sartre » est annoncée à l’Ecole Normale supérieure d’Ulm, proposant à nouveau des « évènements » et des « activités » autour du maoïste de génie qui a écrit Les Mots. (consulter le programme) Un concert de Laurent de Wilde est programmé, et plusieurs « installations artistiques » seront exposées – dont un parcours sonore et une œuvre appelée « Mes mots Cube » présentée en ces termes : « Expérience vidéo interactive qui témoignera de l’empreinte et de la perception de Sartre par et pour le public ». Voilà qui aurait, au minimum, fait marrer le boy-friend de Simone de Beauvoir.
La programmation comporte également un très mystérieux « carrousel philosophique »… « Le temps d’un après-midi, dans le jardin des Tuileries, AccordPhilo vous convie à participer et à inventer un carrousel d’un nouveau genre, un carrousel de pensées. Déambuler parmi les sculptures, improviser des itinéraires de réflexions. Se rendre à la Concorde, lecture par un comédien de textes de Bataille et de Malaparte sur l’Obélisque. » Voilà qui va décomplexer dans les grandes largeurs ! On note aussi, pèle mêle une soirée sur la « pensée » de Martin Luther King, une autre sur la philosophie arabe et la cérémonie de clôture apolitique se tiendra à la Sorbonne, le 17 juin, en présence du Ministre de l’éducation nationale Vincent Peillon avec une table ronde sur le thème : « L’Enseignement de la morale civique ». Ah ça oui, ça va être la fête de la philo…

Vincent Peillon, le ministre aux lunettes qui pensent, qui va vous faire aimer la morale
Libération rend hommage à Jean-Sol Partre
Jean-Paul Sartre a tout inventé : l’existentialisme, le maoïsme germanopratin, les garçons de café, les trous de serrure, Simone de Beauvoir et même la crème brûlée ! Avec la complicité de Serge July il a même eu l’idée d’un grand quotidien de gauche : Libération. C’était en 1973. Quarante ans plus tard, le journal rend hommage à l’un de ses inspirateurs à travers un grand hors-série, disponible dans toutes les bonnes boucheries chevalines.
On y retrouve quelques signatures familières de l’univers sartrien (dont Michel Contat), de nombreux témoignages d’écrivains, et des articles d’intérêts inégaux sur les différentes facettes du personnage (romancier, penseur [Libé dit penseur pas philosophe], journaliste). Signalons un remarquable reportage de Philippe Lançon « Au Havre, sur les traces d’un jeune agrégé. ‘La Nausée’ au bord des lèvres ». Le journaliste retourne sur les pas du Sartre d’avant-guerre qui, entre 1931 et 1936, sera professeur de philosophie au lycée de garçons de la ville. Période qui verra la gestation de son premier roman… « La Nausée est un roman d’initiation métaphysique, mais aussi un grand roman descriptif. L’angoisse du personnage central, Antoine Roquentin, semble naître du paysage qui l’entoure pour le recomposer. Ses déambulations sont les jumelles noires de celles de Sartre. » Le philosophe s’installe dans un hôtel de seconde zone, à côte du chantier bruyant de la nouvelle gare, dans un quartier chaud « la proximité des marins et des prostituées le séduit » écrit Lançon. Le père de Roquentin s’encanaille. A l’endroit où se situait l’hôtel de Sartre, détruit dans les années 70, on trouve une agence Pôle emploi, voisinant avec un McDO. « Tout est laid et sans vie, résume Lançon, le BurgerSartre n’existe pas ». L’auteur dresse le portrait plutôt sympathique d’un enseignant indépendant et libertaire, détestant les relations avec ses collègues et les parents d’élèves. « En été, les cours peuvent avoir lieu sur la plage. Il arrive qu’à minuit on se baigne nu avant de rentrer chez soi. Il amène ses élèves les plus proches boire des bières ». Bien sûr on frôle un peu le Cercle des poètes disparus – « O Captain ! My Captain ! »
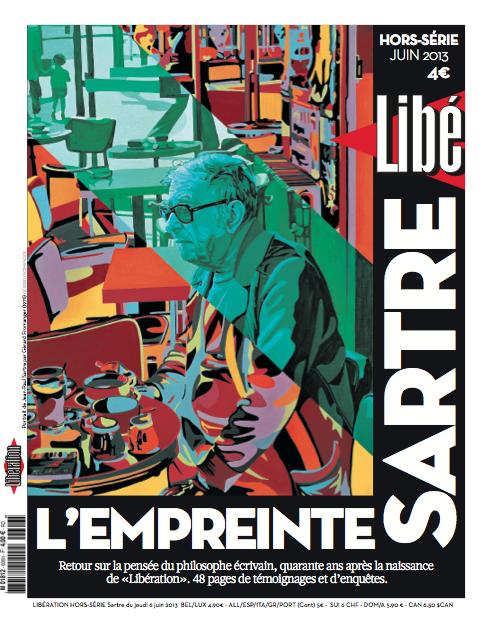
Hors-série Sartre de Libération
C’est depuis ce décor mélancolique d’une ville portuaire triste (osons le mot) que Sartre peaufinera le manuscrit de La Nausée. Plusieurs versions se succéderont. D’abord appelé « Le Factum de la contingence » ce roman, encore trop théorique et pas assez narratif selon les premiers lecteurs (dont Beauvoir), subit des corrections mais est refusé par Gallimard. Ce n’est qu’en 1938 que l’éditeur l’acceptera, dans une version encore allégée.
Philippe Lançon n’oublie pas le square Saint-Roch, et le marronnier, « arbre de l’existentialisme », qui plonge Roquentin dans une « extase horrible » et une pleine conscience de lui-même. « Outre de magnifiques magnolias et quelques autres essences, ce jardin compte aujourd’hui deux marronniers. Mais ils ont été plantés après la guerre. Or, les services municipaux sont formels : il n’y avait ici aucun marronnier dans les années 30. » L’enquête du journaliste lui permet de conclure que l’arbre qui a inspiré Sartre aurait été en réalité un érable. Mais ce reportage ne nous dit pas si le Castor (nom doux de Simone) était vraiment un castor ou bien une belette…
Sachons distinguer l’éloge du fayotage
Oui, sachons distinguer l’éloge du fayotage. Le fayotage est la tendance des esprits les plus vils à s’abaisser à des flatteries, plus ou moins simulées, afin de se faire bien considérer par quelqu’un. L’éloge est une louange empreinte de plus de gratuité. L’enfant fayote son professeur, l’Académicien – à son arrivée sous la coupole du Quai Conti – fait l’éloge de son prédécesseur dans le même fauteuil. Mais l’académicien aussi peut fayoter à l’occasion, pour ravoir deux fois des frites à la cantine… ça s’est vu ! (Je peux donner des noms).
Je dois avouer que j’avais jusqu’à présent un a priori plutôt favorable à Nathalie Rheims, pas seulement car elle a été la compagne du grand producteur et réalisateur Claude Berri (Sex shop, Tchao Pantin, Uranus), mais aussi car elle m’a toujours semblé mesurée dans ses interventions médiatiques. C’était jusqu’à ce que je découvre, consterné, sur le site web du Point une tribune de l’écrivaine titrée sans détour « Bernard-Henri Lévy, le magnifique ! » Manifestement émoustillée par un passage à la télévision du philosophe, à l’occasion de la promotion de son dernier opus Les aventures de la vérité. Peinture et philosophie (Grasset), Nathalie Rheims, qui est inflammable, s’enflamme littéralement… Citons in-extenso : « En le voyant, en l’écoutant, hier, parler d’un grand tableau d’Anselm Kiefer représentant la puissance du surgissement d’un monde, je me demandais qui d’autre que lui pouvait faire ce genre de chose au milieu d’une émission de divertissement regardée par des millions de téléspectateurs. Il a cette capacité, cette hauteur de vues et aujourd’hui, peut-être un peu plus, cette sagesse, qui permettent à la pensée de ne pas disparaître complètement dans un monde qui pourrait facilement plonger dans l’obscurité. Ici, l’intellectuel engagé est dans son rôle de vigie, fouillant l’horizon du regard, Bernard-Henri Lévy, le Magnifique » Résumons-nous, BHL, invité permanant des plateaux de télévision se paie une tranche de name-dropping pictural pour épater le bourgeois dans le salon de Laurent Ruquier, et la Dame – hypnotisée – crie au génie. Non seulement le disciple de Jean-Baptiste Botul est un monument, mais il s’inscrit dans une histoire… « comme Jacques Derrida ou Jean-François Lyotard autrefois, Bernard-Henri Lévy semble avoir l’oreille fine », écrit Nathalie Rheims. Et de conclure en appelant l’humanité aliénée à se libérer du « musée imaginaire » de Malraux (à ses yeux obsolète) en suivant les intuitions esthétiques colossales de BHL, sans en préciser les contours… (Si ce n’est qu’il aurait, seul, compris que l’image avait partout « triomphé » à l’époque actuelle. Bravo !)
Alors, éloge ou fayotage sur le site du Point ? Ne tombons pas dans l’écueil du mauvais esprit… Cette Dame émotionnelle et inflammable, après tout, a peut-être simplement eu une « émotion » très pure devant son poste de télévision…Ah, j’oubliais un petit détail : le grand Bernard-Henri Levy collabore régulièrement à cet hebdomadaire très respectable depuis plusieurs décennies…
Une photo : le repos du guerrier
Paris-Match a publié, dans son édition du 27 décembre 2012 une photographie de Bernard-Henri Levy absolument conforme à l’idée que l’on se fait habituellement du philosophe médiatique, et que l’on se permettra abusivement de légender : « Le repos du guerrier ».

Le repos du guerrier
Il s’agit d’un cliché du célèbre photographe américain Jonathan Becker, qui doit dater d’une quinzaine d’années, et que l’on retrouve dans l’album « Jonathan Becker, 30 years at Vanity Fair » (éditions Assouline). Becker ne s’est pas fait un nom dans le reportage de guerre, mais dans l’imagerie glamour, et les portraits de stars hollywoodiennes. Il déclare, dans les colonnes de Paris-Match : « J’aime beaucoup photographier Bernard-Henri Lévy. Lui et Arielle savent intuitivement se mettre en scène, ce sont à leur façon de grands acteurs de théâtre. BHL, que j’adore, connaît parfaitement ce que veulent les magazines. Il sait exactement ce qu’on attend de lui, c’est quelqu’un d’unique. » Autrement dit, il sait prendre la pose comme un mannequin professionnel, à qui il est inutile de demander de minauder comme ceci ou comme cela devant l’objectif, à qui il n’est pas indispensable de demander tel astucieux mouvement de chevelure ou tel effet de décolleté, mais qui le fait naturellement, comme il respire.
C’est le repos du guerrier. Naturellement ce cliché est bien antérieur à l’épisode militaire de BHL en Libye (pays malheureux dont la population vivait sous le joug de l’infâme Khadafi, et que le philosophe a libéré tout seul grâce à son Opinel n°5 et son Hugo Boss avantageux). Mais Bernard-Henri, quoi qu’il fasse semble toujours revenir d’une guerre. Il goûte la paix, dans une pose lascive, auprès de son épouse – sculpturale et hors du temps – intermittente du spectacle.
Le cliché de BHL, dans son hacienda d’opérette, a été publié par le magazine américain Vanity Fair (publié par le groupe CondeNast qui édite aussi GQ et Vogue), publication chic et superficielle, prescriptrice en matière de vente de cravates, mais ne se privant pas – au besoin- de la caution intellectuelle d’un philosophe avachi.
Une version française de Vanity Fair sera lancée très prochainement. Le groupe américain a eu l’idée d’aller chercher le sexagénaire générationnel Michel Denisot pour diriger le projet. Michel Denisot… Le chef d’orchestre du « Grand Journal » de Canal+, où les philosophes ne sont que décoratifs. La boucle serait donc bouclée ?








