A travers l’exploration des zones laissées en blancs sur les cartes, Philippe Vasset se déprend bien vite de l’illusion un peu grisante de faire de la « géographie alternative »1. De notre point de vue pourtant, il n’en propose pas moins une pensée alternative riche de multiples enjeux tant métaphysiques que politiques en renouvelant la notion de projet et en développant une pensée de la résistance comprise comme transparence qui apparaît comme l’autre face des théories de la domination et permet de penser une résistance qui n’implique pas de prendre position sur son « sujet politique » dépassant en cela les apories traditionnellement rencontrées.
Comme l’indique son titre, l’ouvrage est effectivement un « récit »…accompagné de « cartes » de la proche banlieue parisienne qui servent de points de départ à des expéditions dont le texte va ensuite rendre compte. Un récit ? Mais de quoi ? Nous n’apprendrons rien : pas d’événements, mais aucune psychologie non plus. Ne nous y trompons pas, il ne s’agit nullement d’ « auto-fiction ». Non, il s’agit d’un récit au sens propre du terme puisque ce sont les fait et gestes de l’auteur qui sont minutieusement consignés, un récit d’ailleurs essentiellement fait d’échecs et de tentatives avortées, sans aucun misérabilisme pourtant. Le récit se déroule : l’auteur explore des espaces qu’il a repérés sur les cartes et qui s’avèrent être des « zones blanches », très concrètement des espace qui apparaissent blancs sur le document cartographique et qui excèdent ainsi une lecture appuyée sur la légende accompagnant la carte. Ces zones apparaissent comme des trous ou, au sens propre, des trouées, des excès de réel. Si tout les éléments de réel sont recensés et classés dans la légende, on ne peut que s’interroger sur le statut de ces blancs, de ces vides qui deviennent des points de départ possibles pour découvrir un autre réel que celui qui peut se noter, s’identifier et que l’auteur appelle de manière quelque peu romanesque au départ « le double fond du monde ». Cette tentative pour faire surgir un « autre réel » à partir de ces blancs repérés sur les cartes donne lieu à plusieurs tentatives qui vont de l’exploration, à la tentation du documentaire en passant par le land art. Pourtant, on ne peut qu’être frappé par l’échec répété de ces tentatives successives, frappé et intrigué au point de relire. Et dès lors, c’est une expérimentation minutieusement construite qui se déploie pour nous dans ce coup d’œil rétrospectif, dans cette seconde lecture : rien n’est laissé au hasard, tout s’enchaîne parfaitement pour venir en quelques pages seulement et dans un style limpide et agréable dessiner les contours d’une pensée alternative, à la fois théorique et pratique, qui se distingue explicitement et radicalement d’un quelconque « engagement », redéfinition par l’exemple des notions de projet, et de réel.
C’est le réel qui est en question dans cet ouvrage, mais la mise en question n’est pas de l’ordre de la méditation métaphysique, mais de la pratique concrète. Ce sont les tentatives frénétiques d’un quidam plongé dans le réel et qui refuse de s’en laisser compter et d’accepter, d’abdiquer face à ce qu’ « on » nous présente – au deux sens du terme : le « faire croire » et l’effort concret pour atteindre cette idée d’un réel totalement sous contrôle – comme le réel plein, entier et sans reste, un quidam qui met tout en œuvre pour déterminer chemin faisant une expérience alternative, pour dégager un espace différent.
Un projet très construit
C’est un étonnement qui fait office de point de départ, un étonnement et un intérêt que l’auteur nous fait partager, l’air de rien, dans la mesure où il s’agit d’un émerveillement purement privé et qui ne révolutionne rien : le réel, l’espace réel est hétérogène à sa ressaisie cartographique. Bref, une définition de la carte et un émerveillement un peu naïf pour l’opération de symbolisation qui s’y joue. En poussant un peu plus loin cet étonnement, en repérant des « zones blanches » sur les cartes, un véritable « dispositif expérimental » se déploie. Les « zones blanches » ainsi repérées, dont on se demande ce qu’elles figurent, quelle réalité leur « correspond », permettent de donner corps à l’étonnement et à l’émerveillement liminaire, de dépasser cette pure fascination. C’est la brèche qui assure le passage de la contemplation à l’action, mieux, l’incarnation d’une fantaisie. La « zone blanche » est incitation à l’exploration. Elle participe certes de ce décalage fascinant de la carte et du réel, mais elle est avant tout l’élément qui donne à l’émerveillement la possibilité de déboucher sur quelque chose de plus dans la mesure où elle assure l’élaboration d’un dispositif expérimental. Une hypothèse se fait alors jour, projet initial qui deviendra le « projet fondamental» de ces explorations suburbaines : il y a dans le réel un excès qui se dissimule et que l’on peut excaver, les espaces blancs des cartes étant le coin dans l’univocité d’un réel qu’on nous présente sans aspérités. La « zone blanche » permet de créer une situation-test pour l’hypothèse selon laquelle le réel tel qu’il se donne – tel qu’on nous le présente – et tel qu’il est perçu – tel qu’on nous le dit et nous le montre – n’est pas sans reste : il y a autre chose que ce qui de donne immédiatement, il y a un « double fond » pour lequel les « zones blanches » vont être une porte d’entrée.
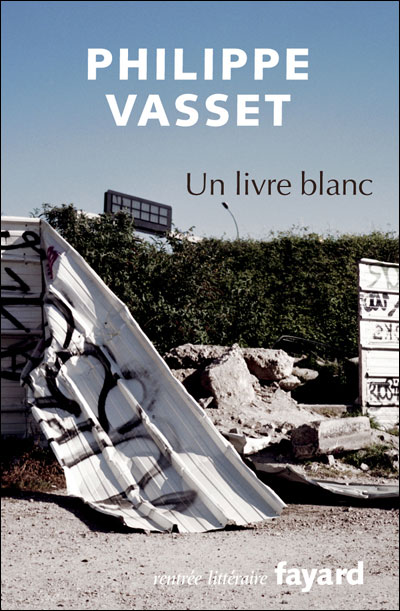
La première tentative, qui consiste à se rendre sur les « lieux » qui correspondent aux espaces blancs des cartes est loin d’être satisfaisante et semble d’emblée invalider le projet visant à trouver du « merveilleux » : en effet, c’est la misère et l’insoutenable qui sautent au visage2. Un deuxième projet émerge alors de cette déception3, qui consisterait à témoigner et à dénoncer cette misère, projet alternatif bien vite abandonné4 à son tour et qui prétendait « rendre compte » de cette misère pour la dénoncer sous la forme d’un documentaire engagé. C’est le temps d’errance et de latence suivant l’abandon de ce projet alternatif, mis à profit dans des opérations de « land art »5 qui ramène notre géographe explorateur à son projet de départ6, la notion de merveilleux en moins, ou disons paradoxalement sublimée en tentative pour trouver de l’inconnu. La question est bien de savoir comment découvrir de l’inconnu. Dans quelle disposition se mettre, quelles pratiques mettre en œuvre pour accéder à cet inconnu, autrement dit à un réel différent de celui que nos habitudes de vies et de société nous imposent ? Deux solutions s’offrent alors : la description minutieuse tentée par le phantasme d’exhaustivité et la production de fictions qui réenchanteraient le monde. Mais dans un cas comme dans l’autre – le texte ou le roman – on manquerait le rapport carte/réel qui fait office de paradigme depuis la première phrase du texte. Se mettre en situation d’observation alors ? En effet, telle va être la solution adoptée, et c’est cette transparence qui permet seule de produire une autre carte, de pratiquer un réel perspectivisme qui ne soit pas un simple jeu de regard. Nous avons alors une réponse au projet initial. Mieux, on peut reformuler la question comme suit : comment faire émerger un excès de réel au cœur même du réel, sans fuir dans la fiction, sans se réfugier dans la quête d’exhaustivité ? Ce n’est ni en rendant compte du réel, ni en l’affublant de fictions que le double-fond du monde se révèle, mais bien dans une observation active qui déjoue les perspectives autorisées7. Contre la description, l’auteur prône une invention de la langue qui excède ses capacités traditionnelles ; contre la fiction, c’est cette expérience des perspectives inusitées qui prévaut. Dès lors, nous réalisons, en suivant l’auteur, un déplacement dans les clivages admis et redessinons une carte du monde. Les enjeux de cette redéfinition ne sont pas minces. En effet, il y va de la possibilité de ce perspectivisme. La reconduction – décalée – de la frontière terres connues/terres inconnues est la condition qui rend possible un excès de réel en attente et par suite permet de déjouer les parcours fléchés et autorisés. En effet, cela revient à ménager la possibilité d’un inconnu. On voudrait nous faire croire que tout est connu, et qu’il n’y a rien « de plus », ce qui reviendrait à imposer de fait un réel, univoque, définitif, positif. Or cette nouvelle cartographie non seulement témoigne qu’autre chose est possible, mais prend la forme d’une véritable sauvegarde du possible d’une part et, d’autre part, de la réalité de ces espaces qui, sans cela, serait simplement des terres non connues, méconnues et délaissées, ces espaces dont la réalité et en même temps le caractère « inconnu » assurent le jeu nécessaire à une perception différente du réel et par suite à une latitude du réel. Dans la mesure où on les inscrit dans cette partition connu/inconnu, ces zones acquièrent une valeur sans précédent. Elles deviennent l’espace de latence qui contrecarre le phantasme de maîtrise de l’idéologie dominante. Cela ne veut pas dire que l’on donne une valeur à la misère en tant que telle et qu’on espère bien l’entretenir. Non, il s’agit plutôt de l’inscrire dans la réalité « de tous », dans le paysage conceptuel « de tous » au lieu de la reléguer dans un monde qui n’existerait pas pour tous mais seulement pour ceux qui y vont8. C’est le possible qui acquiert désormais droit de cité. Cela revient à déjouer les plans d’une logique utilitariste reléguant dans l’invisible et le non réel ces zones de fait contestatrices – puisqu’elles contreviennent par leur simple existence à cette logique d’utilisation – et s’essayant concrètement à endiguer la prolifération de ces espaces en utilisant au maximum l’espace, en maximisant le territoire que l’on inscrit dans un circuit de valorisation.
L’exploration de P. Vasset, quand bien même ne trouve-t-elle « rien », est une manière de conférer une certaine réalité à ces zones. Et le simple fait de leur conférer une réalité, à quoi répond cette nouvelle bipartition du monde, est une manière de faire échec à la logique dominante, sans pour autant prôner une perpétuation de cet état pour ceux qui le subissent. L’auteur déjoue la logique de l’unité qui sévit de nos jours. Cette nouvelle cartographie assure la possibilité de voyages immobiles en fondés à la fois sur l’hétérogénéité de la carte et de l’espace et sur la persistance d’espaces vacants. Il nous semble que cette nouvelle bipartition du monde entre les terres connues et utiles et les zones fangeuses des bidonvilles est une entreprise de protection des « zones blanches » qui, sans pour autant s’accommoder de la misère, assure la possibilité d’un réel plurivoque et alternatif.
Perspectives
Plusieurs remarques peuvent être faite, une fois dégagée l’architecture de l’ouvrage.
Si l’on se retourne sur le chemin parcouru, c’est la cohérence du projet d’ensemble qui apparaît et qui mérite d’être soulignée. Ce qui se donne comme une série de tentatives pour la plupart sans lendemain sont les différents moments d’un projet qui demeure et qui persiste, quand bien même d’autres projets entendraient-ils parfois prendre sa relève. L’étonnement donne lieu à une véritable expérimentation très proche de ce dont parle Hempel dans ses Eléments d’épistémologie. L’étonnement un peu naïf – la différence du réel et de la carte – l’hypothèse plus naïve encore – retrouver une aspiration d’enfant qui consisterait dans un réenchentement du monde – trouve dans les « zones blanches » des cartes de quoi fonder un dispositif expérimental qui va donner corps et maturité à l’étonnement aussi bien qu’à l’hypothèse. A la limite, le premier échec fait partie des données du problème : l’hypothèse du conte de fée, la notion de merveilleux n’est pas tenable un instant à l’épreuve des faits. Pourtant, elle implique moins l’abandon du projet que son affinement : l’inconnu, le « double-fond » du réel demeureront jusqu’au bout – autrement dit jusqu’au succès – les enjeux de la quête. Chaque nouvelle tentative ou tentation est une manière de progresser dans la réalisation de ce projet, les échecs, les abandons permettant d’affiner et d’affûter le projet lui-même, de refuser également les solutions de facilité.
Trois types de projets se font jour : le projet initial et bien réel concrétisé dans un dispositif expérimental et dans diverses tentatives pour le mener à bien ; les projets alternatifs qui rompent avec ce projet initial à la suite d’une expérience malheureuse ; enfin les projets virtuels qui naissent chemin faisant au cours des expérimentations, telles des notes infra-paginales laissées en plan faute de temps, de moyens mais également parce que cela ne satisfait pas pleinement la quête initiale toujours en point de mire. Pourtant, ces trois types de projets se fondent à chaque fois, ou plutôt manifestent une acception bien singulière de la notion de projet. Le projet n’y est pas en effet l’idée directrice qui préside à l’action et que des moyens viendraient soutenir, mais bien l’idée – certes « directrice » – qui émerge du débat – devrait-on dire des ébats – pratique. L’auteur met en œuvre une acception résolument immanente de la notion de projet – et par suite paradoxale dans la mesure où le pro-jet apparaît toujours rétrospectif, comme la phase ultime de l’expérimentation, l’élément découvert sur le tard9. Ne serait-ce que pour cette immanence de la notion de projet, l’ouvrage mériterait le détour et l’attention du philosophe. Mais il y a plus.
La réflexion contemporaine s’est depuis quelques décennies consacrée à la pensée de la domination10, laissant sinon de côté, du moins en suspens, la question toujours problématique d’une pensée de la résistance. Il nous semble que cet ouvrage offre des pistes non négligeables à cet égard, à partir notamment de sa critique de l’engagement et de sa contrepartie positive : l’éloge de la transparence : c’est faute d’être transparent que Vasset renonce à son projet de documentaire11 ; c’est en revanche parce que l’observation se fonde sur la transparence qu’elle le satisfait en se révélant féconde12. C’est un refus de l’engagement qui se fait jour et se donne comme une forme valide et pertinente de résistance.
Cette position a l’avantage de dépasser la question délicate du « sujet politique » de la résistance qui apparaît toujours comme la pierre d’achoppement des tentatives de résistance ou du moins de leur conceptualisation.
- P. Vasset, Un livre blanc, Fayard, 2007, pp. 33-35 : « j’avais l’impression de faire de la géographie parallèle, alternative, à rebours de la science officielle, forcément impersonnelle, réductrice. Deux rencontres sont venues corriger ce sentiment : un vrai géographe, qui faisait au quotidien ce que je prétendais faire en amateur, à savoir mettre les cartes à jour. […] [Ensuite, les] sous traitants de divers sociétés [qui] travaillaient à enrichir la base de donnée de leurs employeurs. […] »
- Ibidem, p. 22 ; « Au bout de deux mois, j’avais complètement oublié l’idée de faire apparaître la moindre parcelle de merveilleux : les blancs des cartes masquaient, c’était clair, non pas l’étrange mais le honteux, l’inacceptable, l’à peine croyable : des familles campant dans la boue en pleine ville […] »
- Ibidem, p. 23 : « J’ai donc radicalement changé d’approche, décidant à rebours de toutes les règles que je m’étais fixées, de m’intéresser au contexte, d’interroger les gens, de consulter des rapports et des spécialistes, bref, d’écrire une sorte de documentaire, un texte qui dirait : « Regardez, voilà comment des gens vivent dans notre ville, et vous, ne voyez rien ; pire, vous vous organisez pour les cacher. »
- Ibidem, p. 24 : « Mais lorsque j’ai voulu synthétiser toutes les informations rassemblées, les phrases ont refusé de s’agencer en argumentaire : mes textes n’expliquaient rien, ne racontaient aucune histoire, et laissaient même transparaître par endroit une fascination difficile à assumer pour ces existences portées jusqu’à l’extrême public, ces patientes appropriations d’un coin de rue, d’un trottoir et ces vies dissolues dans le mouvement et le passage. J’ai vite compris que jamais je n’arriverais à dénoncer quoi que ce soit »
- Ibidem, p. 27 : « Laissant en plan mon « documentaire engagé », j’ai recommencé, faute d’autres projets, à me promener. Hanté par les images de taudis et de bidonvilles, j’ai tenté d’aménager la ville ».
- p. 28 : « Inévitablement, ces bricolages me ramenaient sur des zones mouvantes, mal définies. Je m’attardais sur les terrains en construction et notais mentalement les périmètres abandonnés : au retour, je ne pouvais m’empêcher d’aller voir comment tous ces détails étaient figurés sur la carte. Au bout de quelques semaines, j’ai repris mes explorations. »
- Ibidem, pp. 78-79 : « Les scènes les plus bizarres apparaissent lorsqu’on parvient à déjouer les complexes mises en scène des urbanistes. Pour y arriver, la simple déambulation curieuse et opiniâtre (la fameuse dérive des situationnistes) ne suffit plus : les périmètres sont maintenant sécurisés, les surfaces vernies et les portes condamnées. La seule alternative est de se fixer des itinéraires arbitraires qui faussent les points de vue ménagés et taillent à la serpe dans l’agencement harmonieux des constructions. […] L’exploration systématique des zones blanches des cartes est, on l’aura compris, le dernier avatar de ce vieux projet inabouti ».
- Ibidem, pp. 129-133
- Ibidem, p. 68 : « […] et j’en vins à me demander si, inconsciemment, le but que je poursuivais n’était pas fort différent de mes objectifs affichés ».
- Michel Foucault en serait le principal représentant, mais l’ensemble des penseurs qui travaillent dans son sillage ou en utilisant ses concepts pourraient être cités.
- Ibidem p. 25 : « préférant la confusion à la clarté, m’y prélassant même, et retardant le plus possible le moment où il faudrait choisir mon camp et cesser d’être transparent, sans poids ni place ».
- Ibidem, p. 64 : « J’étais voyageur sans objet, devenu transparent : libre de tout rôle, j’observais tout ce qui venait s’encadrer dans ma mire, sans rien décrire ni recenser ».








