La question fiscale constitue peut-être l’un des mystères actuels de la philosophie politique : instrument de toute politique publique, elle devrait faire l’objet de réflexions nombreuses et contradictoires tant elle renvoie à la question des principes – liberté du citoyen, seuil de confiscation de la propriété privée, égalité devant l’impôt, option en faveur de la liberté ou de l’égalité –, qu’à celle de l’opérativité des décisions publiques. Pourtant, la majorité des réflexions politiques contemporaines contournent cette question sans véritablement discuter la nature de l’impôt ni même sa quantité. Certes, paraissent çà et là quelques exceptions, notamment Peter Sloterdijk et son Repenser l’impôt1, ou encore certains travaux de Byung-Chung Hal et Mikhaïl Xifaras ; mais force est de constater que la réflexion sur l’impôt – sa légitimité, sa nature, sa hauteur, etc. – est laissée à l’abandon comme s’il constituait un point aveugle de la pensée politique.
A : Peut-on penser philosophiquement l’impôt ?
La première question à poser est celle des raisons de l’abandon philosophique à l’endroit de l’impôt. Celui-ci peut sans doute s’expliquer par des phénomènes de domination idéologique au sein du champ intellectuel, domination organisée de telle sorte que la légitimité de l’impôt soit devenue une évidence au regard des pensées quadrillant le monde universitaire et ne pouvant plus véritablement faire l’objet d’une mise à distance critique. Autrement dit, la situation intellectuelle du moment dessine un cadre au sein duquel l’idée même de réfléchir l’impôt et, partant, d’interroger la légitimité de son montant, de sa finalité et de ses objectifs, apparaît d’emblée comme une remise en cause de ce dernier, et s’apparente ipso facto à une entreprise anti-égalitaire douteuse que beaucoup qualifieront d’ultra-libérale ou de réactionnaire.
Pourtant, avec un taux moyen de prélèvements obligatoires établi à 34, 3% au sein de l’OCDE, contre 44, 4 % pour la France en 2015[cf. [source INSEE. [/efn_note], associée à une incapacité des administrations publiques de déterminer le nombre d’impôts et de taxes en vigueur sur le territoire français, nombre oscillant entre 150 et 1000 selon les estimations, la question fiscale mériterait que l’on s’y arrête philosophiquement, afin de déterminer ce qu’est un impôt, quelles sont les raisons pour lesquelles un citoyen doit y consentir, et ce que signifie la « gratuité » des services publics lorsque les impôts et les taxes s’élèvent à la hauteur annuelle d’environ 1 000 milliards d’euros et les dépenses publiques à 57, 5 % du PIB en 2014. Par ailleurs, il serait bon de se demander concrètement ce que veulent dire un certain nombre de penseurs lorsqu’ils qualifient de libéraux ou de néolibéraux les pays européens dont les taux de prélèvements obligatoires et les dépenses publiques, certes plus bas que ceux de la France, demeurent néanmoins bien plus élevés que ce que les auteurs libéraux considèrent comme acceptable.
Dès lors, ne serait-ce que pour déterminer la nature des régimes économiques en place et le contenu des contrats sociaux, il serait fécond d’interroger l’étendue et la nature de la fiscalité dans les pays de l’OCDE en général et de l’UE en particulier afin de circonscrire le sens des mots employés. Jusqu’à quel point cela a-t-il un sens de qualifier un pays de « libéral » lorsque ses dépenses publiques sont telles qu’elles dépassent la moitié du PIB annuel ? Bien loin d’aller de soi, la qualification des régimes économiques en vigueur du point de vue des philosophies qui les inspire devrait prendre en compte la question fiscale et éliminer à partir de cette dernière un certain nombre d’appellations arbitraires, dictées par l’idéologie.
Pourtant, de telles analyses, qui supposeraient de démêler des réalités d’une complexité parfois décourageante, ne sont que très rarement menées ; c’est pourquoi, le dernier livre de Philippe Nemo, Philosophie de l’impôt2, propose une réflexion sur le sujet dans un ouvrage passionnant, interrogeant le problème depuis l’angle libéral qui lui est cher. La fiscalité, note ce dernier, « n’est pas un phénomène autonome, mais une composante organique de la vie politique, économie et sociale. A ce titre, ses principes ne peuvent être envisagés indépendamment d’une réflexion approfondie sur la nature et les missions de l’État, sur les modes de fonctionnement de l’économie – doit-elle être libre ou planifiée, polycentrique ou régulée depuis un centre (…). Ainsi une réflexion sur les principes de la fiscalité est étroitement dépendante d’une philosophie politique, d’une philosophie économique, d’une philosophie sociale – et finalement de la philosophie tout court, puisqu’en définitive, ce dont il s’agit, c’est de l’homme lui-même, au sujet duquel se pose la lancinante question de savoir s’il est fait pour la liberté ou la servitude. »3.
B : La perspective retenue : questionner l’impôt depuis la liberté
L’ouvrage de Philippe Nemo s’inscrit doublement à contre-courant du cadre idéologique actuel : non seulement il questionne l’impôt, donc le met à distance et introduit la possibilité de discuter son montant et ses fonctions, mais en plus il discrédite l’approche de la doxa voulant que l’impôt soit par nature un instrument de la « justice sociale » ; autrement dit, loin d’admettre d’emblée que l’impôt soit lié de manière essentielle à l’égalité, il interroge au contraire celui-là selon l’angle de la liberté, produisant une approche en contrepoint du discours ambiant qui considère comme acquis que l’impôt est par nature un levier de lutte contre les inégalités sociales et économiques.
A cet égard, il serait bon de commencer la lecture de l’ouvrage de Nemo par le chapitre IV qui en donne le la : contre l’idée que l’impôt soit lié à une quelconque opération de « correction » économico-sociale, l’auteur développe de nombreux arguments qui, tous, visent à rétablir ce qui lui semble être la perspective la plus juste, tant économiquement que moralement, à savoir celle du maintien de la liberté politique et du consentement.
De là une sorte de « guerre idéologique » menée au sein de l’ouvrage, et la dimension polémique revendiquée derrière les analyses qui y sont menées. Nemo n’hésite pas à affirmer qu’il existe des théories fausses sur l’impôt, qui ont toutes en commun d’affirmer qu’il est d’intérêt général d’assurer la justice sociale en réduisant les inégalités par le prélèvement fiscal. « Elles écartent donc le problème moral que pose en elle-même la confiscation. Et elles présupposent que l’égalité est désirable par soi. »4
Par une approche rapide – peut-être d’ailleurs trop rapide pour qui aimerait rentrer dans les détails –, l’auteur aborde les fameuses « théories fausses » que sont selon lui le marxisme, l’égalité de sacrifice, le solidarisme et les théories keynésiennes, et le fait tant d’un point de vue économique que moral : nous ne pouvons pas restituer ici toutes les analyses – celle consacrée au keynésianisme nous paraît véritablement trop lapidaire – mais il nous semble crucial d’insister sur un point décisif à savoir que la perspective de l’auteur plaçant la liberté au-dessus de tout est d’abord et avant tout morale ; autrement dit, l’auteur ne fait pas sienne l’idée assez répandue du caractère « amoral » des systèmes économiques en général, et du « capitalisme » en particulier ; il y a à ses yeux des principes moraux fondateurs, que violent les théories fausses de l’impôt, qui se révèlent ainsi fausses économiquement autant que moralement. Parler de « justice sociale » revient à faire comme si la « spoliation » d’autrui ne posait aucun problème moral et comme si « l’égalité était désirable en soi, indépendamment du niveau absolu de richesses atteint par chaque citoyen. Sur ces bases, on entend fonder une fiscalité qui sera uniquement destinée à appauvrir une partie de la population pour en enrichir une autre. »5 Nous sommes ici au cœur du problème : derrière les évidences de notre époque se joue une évidence morale, axiologique même, jugeant qu’il va de soi qu’il est bon de faire de l’égalité un principe inconditionné et mauvais voire immoral de douter de cette affirmation ; à cet égard, le libéralisme dont se revendique Nemo présente quelque chose d’inactuel car il attaque la doxa sur le terrain de la morale en faisant de la liberté et du refus de la confiscation des impératifs moraux supérieurs à celui de l’égalité.
C’est sans doute pour cette raison que la guerre entre les doctrines libérales et les doctrines socialistes et leurs dérivées peut adopter un tour si passionnel : c’est que se joue en amont une détermination de ce qui est moral et de ce qui ne l’est pas, et que les principes axiologiques qui fondent le libéralisme sont en contradiction frontale avec ceux qui fondent les théories socialistes, chacune considérant l’autre comme profondément immorale. Redisons-le, pour un libéral, des prélèvements obligatoires élevés ne sont pas qu’un problème économique, ils sont d’abord un problème moral en ceci qu’ils introduisent une confiscation qui porte atteinte à l’identité humaine elle-même : les doctrines socialistes « écartent donc le problème moral que pose en elle-même la confiscation. Et elles présupposent que l’égalité est désirable par soi. »6.
Une telle perspective axiologique déployant une morale doit être complétée par une certaine anthropologie : s’il est immoral de lever des impôts trop élevés, c’est que l’être de l’individu a à voir avec ce qu’il a. « L’être de l’homme est intimement lié à son avoir. On est ce qu’on fait, et on fait ce qu’on peut faire avec ce qu’on a. »7 A cet égard, l’impôt produit les mêmes effets qu’une mutilation physique. « Cela revient en effet à le priver d’une part de son être qui est aussi constitutive de cet être qu’un membre l’est de son corps. »8 Il n’est d’ailleurs pas sûr que le Marx des Manuscrits de 1844 eût contredit pareille affirmation, une certaine équivalence être-avoir rendant seule compréhensible la théorie de l’aliénation de 1844.
Quoi qu’il en soit, il est essentiel de mesurer l’inactualité – au sens nietzschéen – du questionnement de Nemo, tant par son thème que par ses présupposés qui prennent à rebours une très grande partie du monde universitaire actuel, inactualité qui créera une difficulté morale de lecture pour qui coïncide pleinement avec le paradigme actuel défini par Kymlicka dans Théories de la justice qui fait de l’égalité une intuition incontournable, constituant le point de départ et le point d’arrivée de la réflexion politique actuelle.
C : Méthodologie et sémantique
Il nous faut à présent évoquer la méthodologie retenue : Nemo mêle habilement références historiques permettant d’indiquer les évolutions fiscales les plus significatives et interprétation de ces évolutions. A cet égard, le livre ne doit pas être lu comme un ouvrage historique mais bien plutôt comme la recherche par l’histoire d’une mutation fiscale impliquant une mutation politique de grande ampleur, dont l’impôt serait le symptôme ; cette mutation serait en outre advenue après le Seconde Guerre Mondiale et aurait introduit ce que l’auteur appelle une « inquisition fiscale », faisant triompher les conceptions socialistes de la Société et de l’État. Ainsi, la croissance fiscale « ne s’inscrit pas dans la croissance séculaire des appareils d’État qui a permis la mise en place d’une administration augmentant la sécurité des citoyens et régularisant la coopération sociale. C’est un phénomène d’une autre nature. »9 Autrement dit, on a là une « mutation qualitative »10 par laquelle l’impôt ne servant plus à maintenir l’ordre et la protection des citoyens témoigne du passage des États au socialisme, c’est-à-dire à l’organisation planifiée de la société par confiscation de la propriété privée et redistribution imposée des richesses par des taux de prélèvements inédits dans l’histoire.
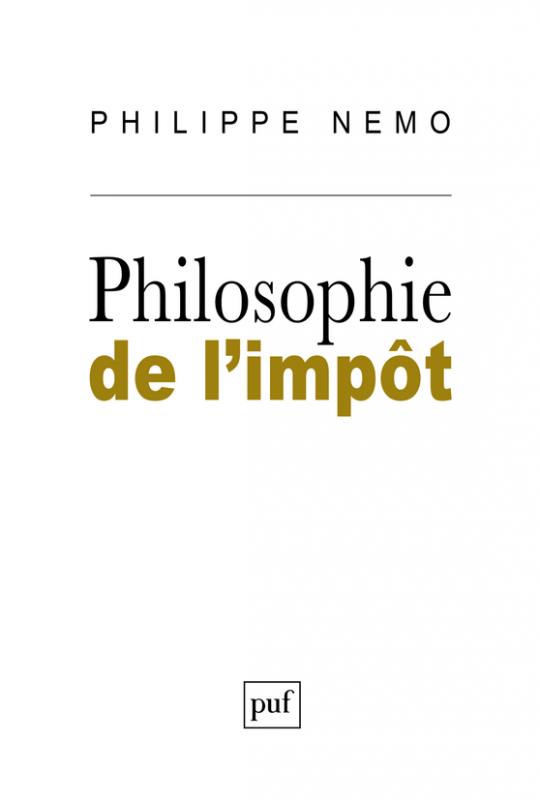
Mais plusieurs éléments doivent d’emblée être précisés. Le premier est que Nemo ne retient pas la définition historique du socialisme liée aux Partis et aux régimes s’en réclamant ; de ce fait, lorsque Nemo pense le socialisme, il le fait à la manière d’Hayek, c’est-à-dire y voit un instinct collectiviste atemporel accompagné de la croyance selon laquelle les sociétés humaines devraient être artificiellement organisées par une sorte d’institution surplombante décidant du type de relations que les citoyens devraient entretenir ; à cet égard, la redistribution fiscale constitue l’élément central par lequel serait opérée l’organisation administrée de la société, l’État et la bureaucratie décidant de ce qui devrait revenir à chacun. Lorsque les taux de prélèvements obligatoires dépassent un certain seuil, alors un changement de nature intervient en ceci que l’impôt devient l’instrument objectif de cette organisation artificielle de la société par décision surplombante de l’instance étatique ou publique. Pour bien comprendre l’ouvrage, il est donc impératif de comprendre la critique hayékienne de l’organisation sociale et de n’en pas rester à la seule lecture de la Route de la servitude à laquelle Hayek se voit bien trop souvent réduit.
C’est en ce sens que Nemo rattache la Sécurité Sociale au socialisme dont il dit qu’elle en est le bras armé. Un tel énoncé peut faire bondir, d’abord parce que la définition libérale du socialisme est contestable, ensuite parce qu’il est très difficile de penser la question de la Sécurité Sociale qui suscite d’immédiates réactions passionnelles, le simple fait de vouloir la penser ou l’interroger philosophiquement constituant le signe d’une intolérable volonté de remise en cause rétrograde aux yeux de beaucoup. Or, justement, par la dimension passionnelle qui s’est cristallisée autour de cette institution se révèle le fait que la Sécurité Sociale n’est peut-être pas qu’un organisme de prestation de services sociaux mais un élément fondamental d’une représentation du monde dont les principes moraux, comme n’importe quels principes, méritent d’être philosophiquement discutés. Ce sera sans doute déjà beaucoup trop pour bien des lecteurs qui n’y verront que le signe d’une entreprise libérale de destruction des « acquis sociaux », mais peut-être la philosophie est-elle en droit de ne rien considérer comme totémique et inquestionnable, et d’ainsi interroger nos certitudes morales et sociales les mieux établies.
Admettons donc que la question de la Sécurité Sociale constitue une réalité méritant d’être philosophiquement questionnée, non pour être dénoncée mais pour être reliée au type de pensée fondant sa légitimité. En elle semblent en effet charriées toutes les ambiguïtés de la question fiscale : avec un budget de 463 milliards d’euros en recettes, premier budget absolu de la Nation, elle n’est l’objet d’aucune analyse précise dans les ouvrages de philosophie politique alors même qu’elle soulève de profondes difficultés intellectuelles. Symbolique, voire totémique, la Sécurité Sociale semble exercer un pouvoir de fascination y compris auprès de ceux qui prétendent adopter une démarche critique. Il y aurait pourtant bien des aspects à questionner intellectuellement : invisibilité des prélèvements et indétermination de ce que coûte la Sécurité Sociale à chaque citoyen, nature ambiguë des Institutions gérant la Sécurité Sociale relevant toutes, à l’exception du régime général, du droit privé mais rendant des services de nature publique, impression de gratuité des services rendus alors même que le service, en dépenses, aura coûté en 2014 472 milliards d’euros prélevés sur les particuliers et les entreprises, etc. Comprendre sur quels principes reposent de telles institutions nécessite une longue investigation et invite à remonter aux éléments fondamentaux d’une Nation : ce que doit l’État au citoyen, mais aussi ce que le citoyen se doit à lui-même, le consentement du citoyen à l’endroit de prélèvements sociaux mais aussi l’impossibilité de consentir ou de ne pas consentir lorsque le montant réel du prélèvement n’est pas explicité, la possibilité d’étendre au-delà de la citoyenneté la protection sociale et, partant, de définir les bénéficiaires d’une politique sociale indépendamment du statut politique, etc. Bref, en tant qu’élément central du pacte social, tant pour des raisons économiques, que sociales et sanitaires, la Sécurité Sociale constitue un objet philosophique légitime qu’il serait incompréhensible de juger inquestionnable.
Cela étant dit, la thèse de Nemo ne consiste pas uniquement à juger questionnables les principes de la Sécurité Sociale et à donc prendre une distance réflexive à leur endroit, mais à les identifier au socialisme au sens défini ci-dessus. Les chiffres qu’il présente sont à cet égard intéressants et témoignent tout à la fois d’une hausse constante et importante de son financement, mais aussi d’une baisse de la part des cotisations sociales dans ce dernier, celles-ci ne couvrant désormais que 62 % du budget ; de ce fait, Nemo voit dans la Sécurité Sociale non plus un organe institutionnel de prestation de services publics mais bien plutôt un élément socialiste assurant concrètement le collectivisme par la redistribution, ce qui impose de comprendre en un second temps ce qu’il entend par ce terme qui, lui aussi, fera bondir certains lecteurs.
Le second point à comprendre est que, au sens libéral du terme, le « collectivisme » qualifie l’accomplissement concret du socialisme : le collectivisme, dans cette optique, n’est pas l’apanage de l’URSS mais décrit la mise en commun des richesses par les politiques fiscales récentes fondées sur la redistribution. Ainsi, précise Nemo, « l’inquisition fiscale n’est pas impliquée par le concept même d’État ; elle n’est indispensable qu’à un certain type d’État, celui qui entend gérer de manière collectiviste la vie sociale et économique. »11 C’est en cela que la question fiscale mérite d’être philosophiquement soulevée car, s’il est vrai que la philosophie doit questionner les évidences idéologiques de l’époque, il est alors nécessaire de se demander s’il est vrai et juste que l’impôt serve une politique de redistribution et, plus en amont, ce que signifie quant au politique et à la nature humaine une telle pratique redistributive. Le problème est fondamental car une forme de neutralisation du questionnement a été comme opérée depuis plusieurs décennies en ceci que toute interrogation sur la légitimité de la redistribution a été délégitimée au sein du monde intellectuel, lequel s’est ainsi dispensé de toute réflexion authentique sur le sujet au nom d’une philosophie du progrès rendant inquestionnable et donc impensable la dimension idéologique de ce qu’il a présenté comme une évidence. Le problème n’est donc pas prioritairement d’être en accord ou en désaccord avec les libéraux mais il est de réinvestir philosophiquement cette question-là en vue d’admettre que les principes sur lesquels repose l’impôt sont discutables, comme tout principe.
Enfin, et tel est le troisième volet qui doit être précisé, Nemo refuse de disjoindre le quantitatif et le qualitatif ; il est des évolutions quantitatives qui traduisent un changement qualitatif. En d’autres termes, il y a comme des effets de seuil dans les politiques fiscales qui traduisent des changements qualitatifs du rôle de l’impôt et, partant, des conceptions de l’État et de la nature humaine. En s’appuyant sur Pierre Vila, Une analyse macroéconomique de la France, Nemo montre l’explosion rapide des prélèvements obligatoires : à 9 % du PIB en 1896, ils avoisinent les 10 % vers 1918, les 18 % dans les années 1930. Contenus avant la Seconde Guerre Mondiale, il explosent après cette dernière. La thèse de Nemo consiste donc à dire que cette explosion observable partout signifie non une amélioration des conditions mais une mutation profonde du rapport à l’État et du rapport à l’homme lui-même. S’il se dit en accord avec certaines analyses de Sloterdijk, il conteste en revanche que la spoliation que décrit ce dernier ne concerne que les classes les plus riches des sociétés : on a là, dit Nemo, un « changement de société »12 lorsque certains seuils fiscaux sont atteints et que toutes les couches d’une société sont concernées. La conséquence en est « la réduction à la portion congrue des aspects de la vie que peuvent gérer directement les personnes, seules ou liées contractuellement les unes aux autres, en d’autres termes la régression spectaculaire des libertés. »13.
D : Thèses explicites de l’ouvrage
Chacun sait qu’il existe une défiance traditionnelle du libéralisme à l’endroit de l’impôt, craignant toujours la menace de la servitude derrière le supposé intérêt public au nom duquel est prélevé l’impôt, crainte dont Alain Laurent avait d’ailleurs regroupé les arguments dans une anthologie intéressante, Théories contre l’impôt14. Il ne faudrait pas croire, néanmoins, que le livre de Philippe Nemo constitue un réquisitoire contre l’impôt, bien au contraire : en interrogeant les conditions de légitimité de l’impôt, Nemo propose bien plutôt de penser les circonstances concrètes par lesquelles le citoyen s’en acquitterait avec intelligence et consentement, ce qui suppose une certaine transparence de ce dernier, et une réflexion générale sur le contrat social et la nature humaine.
Ainsi, l’ouvrage de Nemo contient deux directions : une première, à nos yeux incontestable, vise à réintroduire une réflexion fiscale, à interroger les principes de l’impôt, et à retrouver une des questions centrales de la philosophie politique dont ont traité tous les grands auteurs jusqu’aux années 1950. La seconde, plus discutable, vise à juger intolérable la politique fiscale mise en œuvre depuis plusieurs décennies en tant qu’elle témoignerait de la mise en place effective du socialisme par le biais d’un collectivisme d’autant plus efficace qu’il ne dirait pas son nom. Dans sa monographie sur Hayek, Nemo avait d’ailleurs déjà analysé, à partir des écrits de ce dernier, comment la Sécurité sociale avait opéré le glissement vers un socialisme collectiviste sans que ce glissement ne soit jamais explicité : « La substitution, d’un socialisme de la redistribution à un socialisme de la production à a été rendue possible par le déguisement du premier sous la forme d’une assurance. »15
Toute la question liée à la seconde thèse de l’ouvrage tourne alors autour du problème suivant : en supposant que nous soyons dans un régime collectiviste de nature socialiste au sens libéral de ces deux termes, en quoi serait-ce un mal ? Pour quelle raison précisément philosophique faudrait-il contester une telle situation ?
C’est là qu’apparaît le troisième aspect de l’ouvrage de Nemo, à savoir une réflexion sur ce que devrait être l’impôt, c’est-à-dire une détermination normative de la nature de l’impôt permettant d’argumenter à la fois en faveur d’une saisie libérale de ce dernier et en défaveur des taux actuels de prélèvements obligatoires. La thèse de Nemo est à cet égard classique : l’impôt est un échange de services. Fondement de la pensée libérale, une telle approche de l’impôt se trouve par exemple chez Montesquieu pour qui « les revenus de l’État sont une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l’autre, ou pour en jouir agréablement »16 comme chez Hayek : « Parce que le gouvernement a le droit exclusif de recourir à la contrainte, cela voudra souvent dire que lui seul est capable de fournir certains services qui ne peuvent être financés que par l’impôt. »17 Ainsi se dessine la définition jugée juste de l’impôt, celle par laquelle ce dernier constitue un échange de services, par laquelle le citoyen paie pour un type de services que lui rend l’État, service relevant souvent du cadre régalien. A cet égard, Nemo – comme Hayek – est aux antipodes de la pensée libertarienne pour laquelle même les fonctions régaliennes doivent être privatisées, et l’impôt quasiment neutralisé.
Mais s’il y a un impôt juste aux yeux de Nemo, celui qui procède de la justice et de la justesse de l’échange, alors comment ne pas défendre la progressivité de l’impôt dans la mesure où certains ont plus à perdre dans un cambriolage que d’autres ? L’inégalité de revenus et l’inégalité de la répartition de la propriété n’impliquent-elles pas, si l’impôt est un échange de service, que celui qui possède plus paie beaucoup plus par la progressivité que celui qui possède peu ? Un des passages les plus intéressants de l’ouvrage consiste à justement discuter ce principe et ce raisonnement. Toute la thèse de Nemo, qui consiste à contester la progressivité de l’impôt, doit affronter cette difficulté qu’il va surmonter en deux temps. La première étape consiste à analyser la nature du service rendu : dans le cas de la protection régalienne des citoyens, le service rendu est ici un service négatif ; l’État empêche qu’une nuisance ait lieu. L’État ne donne donc ici rien directement. « Il assume sa mission si et seulement si il ne m’arrive rien. »18 Or il est impossible dans ces conditions de déterminer a priori quelle valeur l’ordre public a eue pour des citoyens déterminés ; on ne peut pas déterminer ce qui a été empêché. Dans ce cas, la somme doit être la même pour tous. D’où cette conclusion ironique : « Pour justifier qu’un riche paie plus alors que les riches et pauvres bénéficient de la même sécurité, on devrait poser en thèse que la vie d’un riche et celle d’un pauvre n’ont pas la même valeur. »19
Mais il demeure l’obstacle de l’inégalité des biens : les individus fortunés ont plus de biens à protéger, donc ils devraient payer plus ; l’impôt serait alors une assurance (thèse de Thiers, dans De la propriété, p. 310) Son coût devrait être calculé comme une prime. Mais c’est une faute de raisonnement, analyse Nemo, car l’assureur s’engage à rembourser le bien assuré en cas de sinistre, et c’est pour cela qu’il compense par une prime élevée le risque financier supérieur qu’il prend en assurant un bien plus cher. L’État qui n’est pas un assureur au sens propre ne saurait avoir ce comportement, « pour la raison qu’il n’a ni le mandat ni les moyens d’indemniser les citoyens des dommages subis du fait des crimes et des délits. Le mandat qu’il reçoit d’eux, c’est d’empêcher que ces événements surviennent ; et, s’il ne peut les empêcher, il doit faire en sorte que la justice s’empare des coupables, et les force à rendre l’argent volé ou à réparer les torts commis dans la mesure où ils sont solvables. Mais là s’arrête sa tâche. Donc il ne dépense pas plus pour protéger les biens ou la vie d’un riche que d’un pauvre, et il n’y a pas lieu que l’un paie plus que l’autre pour obtenir ce même service. »20 L’argument est ici profondément libéral en ceci qu’il est formel : ne prenant pas en compte la matérialité concrète de la situation, il n’envisage que la forme du délit, indépendamment des dommages effectifs causés. La considération matérielle et concrète des dommages subis constituerait une intrusion excessive de l’État au sein de la société civile et serait inacceptable aux yeux de l’auteur. L’argument est séduisant mais il est permis de se demander s’il vaudrait au-delà ou en-dehors de la logique libérale du droit.
Cela étant dit, Nemo limite son refus de la proportionnalité de l’impôt à la question régalienne de la protection.
« Observons maintenant qu’à la différence de l’impôt qui rémunère l’ordre public, celui qui est destiné à permettre à la puissance publique de fournir des biens et services collectifs peut faire l’objet d’une estimation et d’une mesure, puisqu’il s’agit de réalités positives et quantifiables. Il est certain que les différents citoyens en consommeront des quantités variables en fonction de leurs activités et de leurs modes de vie, qui dépendent eux-mêmes de leurs revenus. Cela plaide pour que ce type d’impôt soit proportionnel, et non plus égal comme dans le cas du maintien de l’ordre public. »21
La proportionnalité permet l’échange juste entre puissance publique et contribuables en-dehors des questions régaliennes ; mais cette proportionnalité s’inscrit dans une conception de l’impôt comme échange de services fondé sur l’égalité ; dès lors, le citoyen doit n’avoir à donner en impôts que l’équivalent des biens et services dont il bénéficie. Mais sur quelle base choisir le prestataire ? Nemo propose à cet égard plusieurs conditions :
– choisir le marché dès que c’est possible
– rapprocher l’instance publique décisionnaire de la communauté des contribuables concernés, pour raccourcir les circuits d’information.
– découpler le financement de la prestation. On peut vouloir qu’un bien utile à tous soit financé par une autorité publique sans qu’il ne soit produit par elle. C’est d’ailleurs là un argument classique chez Hayek pour qui ce n’est pas parce qu’une activité est financée par l’impôt qu’elle doit être gérée par l’État. « Parce que le gouvernement a le droit exclusif de recourir à la contrainte, cela voudra souvent dire que lui seul est capable de fournir certains services qui ne peuvent être financés que par l’impôt. Il ne faudrait pas en déduire cependant que le droit de fournir de tels services doit être réservé au gouvernement lorsque d’autres moyens peuvent être trouvés pour les fournir. »22.
– les services sociaux n’ont pas à être traités à part, selon des principes de « solidarité » dont Nemo montre qu’ils sont trop flous pour être définis rationnellement et, partant, être compatibles avec une société de liberté.
E : Peut-on penser l’impôt comme un échange de service ? Discussion de la thèse de l’ouvrage
A partir de la thèse centrale de l’ouvrage – définir l’impôt comme un échange de services – peuvent être développés deux points. Le premier est d’ordre critique et s’inscrit évidemment dans l’analyse hayékienne de la « justice sociale ». Celle-ci avait proposé de révéler comment la « justice sociale », loin d’être un concept rationnel, s’apparentait aux superstitions ancestrales et servait d’intimidation « morale » à toutes les confiscations fiscales et politiques autoritaires des États modernes. La Seconde partie de Droit, législation et liberté, notamment dans le chapitre IX, avait en effet mené une critique très sévère de cette notion, jugée à la fois inepte du point de vue scientifique et scandaleuse du point de vue de ce que les libéraux appellent la justice. Dans un chapitre enlevé, Hayek avait ainsi opposé les sociétés libres, animées par la juste conduite, et les sociétés organisées et collectivisées, où l’action individuelle était sans cesse corrigée par la supposée justice sociale :
« L’on peut dire en effet que la principale différence entre l’ordre de société auquel visait le libéralisme classique, et le genre de société dans lequel il se trouve présentement transformé, est que le premier était gouverné par les principes de juste conduite individuelle, tandis que la nouvelle société doit satisfaire les demandes de « justice sociale » – autrement dit, que le premier exigeait des individus qu’ils agissent justement, pendant que la seconde charge du devoir de justice, de façon croissante, des autorités ayant pouvoir de commander aux gens ce qu’ils ont à faire. »23
Ou encore :
« Cependant, le fait qu’une croyance soit l’objet d’une adhésion quasi-universelle ne prouve pas qu’elle soit fondée ni même qu’elle ait un sens, pas plus que jadis la croyance générale aux sorcières et aux fantômes ne prouvait la validité de ces idées. Dans le cas de la « justice sociale », nous sommes simplement en présence d’une superstition quasi religieuse et, à ce titre, nous la laisserions respectueusement en paix si elle ne faisait que rendre plus heureux ceux qui la professent ; mais nous devons la combattre lorsqu’elle devient le prétexte à user de contrainte envers les autres hommes. Or, le prestige actuel de la croyance en la « justice sociale » est probablement ce qui menace le plus gravement la plupart des autres valeurs d’une civilisation de liberté. »24
Nemo reprend cette analyse et oppose de ce fait la justice réelle de l’impôt comme échange égal de services, à la justice fictive de la justice sociale, autorisant les spoliations au nom d’idéaux flous et indémontrables. Ainsi, parler de « justice sociale » revient à faire comme si la spoliation d’autrui ne posait aucun problème moral et comme si « l’égalité était désirable en soi, indépendamment du niveau absolu de richesses atteint par chaque citoyen. Sur ces bases, on entend fonder une fiscalité qui sera uniquement destinée à appauvrir une partie de la population pour en enrichir une autre. »25 Dans cette logique, le but n’est plus la nécessité de prendre sa part dans les services publics ; dans cette logique, « on est redevable d’un impôt sans contrepartie du seul fait qu’on possède quelque chose qui dépasse la richesse maximale admise. »26 Il en résulte qu’il n’y a plus de limite quantitative au prélèvement, que puisque le fait générateur de l’impôt est la richesse en tant que telle, l’État devra connaître cette richesse ; il devra avoir une information exacte sur tous les gains, et tous les avoirs. De là découle une sorte de droit de regard indéfini de l’État sur les richesses privées puisque l’impôt, investi d’une fonction corrective à l’endroit de la société, ne peut plus être borné par les limites de l’échange juste. Nous ne discuterons pas cet aspect de l’analyse de Nemo parce qu’il constitue la conséquence logique des principes libéraux et il ne nous appartient pas de discuter au sein de cette recension les fondements mêmes du libéralisme.
En revanche, nous aimerions discuter l’idée selon laquelle l’impôt juste serait par nature un échange de services, thèse que défend Nemo mais qui nous semble constituer une dépolitisation de l’impôt. Si, en effet, la question fiscale mérite d’être réinvestie philosophiquement, alors elle mérite du même geste de ne peut-être pas recevoir de solution immédiate dictée par le logiciel intellectuel pilotant son interrogation. L’impôt, nous dit Nemo, est « la rémunération par le citoyen contribuable des services que lui rend l’État. Il correspond à un échange. Il doit donc être réglé, moralement et juridiquement, selon la norme de la justice des échanges, la justice commutative, qui veut que tout échange, pour être juste, soit égal. »27 Et Nemo d’ajouter : « On ne consent à l’État le monopole de certaines tâches et on ne lui octroie les moyens financiers lui permettant de les réaliser qu’en échange de la réalisation effective de ces tâches – et d’elles seules. Sinon il n’y a pas contrat ; il y a usage unilatéral de la puissance, il y a rupture du droit, il y a oppression. »28.
De telles définitions nous paraissent hautement problématiques car elles réduisent l’impôt à un rapport contractuel entre deux contractants, biffant totalement la dimension politique de l’impôt. En d’autres termes, ce dernier n’apparaît que comme une forme particulièrement élaborée de contrat, la contractualité épuisant la nature de ce dernier, en en excluant la politicité. Il est vrai qu’en conclusion de son ouvrage sur Hayek, Nemo remarquait que la pensée d’Hayek ne condamnait pas l’action collective mais jugeait que l’action collective n’avait pas à emprunter les voies politiques, allant jusqu’à dire que l’idée même de « pouvoir politique » était « incompatible avec le concept d’une société d’hommes libres. »29 A cet égard, l’impôt ne semble demeurer compatible avec la liberté qu’à la condition d’être totalement dépolitisé, pour ne recevoir que la forme civile du consentement par la médiation du contrat.
Or cela soulève deux difficultés fondamentales : la première est d’ordre pratique et tient à l’immense difficulté de la détermination du contenu d’un service à l’endroit d’un particulier. La mesure de ce dont je bénéficie comme service étatique semble difficilement déterminable, le service débordant largement ce qui me concerne directement. Si nous prenons par exemple la question scolaire, il est évident que je ne paie pas pour un service qui ne concerne que mes enfants mais que j’ai intérêt à ce que beaucoup d’autres élèves soient scolarisés de sorte que la mesure du service ne saurait être étalonnée à ce qui me concerne directement. La seconde difficulté est plus principielle : si l’impôt n’est jamais qu’une forme élaborée de contrat garantissant un échange de services, alors l’insertion de l’individu au sein d’une collectivité politique s’estompe ; il n’y a plus que des rapports individuels fondés sur une estimation d’intérêts dont a disparu toute politicité. Or, non seulement cela détruit tout sentiment d’appartenance à un cadre collectif mais en plus on ne voit pas du tout comment cette individualité ne pensant plus qu’en termes de service pourrait ne pas déboucher sur un individualisme forcené, Nemo contestant pourtant que sa propre approche libérale soit une approche individualiste. En somme, nous ne voyons pas bien comment une théorisation contractualiste de tout rapport humain, fût-elle fondée sur des principes moraux, saurait échapper à un devenir individualiste que Nemo conteste frontalement.
Il nous semble à cet égard que les analyses hégéliennes développées dans le § 299 des Principes de la philosophie du droit offrent une approche subtile du problème : Hegel pense d’abord le rapport du citoyen à l’État en termes précis d’ « avantages » et de « contributions »30 et, de surcroît, il élabore les conditions du maintien d’une certaine liberté dans l’impôt ; à ses yeux, seule la réduction de ce dernier à une évaluation quantitative de la contribution, médiatisée par la monnaie, permet d’assurer à la fois la liberté individuelle et l’efficience fiscale, dans la mesure où cela prévient le risque d’évaluer la qualité de l’individu qui serait intrusive en même temps que cela autorise une détermination précise du montant de l’impôt. Pour autant, l’impôt n’est pas ici pensé comme un simple échange de services mais comme le moyen le plus rationnel d’assurer la liberté effective du citoyen en vue de répondre au sentiment d’appartenance politique qui le caractérise.
Conclusion
En s’écartant de l’intuition de l’égalité comme cadre paradigmatique de toute réflexion politique, Philippe Nemo propose une réflexion originale sur un sujet qui ne l’est pas moins de nos jours : faisant de la liberté conçue comme absence de coercition la perspective de son approche, il présente un ouvrage stimulant, courageux même, qui déroutera néanmoins bien des lecteurs. L’angle retenu s’écarte à bien des égards de nos réflexes intellectuels habituels, mais il assume un fondement moral pleinement explicité. Au-delà de la question fiscale, c’est peut-être la question axiologique qui nous semble intellectuellement la plus stimulante en ceci qu’elle rend visibles les présupposés de notre époque.
Un exemple permet de bien saisir à quel point l’approche libérale est devenue étrangère aux intuitions intellectuelles de notre temps : il est aujourd’hui fréquent de critiquer les devoirs à la maison non pas pour leur inefficacité intellectuelle mais pour leur remise en cause de l’égalité, le cadre privé de chaque élève n’offrant pas les mêmes conditions pour effectuer lesdits devoirs. De ce fait, beaucoup d’écoles renoncent aux devoirs au nom de l’égalité des chances. De même, au nom de cette dernière, l’épreuve de culture générale, jugée discriminante du point de vue social, a été supprimée au concours de Sciences-Po. Dans la même logique, on avait jadis privilégié les mathématiques, jugées plus neutres socialement, à la littérature, du fait même que la réussite en mathématiques ne pouvait dépendre d’un « capital culturel » donné. La question que pose Nemo est à cet égard la suivante : peut-on maintenir la liberté dès lors que le cadre privé se trouve sans cesse mis en accusation en tant que générateur d’inégalités au nom de l’égalité des chances ? Derrière cette question existe une option axiologique fondant une morale : la liberté comme non-coercition constitue un impératif moral absolu, fondement de toute société authentiquement libre. Ainsi, que deviennent le choix libre et la non-coercition dès lors que se trouve visée l’égalité réelle et contestée toute élaboration privée de l’individu ? Ne faudrait-il pas raccourcir les vacances pour éviter que certains parents n’en profitent pour faire lire leurs enfants et ainsi créer de nouvelles inégalités ? Si certains concours ou certaines épreuves sont déjà supprimés, ne faudrait-il pas supprimer à terme tout examen pour éviter que les conditions privées de révision ne créent elles aussi des inégalités ? « Il faudra même que la santé des écoliers et lycéens soit collectivisée, pour que nul corps ne soit mieux soigné qu’un autre, etc. Ainsi, il apparaît que la recherche de la simple « égalité des chances » implique en réalité de chercher à réaliser de proche en proche l’égalité réelle, au prix, s’il le faut de la suppression des dernières libertés sociales. »31. Une telle question ne fait que prolonger la logique actuelle de réforme d’un grand nombre de pratiques au nom de la neutralisation des inégalités supposément nées des différences de cadre privé.
D’une certaine manière, on pourrait répondre à P. Nemo que oui, bien évidemment, il serait bon que tous les corps soient soignés de la même manière, et reçoivent la même qualité de soin ; celui-ci répondrait alors que, au-delà de la probable inefficacité d’une société si « collectiviste » se jouerait l’abandon de toute forme de liberté, en ceci que coercition et absence de choix constitueraient désormais le cadre quotidien de chaque individu. On voit là toute la dimension axiologique du problème, et les intuitions si profondément différentes qui peuvent animer ceux qui s’emparent de telles questions.
Découle de cela ce qui est peut-être la difficulté séminale, celle de justifier les intuitions axiologiques fondant les préférences qui seront, au sein des systèmes et des croyances, érigées en principes absolus et fondateurs. Et il est à craindre que les intuitions séminales entre libéraux et non-libéraux soient si différentes, si viscéralement opposées, que seul un dialogue de sourd doublé de mutuelles condamnations morales puisse en sortir. Néanmoins, et indépendamment de la détermination de la meilleure option axiologique, Nemo présente l’immense mérite de révéler l’absence d’évidence des choix de l’époque, mais aussi de rappeler, au niveau pratique, que la grande complexité des sociétés humaines rend hautement improbable que l’organisation de la redistribution des richesses par la puissance publique soit suffisamment informée et plastique pour rendre cette redistribution efficace.
- Peter Soterdijk, Repenser l’impôt. Pour une éthique du don démocratique, Traduction Olivier Mannoni, Maren Sell, 2011
- Philippe Nemo, Philosophie de l’impôt, Paris, PUF, 2017
- Ibid., p. 12-13
- Ibid., p. 139
- Ibid., p. 106
- Ibid., p. 136
- Ibid., p. 193
- Ibid., p. 195
- Ibid., p. 21
- Ibid.
- Ibid., p. 25
- Ibid., p. 83
- Ibid.
- Alain Laurent (coord.), Théories contre l’impôt, Paris, Belles Lettres, 2000
- Philippe Nemo, La société de droit selon Hayek, Paris, PUF, 1988, p. 256
- Montesquieu, De l’esprit des lois, XIII, 1, Gallimard, Pléiade, 1951, p. 458
- Hayek, Droit, législation et liberté, chap. XIV, PUF, 2007, p. 696
- Nemo, Philosophie de l’impôt, op. cit., p. 89
- Ibid.
- Ibid., p. 91
- Ibid., p. 95
- Hayek, Droit, législation et liberté, p. 696
- DLL, 452
- Ibid., p. 455
- Nemo, Philosophie de l’impôt, op. cit., p. 106
- Ibid., p. 107
- Nemo, Philosophie de l’impôt, op. cit., p. 104
- Ibid.
- Nemo, La société de droit selon Hayek, op. cit., p. 361
- Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 299, Traduction Kervégan, PUF, 2013, p. 498
- Philosophie de l’impôt, op. cit., p. 159-160








