L’ouvrage1, dans un premier temps, peut surprendre, tant sa construction diffère de ce que nous connaissons en terme d’essai philosophique : la réflexion de l’auteur se poursuit au sein d’un discours constitué d’un ensemble de témoignages recueillis et reconstitués comme une sorte de parcours générique de l’entrée dans la dépendance et de sa sortie, parfois également ponctué de références plus littéraires, en particulier aux textes classiques de De Quincey, Baudelaire, ou de Burroughs. Une fois la surprise surmontée cependant, on lit avec beaucoup d’intérêt cet essai qui articule de façon subtile des considérations théoriques sophistiquées et des témoignages en première personne qui, mieux que de seulement les illustrer, les incarnent de manière subjective autant que réflexive.
Ni enquête sur le sens donné par des individus à leurs choix, évolutions et pratiques, ni investigation des conditions réelles déterminant celles-ci, il s’agit d’entrer dans toute la durée d’un itinéraire inscrit sous un ensemble de contraintes par l’aller-et-retour entre la mise à jour de celles-ci et les façons dont chacun les rencontre, les assume, s’y blesse, tente d’y frayer un chemin. S’il est bien question ici de parcours, c’est que la perspicacité réflexive dont font preuve les personnes interrogées, si elle interdit de faire d’eux de simples acteurs agis par des forces qui les dépassent, s’inscrit bien dans des contextes dont les lignes génériques sont situables, des contextes au sein desquels ils se débattent, face auxquels les dispositions et les actions, loin de révéler des capacités de surplomb, témoignent plutôt d’un murissement et d’une reconfiguration du rapport à soi-même.
La question de la drogue et de l’addiction à la drogue est traitée aux confluents d’un nombre impressionnant de perspectives – sociales et sociologiques bien sûr, neurologiques, philosophiques autant que législatives et politiques. Aussi loin de toute pensée déterministe (que ce soit socialement ou biologiquement) que de toute perspective individualiste, il s’agit de comprendre la réalité d’un parcours qui conduit à entrer dans le cycle de la drogue, dans le cercle de la dépendance puis à chercher à en ressortir. Acteurs engagés sinon agis, les personnes interrogées attestent d’un rapport différencié aux gains, risques et pertes qu’occasionne leur consommation autant que d’un rapport différencié à la temporalité d’un projet de soi-même. A ce titre, l’intérêt du livre est d’avantage dans l’épaisseur temporelle du processus de maturation dont témoignent les multiples extraits d’entretiens que dans les étapes jalons – finalement bien connues – de ce processus.
L’auteur choisit de questionner prioritairement la dépendance et ses aspects. Une des dimensions de celle-ci, rappelle-t-il, est physiologique. Des expériences sur les animaux effectuées depuis les années 50 ont montré comment il est possible de créer des processus addictifs tels que les individus préfèrent alimenter leur stimulation à tous les autres comportements et finissent par mourir de soif et de faim. Pour autant, la dépendance ne peut être envisagée sous ce seul aspect d’un dérèglement des mécanismes : l’entrée dans la drogue et la sortie constituent un itinéraire complexe. De même, il faut se garder de se laisser enfermer dans une approche uniquement behavioriste (associant le plaisir à certains comportements) ou uniquement subjectiviste (certaine qualité de vécu) de la drogue qui constitue précisément un plaisir qui cesse d’en être un et qu’on n’interrompt pas, ou qu’on interrompt au contraire alors qu’il est encore un plaisir. La perspective est plus subtilement de jalonner un « (…) chemin moral qui peut conduire, à partir d’un même type de pratique, d’un état fonctionnel plaisant à un état dysfonctionnel douloureux », à exposer comment on peut en venir à choisir la drogue et comment celle-ci devient plus tard intolérable.
Trois parties, de taille inégale, scandent le développement. La première, qui est aussi la plus longue, relate le processus du « devenir dépendant ». Il s’agit continument ici de pointer la complexité du phénomène, de ses déterminants autant que de ses phases, cela pour récuser toute approche unilatéralement déterministe ou rationaliste. Selon l’auteur,
« (…) on pourrait peut-être considérer les situations d’usage comme une sorte de menu de l’offre qui comprendrait quatre parties : 1) le savoir plus ou moins stabilisé ou dramatisé sur les risques associés à l’usage des drogues ; 2) les offres de récompenses véhiculées par les rencontres et les circonstances de la première fois, de la seconde et des fois suivantes ; 3) l’état d’appétence du corps préparé par les dispositions, les événements personnels et la mémoire des consommations antérieures, et surtout 4) une clef personnelle de choix et de résolution des dilemmes ou des alternatives. » (p. 59)
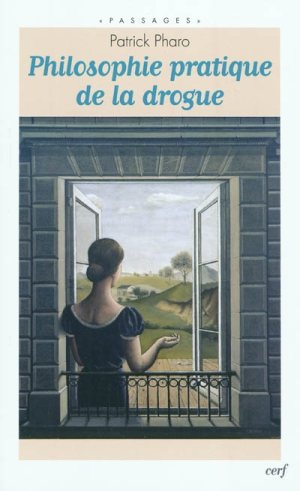
Les facteurs accroissant les risques d’entrer dans un cycle de dépendance peuvent être distingués selon la biologie (une vulnérabilité physiologique ou une hérédité particulière), psychologiques (une situation personnelle difficile, lourde à assumer, un mal être), sociologique (un milieu défavorisé, ou tout simplement lui-même affecté par la drogue). Pour autant, les classifications sont d’emblée à complexifier, car il est difficile de distinguer ce qui relèverait d’une hérédité génétique et ce qui procède de l’influence et des traces physiologiques de pratiques passées des ascendants. Le mimétisme joue également un rôle important, les pratiques visibles dans le cercle familial ou proche, même lorsqu’elles signent des échecs, inscrivant la drogue comme un possible.
Les étapes du processus d’entrée dans la drogue doivent elles-mêmes distinguées de l’état ultérieur de dépendance contre lequel l’individu luttera. Il est insuffisant ici d’évoquer une faiblesse de la volonté (akrasia), ni même d’ailleurs une volonté mal dirigée : ce qui est voulu n’est bien sûr pas la dépendance, qui est plutôt un collatéral esquivé ou assumé comme une fatalité (autre façon peut-être de l’écarter) : « Ce qui se passe en réalité, c’est que l’appétence non seulement oriente vers la recherche du produit, mais détermine aussi la place qui peut être laissée aux jugements, tout en filtrant ceux qui lui conviennent ou non » (p.103). Le discernement, pose l’auteur, inclut le désir et ne peut être identique au jugement. La prise de drogue procède d’abord d’un choix, mais qu’il s’agit de comprendre à la lumière de ce que la drogue rend possible en termes d’expérience et de parcours. A cette aune et dans certains contextes, les bénéfices escomptés de la consommation sont tels qu’ils induisent une mise en suspens du jugement critique, ou encore toutes sortes de stratégies d’esquives, de relativisation, ou simplement d’acceptation. Le rapport à l’ensemble de paramètres, évolutif et variable, impliqués dans la pratique de la drogue dépend d’un certain nombre de circonstances extérieures, de sorte que pour le drogué, « (…) la gestion rationnelle de sa vie est presque toujours considérée comme le meilleur choix, même s’il existe plusieurs conclusions rationnelles pour le même problème : abstinence ou consommation intégrée avec acceptation des risques »
La curiosité, la volonté de s’éprouver face au risque et de braver la mort ou la déchéances possibles jouent elles aussi leur rôle dans ce processus, d’autant que les bénéfices de la drogue s’expriment dans l’instant (la drogue ne demande pas d’abord de long apprentissage ni d’efforts sophistiqués) et ses risques dans un système éloigné de conséquences. Il ne faut, qui plus est, pas négliger le contexte social et la culture qui accompagnent le plus souvent les premières fois : autant que la transgression et l’échappée, la drogue représente une pratique à la fois élitiste et festive, et participe d’un rapport au monde qui rejette les plans sur le long terme. L’information elle-même est traitée de façon différenciée (les différentes sortes de drogues peuvent être jouées les unes contre les autres), et les individus tendent à se convaincre de leur capacité à gérer et de leur rationalité future dans l’usage de la panoplie des possibles, jusqu’à ce que les circonstances, les états de manque, déjouent cette illusion de maîtrise. Ainsi,
« Il faut généralement un certain temps pour que le savoir cesse d’être vain. Et les causes de ce délais sont probablement neurophysiologiques, elles n’annulent pas la réflexivité du sujet qui reste le premier témoin de la théorie qu’il ne peut mettre en pratique, se retrouvant en position de simple spectateur de sa passivité » (p. 58)
Les pratiques des différentes formes de drogues ont leurs motivations et leurs logiques, qui s’entrecroisent mais ne se confondent pas. Le parcours commence généralement par le cannabis, même si le cannabis ne conduit pas nécessairement et pas le plus souvent aux drogues dures. La cocaïne et ses avatars passent plutôt pour des drogues de riches, moins menaçantes en terme de dépendance, et suscitent des états correspondants à un certain idéal social d’hyperactivité, de présence, d’à propos. L’héroïne suscite des états de bien-être, et sa pratique, reconnue comme la plus difficile et dangereuse, synonyme d’une forme de retrait : isolement, paix et silence prennent alors des qualités positives et agréables. Le cas des hallucinogènes (champignons, LSD, MDMA, etc.) est autre encore, car les mécanismes d’action sont ici différents, et ne modifient pas prioritairement les circuits de récompense. Enfin, l’auteur consacre un certain nombre de développements d’abord à d’autres substances addictives comme le tabac, l’alcool, et plus généralement les médicaments, parfois prescrits à fortes doses par les médecins, dont la consommation est souvent considérée par les drogués eux-mêmes comme un équivalent légal et inavoué de leurs propres addictions. Les mécanismes d’addictions sont raffinés à travers le cas de pratiques non liées à la drogue, dont les effets peuvent être considérés comme similaires, telles que certains jeux ou sports extrêmes, et plus généralement toute les pratiques caractérisées par la recherche répétée d’intensités fortes.
Évolutive, l’expérience de la drogue et de sa dépendance devient le plus souvent peu à peu insoutenable. Tout l’enjeu est d’interroger cet itinéraire sur fond d’une compréhension de « (…) l’expérience morale de ce que c’est qu’être soi-même, étant entendu qu’on ne peut pas avoir la même expérience subjective lorsqu’on est abstinent ou qu’on consomme 3g d’héroïne par jour . Au-delà des effets spécifiques des produits, lorsqu’un sujet a le sentiment qu’il s’écarte de ce qu’il est en réalité ou profondément, c’est qu’il se fait une certaine idée de ce qu’il doit être, ou de ce qu’il est mieux pour lui d’être » (p. 180-181).
La décision n’est pas quelque chose d’abstrait et de ponctuel, et ses mises en œuvre varient selon l’accès que l’individu a à lui-même sur un certain nombre de plans sous un certain nombre de contraintes. L’ensemble du « chemin de vie » que constitue la drogue ne peut être surplombé, et il n’y aurait aucun sens à reprocher au dépendant en souffrance le consentement du jeune consommateur qu’il était aux conséquences lointaines et imprécises de l’itinéraire dans lequel il s’engageait :
« Les usagers peuvent avoir assez tôt la conviction qu’ils devront tôt ou tard arrêter, mais sans que celle conviction aille jusqu’à la formation d’une volonté d’arrêter, d’où la surprise de constater qu’on exprime quelque chose qu’on a pas du tout envie de faire » (p. 191).
La consommation, désinhibée, parfois fière, souvent sans gêne dans les années de jeunesse, devient inavouée au fil de l’évolution dans les âges de la vie. Les inconvénients deviennent des handicaps, des causes de souffrance, parfois de mort. La dépendance fait peu à peu de la drogue le centre d’une vie qu’elle devait d’abord alléger et faciliter. Les atteintes au corps se multiplient, avec l’impression toujours plus forte d’impuissance, de déliquescence et d’envahissement, qui finit par susciter un véritable dégoût de soi. Les événements malheureux, rencontres gâchées, déchirures d’amitiés, relations brisées par les accidents, les haines, les deuils parfois ponctuent ce trajet jusqu’à rendre la situation ressentie insoutenable. Ainsi, précise bien l’auteur, si les drogués souhaitent décrocher, il faut bien voir que « ce n’est pas leur désir ou leur volonté qui s’est épuisé, c’est la possibilité de jouir de ses bienfaits » (p. 215). De sorte que « L’arrêt, avant d’être une victoire de la volonté, est un épuisement de la liberté antérieure » (p. 215).
La drogue ne constitue pas seulement le choix d’un possible mais l’entrée dans une façon de vivre et dans un certain monde. De la sorte, sortir de la drogue ne peut relever d’une décision abstraite ; la volonté n’œuvrera qu’au sein d’une nouvelle configuration, attisée par une menace réelle, par un ressenti intolérable, et tout autant, par la présente une véritable alternative. Si critiquée soit-elle, l’invocation d’une transcendance (divine ou plus abstraite), révèle la profondeur avec laquelle la drogue pénètre un monde vécu, lequel ne peut souvent être ébranlé que confronté à une altérité puissante et inspirante. Tout aussi bien cependant, ce sont les rythmes retrouvés de la vie normale, les « plaisirs innocents » du corps fonctionnel, qui reprennent toute leur importance dans le processus de sortie, et acquièrent pour les personnes dépendantes une valeur nouvelle, contrebalançant celle de la drogue.
Une ultime et plus brève partie expose l’inadéquation de la façon dont la société affronte la question de la drogue et dont elle fabrique des drogués « parias » sommés de consentir à leur mise à l’écart au moins symbolique (dans la filiation de Goffman) plutôt que de reconnaître en eux le chemin potentiel de tout un chacun. Un sort particulier est fait au phénomène de sur-incarcération américain, au développement, à la suite de la mise en place de peines planchers frappant unilatéralement consommateurs et vendeurs et de systèmes mécaniques comme la règle des trois coups conduisant à la multiplication de peines lourdes, d’un système pénitentiaire hypertrophié, concentrant plus de 0,8% de la population américaine, dont l’inefficacité est dénoncée par l’ensemble des acteurs, et dont la mise en place procède de l’emballement de tendances collectives attisées par électoralisme 2.
Tout aussi bien, les témoignages montrent des acteurs excessivement conscients de l’ambiguïté d’une société pénalisant la drogue tout en laissant des franges entières de son économie subsister la seule perfusion de l’argent du narcotrafic, stigmatisant les psychotropes alors que les plus grands laboratoires pharmaceutiques sont associés à leur mise au point, admettant dans l’économie des substances addictives reconnues néfastes comme l’alcool et le tabac tout en en qualifiant d’autres de délictuelles. Le sens du rapport de la loi à la drogue doit lui-même être éclairci, car celui-ci agglomère des perspectives très diverses (lutter contre les ravages de la consommation, contre les mafias ou contre la supposée dégradation morale dont attesterait la consommation ne motive certes pas les mêmes actions, et mêmes, le plus souvent, des actions antagoniques, souvent pourtant intriquées dans la législation actuelle).
En fin de compte, dirons-nous pour notre part (sans engager l’auteur de l’ouvrage dans ces considérations), la drogue fait partie de ces zones grises, de ces angles morts qui ne peuvent être tout à fait codés dans un système judiciaire et légal rationnel parfait. Elle est une des expressions de cette réalité humaine dont législation et actions politiques doivent tenir compte, car c’est bien dans la réalité ici-bas que des sociétés se construisent. Dans un monde idéal rationnellement conçu, sans doute, il n’y aurait pas de drogues… Mais, ajouterons-nous, il n’y aurait pas davantage de dépressions, d’insécurité, de violences diverses … cet ensemble de phénomènes multi-fatoriels que nous traitons par le biais de divers codages symboliques, conceptuels, législatifs, mais que la loi ne peut espérer totalement justifier et rationaliser, dont elle doit dès lors admettre l’inéluctabilité et accompagner au mieux les effets. La drogue fait partie de nos sociétés et aucune politique volontariste simple ne l’en éradiquera (d’ailleurs, le faudrait-il vraiment ?)
Dès lors, on comprend la position de l’auteur, lequel prône une liberté appréciative, qui, sans autoriser la drogue, en informant fermement et strictement la population des dangers qu’elle représente, assume et accepte la possibilité de sa consommation et développe un ensemble de dispositifs le plus à-même d’accompagner ceux qui souhaiteront ensuite échapper à une emprise devenue intolérable. Ainsi, « (…) il faudrait plutôt ici revenir à un strict libéralisme pour ce qui est de l’appréciation individuelle des conduites et renforcer au contraire le sens de la responsabilité publique pour accompagner des personnes dont le libre choix initial s’est heurté à la mauvaise fortune de leurs propres dispositions ou des circonstances sociales » (p. 375)
A ceux qui objecteront qu’il n’est pas du ressort de la société d’assumer collectivement le coût des errances de certains, on objectera d’une part qu’il en va finalement de la drogue comme de nombreuses autres pratiques, que la vie, quels que soient les choix que nous faisons, est exposée au risque, à l’accident, à la perte, et d’autre part que l’ensemble de l’ouvrage entend précisément rompre avec une conception trop abstraite de la responsabilité individuelle, laquelle est en réalité toujours contextuelle, et que le rôle de la société est précisément aussi d’assumer tout à la fois la finitude et l’humanité de chaque individu et d’atténuer les effets de son exposition à « la mauvaise fortune de ses propres dispositions ou des circonstances sociales ». En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’il y a de la finitude et de l’inexorable que la société doit y consentir et contribuer à les aggraver encore sous le prétexte d’une conception abstraite de la responsabilité individuelle. Au contraire, sans doute, a-t-elle aussi pour fonction d’atténuer autant que possible l’irréversibilité des processus assignant chacun à un destin écrit une fois pour toute, faciliter les conversion et les reconversion, accompagner les rebonds, bref, donner le plus de jeu possible à la négociation que chacun mène avec le monde et soi-même, de façon à ce que la responsabilité ne ferme pas l’avenir ni l’interdise la réinvention.
Une dernière remarque pour conclure : on notera que les trajectoires suivies et jalonnées se déroulent exclusivement dans un monde occidental, analysées à partir de catégories, voire d’une ontologie occidentale. L’expérience de la drogue est une expérience collectivement induite mais personnelle, motivée par un désir d’ailleurs ou d’évasion. Le terme même d’expérience dénote de l’a priori objectiviste de l’enquête qui se veut sociologique plutôt qu’anthropologique. Le rapport aux expériences sensorielles, imaginaires, etc., induites par la drogue ainsi qu’au sens et aux catégories à partir desquelles ces expériences peuvent être transmises est volontairement mis entre parenthèse. Les trajets de vie suivis sont des trajets d’occidentaux dans le monde occidental ; il est probable que pour des individus se référant à d’autres cultures, d’autres systèmes catégoriaux, d’autres ontologies, la complexité du rapport aux vécus individuels et chaque fois distincts appellent une attention plus soutenu à l’interprétation même des expériences vécues à travers la drogue, et non seulement de l’expérience de la dépendance à la drogue.
- Patrick Pharo, Philosophie pratique de la drogue, Paris, Cerf, 2011
- Sur les mécanismes collectifs conduisant à la volonté d’aggraver les peines, et sur les déterminants qu’il faut supposer pour les expliquer, cf. par exemple A. Ouss et A. Peysakhovitch papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247446.








