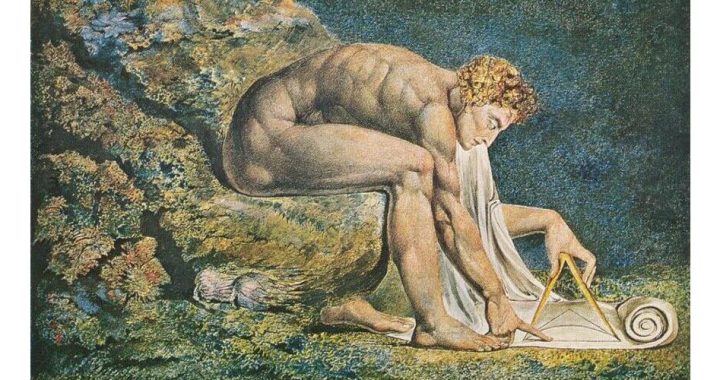Recension par Th. Gress de : O. Tinland, L’Idéalisme hégélien (2013)
Le dernier livre d’Olivier Tinland intitulé Le grand principe de l’expérience[1] vient combler un vide certain dans les études hégéliennes en ceci qu’il cherche à établir le rapport qu’entretient Hegel aux philosophies anglaises de l’expérience, le tout dans une série de chapitres brefs et ramassés. Il s’agit moins de cerner ce que Hegel entend lui-même par expérience – encore que la première partie évoque en partie de tels enjeux – que de déterminer l’approche parfois sous-estimée ou, à tout le moins, peu exploitée de l’empirisme anglais pris au sens large – c’est-à-dire incluant le scepticisme écossais de Hume et l’idéalisme de Berkeley – tel qu’il se voit exposé et décortiqué dans les Leçons sur l’histoire de la philosophie.
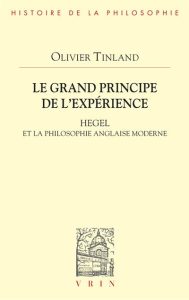 Ce court ouvrage vient ainsi utilement compléter l’article célèbre[2] qu’Olivier Tinland avait consacré au sens hégélien de l’expérience dans la Phénoménologie de l’esprit au sein d’un collectif consacré au même thème. En revanche, bien que l’auteur mentionne dans l’introduction le caractère injuste et partial de la lecture hégélienne des auteurs anglais, allant jusqu’à évoquer « ses partis pris souvent discutables et (…) ses injustices herméneutiques flagrantes[3] », l’analyse de la partialité évoquée ou de l’injustice supposée n’est pas menée : simplement annoncée, elle ne reçoit pas de développement, et demeure un effet d’annonce, l’ouvrage se bornant à constater que Hegel ne retient de la philosophie anglaise que ce qui concerne la théorie de la connaissance et la métaphysique : « l’empirisme moral, politique, esthétique et religieux ne semble pas relever, à ses yeux, de l’histoire de la philosophie[4]. » Curieusement, cette exclusion est constatée et mentionnée, mais non investiguée, ce qui laisse un goût d’inachevé une fois l’ouvrage refermé.
Ce court ouvrage vient ainsi utilement compléter l’article célèbre[2] qu’Olivier Tinland avait consacré au sens hégélien de l’expérience dans la Phénoménologie de l’esprit au sein d’un collectif consacré au même thème. En revanche, bien que l’auteur mentionne dans l’introduction le caractère injuste et partial de la lecture hégélienne des auteurs anglais, allant jusqu’à évoquer « ses partis pris souvent discutables et (…) ses injustices herméneutiques flagrantes[3] », l’analyse de la partialité évoquée ou de l’injustice supposée n’est pas menée : simplement annoncée, elle ne reçoit pas de développement, et demeure un effet d’annonce, l’ouvrage se bornant à constater que Hegel ne retient de la philosophie anglaise que ce qui concerne la théorie de la connaissance et la métaphysique : « l’empirisme moral, politique, esthétique et religieux ne semble pas relever, à ses yeux, de l’histoire de la philosophie[4]. » Curieusement, cette exclusion est constatée et mentionnée, mais non investiguée, ce qui laisse un goût d’inachevé une fois l’ouvrage refermé.
A : Intentions de l’ouvrage
Le livre d’O. Tinland s’enracine dans un constat que chacun peut aisément effectuer : les philosophies de l’expérience sont le « parent pauvre des études hégéliennes[5] », comme si l’idéalisme prêté à Hegel conjugué à son refus de l’immédiateté disqualifiait d’emblée toute étude de la donation originaire et immédiate depuis l’expérience. Or, explique l’auteur, « nous voudrions montrer que tout à la fois que l’interprétation hégélienne de la philosophie anglaise moderne est plus dure, plus discriminante et plus exclusive qu’il n’y paraît, et qu’elle présente néanmoins des enjeux plus importants que ceux que l’on y repère habituellement[6]. » Le premier d’entre eux concerne bien sûr la possibilité de dissocier l’expérience comme telle de l’empirisme comme philosophie : si, à n’en pas douter, la pensée hégélienne accorde à l’expérience une place de choix, il n’en va pas de même pour l’empirisme qui, même dans la période de maturité, se trouve durement attaqué et se voit présenté comme une philosophie inconséquente et aveugle à elle-même. A cela s’ajoute une évolution du rapport de Hegel à l’expérience autant qu’à l’empirisme : les œuvres de jeunesse font bien peu de cas de l’expérience et des sciences empiriques ; mais celles-ci connaissent une progressive réévaluation par laquelle sont découvertes leur dignité et leur nécessité. Rendre compte du sens d’une telle réhabilitation de l’expérience constitue le second élément autour duquel s’articule l’ouvrage, dont le résultat consistera à montrer que l’élaboration de la philosophie spéculative ne pourra s’accomplir que par la requalification positive du principe central de l’empirisme. « C’est donc d’un même geste que Hegel réévalue progressivement le rôle de l’expérience (et des sciences empiriques) dans l’élaboration de la connaissance spéculative, qu’il reconnaît la valeur principielle de l’empirisme dans la mise en évidence d’un tel rôle et qu’il dénie au discours des modernes « philosophes de l’expérience » quasiment toute valeur proprement philosophique[7]. »
C’est ainsi que, dans un premier chapitre beaucoup plus long que les suivants, l’auteur en vient à montrer comment, depuis l’article sur le Droit naturel jusqu’aux deux dernières versions de l’Encyclopédie, le rapport de Hegel à l’expérience ne cesse d’évoluer et de traduire l’affinement de la pensée spéculative. Cette entrée en matière se tient à cheval entre la conception proprement hégélienne de l’expérience, en particulier telle qu’elle est développée dans la Phénoménologie de l’esprit, et la considération critique de l’empirisme, qu’il soit référé ou non à des philosophies précises. Le premier chapitre se trouve ainsi écartelé entre trois directions : la critique initiale de l’empirisme, la détermination du sens hégélien de l’expérience et l’évolution des différentes éditions de l’Encyclopédie à l’endroit de l’empirisme moderne. Une difficulté évidente est celle de déterminer s’il s’agit de la même question au motif que se trouve engagé le même terme ; si l’intention diachronique est évidente, elle se trouve toutefois confrontée à la difficulté de textes aux préoccupations différenciées.
Mais, en dépit de ce qui pourrait apparaître comme un certain manque d’unité, ressort une ligne directrice assez ferme, à savoir l’incapacité de l’empirisme de se penser lui-même, de réfléchir ses propres principes et, par voie de conséquence, la nécessité d’accorder un sens spéculatif à l’expérience pour arracher celle-ci à toute forme d’empirisme irréfléchi. Une telle ligne se retrouve, sous une forme ou une autre, à chaque moment de la réflexion hégélienne, depuis le Droit naturel jusqu’à l’ultime version de l’Encyclopédie.
B : Limites et incohérences de la conception empiriste de l’expérience
Afin de mieux cerner les enjeux du propos, il n’est pas sans intérêt de se reporter aux analyses qu’O. Tinland avait antérieurement développées dans L’idéalisme hégélien[8] où de nombreux passages étaient consacrés à la critique hégélienne de l’empirisme. L’élément central tenait à la mise en évidence du caractère métaphysique d’une pensée prétendument anti-métaphysique, reposant sur une décision initiale que l’empirisme ne pouvait justifier, à savoir la détermination de la réalité comme constituée d’impressions élémentaires et atomiques, se donnant dans la perception. Comme l’écrivait fort bien l’auteur,
« ce que nous révèle la critique hégélienne de l’empirisme, c’est que celui-ci, en dépit de sa valorisation antimétaphysique du donné sensible, est lui-même indissociable d’une décision métaphysique relative à ce qui constitue en dernière instance l’essence du réel (les sense-data ou impressions élémentaires), ou encore qu’il suppose comme sa condition de possibilité un engagement ontologique en faveur d’une certaine conception de la réalité, conception dont l’élaboration suppose forcément de se placer en quelque façon au-delà (ou en deçà) de l’expérience sensible (…).[9] »
L’empirisme apparaît alors sous la plume de Hegel comme une métaphysique de l’expérience mais cette métaphysique se présente comme une métaphysique antimétaphysique car le simple fait d’énoncer la fidélité à l’expérience suppose un champ conceptuel qui dénie la seule expérience. « Il faut donc inverser le diagnostic empiriste, analyse l’auteur : non pas appauvrir la portée théorique du discours philosophique en raison d’une conception limitative de l’expérience, mais tout au contraire élargir le concept d’expérience pour qu’il soit à la mesure de la richesse spéculative du discours qui en dévoile les potentialités[10]. » L’expérience ne peut, en d’autres termes, accéder au rang et à la dignité d’objet philosophique qu’en comprenant en son sein la possibilité du discours par lequel elle accède à l’intelligibilité conceptuelle, ce que n’a pas mené à bien la philosophie empiriste proprement dite, incapable de rendre compte d’elle-même en raison de la cécité sur ses propres principes.
Cet aspect, déjà parfaitement identifié dans l’ouvrage de 2013, se trouve réinvesti dans la troisième partie du grand principe de l’expérience qui, peut-être plus historique, montre comment l’empirisme anglais, parcouru d’une métaphysique non réfléchie, doit être compris comme une étape de la constitution de la métaphysique moderne. Cela explique sans doute en partie pourquoi Hegel ne retient de la philosophie anglaise que sa dimension métaphysique et épistémique, reléguant la sphère pratique et esthétique aux marges du discours philosophique. De surcroît, O. Tinland montre très bien que, sur le plan historique, Hegel interprète la dimension métaphysique de l’empirisme comme une lutte contre la métaphysique médiévale croyant trouver dans la réflexion de quoi établir l’objet en soi.
Mais ce présupposé atomiste de l’empirisme ne relève pas uniquement de la cécité métaphysique ; il se révèle de surcroît intenable au regard des conditions mêmes de l’expérience puisque de tels atomes ne sont obtenus qu’au terme de l’analyse, c’est-à-dire d’une décomposition, et se trouvent donc indument érigés en principe originaire de l’expérience. En somme, l’empirisme sombre dans l’incohérence en ceci qu’il érige un résultat en principe inconditionné puisqu’il hypostasie en élément originaire ce qui demeure conditionné à l’activité de la pensée. Par conséquent, ainsi qu’O. Tinland l’avait déjà fort bien établi dans l’article de 2010 consacré au sens de l’expérience déployé dans la Phénoménologie de l’esprit, il apparaît que Hegel refuse une telle absolutisation du résultat de la décomposition analytique et objecte à pareille démarche qu’une telle absolutisation du moment analytique de l’expérience (sa décomposition méthodique en éléments premiers indifférents les uns aux autres) produit le contraire de ce qui était visé : l’empirisme atomiste reconstruit le réel depuis les particules élémentaires, mais ne reconstruit qu’un « concret abstrait », désarticulé, sans lien, faute de prendre en compte une authentique relation conceptuelle parvenant à une véritable synthèse empirique concrète. Il y a donc chez l’empiriste un parti-pris unilatéral en faveur de l’analyse et un déficit de synthèse, c’est-à-dire d’unité, qui se surajoute à la fascination en faveur de l’illusion de l’immédiateté sensible atomique.
Tout le chapitre XI de l’ouvrage de 2023 reprend ces analyses de manière condensée et établit avec fermeté l’intention hégélienne : contre l’atomisme inhérent à l’empirisme émerge la nécessité d’une approche holistique venant contrer la collection contingente de contenus particuliers que les empiristes appellent « expérience ». Le fameux § 38 de l’édition de 1830 de l’Encyclopédie est fort logiquement mobilisé pour rendre compte de la contradiction inhérente à l’empirisme, ce dernier se voyant « contraint de renoncer dès le départ à ce vers quoi il tend pourtant, à savoir une saisie de l’universalité et de la nécessité immanentes à la réalité sensible[11]. » Il s’agit bien sûr de parvenir à un concept enrichi et holistique de l’expérience, rejetant l’atomisme des sense data et soulignant l’incapacité de la perception sensible à rendre compte de l’unité de l’expérience.
Il n’est pas sans intérêt de souligner la résonance de ces analyses avec le premier moment de l’article d’O. Tinland consacré au sens de l’expérience de la Phénoménologie de l’esprit qui, de manière significative, s’ouvrait par l’analyse du « holisme empirique » hégélien. Il s’agissait ainsi de montrer que, sans légitimer la formation de savoirs extra-empiriques, Hegel n’adoptait pas pour autant les présupposés empiristes, grevés d’une incapacité à rendre compte de l’unité depuis la collection atomiste des contenus particuliers. « Dans l’expérience, tout est lié : l’expérience que la conscience fait d’un objet est nécessairement plus que le simple accueil d’un donné, c’est une mise à l’épreuve de sa prétention au savoir[12]. »
Tout cela conduit à considérer au fond que l’empirisme « anglais » souffre du même défaut que la philosophie schellingienne, celui d’un « empirio-formalisme », qu’O. Tinland aime à étendre, à la suite de B. Bourgeois, au-delà de la critique de la philosophie de la nature contre l’empirisme, ainsi mis à nu dans son incapacité à rendre compte de sa prétention à la vérité.
C : Présentation et analyse des figures de l’empirisme anglais
La deuxième partie de l’ouvrage de 2023 mérite quelques précisions. Présentant plusieurs figures majeures de la philosophie anglaise de l’expérience, depuis Bacon jusqu’à Newton et Hume, elle établit pour chacune d’entre elles les limites et les naïvetés de leur métaphysique et de leur théorie de la connaissance. Les Leçons sur l’histoire de la philosophie sont ainsi mises à profit et clairement restituées selon une présentation organique, les apories de Locke expliquant par exemple celles de Berkeley, dont l’auteur montre très bien qu’il ne propose qu’un simulacre d’idéalisme en raison de la croyance maintenue à l’endroit du « matériau unique brut[13] »
Mais cette seconde partie est, à n’en pas douter, la plus frustrante pour plusieurs raisons. Si en effet Bacon et Locke reçoivent une analyse plutôt développée, Newton, Berkeley et Hume sont rapidement traités, et bien que la question du rapport de Hegel à Newton ait été amplement abordée dans d’autres ouvrages, elle aurait pu ici recevoir un éclairage plus substantiel en tant que se joue chez l’auteur des Principia à la fois une dimension philosophique et en même temps une contribution effective aux sciences empiriques, qui le rendent incommensurable avec un Locke ou un Hume. Du reste, bien que soient çà et là évoquées les sciences empiriques, elles ne le sont curieusement pas pour Berkeley et ses travaux d’optique, ni pour son approche du calcul infinitésimal appliqué en physique ; bien sûr, il serait possible de répondre que Hegel y est indifférent, mais c’est justement cette indifférence de Hegel qui intrigue.
Plus généralement, cette deuxième partie ne développe peut-être pas jusqu’au bout ce que nous avions relevé en introduction, à savoir l’approfondissement des raisons pour lesquelles Hegel ne fait pas droit à ce qui, chez les auteurs anglais, ne relève pas de la métaphysique et de la théorie de la connaissance. Dans une note significative, O. Tinland constate pourtant que dans les Leçons d’esthétique, « aucun des grands penseurs anglais du goût, du beau ou du sublime (Hume, Shaftesbury, Burke, …) n’est mentionné. Le seul auteur anglais de référence est… Shakespeare[14]. » De même, il fait remarquer que Hegel n’accorde pas de crédit aux œuvres historiques et politiques de Hume, alors que l’on sait grâce à Waszek (que cite l’A.) que Hegel les connaissait. Il en va de même pour les œuvres politiques et morales de Locke cantonnées dans le seul domaine de la culture et arrachées à celui de la philosophie.
O. Tinland explique-t-il alors pareille exclusion ? Oui et non. A la fin du chapitre III, il constate que « l’ensemble de la pensée morale et politique de la tradition anglaise se trouve congédiée par Hegel de la scène philosophique, au motif des prémisses empiriques qui la sous-tendent[15]. » Et l’auteur d’ajouter :
« La critique de cette tradition sur le plan de la métaphysique et de la théorie de la connaissance doit suffire à invalider l’empirisme en tant que philosophie cohérente, et la démonstration des faussetés des conséquences pratiques à partir de la mise en évidence de la fausseté des prémisses théoriques ne constitue qu’un enjeu accessoire qui ne retient guère l’attention de l’auteur des Leçons sur l’histoire de la philosophie[16]. »
À l’encontre de cette démarche, O. Tinland développe une critique adressée à Hegel, par laquelle il lui reproche d’aborder la pensée anglaise de manière unilatérale selon un « biais théoriciste[17] » inapte à prendre en charge le caractère indissolublement théorique et pratique de tels écrits. Le « découpage » qu’opérerait Hegel mutilerait les œuvres et contreviendrait à sa propre recommandation de toujours envisager le sens global, Hegel se révélant infidèle à ses propres exigences.
Mais on pourrait considérer que cette critique est étonnante en ceci qu’à aucun moment elle ne semble envisager que la lecture hégélienne de l’empirisme anglais soit fondée : l’analyse hégélienne est énoncée mais elle ne semble pas prise au sérieux et le lecteur est comme sommé d’y voir un biais, comme s’il allait de soi que l’entièreté des écrits des philosophes anglais devait relever de la philosophie. Pourtant, dans la logique même de Hegel, il est pertinent d’exclure de la philosophie des discours dont, non seulement le contenu se borne à décrire un instinct sensible immédiat, mais dont la forme se révèle de surcroît insuffisamment réfléchie. Il est vrai que nous sommes habitués à prendre au sérieux par exemple l’esthétique de Hume, mais pourquoi serait-il égarant d’en interroger la teneur authentiquement philosophique ?
 Que fait en effet Hume dans De la norme du goût ? Soit il énonce des évidences non philosophiques – les goûts divergent, certaines sensations sont associées à l’épreuve du plaisir – soit il soutient des affirmations dont sa philosophie ne fournit pas les moyens théoriques – il existe une nature humaine universelle et cette nature contient des principes généraux d’approbation ou de blâme. Compte tendu du fait qu’un tel traité oscille entre truismes et incohérences globales (d’où viennent, théoriquement parlant, l’universalité et la causalité requises pour rendre compte du sentiment du beau ?), en quel sens faudrait-il lui accorder le statut d’essai philosophique ? Et au nom de quoi serions-nous sommés d’admettre par principe qu’il s’agit d’une réflexion philosophique ?
Que fait en effet Hume dans De la norme du goût ? Soit il énonce des évidences non philosophiques – les goûts divergent, certaines sensations sont associées à l’épreuve du plaisir – soit il soutient des affirmations dont sa philosophie ne fournit pas les moyens théoriques – il existe une nature humaine universelle et cette nature contient des principes généraux d’approbation ou de blâme. Compte tendu du fait qu’un tel traité oscille entre truismes et incohérences globales (d’où viennent, théoriquement parlant, l’universalité et la causalité requises pour rendre compte du sentiment du beau ?), en quel sens faudrait-il lui accorder le statut d’essai philosophique ? Et au nom de quoi serions-nous sommés d’admettre par principe qu’il s’agit d’une réflexion philosophique ?
Il nous semble nécessaire d’inverser le reproche ; il n’est en effet pas certain que Hegel se montre ici infidèle à ses propres exigences et l’on pourrait considérer que c’est inversement la croyance selon laquelle la dimension pratique pourrait être indemne des errances théoriques, qui relèverait d’une approche parcellaire et juxtaposée. Pour reprendre le cas de l’esthétique humienne, il nous semble que c’est justement en faisant abstraction de toute la partie théorique de l’œuvre de Hume, donc de sa critique de la causalité et de l’universalité, qu’il est possible de lui conserver un crédit. Et c’est justement parce que Hegel n’en fait pas abstraction qu’il ne peut lui accorder celui-ci.
Conclusion
À bien des égards, ce petit livre s’avère utile et offre une présentation remarquablement claire du rapport du Hegel des Leçons sur l’histoire de la philosophie à l’empirisme anglais mais aussi de l’évolution du sens de l’expérience dans l’œuvre propre de ce dernier. Bien des analyses en la matière ont déjà été formulées dans des textes antérieurs d’O. Tinland, mais elles ont le mérite d’être ici thématiquement unifiées autour d’une notion essentielle, sur laquelle Bernard Bourgeois n’avait d’ailleurs cessé d’attirer l’attention. On sait que ce dernier refusait en effet que l’hégélianisme fût un panlogisme, puisque « la logique elle-même ne se constitue en tout son sens qu’en assumant le conditionnement de toute pensée effective par l’expérience la plus concrète du réel[18]. »
On peut toutefois regretter qu’O. Tinland n’ait pas davantage développé certains passages, en particulier l’exclusion par Hegel de la partie pratique et esthétique de l’empirisme hors de la philosophie. L’explication par le « biais théoriciste » est en grande partie discutable, et cela se fait particulièrement sentir lorsqu’il est question de l’œuvre politique de Hobbes. Si Hegel loue chez l’auteur du Léviathan l’approche du politique comme négation de la naturalité immédiate, il déplore en revanche la fondation atomiste du contrat – depuis l’individualité – tout comme l’unité despotique et artificielle du cadre politique qui en résulte. En ne réfléchissant pas les conditions de la socialisation effective, Hobbes ne s’écarte-t-il pas de la philosophie en ne produisant au fond qu’une théorie politique aveugle à l’effectivité, posant d’abord un homme qui n’existe pas – l’individu pur – puis un cadre politique despotiquement unifié, faisant fi du processus effectif par lequel l’individu s’accorde au citoyen ? Autrement dit, en quel sens un discours aveugle à la patiente politisation de l’homme, donc aux conditions sociales effectives et à l’intériorisation de normes universelles, peut-il être autre chose que le simple exposé d’une croyance dogmatique défendant un souverain despotique et non le déploiement conceptuel d’une analyse philosophique ? Prendre au sérieux la possibilité qu’une croyance dogmatique de ce genre ne soit pas philosophique ne nous semble pas à exclure.
***
[1] Olivier Tinland, Le grand principe de l’expérience. Hegel et la philosophie anglaise moderne, Paris, Vrin, 2023.
[2] Cf. Olivier Tinland, « Science de l’expérience et expérience de la science dans la Phénoménologie de l’esprit », in Laurent Perreau (dir.), L’expérience, Paris, Vrin, 2010.
[3] Le grand principe de l’expérience, op. cit., p. 14.
[4] Ibid., p. 52.
[5] Ibid., p. 12.
[6] Ibid., p. 13.
[7] Ibid., p. 17.
[8] Olivier Tinland, L’idéalisme hégélien, Paris, CNRS, 2013.
[9] Ibid., p. 37.
[10] Ibid., p. 39.
[11] Le grand principe de l’expérience, op. cit., p. 136.
[12] « Science de l’expérience et expérience de la science… », art. cit.., p. 93.
[13] Le grand principe de l’expérience, op. cit., p. 107.
[14] Ibid., note 7, p. 52.
[15] Ibid., p. 56.
[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Bernard Bourgeois, Hegel. Les actes de l’esprit, Paris, Vrin, 2001, p. 282.