Cet article constitue la suite de celui-ci.
VI) « Le visage et le langage : variations iconoclastes sur le Mitsein »
Dans la contribution de Françoise Collin qui signait ici son dernier texte, la progression du texte n’est pas très structurée, et comme son sous-titre l’indique, il s’agit plus de variations, de remarques mêlées que de la démonstration d’une thèse précisément défendue. Après le rappelle de points communs entre les deux penseurs, Françoise Collin remarque que « tous deux partent de la réalité de l’ « être avec » – du Mitsein qui n’est pas seulement un fait – une structure – mais un acte permanent – et leur philosophie est une philosophie pratique plus qu’une métaphysique ou une ontologie. C’est à l’élucidation et à la repensée de ce Mitsein, décliné respectivement en termes d’altérité ou en termes de pluralité, et confronté à ses formes déviantes qu’ils s’attachent l’un et l’autre. » (p. 94)
Précisant alors le rapport de Levinas et Arendt à Heidegger, elle établit que ce que ceux-ci vont retenir de lui, c’est d’abord que le monde du Dasein est le monde commun. C’est ce qu’on peut constater en lisant Levinas qui écrit qu’ « être au monde est, dans Être et temps1, être avec les autres ». Mais le Mitsein ou le Miteinendersein n’est pour Heidegger, d’après Levinas, qu’une « collectivité de camarades ». Et contre cette collectivité ou cette conception de la relation avec autrui, Levinas défend le visage et l’asymétrie tandis qu’Arendt identifie cette collectivité ou cette conception au social auquel elle oppose le politique. Les deux penseurs insistent contre Heidegger sur la singularité irréductible. Pour eux, comme le dit l’auteur, « l’autre non seulement transcende la représentation, mais il commande par sa présence » (p98). Poursuivant son analyse de la relecture critique de Heidegger par Levinas et Arendt, F. Collin rappelle la critique de la décence du social opposée à la nudité du visage dans de l’Existence à l’existant, qui à nouveau vise Heidegger et sa conception du Mitsein. A partir de là, l’auteur rappelle qu’Arendt médite et analyse la formule de Heidegger : « la lumière du public obscurcit tout » 2 . Le sens qu’elle lui attribue, comme le note F. Collin n’est pas celui d’une critique du social, ce qu’elle fera elle-même, mais celui d’une distinction entre le « on » anonyme, équivalent du social ou de la masse et le « nous », par principe pluriel, fait de « qui » capables de se manifester par la parole et l’action. Après cette réflexion claire et simple sur la commune critique du Mitsein heideggérien, l’auteur indique les différences qui séparent cependant irréductiblement les deux philosophes, en particulier l’opposition entre le monde commun arendtien et le face-à-face chez Levinas.
Puis, F. Collin tente de montrer quel rapport au judaïsme et à l’Etat d’Israël nourrit la pensée de ces deux auteurs. Elle montre en particulier le rôle différent que ces deux auteurs attribuent au peuple Juif. Levinas conçoit, ou veut concevoir, un « Etat éthique » qui serait l’Etat d’Israël, alors qu’Arendt, si elle reconnaît bien le peuple juif comme une nation, pense que la Terre sainte doit être une référence spirituelle et non un Etat – ce qu’elle manifeste clairement par exemple, en s’opposant à la fondation de l’Etat d’Israël. Cette réflexion sur le rôle de l’Etat d’Israël dans la pensée de ces auteurs semble bien légitime vu le du titre du recueil.
VII) « Hannah Arendt : Amor mundi penser et agir après le totalitarisme »
Dans la relativement brève contribution suivante, Wolfgang Heuer commence par rappeler que selon Arendt, ce qui caractérise les temps modernes c’est un mouvement d’éloignement du monde sous la forme de ce qu’Arendt appelle une « évasion du monde vers l’univers et d’une évasion du monde vers la conscience de soi. » 3. Si les découvertes scientifiques et techniques permettent à l’homme de maîtriser l’espace, Arendt remarque que, du même mouvement, on perd le monde, comme cosmos, ou comme créé pour l’homme. L’homme est ainsi comme déboussolé dans un espace qu’il doit plus construire que sentir et auquel il ne sait plus comment se fier. Ce nouveau rapport au monde s’élabore majoritairement et principiellement d’après Arendt en termes de processus, de formalisme. L’auteur rapproche cette importance fondamentale du processus dans la science des temps modernes de la logique de l’idéologie totalitaire et écrit ainsi : « Arendt écrit (…) que la caractéristique et en même temps le côté le plus stupéfiant des idéologies totalitaires consiste, en son fond, moins dans les contenus de la propagande que dans le mouvement autonome d’une logique abstraite. Il s’git donc d’une purge du contenu en faveur d’un automatisme du processus (qui dit A doit aussi dire B, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, etc.). Cette pensée du processus universel et englobant a des précurseurs dans les sciences historiques et naturelles. » (p. 117). Dès lors, on comprend que ce qui est critiquable dans notre tradition politique et philosophique, ce n’est pas seulement le totalitarisme, mais ce qui le rend possible au sein de notre tradition, ce dont il ne fait que dériver ; et parmi ces éléments nocifs, on trouve pointée du doigt la pensée en termes de processus qui préexistait au totalitarisme et qui lui survit aujourd’hui encore. En quoi une telle pensée en termes de processus est-elle nuisible ? La réduction de la pensée à la processualité formelle prohibe toute forme de contingence et de spontanéité, interdisant évidemment de ce fait la liberté, la pluralité et la politique véritable. Ce que critique également Arendt dans la pensée du processus, c’est la transformation de la conception du domaine politique qu’on pense désormais au moyen de l’activité de fabrication, quand par exemple on entend créer un homme neuf. Et en effet, le monde, pour Arendt, est pensé comme lieu destiné aux rapports entre les hommes, toujours pluriels et non comme le réceptacle des objets.
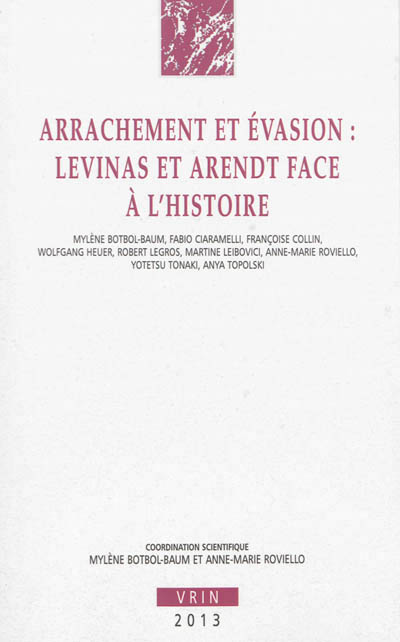
Une telle conception du monde exige le rejet du subjectivisme, rejet qui se traduit par un certain nombre de conséquences qu’énumère et étudie l’auteur. D’abord, cela signifie que « nous n’expérimentons plus qui nous sommes par l’introspection pure mais par la rencontre avec les autres, par la « révélation de la personne en parlant et en agissant » » (p. 118). Autrement dit, il s’agit de faire droit à l’expérience de l’intersubjectivité et de la politique pour être pleinement qui on est. Cela oblige ensuite à redéfinir la liberté qui ne peut plus « exister comme simple liberté passive d’être libre de quelque chose » (Ibid.), mais il faut constituer un monde politique dans lequel sont garanties les libertés individuelles. Troisièmement, il faut élever la faculté de juger et le jugement indépendant au rang de condition de possibilité humaine universelle. Pour éviter d’agir comme Eichmann, il faut parvenir à prendre de la distance sur sa propre perspective, à se mettre à la place des autres. Quatrièmement, il faut redéfinir la notion de pouvoir, le pouvoir ne peut plus être pensé comme l’attribut d’une seule personne, mais ne naît que du consensus, de l’accord entre personnes agissant et parlant ensemble. Enfin, on comprend que le totalitarisme est né du désir de certains de trouver un point d’appui solide correspondant à leur expérience solitaire et non partagée.
Cette réélaboration du politique et de ses conditions de possibilité constitue une sorte d’anthropologie, fondée sur le primat de la pluralité humaine en lien nécessaire avec l’intersubjectivité et qui permet l’imprévisibilité de l’action, l’inouï, l’inédit. Et si l’on cherche à voir comment peut se concrétiser l’action politique pour Arendt, c’est dans le modèle des conseils qu’il faut en chercher la manifestation la plus éminente, dans la mesure où dans les conseils sont distinguées liberté politique et administration du pouvoir, administration du pouvoir auquel on réduit trop souvent l’exercice de la politique.
VIII) « l’idée du proprement humain selon Arendt et Levinas »
Nous nous attarderons sur l’excellente réflexion menée par Robert Legros, qui distingue trois niveaux de propriété pour penser l’humain. Le premier niveau caractérise seulement les hommes. Selon la définition classique, « le propre désigne, concernant un ensemble d’individus, ce qui vaut pour tous, seulement pour eux, toujours sauf accident. » A cela l’auteur ajoute « que le propre de l’homme peut relever d’un propre de l’homme en tant qu’animal ou en tant qu’homme. » (p. 124). Minutieusement, R. Legros montre que « l’appartenance de l’homme à un monde commun et sensé (à un monde qui tend à se confondre soit avec une religion soit avec une culture, mais qui est aussi le monde de l’humanité tout entière), est un propre de l’homme en tant qu’homme. Elle est un propre puisqu’elle caractérise tous les hommes, seulement eux, toujours sauf accident. Elle est un propre de l’homme en tant qu’homme car elle est constitutive de l’humanité de l’homme : une perte du monde commun (une démondanéisation), qui peut se produire par accident, entraîne en effet, inévitablement, une déshumanisation. » (pp. 125-126). Les pratiques exercées universellement sont un propre de l’homme en tant qu’homme.
Après avoir étudié ce niveau de propriété de l’homme, l’auteur pense le propre de l’homme dans un autre sens : le propre qui s’accomplit dès qu’il y a hominisation, un propre normatif. De là, le paradoxe d’un homme qui peut se conduire de manière impropre en ayant une vie proprement humaine, paradoxe illustré par l’auteur à l’aide de la pensée kantienne établissant qu’on peut penser un animal rationnel, un humain, qui serait parfaitement rationnel sans être proprement humain ; comme l’être humain qui agirait de façon intéressée, il serait humain car se déterminant rationnellement, mais pas proprement humain, puisqu’il agirait comme une animal au sens où il ne serait préoccupé que de son bien être. Or, le propre qui advient par un pouvoir d’accéder à une authenticité peut être soit un propre considéré comme authentiquement humain au sein d’une humanité particulière, soit un propre qui advient par le pouvoir de prendre une distance par rapport à toute humanité particulière. Aussi, « chaque humanité particulière est régie par des normes qui déterminent ce que chacun doit viser à être pour être à la hauteur de ce qu’il doit être. [C’]est déterminé par ce que Kant appelle une idée (…). Une idée est propre à une compréhension particulière du monde constitutive d’un type d’humanité, donc propre à une humanité particulière. Au sein d’une compréhension du monde en laquelle une idée d’humanité a pris sens, celle-ci exprime ce que l’être humain a à être ou à faire pour être à la hauteur de ce qu’il est en propre. » (p. 128). L’énumération des différentes idées d’humanité, dans le bouddhisme, au Moyen-âge ou à l’époque moderne n’apporte rien à l’argumentation, mais met en évidence la diversité de ces idéaux d’humanité au sein de cultures différentes. Il apparaît ainsi que chaque conception singulière de l’humanité dépend d’une façon particulière de se rapporter au monde ainsi que d’une façon de concevoir l’homme, auquel on attribue une capacité de pouvoir accomplir quelque chose qui le rende proprement humain. Cet idéal de l’homme dans chaque culture a à voir avec la façon dont les hommes de cette culture ressentent leur humanité par la pratique de ce pouvoir proprement humain.
Comment alors essayer de définir un propre qui ne soit pas seulement un propre considéré comme authentiquement humain au sein d’une humanité particulière, mais un propre qui advient par le pouvoir de prendre une distance par rapport à toute humanité particulière ? L’auteur répond en définissant le propre à un dernier niveau, comme prise de distance avec toute humanité particulière. Le monde quotidien tend à s’imposer comme s’il était naturel, puisqu’il enferme les hommes qui s’y rapportent dans une compréhension qui n’a que cette idée de l’humanité comme référence. L’auteur montre alors que l’homme apparaît comme toujours déjà d’abord enfermé dans une idée particulière de l’humanité qui lui propose un idéal particulier, un propre particulier de l’homme et qu’il est authentiquement humain quand il suspend l’attitude naturelle. Cette prise de distance, qui rompt avec l’attitude naturelle, comme avec la quotidienneté, ouvre à une expérience de la transcendance radicale et de l’inconditionnement par laquelle l’homme atteint son pouvoir être le plus propre.
Cette analyse achevée, l’auteur l’applique à la pensée d’Arendt, rappelée dans sa classique tripartition : travail, œuvre, action. R. Legros écrit ainsi : « Le travail est un propre de l’homme en tant qu’animal (un propre qui ne soustrait pas l’homme à l’animalité qu’il partage avec tous les animaux), le faire-œuvre est un propre de l’homme en tant qu’homme (il témoigne d’un arrachement à son animalité) et l’action est un propre révélateur d’une authenticité ou de ce qu’Arendt appelle « le plus proprement humain ». le travail est une activité qui ne différencie pas fondamentalement l’homme du mode d’être de l’animal dans la mesure où il absorbe le travailleur dans l’entretien du processus vital ; le faire-œuvre suppose un monde qui témoigne d’un mode de vie distinct de la vie animale, proprement humain, mais qui par lui-même n’ouvre pas l’homme à son humanité « authentique » ; parmi les trois modalités de la vie active, (…) seule l’action est proprement (« authentiquement ») humaine, elle élève l’être humain à l hauteur de ce qu’il est en propre. » (p. 136). Ce passage semble assez clair pour nous dispenser de le commenter.
C’est à Levinas que l’auteur applique ensuite sa grille de distinctions entre les propres. « Le « pour soi » comme mode d’existence indique un attachement à soi aussi radical qu’un vouloir naïf de vivre »4. L’être humain qui vit sur le mode du pour soi est en rapport avec d’autres humains, mais ces derniers ne lui apparaissent pas comme des êtres proprement humains mais plutôt comme des puissances naturelles qu’il doit dominer ou fuir. Le pour soi comme mode d’existence peut ainsi être considéré comme un propre de l’homme qu’il partage avec l’animal. Pour penser le proprement humain, au sens de ce qui sépare l’homme de l’animal, dans conférer toutefois à l’homme la plénitude de son humanité, le plus propre de l’homme, R. Legros analyse le rôle du travail, de la possession et de l’habitation. Ces dernières activités peuvent être qualifiées de propres de l’homme en tant qu’homme car elles nécessitent l’appartenance à un monde qui se détache du milieu naturel. Pour désigner le plus propre de l’homme, l’auteur renvoie à la rencontre, au face-à-face, par lequel l’Autre m’appelle à la liberté, me singularisant de fait même. La relation à autrui comme visage élève vers une humanité indéterminée. L’expérience d’autrui comme visage est donc bien expérience d’une transcendance radicale capable d’opérer une rupture avec « l’attitude naturelle », dans la quelle je me consacrais au travail pour posséder et habiter. Elle suppose un pouvoir de prendre du recul par rapport au monde.
En conclusion l’auteur évoque les limites de sa lecture. Si Arendt et Levinas définissent plusieurs formes d’authenticités humaines, dont une, la plus propre, qui advient grâce à une prise de distance avec tout monde particulier, ne faut-il pas considérer que l’expérience universelle du proprement humain se situe au-delà de toute humanité particulière, et donc au-delà de toute idée d’humanité, qui en tant qu’idée est historiquement advenue ?
IX) « Hannah Arendt et Emmanuel Levinas, des humanistes de l’autre homme »
Anne-Marie Roviello entend montrer comment la question de la responsabilité naît chez ces deux auteurs d’un retournement de l’individu comme simple étant persévérant dans son être, et d’une mise en évidence de la singularité de chacun contre les logiques totalitaires biologisantes et totalisatrices. Après le rappel de leur expérience commune d’une traversée du totalitarisme, l’auteur souligne qu’Arendt et Levinas ont assisté tous deux à la « démission des responsabilités » qui a rendu possible nazisme. Après une série d’affirmations peu développées sur ces deux auteurs, A.-M. Roviello émet l’idée que pour ces deux auteurs, il s’agit pour le soi de s’arracher à la sphère des intérêts et des besoins pour accéder à la dimension du désir porteur de la dimension du sens, désir du « Bien » chez Levinas, désir d’elle-même de la liberté chez Arendt. Contre la réduction au Même et à l’Un, il faut se prémunir et sauver une liberté capitale pour l’homme, cette dernière doit pouvoir ouvrir à l’imprévisible pour responsabiliser les hommes et les rendre capables de ne pas se contenter d’assurer leur égoïste subsistance, mais de faire face aux menaces qui peuvent peser sur son humanité et pas seulement sur sa vie.
Précisant la notion de liberté en jeu pour les deux auteurs, l’auteur expose la critique de la liberté comme souveraineté qui leur est commune en notant que « la liberté authentique doit se conquérir sur l’illusion du sujet souverain. » (p. 150) La liberté n’est plus tant la capacité ou le pouvoir d’un sujet que l’autonomie d’un sujet qui s’est en quelque sorte libéré de lui-même pour s’ouvrir à l’autre ; si je suis libre, c’est moins de mon propre fait, grâce à une de mes qualités pour accomplir un projet égoïste, qu’une liberté venue par l’autre et tendue vers l’autre. La responsabilité qui s’en dégage et qui est responsabilité pour autrui (Levinas) ou pour le monde (Arendt) requiert un mouvement de conversion par lequel l’individu cesse brusquement d’être mu par son conatus essendi, par son désir de persévérer dans son être ou sa volonté de survivre. La liberté, chez Arendt s’origine dans la spontanéité : « son « qui » auquel l’individu n’accède qu’en s’arrachant à ce qu’il est : culture, ethnie, classe sociale, profession, mais aussi défauts et qualités psychologiques, etc. » (p. 151). Levinas remarque qu’une façon de réduire ce qui fait la singularité, le « qui » de la personne à un objet, à un quoi, c’est de le dévisager, c’est-à-dire de « détruire son visage en le décomposant, en le réduisant à un ensemble de qualités sensibles » (p. 152). Et on comprend ainsi que, pour Arendt et Levinas, le totalitarisme se comporte comme ce qui dénie toute singularité aux individus en les classant, on les définissant, en les réduisant à des essences, à des êtres, à « ce » qu’ils sont – à des choses, en les empêchant d’être ou de devenir « qui » ils sont. Ce qu’exprime Levinas lorsqu’il écrit que l’horreur totalitaire, c’est, singulièrement, « l’horreur d’une certaine définition de notre être » 5. Et en effet, l’irréductible unicité des individus s’oppose à toute prétention de « totalisation » : « qui » est une personne ne se résume ni ne se réduit à un cas particulier du genre humain, ou de l’espèce humaine, elle est singularité exemplaire. L’action peut alors être pensée comme la forme de la liberté capable d’interrompre le fatalisme des processus historiques.
Si la liberté se trouve dans le commencement, dans l’initiative, dans le pouvoir de commencer, il y a chez Levinas une responsabilité pour autrui antérieure à tout commencement 6. Il y a aussi chez Arendt un avant du libre et du non-libre. L’analyse de sa pensée du totalitarisme révèle « une sorte d’en-deçà du bien et du mal, dans ce mal extrême qui ne peut être ni puni, ni pardonné, parce qu’il est extrême, mais aussi parce qu’il est exécuté par des individus qui n’étaient pas mus par leurs désirs ou leurs intérêts, par des individus « désintéressés », qui ne sont pas simplement démis de leur responsabilité, mais de leur personnalité toute entière.» (p. 155). Après avoir montré ce qu’était et d’où provenait la liberté chez Levinas et Arendt, l’auteur examine les causes de sa disparition, disparition qui a pu rendre le totalitarisme possible. C’est au retrait des hommes dans la sphère privée et l’intériorité qu’Arendt attribue l’effondrement de la liberté politique ; de son côté, Levinas voit dans l’intériorité de la conscience l’ultime refuge pour l’humanité de l’homme 7. A l’encontre de l’importance du repli sur soi, mouvement qu’elle juge propre à la philosophie et antipolitique, Arendt estime que chacun doit assumer sa propre responsabilité pour le monde.
X) « les droits de l’homme au-delà de l’être »
La communication d’Anya Topolski, s’intitule « les droits de l’homme au-delà de l’être : à la recherche d’un sens post-fondationniste chez Arendt et Levinas ». L’auteur commence par remarquer qu’Arendt pointe tôt du doigt le problème des réfugiés et des apatrides. Sa question peut se résumer ainsi : comment les droits de l’homme peuvent-ils avoir une présence politique qui ait du sens sans pour autant être fondés sur l’être ? L’auteur formule la problématique qu’elle prête à Arendt en ces termes : « pourquoi les droits qui devaient protéger les êtres humains s’étaient révélés sans valeur pour ceux qui n’avaient que leur humanité à revendiquer ? » Le problème identifié par Arendt est que « la déclaration de droits humains inaliénables impliquait d’emblée un paradoxe, puisqu’elle se référait à un être humain « abstrait » qui ne semblait exister nulle part »8. Cela signifie que si quelqu’un ne réside plus nulle part, qu’il est sans communauté et sans espace pour apparaître, l’être humain perd une humanité qui devait pourtant lui être naturelle et inaliénable. En perdant leur citoyenneté et donc leur communauté politique, les Juifs avaient aussi perdu un espace dans lequel ils pouvaient être vus et écoutés, un espace d’action politique. De là, pour Arendt, l’idée que le droit le plus fondamental est celui d’appartenir à une communauté, puisque en l’absence de communauté dans laquelle chacun peut se battre pour les droits de l’autre, tous les autres droits possibles se voient dénués de sens.
Après avoir listé des prétendants historiques et possibles pour servir de fondements aux droits de l’homme (Dieu, la nature, l’histoire), il apparaît qu’aucun ne convient. Et puisqu’aucun ne convient, Arendt élabore une tentative pour trouver un fondement « post-fondationniste » des droits de l’homme en s’appuyant sur la notion de pluralité. Arendt réexamine la notion de principe chez Montesquieu. Le chapitre final des Origines du totalitarisme prétend identifier le principe et la nature d’un gouvernement totalitaire. La terreur, comme la peur, a pour but de détruire l’individualité. Elle est le principe du totalitarisme et l’idéologie est sa nature. Dès lors, pour Arendt, il semble que seule la pluralité puisse faire pièce au totalitarisme. Comme preuve de la pertinence de son analyse, elle montre comment le totalitarisme a détruit la pluralité9. Pour cette raison, Arendt consacra ses écrits suivants à l’importance de la pluralité, de la sphère publique et de la politique – moyens grâce auxquels toute possibilité d’un retour au totalitarisme serait réduite le plus possible. Ainsi notre humanité n’est réelle que lorsque nous pouvons être ensemble avec d’autres, en accord ou en désaccord avec eux, situation que vise à prohiber le totalitarisme. Le politique est fondamentalement intersubjectif, c’est une interaction. On comprend en effet bien que si un seul être humain habitait la terre, il n’y aurait personne pour violer ses droits, de même que si nous étions tous pareils, il n’y aurait aucune différence qui pourrait être attaquée. La pluralité s’oppose ainsi à la singularité et à la multiplicité. Parce que les fondements classiques ou traditionnels pour fonder les droits de l’homme ne semblent plus à même de les garantir, et plutôt que de se tourner vers un dieu qui serait extérieur ou vers notre raison intérieure, Arendt propose de s’orienter vers les autres hommes pour créer un « fondement » pour les droits de l’homme qui soit situé « entre les deux ». « Nos droits, comme le fait remarquer l’auteur, ne peuvent être garantis qu’à travers les actes de ceux avec qui nous formons une totalité (…) C’est cette base relationnelle, inspirée par la pluralité, qui motive autrui à se battre pour mes droits. » (p. 177). Et de fait, les droits n’ont de sens que s’il y a des personnes prêtes à les défendre, un droit purement formel ou abstrait n’a aucune force.
Toutefois, concède Anya Topolski à la fin de l’analyse qu’elle consacre à la défense du droit dans la pluralité, on pourrait reprocher à Arendt de ne pas aller assez loi : elle ne développe pas ce qui se trouve comme potentiel sous ce principe. Il faudrait alors trouver des parallèles entre le sens des principes de Montesquieu et celui de la pluralité. C’est cette limite de la pensée arendtienne qui sert de motif à l’auteur pour analyser la pensée lévinassienne des droits de l’homme. Levinas écrit sur les droits de l’homme dans des articles des années 1980. Il y oppose « humain » et « droits naturels » ; pour lui, les droits de l’homme transcendent la nature, alors que la tradition, au contraire, les inscrivait dans la nature. Ni Arendt ni Levinas ne pensent que l’Etat est un garant assez sûr pour ces droits. La manière dont les Juifs ont été dépouillés de leurs droits en est un exemple. Chez Levinas, la fraternité émerge des droits de l’autre. Les droits sont d’abord ceux de l’autre. Une asymétrie apparaît ainsi entre mes droits sur l’autre et les droits que l’autre a sur moi. Une question semble surgir alors, expose l’auteur, qu’elle formule ainsi : n’y a-t-il pas un danger que personne ne fasse attention à mes droits ? L’exemple des juifs dotés de droits depuis 1789, mais que personne n’a défendu (comme pendant l’Affaire Dreyfus) semble concrétiser cette situation. Mais, remarque Levinas, mettre les droits de l’autre avant les miens peut paraître excessif, mais semble moins dangereux que le système libéral qui a pu mener au totalitarisme. Arendt et Levinas semblent tacitement d’accord pour placer leur foi dans une solidarité entre les êtres humains plutôt que dans l’Etat. Cette intersubjectivité relationnelle n’offre aucune garantie absolue. Et cette garantie, qui ne se fonde sur aucun principe traditionnel, peut être dite un fondement, mais dans un sens bien particulier, un fondement « post-fondationniste » c’est-à-dire « un fondement qui n’a qu’un fondement contingent » (p. 185). Comme la sphère humaine se caractérise par la « natalité » qui peut se définir comme spontanéité et imprévisibilité, tout fondement post-fondationniste « ne peut nous procurer une assurance absolue, mais peut nous donner une certaine stabilité. C’est de cette stabilité dont nous avons besoin, en tant qu’êtres humains, pour pouvoir prendre les risques nécessaires à la création d’un monde intersubjectif. » (Ibid.)
Conclusion
La lecture de ce recueil suscite quelques petites déceptions. D’abord certains auteurs ne jouent pas vraiment le jeu et semblent se contenter d’esquisser un certains nombres d’idées plus ou moins profondes et développées et qui n’ont qu’un vague lien avec l’intitulé exact de l’ouvrage et qui devrait pourtant servir de fil conducteur à la réflexion. Ensuite, – et c’est sans doute lié à la précision du sujet de l’ouvrage – les articles qui prennent au sérieux le champ de réflexion en viennent à répéter souvent des choses identiques (le commun rapport à Heidegger dont on tente de dépasser l’approche, l’expérience du totalitarisme et de la Shoah, l’insistance sur l’éthique de l’un, sur la politique de l’autre, le rapport privilégié au monde de l’une, au visage de l’autre, etc.). Enfin, il peut sembler dommage que le rapport à l’histoire, qui est pourtant explicite dans le titre, soit presque tout le temps réduit à la question du totalitarisme, et ne soit jamais traité comme tel – quand il n’est pas complètement tu.
Cependant, et c’est sur dernière note qu’il faut insister, la diversité des perspectives offre un vaste panorama de questions à partir de ce sujet et un grand nombre de réponses – ou d’ébauches de réponse – satisfaisantes, fécondes, voire absolument remarquables. Si l’on peut déplorer le manque de rigueur dans la présentation de certains articles, d’autres provoquent ce qu’on peut attendre de meilleur de la lecture d’articles critiques : un renouvellement du questionnement et une nouvelle lumière une œuvre, qui ouvre à une compréhension plus pleine, plus juste et plus complète, et surtout qui permet de se poser de nouveaux problèmes.
- M. Heidegger, Être et temps, trad. fr. Fr. Vezin, Paris, Gallimard, 1986
- H. Arendt, « préface », Vies politiques trad. fr. E Adda et al., Paris, Gallimard, 1974
- H. Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München, Piper, 1983, p13
- E. Levinas, Totalité et infini, op. cit., p. 59
- E. Levinas, De l’évasion,op. cit., p. 71
- « L’intériorité, c’est le fait que dans l’être le commencement est précédé mais que ce qui précède ne se présente pas au regard libre qui l’assumerait, ne se fait pas présent ni représentation. », E. Levinas,Autrement qu’être ou au-delà de l’essence,Le Livre de poche, Paris, 1974,p. 74
- « Dans le silence ou le mensonge des institutions aliénées et le déploiement sans frein de la perversité et de la violence, l’humanité de l’homme arrive à s’abriter dans le « for intérieur » de la conscience morale. » E. Levinas, Noms propres, op. cit., préface. »
- H. Arendt,Les origines du totalitarisme, op. cit., p. 592
- En premier lieu, en abolissant la loi qui fournissait la sécurité de base nécessaire aux interactions humaines. En deuxième lieu, en usant de la peur pour détruire les liens de moralité qui facilitent les relations entre individus. Et troisièmement, en créant des camps qui excluent tout signe d’identité et de particularité.








