On peut consulter la première partie de cette recension à cette adresse.
D : Le développement de la pensée de la Machenschaft.
Le contenu proprement philosophique de ce volume est riche et varié, les thèmes abordés sont nombreux et hétérogènes. Les grands thèmes sont la Machenschaft, l’expérience vécue, Nietzsche, l’Ereignis, la fondation de la vérité de l’Être, l’errance, le rôle de l’histoire entendue comme historiographie (Historie), la décision, l’œuvre d’art…
Heidegger consacrant presque la totalité de ses cours de 1936 à 1940 à son explication avec Nietzsche, il n’est guère étonnant que ce dernier soit le principal interlocuteur de Heidegger dans ces cahiers. On trouvera donc dans Ga 95 des compléments intéressants aux cours sur Nietzsche qui font en quelque sorte le lien entre ces cours et les traités d’histoire de l’Être. On retrouve ici l’interprétation qui fait de Nietzsche le dernier penseur de la métaphysique occidentale, celui qui l’accomplit dans l’interprétation de l’étantité comme « vie » et comme « volonté de puissance », puissance propre à l’époque du déploiement de la technique comme Machenschaft. Nous n’y revenons pas.
Heidegger rappelle tout au long du volume la signification de la décision de l’histoire de l’Être, à savoir la décision qui tranche entre le deux possibilités fondamentales de l’alternative :
« soit l’abandon de l’étant par l’être ayant atteint son paroxysme ravale l’homme dans la simple réduction à lui-même, assuré d’y trouver une longévité ad vitam aeternam ; soit l’être devient urgence, telle qu’elle se déploie allant s’abritant en son retrait, et cette urgence dispense la liberté d’une fondation inaugurale de l’étant dans la simplicité de son essence » (p. 319), « Vers la vérité de l’Être, ou alors la faisance de l’étant tirant à sa fin » (p. 421).
La manière dont est pensée la possibilité de la fondation n’évolue pas véritablement par rapport aux Beiträge et à Ga 94, elle est toujours la tâche des peu nombreux, les poètes et penseurs qui sont appropriés par l’Être à la garde de sa vérité en la disant et la pensant. A l’inverse, la manière dont est pensé l’accomplissement des temps modernes comme Machenschaft donne lieu à de nombreux développements par rapport aux Beiträge. En effet, c’est la jonction « La résonance », qui l’expose, qui est pensée la dernière, de 1936 à 1938, parallèlement aux cours sur Nietzsche, de sorte que Ga 95 prolonge cette pensée en l’approfondissant à partir des concepts nietzschéens de « vie » et de « puissance », la métaphysique de Nietzche étant véritablement à l’œuvre dans l’époque présente, selon Heidegger. On retrouve donc dans ce volume de nombreux développements sur le gigantesque et l’expérience vécue, la culture étant comprise comme l’organisation gigantesque de l’expérience vécue, en des constats sur la manière d’être de l’homme occidental moderne qui n’ont rien perdu de leur pertinence quatre-vingts ans plus tard, les phénomènes que Heidegger a en vue s’étant considérablement développés. Au par. 2 de Réflexions VII, Heidegger donne l’exemple du développement contemporain du journalisme : « « Schemling – à vivre en direct : le monde retient son souffle » – et si ce n’était pas seulement là une phrase glanée dans un journal, et si cette formule journalistique, loin d’être un compte rendu de circonstance et sans plus d’intérêt, exprimait le comble de la réalité ? » (p. 17). Au par. 3, c’est « la figure du gigantesque appareillage de l’appareil du Parti et de l’appareil d’Etat en leur unité » (p. 20) qui est reconduit à la Machenschaft, dans ce contexte comme un organisateur de l’expérience vécue à travers sa politique culturelle. Au par. 12, Heidegger illustre encore ce phénomène à partir du développement du tourisme de masse d’une part, et de la volonté de populariser la culture auprès des masses, raison pour laquelle il prend l’exemple du boulanger et de la blanchisseuse : « Pourquoi un maître boulanger parfaitement respectable ayant eu la chance de « vivre/faire » la côte norvégienne n’en viendrait-il pas à l’idée que c’est à lui au fond que revient le mérite d’avoir découvert cette contrée ? Et pourquoi donc une brave blanchisseuse ayant pour la première fois l’occasion de « vivre/s’offrir » une représentation de Cabale et amour ne se convaincrait-elle pas que si elle a pu, elle, fréquenter le théâtre, c’est que commence enfin la véritable « culture » populaire ? » (p. 27)1. Au par. 55, comme dans le cas précédent du théâtre, c’est l’art qui est interprété comme une expression de l’expérience vécue, l’art devenu un objet festif, et la fête promue en manifestation, une manifestation éphémère chassant l’autre, Heidegger y voyant « la preuve sans ambiguïté – et peut-être même parfaitement superflue – que l’art touche à sa fin – doit toucher à sa fin » (p. 63). Le par. 75 évoque le slogan contemporain consistant à aller « se ressourcer » au contact de la nature, ce qui est une manière pour l’homme pensé comme subjectum de la réduire à n’être qu’un paysage pour sa jouissance, c’est-à-dire une fois de plus à en fait un stock d’expériences vécues formatées et organisées, au lieu d’être la terre mère sacrée que chante l’hymne hölderlinien :
« Et pourtant – qu’en est-il de ce « ressourcement » et de son organisation ? La forêt et le ruisseau, la montagne et la prairie, le grand air et le ciel, la mer et l’île, l’homme prend tout cela à présent comme autant d’occasions de se distraire, sources de relaxation, objets de son délassement, au gré d’activités formatées et planifiées en fonction de ses attentes. En mettant les choses au mieux, l’homme prend tout ce que l’on vient de dire comme « paysage » dont il a pris connaissance lors d’un bref séjour ou en le parcourant à la hâte pour l’emmagasiner peut-être dans sa mémoire comme éventuel sujet de conversation à venir. » (p. 89).
Heidegger interprète cette « jouissance de la nature » comme une « curiosité du paysage » (p. 90), la curiosité étant déjà pensée dans le par. 36 d’Être et temps comme la modalité inauthentique du voir où le Dasein sautille d’un étant à un autre sans s’attacher véritablement à aucun de manière sérieuse. L’exemple est intéressant, car on voit que la Machenschaft, le caractère manipulable, transformable, productible, fabricable, faisable, de tout l’étant, n’est nullement réductible à la technique au sens de la grand industrie. Ce dont il y va avec le tourisme de masse, c’est bien de l’organisation de cet étant qu’est la nature pour l’affairement humain qui a pour conséquence « la destruction du village et de la ferme » (p. 367) où les paysans eux-mêmes sont repris par la gestion affairée de la nature. On pourrait, comme cela a souvent été fait, voir en Heidegger un petit provincial réactionnaire et nostalgique. Il précise pourtant que ce serait mécomprendre son propos que de croire qu’il s’agirait de « regretter le « bon vieux temps » » (p. 91). En effet, les constats de Heidegger peuvent tout à fait faire écho à ce que nous faisons de nos jours concernant la manière dont le tourisme de masse détruit les cultures locales et les modes de vie locaux. Il ne s’agit pas non plus pour Heidegger, par fermeture d’esprit, de condamner le voyage en tant que tel, comme s’il fallait absolument rester chez soi, lui qui fit en 1962 un voyage en Grèce qui lui inspira Séjours, et l’on peut sans doute appliquer au voyage la distinction entre inauthenticité et authenticité.
Le par. 13 de Réflexions VIII interprète l’essor de la psychologie comme relevant lui aussi du règne moderne de l’expérience vécue. Au par. 14, c’est l’organisation du festival de Bayreuth avec « la musique prenant aux tripes de Wagner » (p. 120) qui lui permet de définir le romantisme comme « l’organisation fervente de la ferveur en « expérience vécue » » (p. 120).
Mais si l’expérience vécue et sa quête de sentiments et d’émotions fortes et toujours neufs sont caractéristiques de la métaphysique des temps modernes, où l’homme devient subjectum, et de son accomplissement contemporain, on pourrait croire que Heidegger condamne l’affectivité comme telle et que le délogement de l’homme du subjectum vers le Da-sein désigne une mort de l’affectivité, comme s’il s’agissait de devenir impassible. Cela serait étonnant si l’on se souvient du rôle majeur qu’accordait le par. 29 d’Être et temps à la disposition affective, tout comprendre étant nécessairement disposé affectivement d’une certaine manière, fusse de manière neutre. Au par. 40, la disposition affective fondamentale de l’angoisse était essentielle à la ressaisie de l’être du Dasein en sa totalité structurelle comme souci. La position de Heidegger à cet égard n’a pas changé. Il ne s’agit pas de rejeter les sentiments, mais plutôt la manière dont les interprète la métaphysique de temps modernes, à savoir, précisément, comme des sentiments, comme des expériences vécues, des vécus de conscience. Être et temps les réinterprétaient comme des tonalités affectives, comme le ton même de l’ouverture du monde et comme ce qui transporte l’homme dans cette ouverture. Essentiel est ici le par. 33 de Réflexions VIII qui précise que la décision de l’histoire de l’Être, comme décision à l’égard de l’être-homme, pour le sujet ou pour le Da-sein, doit aussi être une décision à l’égard de l’essence du sentiment, renvoyant justement en note au par. 29 d’Être et temps :
« Relativement au sentiment, la décision relevant de l’histoire de l’Être tranche entre l’une et l’autre façon dont l’homme est homme en ce qu’il éprouve et en ce qu’il sent ; ce qui veut dire : il véhicule des sentiments qu’il organise et savoure, sentiments qui, quant à eux, sont quelque chose qui survient en lui – ou alors : ce que l’on connaît depuis longtemps et tout naturellement sous le nom de sentiment est appelé à recouvrer sa véritable nature à l’aune de l’Être en ce qui, au lieu de se trouver tout bonnement en l’homme, porte de fond en comble l’être de l’être humain, a d’emblée pris en charge la détermination de son essence, autrement dit : ne retient pa l’animal rationale et ne retient plus non plus le sujet comme modalité de l’être-homme.
La préparation en vue de cette possibilité-là est indiquée dans Être et temps par la qualification des « sentiments » sous l’appellation de Stimmung, la manière d’être accordée à… (…) Ressentir les sentiments que l’on éprouve, c’est se crisper sur le sujet ; être disposé et accordé, c’est être ravi dans l’ouvert et la vérité de l’Être (…) appelé à être éprouvé comme ce qui nous approprie en son Ereignis (cf. Beiträge) » (p. 165).
On le voit, ce qui s’oppose à l’expérience vécue comme jouissance de l’étant, c’est la tonalité affective fondamentale dans laquelle nous plonge l’Être lui-même en se déployant comme événement appropriant l’homme à la garde de sa vérité à laquelle il ouvre l’homme par cette tonalité affective.
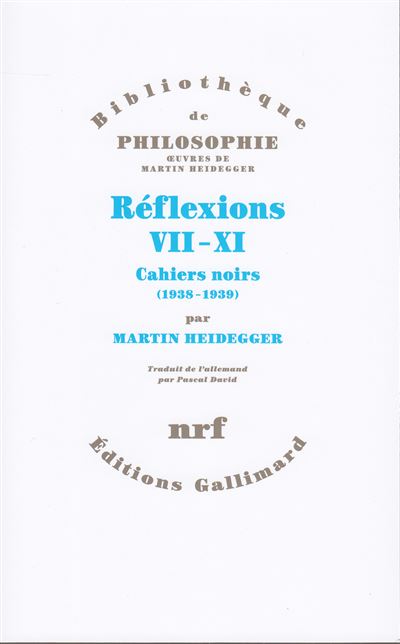
Si Ga 95 constitue un approfondissement de la pensée de la Machenschaft, c’est aussi par la venue au premier plan de la notion du subjectum pour caractériser les temps modernes, développée parallèlement dans Besinnung, et qui signifie ce que Heidegger appelle « métaphysique de la subjectivité » dans les cours sur Nietzsche : « pour l’instant et probablement pour longtemps encore l’homme est conçu comme subjectum au beau milieu de l’étant » (p. 157). Si l’homme, dès l’instauration platonico-aristotélicienne de la métaphysique, est animal rationale, il devient avec les temps modernes le « subjectum de tout étant » (p. 52) qui de son coté devient l’objet de la représentation, correspondant au point extrême de l’oubli de l’être : « L’oubli de l’être est scellé par la venue au premier plan de l’homme comme subjectum » (p. 255). La transition est pensée comme une décision qui doit trancher entre la fermeture sur soi de l’homme comme sujet enclôt dans sa subjectivité et ses expériences vécues, ou l’ouverture de l’homme comme Da-sein à la vérité de l’Être. Apparaissent aussi d’autres notions absentes des Beiträge et développées dans Besinnung comme « l’absence de but (Ziel-losigkeit) », l’animal historique « (historische Tier) », ou la « réduction de l’homme à lui-même (Vermenschung des Menschen) », qui trouvent leur source dans l’explication avec Nietzsche. « L’absence de but » est l’une des manières dont ce dernier caractérise l’époque contemporaine du complet nihilisme. Mais c’est avec la notion même de « but » qu’entend rompre Heidegger et la pensée méditante n’a nullement pour projet de fixer de nouveau buts pour l’humanité, mais plutôt de « prendre de la hauteur par rapport à quelque chose de tel que des buts » (p. 157). Les buts, comme les valeurs, sont toujours fixés par l’homme comme subjectum, de sorte qu’il ne s’agit pas de fixer un nouveau but tel que le surhumain, le besoin d’avoir un but étant encore un obstacle à la transition et une manière de se maintenir dans la métaphysique. La notion d’« animal historique » provient de l’interprétation de la seconde Considération inactuelle de Nietzsche à laquelle Heidegger consacre son séminaire de l’hiver 1938-39. Nietzsche questionnait l’utilité et les inconvénients de l’histoire pour la vie, ce qui amène Heidegger à interpréter l’homme contemporain comme animal voué à l’enquête historique (Historie) pour la cultivation de sa vie pour elle-même : « L’animal rationale s’est mué en animal historique, à savoir en cet être vivant qui s’occupe de « la vie », de sa conservation et de son amélioration et qui tient tout cela pour un « but » à atteindre » (p. 191). Pour un tel animal, tous les idéaux du passé, toutes les valeurs, sont escomptés à partir de leur utilité pour sa vie. On le voit, l’animal historique est la figure de l’humain correspondant à la métaphysique de Nietzsche. Elle correspond à une époque où l’homme se fait toujours plus animal et s’enferme dans son animalité vivante et corporelle au lieu de se dépasser vers le Da-sein : « l’animalité est déclarée constituer l’étantité de l’étant (entendu comme vie), l’homme – au titre d’animal historique – va développer historiquement sa propre essence en sombrant « en dessous » de l’animal » (p. 254), « l’animal historique est référé à « lui-même », mais de telle sorte qu’il relègue de plus en plus son essence dans ce qui est déjà présent là-devant – l’animalité – « la vie » » (p. 296). La réduction de l’homme à lui-même caractérise l’animal historique. La notion apparaît dès le par. 76 de Réflexions VII où Heidegger demande : « Qu’est-ce à dire : réduire l’homme à lui-même ? » (p. 92). La réponse est que cela signifie que l’homme se prend pour un étant comme les autres, c’est-à-dire pour un étant subsistant (vorhanden) doté de propriétés, où le lecteur d’Être et temps reconnaît la compréhension inauthentique du Dasein à partir de l’étant intramondain. L’élément qui s’ajoute ici est que, se représentant de la sorte, l’homme s’inscrit dans l’étant pour y occuper la place centrale, celle du subjectum. La Vermenschung devient donc un autre nom pour le Weg-sein, pour la perte du rapport à l’Être : « Au fond, cette réduction de l’homme à lui-même signifie une seule chose : l’homme est soustrait à la relation à l’être » (p. 92). Cette notion caractérise donc l’accomplissement de la métaphysique des temps modernes sous la forme de l’animal historique : « ce qui destine les temps modernes de manière de plus décidée à leur essence, c’est : la réduction de l’homme à lui-même : le règne de « la vie » » (p. 351-352). A la fin de Réflexions XI (par. 42), c’est la notion de brutalitas que Heidegger met en avant pour caractériser le règne de la Machenschaft, donc pour accentuer sa dimension de violence faite à l’étant, et d’abord à cet étant qu’est l’homme sous la forme de son animalisation extrême qu’est le racialisme : « La brutalitas de l’être a pour conséquence – mais non pour fondement – que l’homme lui-même en tant qu’étant se fait proprement et de fond en comble factum brutum et « fonde » son animalité par la doctrine raciale » (p. 400). Avec cette doctrine raciale, l’homme contemporain se fait animal prédateur qui « accomplit l’effectuation de la brutalitas de l’être » (p. 401).
E : Développements sur l’art
La question de l’art revient de manière développée dans Ga 95, et parallèlement dans Besinnung, le par. 11 « L’art à l’époque de l’accomplissement des temps modernes » renvoyant justement en note aux Réflexions VIII.
Heidegger s’efforce de penser dans ces cahiers ce que devient l’art à l’époque de l’accomplissement des temps modernes. C’est l’époque où l’homme devient animal historique, de telle sorte que l’art devient objet d’enquête pour l’histoire de l’art : « l’« art » est capté dans le champ objectif du décompte historique, alors que l’art relève des fondations historiales originaires » (p. 216). L’œuvre fait alors l’objet d’une explication historique consistant à en rechercher les sources. C’est le domaine de l’art repris par la pensée calculante. Mais Heidegger remarque que l’autre voie est celle de l’approche psychologisante des œuvres qui en fait des expressions de sentiments, c’est-à-dire d’expériences vécues du subjectum, les deux allant de pair. A l’époque de la Machenschaft, l’art est devenu l’objet d’une organisation par la politique culturelle pour être pourvoyeur en expériences vécues au lieu d’être un formateur de monde qu’il installe sur une terre. De ce point de vue, le développement de l’esthétique dès le début des temps modernes en est la parfaite illustration pour Heidegger, l’art étant alors pris en vue à partir des sensations et des sentiments qu’il suscite chez le subjectum : « l’« art » « éprouvé esthétiquement – nourrissant à son tour cette « expérience vécue » » (p. 411), « Là où l’on veut dépasser la réception historique de l’œuvre, on tombe dans l’« esthétique » (l’œuvre comme stimulation du vécu) » (p. 109-110).
Avec l’histoire du premier commencement comme histoire de la métaphysique a eu lieu l’histoire de l’art qui lui correspond, car l’art est lui-même un produit de la métaphysique : « L’art – ce que nous appelons ainsi et dont nous connaissons l’histoire selon le décompte historique – n’est possible que sur le fond de la décision métaphysique dont l’évidence s’est imposée sous la forme de la distinction entre l’étant et l’étantité, du sensible et du non- (ou supra-) sensible, du « réel » et de l’« idée » » (p. 144). Il s’agit là des distinctions platoniciennes, et Heidegger souligne que le retournement du platonisme avec Nietzsche ne fait qu’accomplir cette distinction métaphysique. Avec l’achèvement de la métaphysique a donc lieu une fin de l’art, « la fin déjà advenue de l’art (métaphysiquement porté) » (p. 145). Toute la question est alors de savoir ce qu’il doit en être de l’art avec l’autre commencement : « Si toutefois la fin de la métaphysique n’est pas la fin de la pensée mais seulement l’achèvement de l’histoire de son premier commencement, si la pensée devient pensée de l’Être, (…) qu’est-ce qui va venir à la place de ce qui jusqu’à présent a été l’art en régime métaphysique ? » (p. 145). La réponse doit venir de l’Être lui-même. Ce qu’il faut à l’art, ce ne sont pas de nouveaux idéaux et de nouvelles valeurs. Heidegger renvoie à la conférence de 1936, « L’origine de l’œuvre d’art », comme étant le texte par lequel il entend « amener la méditation portant sur l’art dans le domaine de ce qui est décisif et à préparer l’instant historial où s’opérerait la mutation de l’essence de l’art, de l’art tel qu’il a été « métaphysiquement » porté à un art autre » (p. 146). Mais Heidegger maintient ouverte la possibilité que plus rien ne corresponde à l’art dans l’autre commencement si ce dernier échoue à devenir ce qu’il doit y être, à savoir l’abritement de la vérité de l’Être dans l’étant, la mise en œuvre de la vérité de l’Être, et non plus la représentation de l’étant : « L’art – ne se justifie inauguralement, à savoir comme porteur d’avenir, qu’à partir de l’« œuvre », dans la mesure où l’œuvre installe la vérité (de l’Être) dans toute sa splendeur en un étant et amène l’étant à lui-même, comme garde de l’Être en sa vérité, et cela de telle sorte – que celui-ci en vienne à nous approprier » (p. 261).
Puisque Heidegger s’explique pendant ces années avec la métaphysique de Nietzsche pour y voir la vérité de notre temps, c’est aussi la conception de l’art comme « grand stimulant de la vie » qui est visée par Heidegger, ce qu’il fait en s’en prenant surtout à Wagner, mais du même coup au wagnérisme du jeune Nietzsche écrivant La Naissance de la tragédie enfantée par l’esprit de la musique et même au dernier, qui n’a jamais véritablement surmonté son wagnérisme, juge Heidegger : « La pensée de la culture chez Nietzsche montre qu’il n’a jamais surmonté le culte de Wagner, si vivement qu’il ait pu s’en défendre par la suite » (p. 328). Quand on connait la place accordée à la musique de Wagner par la politique culturelle nazie, on peut se douter que c’est elle aussi et son wagnérisme qui est visée (cf. p. 338 : « les effets entièrement dévastateurs du « wagnérisme » ».). Au par. 14. de Réflexions VIII est évoqué rapidement l’organisation du festival de Bayreuth et « la musique prenant aux tripes de Wagner » (p. 120) comme organisation de l’expérience vécue. Au par. 27 Heidegger voit dans son époque celle du triomphe du romantisme sous la forme de la musique wagnérienne, association du calcul et de l’expérience vécue qui ne fait qu’un avec le triomphe de la Machenschaft technique : « La musique, ce qui est sans parole et sans vérité mais entièrement calculé, touchant la « vie », le « corps », devient « l’art » par excellence, seul à confédérer tous les arts en lui et autour de lui ; autrement dit, l’art devient téchnè au sens de la technique, répondant à un impératif et à un calcul d’ordre politique, un moyen parmi d’autres de manipulation du présent subsistant porté aux nus. Lohengrin toujours et encore Lohengrin, le passage des divisions blindées et le vrombissement des escadrilles font partie du même monde, ils sont le même » (p. 142-143) On notera dans ce contexte que le propos sur la manipulation politique de l’art à travers le wagnérisme, associée aux défilés militaires, ne peut que viser l’utilisation de cette musique par la politique culturelle nazie. Le par. 32 évoque « l’œuvre d’art totale » (p. 154) wagnérienne comme modèle de l’affairement culturel. Mais c’est le par. 33 qui développe cette question en prenant à nouveau comme exemple la musique, Wagner et Nietzsche comme le témoignage parfait de l’association du règne du calcul avec celui de l’expérience vécue :
« L’accomplissement et l’organisation de l’expérience vécue comme ressenti, dans chaque cas de figure, c’est « l’art » qui s’en charge, et c’est bien pourquoi doit naître la conviction qu’à présent enfin est découverte et consolidée la tâche de calculer et de planifier, et par là l’essence de l’art. Mais comme le ressenti éprouvé se fait toujours plus tapageur et jouissif, et cela d’autant plus que le sentiment est plus vague et plus vide au fond, la musique suffit toutefois à susciter instantanément un tel sentiment, la musique elle-même devenant le genre artistique canonique (cf. le romantisme, Wagner – et Nietzsche). Que la musique en elle-même obéisse à des lois qui lui sont propres et ressortisses à une calculabilité de haut vol ne contredit pas mais ne fait que rendre manifeste à quel point le pur nombre et le pur ressenti sont compatibles et s’appellent l’un l’autre. Appréhendés à l’aune de la musique, tous les genres artistiques deviennent musicaux, c’est-à-dire expression et incitation de la jouissance éprouvée à ressentir » (p. 160).
« Ressentir passe pour être le « summum » de l’expérience vécue (la musique devenant à partir de là « l’art absolu ») » (p. 162).
« L’homme des temps modernes s’embobine lui-même dans une contorsion de son essence prétendue, contorsion qui son constitue sa « véritable » essence dans la mesure où elle le contraint sans esquive possible à fixer l’animalité comme la puissance véritable de sa « vie » en le retreignant aux seules aspirations à la « force » et à la « beauté » (entendons ce qui stimule son plaisir – la musique wagnérienne en étant le symbole ») » (p. 323).
« Que peut-on bien attendre de l’éducation artistique « cultivant les muses », plus généralement de « la dimension de la Muse » et cela sous la forme de l’accession au premier plan de « la musique » ? Peut-être est-ce là indispensable pour tenir les masses à distance de la défiguration de l’Être. La « musique » au sens le plus large serait-elle ce qui vous berce dans un vague semblant de « vitalité » qui rend toujours moins exigeant et moins disposé à toute expérience de l’urgence de l’Être ? Et à l’aide de l’« étant » (de ce qui comble en « expérience vécue », une esquive devant l’Être ? » (p. 146).
De même que Heidegger n’envisage jamais le cinéma comme autre chose qu’un pourvoyeur d’expériences vécues, il n’évoque jamais dans ces cahiers une musique qui pourrait être autre chose qu’une manière de faire ressentir des sentiments. Si la musique wagnérienne est interprétée justement, comme le faisait déjà le jeune Nietzsche, comme un stimulant de la vie, la mutation de l’essence de l’art que doit rendre possible l’autre commencement ne devrait-elle pas être aussi une mutation de l’essence de la musique ? La chose semble difficile à penser, tant c’est dans ces passages l’essence même de la musique comme composition par le calcul et comme rythme physiquement vécu qui semble bien lui interdire d’être autre chose que « ce qui est sans parole et sans vérité ». L’œuvre d’art doit être mise en œuvre de la vérité, mais l’on sait que pour Heidegger celle-ci est foncièrement parole et mot comme adresse de l’Être lui-même. Heidegger déplore dans le même paragraphe l’évolution contemporaine de la poésie se faisant chant, où « la parole n’est plus que ce qui vient s’ajouter accessoirement à la résonance, à son ondulation et à sa vibration » (p. 160), et il est vrai que dans sa manière de lire les poèmes, Heidegger ne s’intéresse qu’à leur sens, donc à leur charge de vérité, et ne fait jamais de remarques purement littéraires sur le rythme d’un vers ou sur le jeu des sonorités. A cette époque où la musique devient l’art par excellence qui confédère tous les autres arts autour de lui, conformément à l’idée wagnérienne d’œuvre d’art totale, Heidegger préfère sans doute, et regrette aussi, la Grèce pré-métaphysique d’Homère, Pindare, Eschyle et Sophocle, où c’est la poésie qui est l’art par excellence et qui fédère tous les autres autour de lui (dans la conférence de 1936, il va jusqu’à dire que tout art trouve son essence dans la poésie). Mais comment la musique pourrait-elle ouvrir un monde ? De même, le caractère éphémère de l’exécution musicale ne l’empêcherait-elle pas de donner une assise solide à ce monde sur la terre ? Ne pourrait-on pas repenser la dimension affective de la musique à partir des Stimmungen plutôt que de l’expérience vécue et faire d’elle ce qui nous transporte dans les dispositions fondamentales, et nous ouvre ainsi à la vérité de l’Être ? S’il y a une parole de l’Être qui inspire le poète, pourquoi pas une musique de l’Être qui inspire le musicien ? La musique peut être autre chose qu’une source de sentiments, pensons par exemple au dodécaphonisme, mais Heidegger y verrait sans doute le triomphe du calcul. Ce n’est sans doute pas un hasard si Heidegger ne donne aucun exemple d’œuvre musicale dans sa conférence de 1936. Il y a peut-être là un impensé chez Heidegger, même si l’on sait par ailleurs qu’il admirait la musique de Bach et Mozart, qu’il évoque rapidement dans le cours Le Principe de Raison.
F : La nuit de l’errance
On trouve dans Ga 95 des remarques tout à fait originales sur la nuit. En effet, à l’exception de la remarque de la conférence « Qu’est-ce que la métaphysique ? » à propos de la « claire nuit du rien de l’angoisse », Heidegger en parle très peu, et caractérise la vérité comme Lichtung, donc comme une percée de lumière (Licht). C’est contre une telle approche, finalement classique, de la phénoménalité en termes de lumière que Levinas dans De l’existence à l’existant, puis Blanchot dans L’espace littéraire décrivent le phénomène de la nuit comme l’apparition de la dissimulation.
La question de la nuit est abordée en même temps que celle de l’errance (Irren), thème développé dans Besinnung dont la section XIX s’intitule justement « Die Irre », mais qui intervenait déjà très discrètement dans les Beiträge, et qui apparaît pour la première fois en 1930 dans la conférence « De l’essence de la vérité » (cf. VI. La non-vérité en tant qu’erroire). Le par. 72 qui, constitue à lui seule cette section XIX, dit clairement les choses. L’expérience de la pensée, quand elle a abandonné la fuite dans l’étantité de l’étant, devient une errance dans ce que Heidegger appelle « die Irre », c’est-à-dire le lieu ouvert où l’on erre, donc « l’erroire », ou encore « l’erre ». Il écrit : « Cet erroire est l’éclaircie elle-même (ouverture – vérité) de l’Être » (Ga 66, p. 259). L’erroire est l’apparition de la vérité de l’Être dans son propre déploiement. C’est dans l’erroire que se produit toute méprise dans l’explicitation de l’Être qui se refuse à l’explicitation. C’est que la vérité est toujours aussi non-vérité pour Heidegger. En tant qu’éclaircie et décèlement (Unverborgenheit), elle est aussi cèlement (Verbergung), elle est, c’est le leitmotiv des Beiträge, « éclaircie pour le se-céler », éclaircie du refus de l’Être. Cette pensée de l’erroire appartient à la pensée de la vérité de l’Être dès lors qu’est surmontée sa compréhension en termes d’exactitude de la représentation d’un étant par le subjectum. Penser, c’est, nous dit le par. 7 des Réflexions VII, « faire l’expérience de l’erroire de l’Être, plus riche et plus « étant » que toute exactitude de tout vécu de l’étant » (p. 22). Il y a là un déplacement par rapport à la conférence de 1930, car dans la section VI., où il faisait intervenir pour la première fois la question de l’errance, celle-ci était définie comme le comportement de l’homme qui fuit la vérité de l’Être pour se réfugier dans la réalité courante en sautant d’un objet à un autre, autrement dit était synonyme d’inauthenticité et de l’insistence dans l’étant. Parce que la vérité était ouverte dans l’authenticité comme ek-sistence résolue, la non-vérité comme errance ne pouvait que correspondre à l’insistence inauthentique, ce qui n’est plus le cas en 1938 où l’errance désigne dorénavant le mouvement même de la pensée de l’Être. Penser, c’est s’ouvrir à l’erroire comme éclaircie du refus de l’Être. Le par. 13 affirme que « l’erroire est l’offrande (Geschenk) la plus inapparente que nous offre la vérité – car c’est en lui qu’elle offre (verschenkt) l’essence de la vérité comme garde du refus (Verweigerung) » (p. 28). « Le refus comme dispensation de l’Être (Die Verweigerung als die Verschenkung des Seyns) », écrivait déjà Heidegger dans Ga 94 (p. 422). Heidegger ajoute que l’erroire ne peut être parcouru que dans l’errance, et ajoute « mais comme il est rare qu’il soit permis à quiconque d’« errer » de la sorte ! » (p. 28). Cela est réservé aux peu nombreux, les penseurs, et la pensée doit être caractérisée par sa « force d’errer » (p. 30), son « audace d’errer » (p. 221), sa « liberté d’errer » (p. 367). Errer, c’est questionner, et l’erroire est « erroire du questionnement » (p. 106). Ces peu nombreux, parce qu’ils errent dans l’erroire, sont caractérisés de manière inédite par Heidegger comme « les errants » (p. 47), et l’événement appropriant qui les approprie est cette « mutation à partir du déploiement de l’Être propre à mettre l’homme plus proprement en errance et par là aux abords de l’Être » (p. 106). Mais l’errance ne caractérise pas seulement les penseurs à venir, elle caractérise en fait tout penseur essentiel dans l’histoire de l’Être, de telle sorte que Heidegger peut définir l’histoire de la philosophie comme « une odyssée (Irrfahrt) dans laquelle il est fait expérience de l’erroire » (p. 235), et il a peut-être ici en tête l’odyssée d’Ulysse errant en mer Méditerranée.
C’est dans ce contexte qu’intervient la nuit pour décrire l’expérience de l’erroire. L’expérience du refus de l’Être est habituellement décrite par Heidegger, par exemple dans les Beiträge, comme expérience du rien. Au par. 2 des Réflexions X, il écrit que le rien apparaît comme « la première ombre de l’Être » (p. 282), la métaphore décrivant bien le rapport entre le rien et l’Être, à savoir que le rien est la trace que l’Être laisse en se retirant2 C’est cette ombre qu’est le rien, la « claire nuit du rien de l’angoisse » de 1929, qui intéresse Heidegger dans quelques paragraphes de Ga 95, la métaphore permettant de décrire l’erroire devenant « la nuit ». Au par. 37 des Réflexions VII, il écrit : « il faut que soit l’erroire qui s’amorce à partir des cœurs ardents errants et luit comme la nuit » (p. 47). Au par. 3 des Réflexions VIII, il évoque « la nuit de l’errance du questionnement » (p. 103). De ce point de vue l’autre commencement comme nouvelle dispensation de l’Être consisterait à faire « se lever le jour nouveau » (p. 47), ce qui suppose d’abord d’endurer la nuit comme nuit, donc l’Être comme refus, au lieu de demeurer dans l’indécision de l’histoire que Heidegger décrit comme un crépuscule où « on ne sait si c’est le crépuscule du soir ou l’aube d’un matin » (p. 47). Il est sans doute en discussion implicite avec Nietzsche qui décrit déjà dans Le Gai savoir, la mort de Dieu comme une nuit sans étoile, et le surmontement du nihilisme comme la possibilité d’une aube nouvelle. Parce que la nuit est le nom même de l’éclaircie de l’Être, Heidegger peut en conclure au par. 63 : « Alors la nuit ne serait pas la simple contrepartie du jour (…) mais la lumière elle-même en sa solitude – au cœur des ténèbres » (p. 73). Et p. 104 que « la nuit appartient à l’Être » et est un déploiement (Wesung) de l’Être.
G : Enquête historique et histoire de l’Être
Le thème qui court le plus largement et le plus longuement des cahiers VII à XI est celui du rapport entre Historie et Geschichte. Cette distinction n’est pas nouvelle chez Heidegger, elle est présente depuis les tous premiers cours des années vingt, et on la retrouve dans Être et temps qui veut retrouver, en-deçà de l’histoire mondiale dont l’Historie est l’étude, l’historialité du Dasein qui la rend possible. La distinction est reprise dans le cadre de la pensée de l’histoire de l’Être, où la Geschichte devient « histoire de l’Être », quand l’Historie devient l’enquête portant sur l’étant passé. Dès lors, l’Historie ne peut qu’être un recouvrement de l’histoire de l’Être : « L’Historie est la destruction pure et simple de la Geschichte – l’ensevelissement de la décision pour l’Être par l’occupation consacrée à l’étant passé » (p. 438). Elle appartient donc à l’oubli de l’Être, donc à la métaphysique, mais du même coup trouve son fondement dans l’histoire de l’Être elle-même (cf. Ga 66, p. 182 : « L’Historie se fonde dans la Geschichte »). C’est cette interprétation de l’enquête historique à partir de l’histoire de la métaphysique s’achevant dans le règne de la technique qu’accomplit Heidegger dans Ga 95, et parallèlement dans Besinnung, dont la section XII s’intitule « Historie und Technik » où le par. 64 du même titre renvoie p. 183 et 184 aux Réflexions VII et IX. Ces cahiers datent manifestement de la fin de l’année 1938 et du début de l’année 1939, donc sont contemporains du séminaire sur la seconde Considération inactuelle de Nietzsche qui porte sur l’utilité et les inconvénients de l’Historie pour la vie, à partir duquel Heidegger détermine l’homme contemporain comme « animal historique ». Prenant Historie au sens grec de l’istorein, de l’enquête et Technik au sens de la technè comme savoir se représenter et savoir produire, Heidegger affirme qu’histoire et technique sont finalement le même, sont deux visages des temps modernes et du règne de la Machenschaft qui produit l’étant (« la Machenschaft de l’étant (de l’histoire et de la technique) » (p. 242)), l’enquête historique étant la technique de production de l’étant passé et la technique étant l’histoire/enquête de la nature (« la technique comme enquête/histoire de la nature », p. 218), comme production de l’étant à venir. Le rapport de l’enquête historique à l’étant passé est le même que le rapport technique à l’étant présent, rapport à l’étant qui devient le seul dont est capable l’homme des temps modernes : « La technique entendue comme enquête/histoire de la nature devient la forme privilégiée de ce « savoir » de l’étant en général, elle s’empare également de l’enquête/histoire de l’histoire (du passé) et s’étend jusqu’à devenir la forme foncière de tout rapport à l’étant » (p. 142)3. Au par. 63 des Réflexions IX, il écrit que c’est dans « la mêmeté de la technique et de l’enquête historique [que] réside la raison pour laquelle l’homme, pour autant qu’il les a mis en œuvre et a fini par leur accorder la priorité » (p. 243), a laissé l’étant prédominer sur la vérité de l’Être. L’une comme l’autre trouvent leur fondement dans l’interprétation de l’étantité de l’étant comme présence constante productible et représentable, donc sont d’essence métaphysique. Au par. 37, Heidegger montre que si, dans la seconde inactuelle, Nietzsche voit dans l’enquête historique un inconvénient pour la vie en ce qu’elle réduirait à néant l’« atmosphère d’illusion (Illusionsstimmung) » (p. 217) nécessaire à toute création, lui réinterprète cet inconvénient à partir de sa propre compréhension de la Stimmung comme tonalité exposant en l’ouvert de l’Être, pour affirmer que l’enquête historique détruit les tonalités fondamentales en faisant de l’homme l’animal historique et en l’y enfermant (« l’histoire tient pour arrêtée l’essence de l’homme (entendu comme animal historique ») » (p. 260), conformément à la réduction de l’homme à lui-même, là où les tonalités fondamentales sont ce qui nous délogent de cette essence métaphysique de l’homme/animal. Au par. 70 des Réflexions X, Heidegger reconnaît à Nietzsche d’avoir compris à quel point l’Historie est une question essentielle aux temps modernes, mais lui reproche de n’être pas parvenu à la surmonter dans la Geschichte et d’avoir renforcé encore son rôle en la mettant au service de la vie.
I : Le jaillissement originaire de l’Être et la question de la parole
Dans ces cahiers de 1938-39, Heidegger retravaille le concept d’origine, d’Urpsrung, pour y trouver de quoi dire la mobilité même de l’Ereignis, comme il le fait parallèlement dans Besinnung. Il y écrit comme un leitmotiv, « das Seyn selbst als der Ur-sprung » (Ga 66, p. 53), das Seyn als Ur-sprung (Ga 66, p. 255), Das Seyn, das als Ur-sprung » (Ga 66, p. 254), « das Seyn selbst als Ur-sprung » (Ga 66, p. 282). C’est dans la section XVII, « L’histoire de l’Être », que Heidegger renvoie aux Réflexions X à propos de cette formule : « Seyn als Ur-sprung (Überlegungen X, 47 ff.) » (p. 224). Au par. 38 des Réflexions X, Heidegger demande si l’Être peut être expliqué comme cela est fait avec l’étant c’est-à-dire en le reconduisant à son origine, et il répond : « l’être ne se laisse expliquer par aucun étant – il n’« a » nulle part son origine (Ursprung,) vu que c’est lui-même l’origine (Ur-sprung) » (p. 311). Le tiret permet à Heidegger de rappeler le sens propre de l’origine comme jaillissement originaire, que Pascal David traduit par « bond initial » ou « prime-saut ». L’Être est le jaillissement originaire de l’éclaircie au sein de laquelle l’étant peut surgir (ent-springen), mais il précise que « surgir n’est pas provenir de… (Ent-springen ist kein Herkommen aus …) » (p. 311), l’Être n’étant pas un étant qui aurait le pouvoir de créer l’étant comme son effet. C’est la notion de trait (Riß), comme un coup de canif qui déchirerait l’obscurité et ferait jaillir la lumière, qu’utilise Heidegger pour dire le jaillissement originaire de l’éclaircie et la manière dont il permet à l’étant de surgir en se tenant en elle : « Le jaillissement originaire (Ur-sprung) est bien plutôt en sa surgie l’incision d’un trait, l’éclaircie » (p. 311), « Le jaillissement originaire comme trait commençant de l’éclaircie » (p. 312-313). Un tel jaillissement advient pour la pensée qui le laisse survenir, de telle sorte qu’il devient un commencement. Qu’il s’agisse là de penser la mobilité de l’Ereignis, Heidegger le signale un peu plus loin : « Ce « jaillissement » du « jaillissement originaire » – l’Être comme appropriation (Er-eignung) » (p. 313). Le par. 51 revient sur ce point et insiste : « Le commencement comme commencement de l’Être (de l’Être comme commencement), est jaillissement originaire, trait d’une déchirure dans l’abyssale mais en tant que telle encore inapparente éclaircie de laquelle seulement l’étant peut « être » comme entrant en présence – et se trouver recueilli par l’éclaircie. (…) l’Être comme jaillissement originaire est l’appropriement de l’homme dans l’assignation à la vérité de l’Être » (p. 332). On retrouve dans Besinnung cet insistance sur le trait de la déchirure pour dire ce qui se produit dans l’Ereignis, traité d’histoire de l’Être dans lequel Heidegger médite le Lichten de la Lichtung, l’« éclaircir », ou l’« éclairement », qui se produit avec l’éclaircie : « La vérité est l’éclaircie du refus, dans laquelle le refus et en tant que refus est jaillissement originaire – la déchirure de l’éclairement (der Auf-riß des Lichten » (Ga 66, p. 98), « Être comme jaillissement originaire (Réflexions X, p. 310 et ss.) est le trait éclaircissant, en lequel l’étant peut venir « se tenir », l’appropriation de l’homme dans l’assignation à la vérité de l’Être » (Ga 66, p. 224).
L’enjeu de cette pensée de l’origine, du jaillissement et du trait déchirant, est la manière dont Heidegger entend repenser l’essence de la parole, de la langue et du mot depuis sa pensée de l’Ereignis. La question était évoquée rapidement à la toute fin des Beiträge (par. 281 « Langue (son origine) »), qui fut rédigée en 1938, où il évoque « le trait le plus intime » (Ga 65, p. 510) pour décrire l’ouverture du lieu ouvert. C’est dans Besinnung, et parallèlement dans Réflexions X, que Heidegger retravaille cette question. Au par. 38, après avoir évoqué le jaillissement originaire et le trait déchirant, il écrit que « l’Être lui-même et lui seul – cette éclaircie – est mot » (p. 313) (cf. GA 66, p. 23 : « l’Être se déploie dans le mot et en tant que mot »). « Wort » est le mot qu’avance Heidegger pour penser le langage depuis l’Ereignis, ce terme pouvant signifier à la fois le mot au sens étroit, et un mot au sens large, au sens on l’on peut parler en français d’« écrire un mot » pour « écrire un parole », Heidegger conservant au mot Wort cette ambiguïté. Le par. 55 confirme : « Le mot – la Première Adresse de l’Être lui-même dans l’appropriation de l’être-homme (…). Le mot surgit du jaillissement originaire – et par là de l’Être lui-même, et l’homme n’est que le récepteur du mot » (p. 338). La suite du par. 38 ajoute que « le mot est en son essence le trait qui déchire de l’éclaircie, ce qui veut dire la résonance silencieuse de la déchirure de chaque trait de l’éclaircie, dont l’ouvert fonde toute « signification » et garantit au mot que l’on dit, s’il est dit à bon escient, d’ouvrir chaque fois l’Être » (p. 313), et encore que « chaque trait déchirant est le mot originaire lui-même » (p. 313). Il s’agit ici de repenser l’articulation entre le sens et la langue qui était pensé au par. 34 d’Être et temps, où le sens était toujours déjà (a priori) articulé discursivement dans la compréhension du monde, ce qui était le niveau du Rede, le discours, sens articulé qui était la signifiance (Bedeutsamkeit) au niveau de l’explicitation de l’étant en son « comme existential-herméneutique », qui rendait possible l’expression des significations dans telle ou telle langue déterminée, dans l’explicitation du « comme apophantique » dans l’énoncé. C’est cette compréhension transcendantale de la langue qui consiste à remonter à sa condition de possibilité a priori dans le Dasein, qui est ici surmontée dans la pensée de la langue depuis l’Ereignis. C’est l’Être comme jaillissement originaire et trait déchirant ouvrant l’éclaircie de la vérité qui est ce qui rend possible la langue, car l’éclaircie est d’emblée « mot », ce dernier est lui-même le trait déchirant de l’éclaircie fondant les significations linguistiques, mais cette condition de possibilité n’est plus a priori, elle est historiale, elle relève de l’histoire de l’Être, et ne se trouve plus en l’homme comme Dasein mais en l’Être lui-même comme Ereignis. Et c’est parce que l’Être est en-lui-même mot que l’homme peut dire l’Être, c’est la mission de la parole des poètes et des penseurs, et devenir ainsi gardien de la vérité de l’Être. Poètes et penseurs sont ceux qui soutiennent le « choc de l’Être (Stoß des Seyns) » et sont les récepteurs du mot pour devenir les nomothètes de leur langue. C’est donc par son appartenance à l’Être que l’homme est doué de parole, et c’est bien elle qui élève l’homme au-dessus de l’animal.
Dans ce par. 38, Heidegger retourne le reproche qui lui est fait d’élaborer une philosophie purement verbale, un pur jeu avec des significations. Un tel reproche se fonde sur la mécompréhension de l’essence du mot, qui est alors coupé de son appartenance à l’Être, cette essence étant la manière même dont l’Être ouvre son éclaircie par un trait déchirant. Heidegger peut alors utiliser la manière dont il recomprend la Machenschaft pour montrer comment c’est l’accomplissement de la métaphysique qui réduit la langue à n’être rien d’autre qu’un outil dans les mains de l’homme, animal rationale, c’est-à-dire qui a le logos/parole. C’est la réduction de l’homme à lui-même en animal historique qui fait du mot ce qui doit être expliqué psychologiquement et physiologiquement par la phonétique et la sémantique, Heidegger ayant manifestement en vue l’émergence de la linguistique au XXème siècle en tant qu’approche scientifique du langage. P. 295, Heidegger fait le même reproche à la philosophie analytique, et écrit p. 34 que l’usage de la langue qui a cours, l’utilisation quotidienne de la parole, n’est jamais ce qui oblige en premier lieu les penseurs, car l’usage galvaude les mots et provoque une déperdition du sens4, de sorte que pour Heidegger, les penseurs et poètes doivent « forger la langue avant qu’elle ne soit de nouveau galvaudée dans l’« usage » (p. 34)) (« Meaning is not use », pourrait dire Heidegger). Est intéressante la précision, dans le même par. 38, du fait que l’Être comme mot est in fine « indicible (unsagbar) » (p. 314). En effet, si l’Être est origine, jaillissement originaire du mot qui permet à l’homme, dans la langue, de nommer l’étant et d’en dire quelque chose, on ne peut dire avec le mot ce qui est toujours en deçà de tout mot comme son origine, on ne peut lui appliquer la logique, car cela reviendrait à vouloir dériver la source du courant qui s’écoule d’elle. La poésie institue l’Être, la pensée laisse venir l’Être à la pensée : « La parole (…) qui échappe à toute « logique », dont seuls possèdent l’art les poètes et les penseurs » (p. 295). Mais l’expérience fondamentale de l’Être dans la tonalité fondamentale est toujours silencieuse, raison pour laquelle Ga 94 et les Beiträge insistaient sur le faire-silence comme expérience fondamentale du silence de l’Être lui-même. Pour aller puiser à la source silencieuse de toute parole, il faut faire-silence, afin de pouvoir y saisir le mot originaire de l’Être. C’est manifestement dans ce paradoxe d’une remontée à la source de toute parole que trouve sa source l’extrême difficulté de la langue de Heidegger dans les traités d’histoire de l’Être et dans les cahiers noirs qui leur sont contemporains, qui s’efforcent avec des mots d’approcher l’indicible et l’au-delà de la logique : « pour le dire qui s’impose à elle [la pensée de l’histoire de l’Être], la langue jusqu’à présent usuelle est sans vigueur aucune » (p. 315). La tautologie fameuse d’Acheminement vers la parole, « la parole parle », est déjà présente dans ces textes, Heidegger écrivant que « la langue, comme profération du mot (c’est-à-dire de l’Être), parle à partir de la relation à l’étant, qui se rencontre déjà avec le mot qui n’est pas encore proféré » (p. 314). Ce que veut dire ici Heidegger, c’est que le mot originaire qu’est la déchirure de l’éclaircie fonde un rapport à l’étant avant même d’être explicitement proféré par l’homme dans sa langue, et rend possible une telle profération. Il écrit que c’est par la langue que les « mots » entendus au sens originaire comme traits déchirants de l’éclaircie, viennent aux mots, entendus en leur sens courant comme les mots qui appartiennent à telle ou telle langue déterminée. Mais en lui-même, le mot originaire est silencieux, et saisi dans la réserve silencieuse par les poètes et penseurs, le mot étant cette ouverture du sens dont le silence est rompu dans le dire qui le profère. Dans la pensée de l’histoire de l’Être, c’est l’Être comme « mot (Wort) » qui prend la place de ce que Être et temps appelait « discours (Rede) ». Dans Être et temps, c’était le discours qui était le fondement de la parole, maintenant, « le mot est fondement de la parole » (p. 239).
Conclusion
Le tome 95 de la Gesamtausgabe est donc un volume très riche, très important pour comprendre le rapport de Heidegger au nazisme et le développement de sa pensée de la Machenschaft. Le lecteur pourra y trouver aussi quelques textes originaux dans lesquels Heidegger parle de plusieurs auteurs qui ne sont pas ou peu cités ailleurs dans la Gesamtausgabe, comme Wagner, nous l’avons dit, mais aussi Pascal, Schopenhauer, Beethoven, Caspar David Friedrich, Rilke, Spengler, Jünger, Karl Barth, et même Lawrence d’Arabie. La traduction demeure dans l’ensemble lisible même si elle n’est pas toujours aussi précise qu’elle le devrait. On peut se féliciter de la rapidité de la traduction. Les deux premiers volumes de cahiers noirs étant parus simultanément, il reste à espérer que les volumes suivants (Ga 96, 97 et 98) puissent à leur tour paraître rapidement.
- Au par. 11 de Réflexions XI, Heidegger évoque les voyages en Grèce, Pascal David traduisant alors de manière pertinente et amusante « Hellas erleben » par « s’éclater en Grèce » (p. 371).
- cf. Ga 94, p. 439 de la trad. fr : « rien (ombre de l’Être) ». Et aussi p. 435 : « l’Être, plus étrange encore que le rien, qui le projette autour de lui comme son ombre la plus propre ».
- Cf. p. 355 : « L’Historie : technique de la « Geschichte »./ La technique : Historie de la nature ».
- L’idée n’est pas neuve chez Heidegger. Dès les premiers cours des années 20, la méthode de la destruction phénoménologique devait contrecarrer l’estompage (Verblassen) du sens dû à sa transmission traditionnelle des concepts philosophiques. Le bavardage tel qu’il est caractérisé dans le par. 35 d’Être et temps a le même effet, en redisant ce que « On » dit et en coupant ainsi les mots de la source (le sol phénoménal de l’expérience) à laquelle ils ont été puisés.








