Marlène Zarader est professeur de philosophie à l’université Paul Valery de Montpellier. Elle est l’auteur de nombreux livres de philosophie consacrés à l’étude d’un auteur, le plus souvent Heidegger[voir notre recension de son Lire Être et temps de Heidegger [ici et là [/efn_note], mais aussi Blanchot.
La première originalité de ce Lequel suis-je ?1 est qu’il n’en va pas ainsi : l’ouvrage n’est pas consacré à un auteur, il est consacré à un problème que l’auteur entend traiter de manière très personnelle. Ce trait apparait clairement dans le fait que l’ouvrage est intégralement écrit à la première personne du singulier et que Marlène Zarader n’hésite pas à s’appuyer sur sa propre vie, évoquant des discussions avec des amis2, ou bien racontant la manière dont elle a trouvé un exemplaire de L’étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde au marché aux livres de la ville où elle réside3
Le titre de l’ouvrage est au premier abord énigmatique. Il s’agit d’une question demandant « lequel suis-je ? » donc qui est subordonnée à la question de savoir qui je suis, la question « qui suis-je ? ». Le titre présuppose un sujet qui fait face à une multiplicité de personnages et tente de discriminer le vrai du faux, le réel de l’irréel. C’est ici l’identité personnelle qui est comme morcelée, qui est devenue problématique, d’où le sous-titre « variations sur l’identité ».
A : Justification méthodologique
Le livre s’ouvre sur une introduction dont l’enjeu est méthodologique : il s’agit d’y justifier la démarche qui consiste à faire appel à des figures tirées de la littérature, donc relevant de l’imaginaire, pour en dégager la réponse à un problème qui, lui, concerne le réel. A l’objection selon laquelle les figures étudiées relèvent de l’imaginaire, et ne sont donc pas pertinente pour penser le réel, l’auteur répond par la notion de figure. A travers des œuvres très diverses, on retrouve sans cesse une figure, un motif récurrent, et cette récurrence témoigne d’une nécessité qui nous fait approcher quelque chose de bien réel. Le motif récurrent que va dégager l’auteur est celui d’une identité double, mais où les deux pôles ne sont pas celui d’un moi réel et d’un moi irréel, ils coexistent simultanément.
La méthode pour traiter la question « lequel suis-je ? » consiste en « une double perspective » (p.15). D’abord, l’analyse des figures, ensuite leur configuration. Marlène Zarader reprend cette méthode à Jacques Le Brun, dans son livre sur le pur amour. Les figures, ce sont les exemples analysés, ce sont des images parlantes qui ont besoin d’être interprétée pour livrer leur vérité. Réunissant des figures, nous dessinons alors une configuration, et le second moment de la méthode consiste à interroger cette configuration afin de dégager l’énigme répétée dont elle témoigne.
Avant de commencer, l’auteur répond à une dernière objection : les cas de fragmentation de l’identité que sont les figures seraient pathologiques, et donc relèveraient de la psychiatrie. La réponse à cette objection est simple : l’approche clinique de ce problème d’identité scindée est légitime, mais il n’est « qu’un point de vue parmi d’autres, non la vérité de ces phénomènes » (p. 18).
Après cette introduction, l’auteur passe à l’examen des figures en sept temps.
B : Utilisation de nouvelles littéraires
Le premier s’appuie sur des nouvelles de Cortázar réunies dans Les armes secrètes. La première nouvelle qui retient l’attention de Marlène Zarader s’intitule « La nuit face au ciel ». Elle raconte l’histoire d’un homme qui a un accident de moto et perd conscience. Reprenant ses esprits, il voit qu’il est à l’hôpital et qu’on le soigne. Il est très fatigué et s’endort. Il rêve alors qu’il est un guerrier motèque poursuivis par des aztèques qui veulent le sacrifier dans un de leur temple. Il se réveille et retrouve l’atmosphère rassurante de l’hôpital. S’ensuit une alternance entre la réalité de l’hôpital et le rêve du guerrier motèque jusqu’à ce qu’il rêve que le guerrier motèque soit capturé et enchainé, voyant le sacrificateur qui vient vers lui avec son couteau de pierre sanglant. Le rêve devient ici cauchemar et l’homme fait un effort pour se réveiller et retrouver l’atmosphère bienfaisante de l’hôpital. Il parvient à se réveiller, mais ce qu’il découvre avec horreur, c’est qu’il est allongé sur le dos, le visage face au ciel étoilé, et que le sacrificateur s’approche de lui. On comprend alors que le rêve c’était l’autre, c’était l’accident de moto et l’hôpital. On a donc une alternance entre deux personnages et une question, « lequel suis-je ? », lequel est le réel, lequel est le rêve. Marlène Zarader n’y fait pas référence, mais la situation décrite par la nouvelle nous fait penser à Tchouang Tchéou qui rêve qu’il est un papillon, qui se réveille, puis se demande s’il est Tchouang Tchéou ayant rêvé qu’il est un papillon ou bien s’il est un papillon qui rêve qu’il est Tchouang Tchéou.
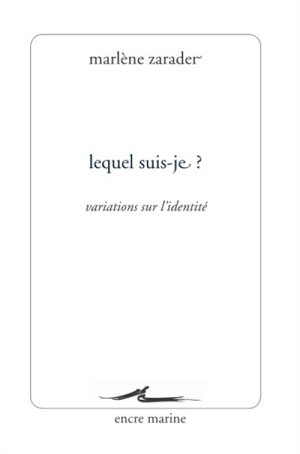
Deux nouvelles font ensuite l’objet d’une analyse, « axolotl » et « la lointaine », pour dégager un motif commun un peu différent de celui de la nouvelle précédente. Ici, il n’y a pas d’alternance entre deux personnages, mais un passage de l’un dans l’autre, une substitution : « dans ces échanges compassionnels, un être pénètre si profondément dans l’intimité d’un autre qu’il finit par prendre sa place » (p. 27). Un visiteur du jardin des plantes est fasciné par la contemplation d’un aquarium dans lequel se tiennent des axolotls. Il fait tellement preuve d’empathie qu’il finit par devenir lui-même un axolotl et voit le visage humain qui le contemple être délivré de la fascination et partir. Alina Reyes est une jeune femme hantée par l’image d’une femme misérable vivant à Budapest. Elle convainc son mari de faire leur voyage de noces à Budapest. Arrivé sur place, elle reconnaît les lieux et trouve cette femme misérable. Elles s’étreignent toutes deux, et au sortir de l’étreinte, elle est devenue cette mendiante qui voit Alina Reyes s’éloigner.
Le second temps, et donc la seconde figure, est trouvé dans une nouvelle de Borges, « Les ruines circulaires », dans Fictions. Un homme veut en créer un autre par la seule puissance du rêve. Il rêve un homme avec un tel souci des détails qu’il parvient à l’imposer à la réalité. Il rêve ainsi dans un temple abandonné où le dieu du feu l’aide à donner vie à son homme rêvé. Mais un jour, le feu détruit son temple, et il décide de ne pas fuir, de se laisser consumer. Il découvre alors que les flammes ne l’atteignent pas, ce qui est le signe que lui-même est un simulacre, non un homme réel. Le rêveur était lui-même rêvé. Le créateur se découvre lui-même être la créature d’un autre homme, il découvre que « nous sommes tous des simulacres n’ayant que l’illusion de la consistance » (p. 33).
C : Entre psychiatrie et littérature
Le troisième temps, la troisième figure, n’est plus une figure littéraire, c’est un cas réel que l’auteur emprunte à la psychiatrie. Il s’agit du cas Félida X, rapporté par son médecin, Eugène Azam, à la fin du XIXème siècle. Félida possède deux états aux caractéristiques différentes, et « le trouble consistait dans le passage d’un état premier (dénommé « état normal ») à un état second » (p. 37). L’état dit normal consiste à être apathique, morose, douloureux et aussi à perdre la mémoire. L’état second, dit « de crise », consiste à être gaie, active et sociable, avec une mémoire qui fonctionne. L’état second est donc supérieur à l’état normal, c’est seulement en lui que Félida est heureuse. Dans l’état premier, elle ne conserve aucun souvenir de ce qui s’est passé en état second. L’évolution de sa pathologie consiste en cela que l’état second, d’abord rare, devient peu à peu son état permanent.
Marlène Zarader effectue une lecture et une critique de l’interprétation de ce cas par Eugène Azam. Ce dernier est persuadé que l’état premier est l’état normal, et que l’état second est un état de crise, même s’il est plus riche. La retombée dans l’apathie et l’amnésie est pensée comme une guérison, ce qui est paradoxal. Marlène Zarader voit là une « singulière inversion de ce qu’on aurait pu tenir pour la conclusion de bon sens (à savoir que l’état normal est celui où la patiente est en pleine possession de ces facultés, tandis que l’état morbide se caractériserait par l’amnésie) » (p. 42). Ce cas témoigne d’une fissure dans l’identité personnelle entre deux états, l’un normal, l’autre pathologique, l’un véritable, l’autre une apparence, sans que l’on arrive à savoir lequel est un simulacre, lequel est réel. Le médecin tranche en faveur de l’état premier. Marlène Zarader préfère ne pas trancher et dire qu’aucun n’était plus vrai que l’autre.
Le quatrième temps, la quatrième figure, est de nouveau un personnage littéraire, à savoir le prince Mychkine dans L’Idiot de Dostoïevski, qui est victime de crises d’épilepsie. Le débat qu’entretien Dostoïevski porte sur l’aura fugace qui précède immédiatement la crise. Il s’agit là d’un état de plénitude, de bonheur. Toute la question est alors de savoir s’il s’agit d’une hallucination, à la manière du rêve ou des illusions que font voir les drogues. Pour Dostoïevski, cet état n’est pas illusoire, il donne accès non à une hallucination mais à une vision, et à ce titre il est un état supérieur à l’état normal. On retrouve ici la même hésitation que dans les figures précédente : il s’agit de « la question de savoir lequel des deux pôles est réel, et lequel est illusoire » (p. 56).
Le cinquième temps, la cinquième figure est le docteur Jekyll dans le livre de Stevenson, L’Etrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde. Il s’agit d’un savant qui joue à l’apprenti-sorcier en décidant de se scinder, à partir de son être antérieur, en deux êtres purifiés parfaitement antagonistes. Son être lui apparaît comme un composé, et cette composition comme la source du malheur de l’homme. La double nature est une torture, de sorte que la séparation doit être un apaisement. Il parvient à les séparer grâce à un breuvage de son invention, et ce faisant il crée un nouvel être, Hyde. Dès lors, il y a deux être opposés en tout. D’abord, Jekyll, qui représente le bon côté : il est d’apparence agréable, raisonnable, philanthrope. Ensuite Hyde, qui représente le mauvais côté : il est difforme, asocial et fondamentalement malfaisant. Le docteur pensait trouver l’apaisement, il découvre au contraire que sa métamorphose en Hyde cesse d’être volontaire et que la personnalité de Hyde va irrévocablement prendre sa place, destin auquel il ne pourra échapper que par la mort.
Marlène Zarader passe alors à l’interprétation de cette dualité en exposant d’abord celle de Jekyll qui consiste à affirmer que « la dualité dont il est question est celle du Bien et du Mal » (p. 62). Cette interprétation morale, la plus évidente, Marlène Zarader souhaite la dépasser vers une interprétation ontologique. Cette dualité n’est pas seulement l’opposition entre bien et mal, c’est, en deçà, le fait que l’homme en tant que tel est un être multiple, divisé, qui est plusieurs en un seul être. C’est la dualité comme telle qui vient au premier plan, l’opposition de Jekyll à Hyde n’étant que la dimension morale de cette dualité. Il s’agit alors de la dualité de la vie et de la mort au sein de chaque homme. Marlène Zarader voit ici une dualité analogue au combat d’Eros et de Thanatos chez Freud : « la lutte de deux forces antagonistes, un déchirement entre deux désirs, l’un qui ouvre sur la vie, son mouvement et ses risques, l’autre qui n’aspire qu’au grand sommeil de la mort » (p. 71).
Le sixième temps, la sixième figure, consiste en une interprétation de Sueurs froide de Boileau-Narcejac et Vertigo, le film de Hitchcock. En vérité, il est très peu fait référence au film, et c’est bien au roman que va la préférence de Marlène Zarader. Ce qui l’intéresse ici, c’est le personnage féminin, marquée par une double personnalité. Elle est d’abord Madeleine, elle meurt, puis réapparait sous le nom de Renée. La dualité se complexifie en cela que Madeleine est déjà double, car elle s’imagine être son ancêtre, Pauline Lagerlac. C’est une dualité entre un côté lumineux, tourné vers la vie, et un côté nocturne, morbide, tourné vers la mort, qui la rend froide et incapable de se passionner pour quoi que ce soit. L’autre dualité, c’est celle de Renée, qui d’abord ne veut rien savoir de Madeleine, puis se laisse progressivement transformer en Madeleine par le héros du livre, Flavières, pour mieux pouvoir lui plaire. Il se produit dans le roman un renversement analogue à celui de « La nuit face au ciel », où l’on découvre que ce qu’on a pris pour le rêve est la réalité et ce qu’on a pris pour la réalité n’est qu’un rêve. Ici, c’est Madeleine qui semble être la vraie femme, et Renée un simple rôle. Ce n’est qu’au terme du roman que l’on comprend que « c’est bien Renée qui a « rêvé » Madeleine, qui lui a donné corps (un corps illusoire) et qui a tenté de faire passer cette ombre pour la réalité » (p. 80).
Le septième temps, la septième et dernière figure, est celle de Michel B., personnage dont on a raconté l’histoire à l’auteur. Michel B. est romancier et essayiste. Son histoire se déroule comme un drame en trois actes. Le premier acte, c’est celui d’une grande souffrance dont il ressort exténué. Il est alors sur une pente dépressive, celle d’un sentiment d’usure, d’épuisement de ses ressources. Il se sent éteint. Michel B. décrit cela comme la perte de l’âme. Cette dernière n’est pas à prendre en un sens théologique, mais comme un principe d’animation. Elle est aussi mortelle que le corps et peut même mourir avant lui, et c’est bien ce qui arrive à Michel B. : « il avait l’impression d’avoir perdu son âme » (p. 86). Le deuxième acte est celui de l’apparition de la dualité, événement qui le plonge dans la stupeur et qu’il a du mal à raconter. Michel B. suit une psychothérapie et se rend compte que celui qui parle dans la thérapie n’est pas lui, n’est pas cet homme épuisé, car il est gai, léger, plein d’humour, déborde de vitalité. Il ne sait alors plus du tout qui il est entre ces deux êtres si différents. Ce qu’il découvre, c’est la puissance de la parole : même lorsqu’il veut dire l’obscurité, l’épuisement et la mort, c’est-à-dire la vérité du premier Michel B., la parole est porteuse de lumière, elle le reconduit à la vie. Alors survient le troisième acte : il perd la parole, n’arrive plus à écrire son livre. Le cas Michel B. est donc celui d’un homme qui « a expérimenté deux identités, les a reconnues comme antagonistes et a fait de cet antagonisme une question » (p. 93).
D : Une conclusion analytique
Après avoir dégagé et analysé des figures, il s’agit, conformément à la méthode présentée en introduction, d’en dégager la configuration. C’est ce à quoi s’atèle l’auteur en conclusion. La démarche interprétative consiste à se laisser éclairer par ces figures, et cela n’est possible qu’à quatre conditions. D’abord, se défier des réponses toutes faites, car il ne s’agit pas de renvoyer les figures à une interprétation déjà donnée mais à se laisser dicter par elle une interprétation neuve. En second lieu, il ne faudra pas viser une explication d’ensemble, il faudra plutôt procéder par touches brèves proposant quelques aperçus fructueux. Ensuite, ne pas chercher une interprétation trop générale rn se concentrant sur une seule question. Enfin, il ne faut solliciter que les concepts nécessaires à l’éclairement de cette question. C’est là, nous dit Marlène Zarader, un projet modeste, ce que montre aussi le titre donné à cette conclusion, à savoir une esquisse de configuration.
Le premier temps de la conclusion s’efforce de formuler la question. Son problème est d’abord celui de l’unicité du moi, puisque les figures étudiées présentent à chaque fois des personnages qui sont divisés entre deux identités distinctes dont aucune n’a de prévalence. Mais le problème est plus vaste, car les deux pôles ne sont pas seulement distincts, ils sont antagonistes : « ces figures présentent des identités divisées, dont les deux pôles sont antagonistes » (p. 101). La question peut alors être posée : « n’y a-t-il pas, dans l’identité comme telle, au moins la tentation de l’antagonisme, tentation qui ne serait résorbée que par un acte second, toujours précaire et fragile ? Et, si tel était le cas, quel pourrait être le fondement d’un tel antagonisme ? » (p. 102).
Le deuxième temps de la conclusion demande de quels instruments théoriques, c’est-à-dire de quels concepts, avons-nous besoin pour répondre à la question. Marlène Zarader en trouve deux : l’identification et l’identité narrative. L’identification d’abord, est un concept qu’elle emprunte à la psychanalyse et qui tente de dire comment l’identité se constitue comme une construction progressive. L’identification procède par intériorisation de certain objet, par exemple les parents. Elle n’est pas unique, elle procède selon une série d’identifications qui sont multiples et peuvent être conflictuelles. L’identité narrative ensuite, est un concept qu’elle emprunte à Paul Ricoeur et qui tente de réintroduire le temps et l’histoire dans l’identité personnelle. L’histoire est réintroduite sous la forme du récit, qui donne cohérence et unité à la série des événements d’une vie. L’identité se constitue par le récit. Le trait commun à ces deux concepts est qu’ils permettent de penser une identité plurielle où les identifications et les récits sont multiples et peuvent se combattre.
Le troisième temps de la conclusion s’efforce d’avancer une hypothèse, car le concept d’identité narrative ne permet pas encore d’expliquer la dualité des identités et leur antagonisme que l’on retrouve dans chaque figure. L’hypothèse est la suivante : « la dualité rencontrée n’est pas un simple fait que l’on pourrait se contenter de décrire, elle résulte d’un combat que les personnalités divisées permettent de mieux appréhender, mais qui est sans doute sous-jacent à toute identité. Celles que l’on tient pour « normales » n’en sont nullement exemptées » (pp. 110-111). Marlène Zarader doit alors analyser le combat en question en en dégageant les protagonistes : il s’agit de deux forces primordiales, l’une de vie, qui nous tourne vers les projets et les possibilités de la vie, l’autre de mort, qui veut le retour du vivant à un en-deçà de la vie qui est la mort. C’est cette dualité que Marlène Zarader trouvait chez Stevenson dans l’opposition de Jekyll à Hyde.
On ne peut s’empêcher ici de penser à Freud, celui de la seconde topique, qui trace une frontière parmi les pulsion entre ce qui relève d’Eros, la pulsion de vie , et ce qui relève de Thanatos, la pulsion de mort. L’auteur reconnait bien volontiers cette dette, mais entend effectuer un déplacement, car le combat est pour Freud un caractère essentiel, non seulement du psychisme, mais de toute vie, alors que Marlène Zarader entend ce combat dans une perspective qui relève d’une « ontologie de l’existence » (p. 111), et c’est ici implicitement à Heidegger qu’il est fait référence, le Heidegger qui élabore dans Être et temps une analytique existentiale. Le déplacement par rapport à Freud consiste donc à passer de la vie à l’existence : « ces forces que Freud nommait pulsionnelles, et qu’il supposait à l’œuvre dans la vie – parce que son modèle était biologique – je propose de les reconnaître dans l’existence » (p. 112). Pour justifier un tel déplacement, Marlène Zarader renvoie à la psychiatrie existentielle, la Daseinsanalyse, qui aurait déjà effectué un tel déplacement en entendant l’existence comme être-au-monde, comme transcendance. Elle peut alors revenir sur le combat entre les deux puissances, l’une de vie, l’autre de mort, pour dire qu’il est caractéristique de l’être-au-monde comme tel, et doit donc être tenu pour un existential, au sens où l’entend Heidegger, à savoir une détermination de l’existence. C’est là une suggestion tout à fait stimulante, mais nous restons sur notre faim car elle n’est guère développée, alors qu’on aimerait voir comment ce combat peut avoir une place dans l’analytique existentiale et comment il se rapporte aux autres existentiaux, comment aussi il pourrait coïncider ou pas avec la dualité que Heidegger met au jour dans Être et temps, à savoir celle du projet et de l’être-jeté.
Le quatrième et dernier temps de la conclusion peut alors effectuer une relecture des figures à l’aune de l’hypothèse d’un combat comme structure de l’existence, afin de montrer la légitimité de ladite hypothèse. On en voit la pertinence de la manière la plus nette chez Stevenson, dans le combat de Jekyll contre Hyde, mais Marlène Zarader le retrouve aussi dans les personnages des nouvelles de Cortázar qui sont comme appelé par la nuit, par un côté obscure d’eux-mêmes, à savoir le guerrier motèque, les axolotls et la mendiante. On retrouve cette structure chez la Madeleine de Sueurs froides ainsi que dans la manière dont Félida s’effraie de sa scission en deux états antagonistes. Dans chaque cas, les cas paradoxaux sont porteurs d’une vérité, à savoir que la division dont ils témoignent est le résultat de combat de la vie contre la mort. Le cas Michel B. fait l’objet de la dernière relecture : il témoigne du rôle de la parole qui instaure une face lumineuse dans l’acte même par lequel il s’efforçait de dire sa face obscure, et Marlène Zarader renvoie à la nuit chez Blanchot et à l’interprétation qu’elle en donne dans son livre L’Être et le neutre. A partir de Maurice Blanchot : « le langage ne peut pas dire ce qui se dérobe à l’être et à la vie , il ne peut pas dire ce que Blanchot nommait la « nuit » » (p. 122). La référence à Blanchot nous semble particulièrement pertinente ici mais elle n’est malheureusement pas développée. Elle aurait pu l’être en retrouvant chez Blanchot ce combat de la vie et de la mort, dans la mesure où l’existence telle que la décrit Blanchot est foncièrement double, et c’est la dualité du possible et de l’impossible, de la mort comme négativité et du mourir interminable, du temps et de l’absence de temps, de la première et de la seconde nuit, de la première et de la seconde version de l’imaginaire, etc. Marlène Zarader intitule sa conclusion « esquisse de configuration », et c’est sans doute à ce statut d’esquisse qu’il faut renvoyer cette absence de développement.
Concluons en affirmant que Lequel suis-je ? est un petit ouvrage aux idées stimulantes, mais dont la conclusion nous laisse quelque peu sur notre faim.
- Marlène Zarader, Lequel suis-je ? Variations sur l’identité, Paris, les Belles Lettres, 2015
- cf. p 83 : « Il s’agit d’un témoignage oral, au demeurant très indirect. Il m’a été rapporté par un ami magistrat, Jean-Marie Baudoin. »
- cf. p. 57 : « Le dernier samedi de chaque mois, dans la ville où je réside, se tient un « marché aux livres », où je flâne volontiers. C’est ainsi que je me retrouvai à feuilleter une assez belle édition, agrémentée de gravures, de Docteur Jekyll et M. Hyde. »








