L’ouvrage Le don des philosophes, Repenser la réciprocité (Paris, Seuil, 2012) du philosophe et anthropologue Marcel Hénaff a récemment fait l’objet d’une recension de Frédéric Porcher sur ce site. Notre collègue en a remarquablement présenté le projet essentiel. Proposer un regard croisé, c’est néanmoins tenter d’en approfondir quelques points ciblés, c’est surtout insister sur la sortie d’un ouvrage fondamental sur la question du don et de la réciprocité.
La dilapidation phénoménologique
L’un des nombreux attraits de l’ouvrage est sa critique en creux de la phénoménologie française. La plupart des auteurs directement discutés dans Le Don des philosophes appartient en effet à la grande mouvance phénoménologique. C’est évidemment le cas de Derrida, Lévinas, Marion et Ricœur qui font chacun l’objet d’un chapitre distinct. Une mouvance dont il faut cependant rappeler qu’elle a des limites. Si « Lefort s’inspire en grande partie de la phénoménologie de Merleau-Ponty », comme le repère à juste titre Frédéric Porcher, il ne nous semble pas que cette dette s’exprime particulièrement dans ses textes sur Mauss et le don rituel. Quant à Descombes, ne pas le considérer comme un théoricien de l’intersubjectivité, à tout le moins des « rapports intersubjectifs », comme le fait notre collègue, autorise justement M. H. à privilégier chez lui un intérêt pour la relation sociale comme radicalement différente des rapports intersubjectifs. Bien qu’ils prêtent l’un comme l’autre le flanc à une discussion serrée dans le septième chapitre de l’ouvrage, le détour par Lefort et Descombes aide par conséquent l’A. à « problématiser de manière plus précise les rapports que peuvent entretenir philosophie et anthropologie sociale et de le faire sous l’angle des échanges de don » (p. 233) ; ce qui s’avérait justement impossible avec les auteurs issus de la tradition phénoménologique.
Car une partie de l’enjeu est bien là. L’A. démontre de manière convaincante comment s’est fait jour en France un héritage particulier de la pensée de la donation (Gegebenheit) ou du donner (Geben) sans que le sens investi ne corresponde plus au sens précis qu’il recouvrait chez Husserl et chez Heidegger. Un glissement dont l’A. montre qu’il ne repose en fait que sur une simple succession de « paralogismes ». « Entre, d’une part, la donation telle qu’elle peut être pensée à partir de l’approche husserlienne et dépassée vers une radicalité nouvelle et, d’autre part, le don comme le geste par lequel un donateur gratifie un bénéficiaire, y a-t-il autre chose, se demande Marion, qu’une simple paronymie ? ». Pour M. H., c’est pousser un peu « loin l’exigence du doute car il y a bien parenté lexicale ; mais celle-ci vaut-elle la peine d’engager une interrogation philosophique » (p. 170) ? Or les héritiers français de la phénoménologie allemande vont s’engouffrer sans réserve dans cette parenté lexicale pour opérer un glissement – jamais justifié – de la donation du phénomène au don entre personnes, autrement dit entre deux domaines incommensurables qui ne présupposent en aucun cas la continuité d’un champ problématique, usant d’une « naïveté linguistique » que Jocelyn Benoist leur avait déjà objectée. Une naïveté linguistique qu’ils poursuivront du reste avec une même ferveur lorsqu’il s’agira de commenter l’essai maussien à l’aune de leurs hypothèses phénoménologiques. Rappelons cette amusante considération derridienne : « L’Essai sur le don se complique lui-même, se prend à sa propre complication interne : se donnant pour un essai sur le don, il est aussi un essai sur le prendre. Bien qu’il se donne comme et pour un essai sur le don, il peut se prendre comme un essai sur le prendre. Ou encore : bien qu’il se prenne pour un essai sur le don, il se donne en fait, en vérité, comme un essai sur le prendre. On ne sait s’il faut le prendre pour ce pour quoi il se prend ou comme il se donne, ou ce qu’il se donne dès lors qu’il donne à penser ou à lire, c’est que donner doit être équivalent à prendre. Ce qui ne veut pas dire que ‘‘se prendre pour’’ et ‘‘se donner pour’’ reviennent au même »1. Pour M. H., « le lecteur sur-pris décidera si tout cela est à prendre ou à laisser. Et, son choix fait, verra bien ce que ça donne… » (p. 48).
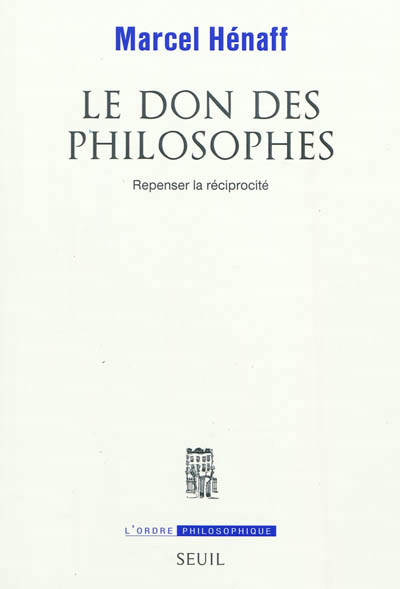
Il ne s’agit pas seulement pour nos phénoménologues français de réduire par ce biais leur objet d’étude au seul don gratuit. Bref, au don oblatif. Mieux, « pur ». (Un héritage philosophique dont on conviendra qu’il est relativement maigre au regard de la richesse anthropologique de l’essai maussien et particulièrement unilatéral face à l’articulation trilogique du don cérémoniel : donner, recevoir, rendre). Il s’agit également de jeter le soupçon vis-à-vis des pratiques historiquement situées parmi lesquelles M. H. distingue soigneusement ce qui relève du don cérémoniel, des dons gracieux ou solidaires, recadrant les propres hésitations de Mauss devant l’obligation de rendre qu’il constatait dans les faits étudiés. Or, à suivre les auteurs commentés, il n’y a même plus d’hésitation qui tienne : dans le don cérémoniel, il ne faut voir qu’un prêté pour un rendu. Pire, il faut déjà dénoncer l’amorce du commerce. Seule la vertu évangélique d’une main gauche ignorant ce que donne la droite semble digne d’être considérée comme un don 2. Cela paraît manifestement évident pour Marion : « Le don pour qu’il se donne, doit se perdre et rester perdu sans retour » 3. Et tout aussi certain pour Derrida : « La simple intention de donner, en tant qu’elle porte le sens intentionnel du don, suffit à se payer en retour » 4. Mais les interminables jeux de mots autour du « es gibt » allemand, qui se piquent d’être autant d’assises phénoménologiques alors même que les analyses linguistiques invitent sans réserve à le traduire par « il y a », ont une conséquence plus décisive encore : « si tout don – tout geste de don – est à comprendre à partir de ce ‘‘ça donne’’ qui ne donne aucun étant, alors en effet il ne saurait être question de donner quoi que ce soit » (p. 30).
Face à ce choix interprétatif restrictif, M. H. entend donc, redisons-le, s’en tenir à l’exigence épistémologique propre à l’analyse des faits ethnographiques et rappelle la positivité anthropologique du don et ses pratiques historiquement situées dont découlent l’hétérogénéité des ordres du don. « Le fait que les sciences sociales – ou humaines – restent largement, et probablement resteront, des sciences de l’interprétation ne signifie pas qu’elles soient affaire de simple opinion, fût-elle philosophique. L’interprétation doit se développer sur la base de faits attestés au mieux dans l’état des savoirs existants et discutés avec la précision que requiert toute enquête digne de ce nom » (p. 22-23).
On ne peut dès lors que comprendre l’exclusivisme intellectuel que la tradition phénoménologique affiche lorsqu’on lit, par exemple chez Marion, que « le don ne doit rien à un modèle social et anthropologique quelconque » 5. Et comment le contester, comme le reconnaît volontiers M. H., « s’il s’agit de la donation du phénomène au sens husserlien ou du don de l’être au sens heideggérien, et pourrait encore se soutenir pour un don auquel se déciderait tel ou tel individu animé d’un mouvement propre de générosité ». Mais l’affirmation n’est franchement pas défendable si l’on parle du don cérémoniel qui concerne la formation du lien social, les échanges matrimoniaux, les alliances. « Plus encore, ajoute M. H., il faudrait dans ce cas inverser la proposition et affirmer sans ambages : le don cérémoniel ne doit rien à un quelconque modèle phénoménologique de la donation. En d’autres termes, le passage d’une analyse de la donation du phénomène (qui est un choix interprétatif possible quant à l’appréhension de son mode d’être) à une analyse du don comme pratique sociale et même comme geste privé est une décision théorique périlleuse – voire arbitraire – qui tend à se méprendre sur la nature spécifique des faits sociaux, puisqu’elle les ramène implicitement à des pratiques individuelles, immotivées et décontextualisées » (pp. 184-185).
À force de réduire, à chercher toujours davantage de réduction pour viser davantage de donation, les phénoménologues finissent en effet par ne plus rien voir du tout, en tout cas par occulter complètement les ordres hétérogènes du don. À exciter l’opposition entre oblativité et réciprocité, à biffer la dimension sociale du don, à soumettre le don à la donation, ils en arrivent à définir un don qui n’a « aucun sens pour l’anthropologue » (p. 317). Un don qui n’est, en définitive, le « don de personne » (p. 316) et, serait-on tenté d’ajouter, « pour personne ».
Cette formule de Derrida suffit pour s’en convaincre : « L’énigme se concentre à la fois dans le ‘‘il’’ ou plutôt le ‘‘es’’, le ‘‘ça’’ de ‘‘ça donne’’ qui n’est pas une chose, et dans ce don qui donne mais sans rien donner et sans que personne ne donne rien – rien que l’être et du temps » 7 » (M. Hénaff, Le Don des philosophes, op. cit., p. 27).[/efn_note]. Marion, de son côté, entend bien exercer « sa vigilance critique contre toute tentation de nommer un ‘‘acteur ontique’’ ou une transcendance personnelle » (p. 167) derrière le « ça » de « ça donne ». Et pourtant, la donation « qui opère [chez lui] comme non-figure semble constamment tentée de devenir personnage. Les verbes qui la qualifient frôlent l’hypostase allégorique » (pp. 169-170). Cette non-figure doit rester dans l’anonymat, mais Marion explique en même temps que « la mise en scène du phénomène se joue comme la remise d’un don » 8 dont nous serions les bénéficiaires. Comme s’étonner que l’A. « demande à voir » puisque « le régisseur déjà nous attend »…
S’agit-il d’une forme subtile de réplique du Tournant théologique de la phénoménologie française développé par Dominique Janicaud ? M. H. n’entre pas explicitement dans cette discussion, mais il affleure de ses analyses que cette pensée française de la donation ne va pas sans l’arrière-fond d’une position religieuse. Certes, celle-ci ne prend pas toujours la forme d’une adhésion religieuse comme chez Marion ou Henry, mais elle se développe souvent à partir d’emprunts à la tradition religieuse comme chez Derrida ou Lévinas. Si ce dernier auteur, pour en dire aussi un mot, ne parle évidemment pas de « don pur », il reste qu’il met en avant le « don qui coûte » qui relève lui aussi du don solidaire : « s’arracher le pain de la bouche » ; « soutenir la veuve et l’orphelin »… Seul Ricœur, comme l’a déjà expliqué Frédéric Porcher, fait exception en évitant « toute interférence de sa réflexion philosophique avec ses positions religieuses » (p. 15). D’une manière plus générale, l’A. constate en tout cas la « propension à privilégier l’acception consacrée par une longue tradition religieuse et morale qui, en raison même de sa stabilité, semble relever du bon sens et tend à être considérée comme norme d’évaluation des autres formes de don. Cette acception est celle du geste généreux sans contrepartie. Ce régime d’oblativité rend possible l’usage indistinct du terme allant jusqu’à une formulation métaphysique : il y a du don » (p. 265).
La part réservataire
Comme nous le disions en préambule, Frédéric Porcher a livré une recension réfléchie de l’ouvrage. Qu’il nous soit cependant permis de revenir sur l’une ou l’autre appréciation critique que, tenu d’aller à l’essentiel, il nous semble avoir un peu trop rapidement traitée. Nous nous arrêterons en particulier sur les « dettes » qu’il prête à M. H. vis-à-vis de Ricœur et du MAUSS.
Commençons par Ricœur. Frédéric Porcher a suffisamment expliqué que, dans le panorama de la phénoménologie française, M. H. reconnaissait à Ricœur une place d’exception. Mais l’une de ces appréciations mérite discussion : « Pour M. H., Ricœur pense le don de façon singulière et opportune en le considérant sous l’angle de la réciprocité et non plus de la donation. De sorte que Ricœur, relu par M. H., pose une exigence de réciprocité dans le don, d’abord dans la ‘‘règle d’or’’, puis partout dans Parcours de la reconnaissance ».
Cette appréciation évacue selon nous trop rapidement une partie du mérite des analyses et des propositions de M. H. Car s’il est parfaitement exact de dire que Ricœur parle de réciprocité et de l’excellence de la règle d’or (et, à cet égard, il est bien une exception dans le paysage), il importe de préciser que, dans un premier temps, il ne lie jamais la question de la réciprocité à la question du don. Ensuite, lorsque Ricœur évoque le don, c’est toujours pour le rapporter à l’agapè, et donc au don oblatif en opposition à l’économie du don (et, à cet égard, il ne fait plus du tout exception). Cette mise en relation ressort très clairement dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Enfin, quand Ricœur discute le don réciproque comme tel dans Parcours de la reconnaissance, c’est en se référant aux travaux de… M. H., en particulier le chapitre IV du Prix de la vérité « où les échanges cérémoniels sont interprétés comme étant avant tout une procédure de reconnaissance publique entre groupes, où les biens offerts sont d’abord des symboles d’un accord conclu : des gages et des substituts des donneurs. Cette approche nouvelle, remarque Ricœur, permet de se dégager définitivement des hypothèses économistes (le don rituel comme forme archaïque de commerce) et moralisantes (geste charitable) » (p. 224). Ceci n’empêche pourtant pas Ricœur de continuer à se méfier du terme « réciprocité » au point de lui préférer celui de « mutualité qui seule, à ses yeux, débouche sur ce qu’il appelle les ‘‘états de paix’’ et qui, plus encore, permet cette forme de générosité inconditionnelle que toute une tradition nomme agapè » (p. 219). Autrement dit, « tout se passe en effet comme si, malgré tout, confirmant le vieux soupçon souvent rencontré chez tant d’autres auteurs, la notion de réciprocité dans Parcours impliquait non seulement une circularité mais plus encore un retour avantageux vers soi, bref un certain ‘‘égoïsme’’ » (p. 226). Dans le long débat qui a animé la carrière des deux philosophes, la publication du Don des philosophes est une nouvelle occasion pour M. H. de rappeler que ces deux concepts ne sont pourtant pas à confondre, comme il tente de le démontrer dans le chapitre intitulé « Propositions II. Approches de la réciprocité ».
Venons-en maintenant au MAUSS. Frédéric Porcher conclut son compte-rendu sur une question : « Et la Revue du Mauss ? ». Et, de fait, si l’on excepte une note de bas de page, la référence brille par son absence, (ce que n’a pas manqué de relever Caillé en personne dans sa recension du Don des philosophes 9). Frédéric Porcher souhaite ainsi rappeler que, dans un entretien publié dans la Revue Esprit 10, « M. H. rend hommage à la Revue du Mauss tout en lui objectant d’être encore passible d’une économie du don ». De cette critique naîtra une correspondance entre Caillé et M. H. publiée dans la Revue du Mauss 11. Leur échange, précise Frédéric Porcher, « tourne autour de cette question et il faut attendre, d’après notre lecture, juillet 2003 pour que Hénaff reconnaisse que le MAUSS ne défend pas une position économiciste et que, du coup, il rejoint sa position sur ce point précis de l’économie du don ». Pour notre collègue, il s’agirait même de renverser la critique suite à la publication du Don des philosophes. « À travers le privilège accordé à la réciprocité, Hénaff fait du don une forme ou encore une structure de l’échange généralisé et c’est pourquoi l’on peut se demander si, en dépit de sa critique de l’économie du don, il ne reconduit pas ce dernier à l’échange et donc à une économie non pas au sens restreint mais généralisé ». Or, non seulement M. H. évite scrupuleusement de parler du « don en général », mais, en outre, il pointe tout aussi soigneusement la confusion qui règne autour du terme « échange ». « Parler [au sujet du don rituel] de simple échange économique, explique-t-il à plusieurs reprises, constitue un regrettable contresens. Marion et Derrida semblent n’admettre qu’une seule acception du terme ‘‘échange’’ : l’échange profitable, faisant tous deux échos à un usage lexical qui s’est imposé dans les deux derniers siècles seulement, mais qui occulte un grand nombre d’acceptions très différentes : échange de regards, échange de coups au jeu, échange de messages, échange de bons procédés, échange de points de vue… et, bien entendu, échange de dons. Ne prendre en compte que l’acception commerciale, c’est entériner une vue standard au moment même où on entend la contester » (pp. 1821-182).
À suivre rigoureusement M. H. dans cette correspondance comme dans Le Don des philosophes, le problème général de la réception de Mauss continue donc bien de résider dans le refus de prendre en compte la diversité des ordres du don. S’il ne nous appartient ni de trancher ni même de commenter plus avant les échanges entre M. H. et la Revue du Mauss, nous ne pouvons pas rejoindre Frédéric Porcher lorsqu’il écrit que l’absence de discussion avec les représentants de la Revue du Mauss constitue un « manquement » qui « semble infléchir la portée critique de l’ouvrage ». Il nous semble au contraire que l’absence de référence au MAUSS s’explique de manière assez évidente par un souci de clarté de l’exposé qu’il n’est nul besoin de souligner davantage en rappelant que le livre se concentre explicitement sur le don des philosophes… et non des sociologues. De là à laisser entendre que M.H. aurait, sans l’avouer, une position identique à celle de la Revue du Mauss, c’est un pas que nous ne nous permettrions certainement pas de franchir… Tout comme nous nous contenterons uniquement de signaler que Mauss n’a jamais prétendu fournir une « explication totale » du don, comme l’a un peu rapidement résumé Frédéric Porcher, mais qu’il parle du don comme d’un « fait social total ». À ce niveau, M. H. entend justement distinguer à nouveau avec précaution le discours développé de l’objet visé afin d’éviter d’être contraint « de soutenir que le don cérémoniel fonde la société humaine » pour préférer avertir son lecteur que l’« on peut seulement affirmer que [le don cérémoniel] révèle ce qui la fonde » (p. 88).
- Donner le temps. La fausse monnaie, Paris, Galilée, 1991, pp. 108-109.
- Mal comprise, car, comme le fait remarquer M. H., l’Évangile ajoute un tiers : « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6,4). On se tromperait donc, explique-t-il, à penser que la gratuité destitue nécessairement la réciprocité : « Ce sont deux ordres différents de relations – car dans la gratuité elle-même il y a relation. Dans le geste le plus généreux, le plus inconditionnel, le plus humble et secret, l’autre est présent et ne peut pas ne pas l’être » (p. 51).
- Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris, PUF, 1997, p. 125.
- Donner le temps, op. cit., p. 38.
- Étant donné, op. cit., p. 164.
- Donner le temps, op. cit., p. 34. C’est pourquoi Derrida ne parle pas du « don impossible », contrairement au résumé un peu trop rapide de Frédéric Porcher sur ce point. « D’emblée, le questionnement sur le don que propose Derrida se situe dans l’aporie, veut l’aporie. Mais laquelle exactement ? Non pas – et cela a souvent été dit – que Derrida affirmerait : ‘‘le don est impossible’’ ; ce serait absurde devant l’évidence factuelle que des choses sont offertes et que, souvent, d’autres sont données en retour. Derrida énonce exactement ceci : ‘‘Non pas impossible, mais l’impossible. La figure même de l’impossible. Il [le don] s’annonce, se donne à penser comme l’impossible’’ 6Donner le temps, op. cit., p. 19
- Étant donné, op. cit., p. 42.
- Revue du Mauss, 1/39 (2012), pp. 519-520.
- Esprit (février 2002), p. 145.
- Revue du Mauss, 1/23 (2004), pp. 242-288.








