Maine de Biran et la perception de l’espace.
Le rôle du toucher et du sens musculaire
par Denise Vincenti
Università degli Studi di Perugia
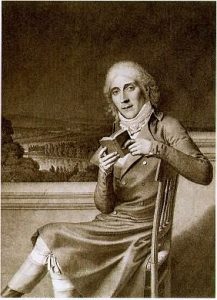
Introduction
Dans les différentes études consacrées à la réflexion de Maine de Biran, on trouve fréquemment des aperçus de sa théorie du toucher. L’érudition a déjà largement exploré cet aspect de la philosophie de Biran, tout comme sa notion de toucher actif et passif a fait l’objet de nombreuses discussions. L’objectif de cet article n’est donc pas tant de revenir sur un thème bien connu de la pensée biranienne, mais plutôt de le situer dans un cadre interprétatif différent : celui de la perception spatiale et du problème de Molyneux. Un tel repositionnement thématique présente plusieurs avantages. Non seulement il permet d’inscrire le nom de Biran dans une histoire de la réception du problème de Molyneux qui, jusqu’à présent, n’a pas pris en compte l’apport des réflexions du philosophe de Bergerac, mais il offre également la possibilité d’aborder certains traits de sa philosophie, comme le problème de l’origine innée ou acquise de la connaissance et le thème du rapport entre les données visuelles et tactiles, qui ont souvent été passés sous silence.
Il n’est d’ailleurs guère surprenant que les contributions biraniennes au débat de longue date sur la perception spatiale aient reçu très peu d’attention, étant donné que Biran mentionne rarement ce débat, ou qu’il le fait d’une manière particulière et indirecte. Pourtant, certains passages de son corpus peuvent se révéler très utiles pour dévoiler sa position et attirer l’attention sur sa conception de l’espace. En particulier, nous trouvons des traces de cette discussion dans deux ouvrages : L’influence de l’habitude sur la faculté de penser (mémoire couronné en 1802) et un bref texte intitulé Réponses aux objections contre la dérivation de l’idée de corps (1815).
À partir de ces écrits, l’article tentera de présenter la position de Biran sur la question de la perception spatiale, en articulant le raisonnement en trois parties : une première section sera consacrée à la présentation du problème de Molyneux et des différentes implications théoriques qui en découlent ; la deuxième partie sera dédiée à la discussion de Biran sur l’immédiateté ou non-immédiateté de l’appréhension spatiale (avec une comparaison avec certaines solutions empiristes et innéistes). Enfin, la troisième section explorera la proposition de Biran en considérant son idée de l’espace comme une perception complexe et ses deux principales déclinaisons : l’extension du corps propre et l’extension de l’objet extérieur.
- Le problème de Molyneux et ses enjeux
Bien que les discussions épistémologiques sur l’origine de la perception spatiale aient longuement marqué l’histoire de la philosophie et de la science, c’est surtout à l’Âge moderne et grâce à l’expérience mentale présentée par le penseur irlandais William Molyneux au père de l’empirisme britannique, John Locke, qu’une telle interrogation reçoit une impulsion décisive. Le problème de Molyneux, qui consistait à savoir si un aveugle-né, ayant recouvré la vue, était capable de distinguer un cube d’une sphère, a en effet catalysé les débats philosophiques au cours des xviiie et xixe siècles et a constitué une référence constante pour de nombreuses perspectives[1]. Diderot lui-même rappelle que « préparer et interroger un aveugle-né n’eût point été une occupation indigne des talents réunis de Newton, de Descartes, de Locke et de Leibniz »[2]. Les témoignages des aveugles-nés sur la perception de l’espace sollicitaient alors l’attention d’une philosophie qui s’efforçait de saisir le mécanisme de la perception et ouvraient la porte à de nouveaux problèmes et questions.
 Face à cette riche histoire, on peut se demander si et dans quelle mesure Maine de Biran, interprète raffiné de son temps, a pris part à ce débat, et quelle était sa position sur le sujet. La réception du problème dans la pensée biranienne est complexe. Même s’il est entré en contact assez tôt avec le problème de Molyneux – on trouve des renvois à cette célèbre expérience de pensée dans L’influence de l’habitude[3] –, les références à cette problématique se révèlent presque absentes dans ses œuvres successives[4]. À ce manque de références textuelles, il faut ajouter un élément historiographique ultérieur : Biran a probablement connu ce problème grâce aux mémoires du philosophe suisse Jean-Bernard Mérian sur Molyneux[5] (ou du moins a-t-il été influencé dans sa réception par ces écrits)[6], en héritant ainsi d’une interprétation assez spécifique et parfois déformée de la question elle-même. En traitant de la réception de ce problème par Biran, il est alors primordial de garder à l’esprit deux aspects : que sa compréhension a été en quelque sorte déformée par le récit de Mérian ; et que ce qui est en jeu ici n’est pas vraiment l’intérêt de Biran pour le problème de Molyneux, mais plutôt la position de la réflexion biranienne au sein d’un réseau d’interrogations de portée plus large. Autrement dit, le problème de Molyneux doit être considéré comme un symbole, un gage d’un débat beaucoup plus complexe auquel Biran apporte des considérations importantes. Ces prémisses posées, il serait utile de partir de l’expérience mentale formulée par le philosophe irlandais et de préciser certaines de ses implications théoriques, afin de préparer le terrain pour l’analyse successive concernant la position de Biran.
Face à cette riche histoire, on peut se demander si et dans quelle mesure Maine de Biran, interprète raffiné de son temps, a pris part à ce débat, et quelle était sa position sur le sujet. La réception du problème dans la pensée biranienne est complexe. Même s’il est entré en contact assez tôt avec le problème de Molyneux – on trouve des renvois à cette célèbre expérience de pensée dans L’influence de l’habitude[3] –, les références à cette problématique se révèlent presque absentes dans ses œuvres successives[4]. À ce manque de références textuelles, il faut ajouter un élément historiographique ultérieur : Biran a probablement connu ce problème grâce aux mémoires du philosophe suisse Jean-Bernard Mérian sur Molyneux[5] (ou du moins a-t-il été influencé dans sa réception par ces écrits)[6], en héritant ainsi d’une interprétation assez spécifique et parfois déformée de la question elle-même. En traitant de la réception de ce problème par Biran, il est alors primordial de garder à l’esprit deux aspects : que sa compréhension a été en quelque sorte déformée par le récit de Mérian ; et que ce qui est en jeu ici n’est pas vraiment l’intérêt de Biran pour le problème de Molyneux, mais plutôt la position de la réflexion biranienne au sein d’un réseau d’interrogations de portée plus large. Autrement dit, le problème de Molyneux doit être considéré comme un symbole, un gage d’un débat beaucoup plus complexe auquel Biran apporte des considérations importantes. Ces prémisses posées, il serait utile de partir de l’expérience mentale formulée par le philosophe irlandais et de préciser certaines de ses implications théoriques, afin de préparer le terrain pour l’analyse successive concernant la position de Biran.
Dans une lettre de 1693, William Molyneux pose à John Locke un « problème ludique » (jocose problem) sur l’origine de la perception de l’espace. L’expérience de pensée qu’il propose est la suivante :
Supposons qu’un homme né aveugle, et maintenant adulte, apprenne par son toucher à distinguer un cube et une sphère du même métal, et presque de la même taille, de manière à pouvoir dire, lorsqu’il sent l’un et l’autre, lequel est le cube, lequel est la sphère. Supposons donc que le cube et la sphère soient placés sur une table, et que l’aveugle soit amené à voir : quaere, si par sa vue, avant de les toucher, il peut maintenant distinguer et dire quel est le globe, quel est le cube.[7]
À partir de ces quelques lignes de la deuxième édition de l’Essai sur l’entendement humain, on voit que l’expérience de pensée de Molyneux soulève plusieurs questions.
Premièrement, le problème porte sur l’interchangeabilité des données visuelles et tactiles, c’est-à-dire la possibilité de les concevoir comme étroitement liées, au point qu’il est possible d’appliquer automatiquement les notions acquises par le sens du toucher aux images visuelles. En d’autres termes, il s’agit de comprendre si la figure visible et la figure tangible sont la même figure ; si elles sont similaires, ou s’il existe un terme moyen permettant au raisonnement de déduire que la figure vue et la figure touchée sont les mêmes[8].
De cette question découle la deuxième implication, plus générale, du problème : le caractère inné ou acquis de la perception de l’espace. En effet, l’hypothèse qu’un aveugle-né recouvrant soudainement la vue distingue d’emblée un cube d’une sphère s’explique par l’idée qu’une seule et même notion abstraite de cubicité ou de sphéricité est réveillée par les impressions sensorielles de la vue et du toucher. La figure cubique perçue par la vue et la figure cubique perçue par le toucher sont donc toutes deux capables d’éveiller une même idée abstraite de cubicité, ce qui rend la traduction immédiate d’une impression dans l’autre possible. D’après cette perspective, la notion d’espace est immédiatement donnée sous forme d’idée abstraite ; elle est une propriété innée de l’esprit. En revanche, l’impossibilité pour l’aveugle-né de distinguer ces deux objets s’explique par le fait que la figure cubique visuelle et la figure cubique tactile sont hétérogènes et ne relèvent pas de la même idée de cubicité. Ainsi, il n’y a pas de correspondance entre la perception tactile d’une surface cubique et l’impression de cubicité offerte par la gradation de couleurs, et l’association de ces deux séries d’impressions ne peut se faire que par l’expérience, l’apprentissage et le jugement. Cette opinion est renforcée par le fait que l’aveugle-né a appris à distinguer un cube d’une sphère en perfectionnant son sens du toucher au fil du temps. Et comme il n’a jamais été entraîné à discerner des configurations spatiales par la vue, l’idée qu’il puisse distinguer immédiatement ces deux formes est absurde.
Ce deuxième enjeu du problème de Molyneux peut être symboliquement considéré comme le point de départ de la longue controverse entre l’empirisme et le rationalisme/innéisme[9]. Alors que des philosophes comme Locke lui-même, George Berkeley ou John Stuart Mill ont proposé une solution empiriste à cette question, en affirmant que la notion d’espace est toujours dérivée de l’expérience et de l’apprentissage, d’autres, comme Leibniz ou William Hamilton, soutiennent au contraire que l’espace est une idée innée et qu’il faut des impressions tactiles ou visuelles pour qu’elle soit réveillé.
 Chez Locke, par exemple, la vue et le toucher donnent au sujet deux idées distinctes de la cubicité. Pour que ces deux sensations s’associent et deviennent inséparables, il faut exercer la faculté de jugement[10]. La connexion entre les domaines visuel et tactile ne peut donc se faire qu’avec le temps et par l’acquisition d’expériences répétées, ce qui exclut la possibilité pour un aveugle-né de reconnaître immédiatement un cube ou une sphère. Cela dit, il est opportun de remarquer que, quoique Locke rejette sans difficulté l’option innéiste selon laquelle la capacité de distinguer entre les deux formes géométriques dépend de la possession d’idées abstraites et innées de sphéricité ou de cubicité, sa position sur le rapport entre les données tactiles et visuelles est plutôt nuancée. Si la traduction immédiate des données tactiles et visuelles est impossible, il n’en reste pas moins vrai que les deux sens offrent, de manière égale, un accès à la « forme » comme propriété de l’espace[11]. En général, toutes les déterminations spatiales, comme l’extension, la forme ou la taille, etc., sont pour lui cognitivement données à la fois par le toucher et la vue. Elles représentent ce que la doctrine aristotélicienne appelait le « sensible commun », c’est-à-dire un type de qualité qui peut être perçu par plusieurs modalités sensorielles. À la différence des couleurs, qui sont l’objet spécifique (sensoriel propre) de la vue, ou des odeurs, qui sont l’objet spécifique de l’odorat, et ainsi de suite, les déterminations de l’espace ne constituent pas le matériau cognitif privilégié d’un seul sens.
Chez Locke, par exemple, la vue et le toucher donnent au sujet deux idées distinctes de la cubicité. Pour que ces deux sensations s’associent et deviennent inséparables, il faut exercer la faculté de jugement[10]. La connexion entre les domaines visuel et tactile ne peut donc se faire qu’avec le temps et par l’acquisition d’expériences répétées, ce qui exclut la possibilité pour un aveugle-né de reconnaître immédiatement un cube ou une sphère. Cela dit, il est opportun de remarquer que, quoique Locke rejette sans difficulté l’option innéiste selon laquelle la capacité de distinguer entre les deux formes géométriques dépend de la possession d’idées abstraites et innées de sphéricité ou de cubicité, sa position sur le rapport entre les données tactiles et visuelles est plutôt nuancée. Si la traduction immédiate des données tactiles et visuelles est impossible, il n’en reste pas moins vrai que les deux sens offrent, de manière égale, un accès à la « forme » comme propriété de l’espace[11]. En général, toutes les déterminations spatiales, comme l’extension, la forme ou la taille, etc., sont pour lui cognitivement données à la fois par le toucher et la vue. Elles représentent ce que la doctrine aristotélicienne appelait le « sensible commun », c’est-à-dire un type de qualité qui peut être perçu par plusieurs modalités sensorielles. À la différence des couleurs, qui sont l’objet spécifique (sensoriel propre) de la vue, ou des odeurs, qui sont l’objet spécifique de l’odorat, et ainsi de suite, les déterminations de l’espace ne constituent pas le matériau cognitif privilégié d’un seul sens.
C’est à partir de ce dilemme sur la relation entre les données tactiles et visuelles que Berkeley décide d’abandonner l’idée des données spatiales en tant que sensibili communi, en niant ainsi l’hypothèse d’un accès multisensoriel aux idées d’extension, de forme, de distance, etc. Pour Berkeley, l’espace n’est pas un objet partagé par le toucher et la vue, étant donné leur hétérogénéité radicale. Toutes les déterminations spatiales sont le résultat d’un processus perceptif complexe, qui ne peut se produire que lorsque les données visuelles et tactiles sont devenues des signes les unes pour les autres[12]. Cet aspect est tout à fait crucial, car il indique qu’il n’y a pas d’accès direct aux déterminations spatiales, mais toujours une médiation cognitive. Cette médiation est assurée par la construction progressive d’une série de relations entre les données tactiles et les données visuelles (les signes), de telle sorte qu’une certaine impression visuelle peut rappeler une impression tactile, sans qu’il y ait de relation biunivoque entre elles. Chez Stuart Mill, l’union des données visuelles et tactiles pour la construction de l’idée d’espace se fait finalement par une opération intellectuelle qu’il appelle chimie mentale[13].
L’idée d’une immédiateté de la notion d’espace, liée aux structures rationnelles qui précèdent et fondent la perception des objets, est en revanche caractéristique du rationalisme/innéisme. La pensée de Leibniz est à cet égard emblématique : selon lui, l’aveugle-né, grâce aux principes de sa raison et aux connaissances acquises par le toucher, est capable de distinguer le cube de la sphère, car il constate que dans la sphère il n’y a pas de points et d’angles distincts, alors que dans le cube il y en a. Si ce n’était pas le cas, les aveugles ne pourraient pas apprendre la géométrie. Selon Leibniz, les deux géométries (celle des voyants et celle des aveugles) sont fondées sur les mêmes idées, bien qu’elles n’aient pas d’images sensibles communes[14]. Dans la même veine, mais avec quelques variations intéressantes, William Hamilton défend l’innéité de l’idée d’espace en affirmant qu’il faut « réclamer exclusivement au sens de la vue le pouvoir de nous offrir nos notions empiriques de l’espace », mais que rien n’empêche de concevoir ce dernier comme une « forme de la pensée »[15]. Les aveugles possèdent donc l’idée d’espace, comme le démontre leur capacité à apprendre la géométrie[16], mais ils ne peuvent pas remplir cette forme vide, car ils manquent de données empiriques visuelles.
Or, la question au centre de notre investigation est la suivante : comment Maine de Biran se positionne-t-il par rapport à la qualité acquise ou innée de l’espace ? et quelle est sa position à l’égard de l’interchangeabilité et de l’interconnexion des données tactiles et visuelles ?
- Innéisme et empirisme, immédiateté et médiation. Le choix de Biran
On peut partir du premier point et se demander si l’espace est, selon Biran, une propriété innée de l’esprit ou une notion acquise par l’expérience. Étant donné le lien philosophique étroit qui lie Biran à la tradition empiriste, notamment dans ses premiers écrits, il est facile de supposer que la première solution est incorrecte. La théorie de l’espace de Biran n’est ni rationaliste ni innéiste. Il convient toutefois d’examiner pourquoi l’espace ne peut pas être une propriété innée de l’esprit, et quelle est précisément sa position à cet égard.
Comme nous l’avons remarqué auparavant, l’un des principaux piliers de la position rationaliste sur l’espace est l’idée qu’une telle notion est immédiatement donnée dans la sensation, qu’elle soit tactile ou visuelle. L’immédiateté de l’espace découle du fait que cette qualité n’est pas vraiment une propriété intrinsèque de la sensation, mais appartient à la raison elle-même et précède l’expérience sensorielle du monde. Il ne s’agit pas d’une sensation, mais d’une idée abstraite, d’une propriété rationnelle, qui constitue la condition même de la perception sensorielle. C’est la raison pour laquelle l’aveugle-né est capable, selon l’innéisme, de distinguer l’image visuelle d’une sphère de celle d’un cube : sa notion d’espace, étant déjà possédée rationnellement, s’applique instantanément à ces deux figures, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un véritable apprentissage.
Or, dans L’influence de l’habitude, Biran ne positionne pas sa réflexion sur l’espace dans la section consacrée à l’influence de l’habitude sur la sensation, mais dans celle concernant l’influence de l’habitude sur la perception[17]. À première vue, ce positionnement semble faire écho à celui que l’on trouve dans l’Essai de Locke. En effet, c’est précisément dans la section « Perception » que Locke répond à la question de Molyneux, affirmant que l’aveugle-né (devenu voyant) est incapable de distinguer le cube de la sphère parce que la traduction des données tactiles en données visuelles nécessite toujours un jugement fondé sur la répétition de l’expérience[18]. Toutefois, un autre élément doit être pris en considération. Biran avait en effet emprunté au philosophe écossais Thomas Reid la distinction entre sensation et perception[19], affirmant ainsi que, si la sensation est immédiate et passive, la perception implique au contraire une médiation, ou plutôt une combinaison d’éléments passifs (impressions) avec des éléments actifs (effort, résistance et mouvement volontaire)[20]. C’est le cas de l’espace, qui n’est pas une simple notion issue de notre premier contact passif avec le monde extérieur, mais plutôt quelque chose qui implique une combinaison de différents éléments. Il fait partie de la sphère perceptive de l’individu et découle donc de l’expérience et de l’apprentissage.
Ce qui est particulièrement curieux, c’est que Biran n’oppose pas tant cette idée de la non-immédiateté et de la complexité de l’espace à l’innéisme qu’à l’empirisme lui-même. Biran ne doute pas en effet qu’une forme subreptice d’immédiateté sous-tend certains récits empiristes sur l’espace, ce qui amène cette tradition à trahir ses propres postulats[21]. En soutenant que la sensation est à l’origine de notre connaissance de l’objet externe, l’empirisme conduit, selon Biran, à des conclusions erronées. L’interprétation biranienne de la solution empiriste concernant la spatialité recèle des considérations théoriques intéressantes et une analyse de la question qui nous permet de mieux comprendre le rôle de Biran dans ce débat. L’idée que l’empirisme britannique fonde la notion d’espace sur une sensation immédiate plutôt que sur une perception, semble découler, comme on le disait auparavant, de la lecture des mémoires de Mérian sur le problème de Molyneux. Dans le premier mémoire, Mérian affirme que la solution proposée par Locke à cette expérience de pensée est ambiguë :
En général, quoique Locke soit pour la négative, comme Molyneux, il ne laisse pas de s’exprimer avec de certaines restrictions. Il croit que l’aveugle-né ne soit point capable, à la première vue, de dire avec certitude, quel est le globe et quel est le cube.
Par-là que faut-il entendre ?
Est-ce qu’à la simple vue, & sans le secours du Toucher, l’aveugle-né ne saura discerner les deux corps ?
Veut-il insinuer qu’en les considérant plus long-temps, ou de plus près, sans cependant les toucher, l’aveugle-né les discernera ?
Veut-il dire enfin qu’il pourra les distinguer au moyen de la réflexion, & du raisonnement, sans avoir besoin d’une confrontation de la Vue avec le Tact ?
Et quand Locke ajoute que l’aveugle-né ne sauroit dire avec certitude quel est le globe, & quel est le cube, pense-t-il que cet aveugle-né pourroit au moins le soupçonner avec vraisemblance ?
Qui qu’il en soi, Locke, sur ce sujet, est beaucoup moins péremptoire que Molyneux.
J’ai de la peine à me persuader que Locke ait voulu soutenir qu’il n’y auroit pour son aveugle-né absolument aucun moyen de reconnoitre le globe & le cube, parce que par une telle assertion il heurteroit ses propres principes.[22]
La solution de Locke présente en fait une certaine ambiguïté qui renvoie à sa conception de la spatialité. Bien qu’il réponde négativement à la question de Molyneux (en disant que, non, l’aveugle-né ne peut pas distinguer un cube d’une sphère à la première vue et avec certitude, sauf à recourir au jugement), l’espace est décrit dans sa théorie comme une donnée quelque peu immédiate, puisque la vue et le toucher peuvent tous les deux y accéder directement. D’autre part, il définit l’espace comme une idée simple de sensation[23], alors que les configurations spatiales plus articulées, telles que la distance, l’espace circonscrit, etc., sont définies comme des idées complexes du mode simple de l’espace[24]. Cette ambiguïté de la pensée lockienne, qui sera définitivement dissoute par Berkeley – se prononçant en faveur d’une théorie totalement constructiviste de l’espace –, résonne aussi dans sa réponse à Molyneux, comme le montre Mérian.
À partir de cette lecture, Biran prononce un verdict sans appel contre l’empirisme : cette tradition, qui considère l’espace comme une sensation et non comme une perception, est condamnée à penser les propriétés spatiales comme immédiates et non comme le résultat d’un état psychologique complexe. Une position qui n’est pas très différente de la position innéiste et rationaliste, pourrait-on ajouter. Voilà pourquoi la réponse au problème de Molyneux est souvent ambiguë. Pour Biran, l’origine de cette erreur ne se trouve pas tant chez Locke que chez Berkeley. Il affirme en effet que plusieurs empiristes sont tombés dans les sophismes de Berkeley en croyant que l’espace est une sensation et non une perception[25]. Une telle interprétation peut et doit paraître étrange à ceux qui connaissent la philosophie de Berkeley et son idée, déjà évoquée, de l’espace comme construction mentale. Biran adopte ici une vision simplifiée de la pensée berkeleyenne, mais qui en révèle beaucoup sur sa compréhension du problème. L’immédiateté de la spatialité dans la sensation est un héritage berkeleyen qui se lie à deux sous-questions primordiales : le thème du toucher dans la connaissance de l’espace et la croyance en l’existence d’objets extérieurs.
En commençant par la première sous-question, il est possible de dire que si Berkeley est, selon Biran, le principal responsable de la méprise empiriste de la question de l’espace, c’est en raison de la place centrale qu’il attribue au toucher dans la connaissance immédiate de la spatialité. L’érudition tend aujourd’hui à mettre en doute l’idée que Berkeley ait réellement donné au toucher un statut prioritaire par rapport aux autres sens et l’ait présenté comme un accès immédiat et prioritaire à l’espace, penchant ainsi vers une solution entièrement constructiviste du problème[26]. Il n’en reste pas moins vrai que Berkeley suggère, à certains moments, que le toucher joue effectivement un rôle différent de celui des autres modalités sensorielles[27]. Une certaine tension traverse sa pensée, et Biran semble pencher pour une interprétation plutôt classique de la question. Plusieurs penseurs s’inscrivent ainsi dans la lignée de Berkeley. En premier lieu, Maupertuis, dont il cite un passage intéressant dans une note du mémoire sur l’habitude :
Je touche un corps. Le sentiment de dureté semble déjà lui appartenir plus que ne faisaient les sentiments d’odeur, de son, de goût. Je le touche encore, j’acquiers un sentiment qui me paraît encore plus à lui… c’est l’étendue. Cependant, si je réfléchis attentivement sur ce que c’est que la dureté, l’étendue, je n’y trouve rien qui me fasse croire qu’elles soient d’un autre genre, que l’odeur, le son et le goût ; […] et rien ne me porte à croire que ce sentiment appartienne plus au corps que je touche qu’à moi-même.[28]
Or, l’erreur principale de ce raisonnement, selon Biran, réside dans l’application du « même terme sentiment, sensation, à tous les produits des opérations de nos sens » , ce qui conduit à ne voir « aucune différence entre les manières dont nous acquérons les perceptions d’étendue et de solidité, et celle dont nous sentons une odeur »[29]. En d’autres termes, selon Maupertuis, l’extension est une sensation dont la nature n’est pas différente de celle de l’odorat ou du goût. C’est pour cette raison que la sensation d’extension appartient au sujet plutôt qu’à l’objet touché. Il s’agit, pourrait-on dire, d’une qualité secondaire et non d’une qualité première.
 La perspective de Condillac ne diffère de celle de Maupertuis qu’en apparence. Bien que Condillac ne considère pas le toucher comme comparable aux autres sens (ce dernier ayant un statut particulier dans l’appréhension de l’espace), il décrit lui aussi l’espace comme une sensation et non comme une perception complexe. La deuxième sous-question mentionnée plus haut, à savoir le problème de l’existence des objets extérieurs, occupe une place centrale dans sa réflexion[30]. Le problème est le suivant : puisque les sensations sont des modifications de l’âme et ne nous renseignent en rien sur ce qui se trouve à l’extérieur de l’âme[31], comment la connaissance dérivée des sensations peut-elle porter sur l’extérieur ? Pour résoudre cette énigme, Condillac postule un dualisme des sens, de sorte que toutes les modalités sensorielles[32], à l’exception du toucher[33], sont incapables de juger de l’existence d’objets extérieurs. C’est en fait le toucher lui-même qui apprend aux autres sens (en particulier à la vision) à déduire l’extériorité des objets[34]. Mais pas le toucher simple, à savoir celui des qualités tactiles telles que la douleur, le plaisir, le chaud, le froid, etc. Il s’agit d’une de ses applications spécifiques : le double toucher. Lorsqu’une personne pose une main sur sa poitrine, elle éprouve deux sensations : l’une sur la main, l’autre sur la poitrine. D’où l’idée du corps propre[35]. À l’inverse, lorsqu’elle ressent une pression contre sa main sans percevoir de seconde sensation, elle en conclut qu’elle touche un corps extérieur. D’où l’idée complexe de corps en général et d’objet extérieur[36]. Comme on le comprend aisément, le raisonnement de Condillac aboutit à la conclusion que seule l’idée de corps en général et d’objet extérieur est une idée complexe, tandis que l’idée d’espace, immédiatement donnée par le double toucher, est une idée simple. Le double toucher est, en effet, une sensation, et non une perception. C’est pourquoi Biran peut affirmer que « Condillac dit à peu près la même chose que Maupertuis »[37].
La perspective de Condillac ne diffère de celle de Maupertuis qu’en apparence. Bien que Condillac ne considère pas le toucher comme comparable aux autres sens (ce dernier ayant un statut particulier dans l’appréhension de l’espace), il décrit lui aussi l’espace comme une sensation et non comme une perception complexe. La deuxième sous-question mentionnée plus haut, à savoir le problème de l’existence des objets extérieurs, occupe une place centrale dans sa réflexion[30]. Le problème est le suivant : puisque les sensations sont des modifications de l’âme et ne nous renseignent en rien sur ce qui se trouve à l’extérieur de l’âme[31], comment la connaissance dérivée des sensations peut-elle porter sur l’extérieur ? Pour résoudre cette énigme, Condillac postule un dualisme des sens, de sorte que toutes les modalités sensorielles[32], à l’exception du toucher[33], sont incapables de juger de l’existence d’objets extérieurs. C’est en fait le toucher lui-même qui apprend aux autres sens (en particulier à la vision) à déduire l’extériorité des objets[34]. Mais pas le toucher simple, à savoir celui des qualités tactiles telles que la douleur, le plaisir, le chaud, le froid, etc. Il s’agit d’une de ses applications spécifiques : le double toucher. Lorsqu’une personne pose une main sur sa poitrine, elle éprouve deux sensations : l’une sur la main, l’autre sur la poitrine. D’où l’idée du corps propre[35]. À l’inverse, lorsqu’elle ressent une pression contre sa main sans percevoir de seconde sensation, elle en conclut qu’elle touche un corps extérieur. D’où l’idée complexe de corps en général et d’objet extérieur[36]. Comme on le comprend aisément, le raisonnement de Condillac aboutit à la conclusion que seule l’idée de corps en général et d’objet extérieur est une idée complexe, tandis que l’idée d’espace, immédiatement donnée par le double toucher, est une idée simple. Le double toucher est, en effet, une sensation, et non une perception. C’est pourquoi Biran peut affirmer que « Condillac dit à peu près la même chose que Maupertuis »[37].
Le principal défaut de ce type de raisonnement réside, pour Biran, dans la possibilité de concevoir des idées complexes, telles que celle de l’existence des objets extérieurs, comme dérivées de l’expérience sensorielle elle-même. Chez Condillac, comme nous l’avons vu, une chaîne de « vérités », qui va des sensations aux jugements, permet d’atteindre les idées complexes de corps extérieur et de corps propre. Biran retrouve chez Reid un cheminement similaire, , mais dans l’ordre logique inverse. Si Reid a eu le mérite de distinguer la sensation de la perception, sa théorie de l’espace est entachée de sophismes et d’erreurs. Dans une note écrite en marge de la section sur la perception de l’espace, Biran discute de l’idée de Reid concernant la croyance humaine en l’existence d’un monde extérieur. Il s’agit d’une question étroitement liée, comme chez Condillac, à l’idée d’espace, puisque c’est précisément l’appréhension spatiale d’un objet qui, selon Reid, nous donne en premier lieu l’idée de son existence extérieure. Voici ce qu’il affirme dans Enquête sur l’esprit humain :
La connexion de nos sensations à la conception et à la croyance en existences extérieures ne peut être dérivée de l’habitude, de l’expérience, de l’éducation ou de l’un des principes de la nature humaine admis jusqu’à présent par les philosophes. Par ailleurs, il est indéniable que ces sensations sont inévitablement liées à la conception et à la croyance en existences extérieures. […] Il faut donc en conclure que cette connexion est un effet de notre constitution, et qu’elle devrait être considérée comme un principe original de la nature humaine[38].
Selon Biran, une telle idée cache une conception innéiste de l’espace et de l’existence des corps extérieurs[39]. En effet, pour Reid et d’autres philosophes de l’école d’Édimbourg, les sensations en général sont conçues comme des signes naturels que la nature a liés à la perception d’existences extérieures. Cette façon de penser implique également un jugement inné sur ces mêmes existences. Dans Réponses aux objections contre la dérivation de l’idée de corps, Biran revient en effet à la notion de sensations comme signes naturels de Reid et affirme :
Th. Reid a fait une analyse trop légère et trop superficielle des sensations. S’il l’eût faite plus exactem[en]t, il aurait vu que beaucoup de sensations qu’il regarde comme simples, quoiqu’elles soient signes de propriétés ou qualités diverses, sont composées de plusieurs éléments, dont certains peuvent expliquer ce qu’il regarde comme inexplicable, et qu’il met par suite sur le compte de la nature.[40]
Selon Biran, Reid est en quelque sorte contraint de s’appuyer sur un principe inné de la nature humaine pour expliquer les notions d’espace et d’existences extérieures, car il estime que ces dernières dérivent d’une simple sensation[41]. En particulier, il s’agit de la sensation de toucher. Reid explique qu’il suffit de glisser la main le long d’une table pour que le toucher, simple au premier abord, permette d’appréhender plusieurs choses : la dureté, la rugosité, la froideur, l’extension, etc. La difficulté, on le voit, est que des sensations multiples produisent l’idée d’une table occupant un espace et ayant une extension[42]. La synthèse de ces différentes sensations en une sensation unique, supposée simple, est alors garantie non pas par une association a posteriori de sensations tactiles, mais par un jugement a priori propre à la nature humaine. Le jugement consiste ainsi, chez Reid, non seulement à considérer les sensations comme des signes naturels d’une existence extérieure, mais aussi, dans le cas des sensations tactiles, à les synthétiser en une seule sensation univoque d’un objet spatialement étendu.
Les observations de Biran visent à démontrer que l’empirisme et l’innéisme ne proposent pas de solutions radicalement différentes concernant la perception spatiale. Dans les deux cas, en effet, l’immédiateté de l’espace – qu’elle soit due à la présentation d’une idée abstraite, comme chez l’innéisme, ou à la simple sensation, comme chez l’empirisme – fait que l’appréhension spatiale exclut la médiation, l’expérience et l’apprentissage. Biran essaiera de remédier à ce défaut fondamental en recourant aux notions de perception, de motilité et d’habitude.
- L’espace et le toucher. Éloge de la perception kinesthésique
Dans les pages biraniennes, empirisme et innéisme partagent le même défaut d’interprétation, car ils conçoivent tous deux l’espace comme une notion immédiatement donnée. Cela dit, Biran reste fidèle à l’empirisme et à l’idée qu’une connaissance spatiale innée et a priori n’existe pas. L’empirisme a également l’avantage d’avoir correctement identifié le toucher comme une voie d’accès privilégié à la spatialité, même si, comme nous l’avons mentionné, ses descriptions du lien toucher-espace se sont révélées entachées d’erreurs grossières. Le péché d’empirisme n’est toutefois pas irrémédiable et peut être facilement surmonté, surtout si l’on considère que « le toucher n’est point simple »[43]. Aristote lui-même, dans le deuxième livre du De anima, affirmait que « c’est un problème de savoir si le toucher est un sens unique ou un groupe de sens »[44]. L’histoire des réponses à cette question est longue et complexe. Il suffit ici de souligner combien l’étude du toucher soulève de nombreuses questions et nous confronte à un objet d’étude difficile à démêler[45]. Par rapport aux autres sens, le critère permettant de définir le toucher n’est pas clairement établi. Comme le dit Aristote, les modalités sensorielles sont ordinairement identifiées par leurs objets intentionnels (les sons pour l’ouïe, les couleurs pour la vue, etc.), mais les objets tactiles ne constituent pas une classe naturelle[46]. En effet, les objets propres et primaires du toucher sont multiples : dureté, solidité, imperméabilité, texture, poids, masse, pression, tension, contact, température, humidité, vibration, douleur, etc. De même, si l’on tente de définir le toucher selon un critère biologique, c’est-à-dire selon les organes qui lui sont propres et primaires, on se heurte à une hétérogénéité fondamentale : peau, nerfs, récepteurs anatomiques et fonctionnels, etc. Lorsque Biran affirme que le toucher est tout sauf simple, il fait probablement (/ implicitement) référence à cette complexité et reproche à ses collègues empiristes de ne pas en avoir suffisamment tenu compte.
Quelle est donc la réponse biranienne à l’énigme du toucher ? Elle consiste à abandonner toute prétention à la simplicité et à l’immédiateté, afin de comprendre que le toucher est une modalité complexe :
Le toucher n’est point simple, car il comprend l’exercice de deux sens différents, savoir le sens musculaire, qui seul connaît la dureté, la résistance, l’étendue solide et la mobilité, et le tact proprement dit, qui connaît le poli, le chaud, etc.[47]
Le toucher n’est pas un sens unique, mais la collaboration de deux facultés différentes, que l’on pourrait appeler le tact actif, puisqu’il est lié aux sensations musculaires – d’où la motricité, la kinesthésie, la résistance, la volonté et l’effort –, et le tact passif, qui se lie aux qualités tactiles proprement dites, telles que la chaleur, le poli, la douleur, etc.[48] Or, c’est précisément ce toucher à la fois passif et actif qui, selon Biran, demeure à l’origine de notre compréhension de l’espace. Le double tact postulé par Condillac n’est qu’une formulation encore sommaire et inadéquate de la question, puisqu’il ne se réfère qu’au côté passif de l’appréhension tactile de l’espace. Si Condillac reconnaissait en effet un certain rôle aux sensations kinesthésiques et de résistance, il se concentrait en tout cas exclusivement sur les organes périphériques (principalement la main en mouvement) et tendait à sous-estimer la contribution des sensations kinesthésiques par rapport aux qualités tactiles proprement dites[49]. L’idée d’une modalité complexe du tact, Biran ne pouvait pas la retrouver chez Condillac. Comme il l’avoue explicitement[50], il s’agit d’une intuition heureuse de l’idéologie de Destutt de Tracy :
Pourquoi – demande Tracy – le simple sentiment d’une piqure, d’une brulure, d’un chatouillement, d’une pression quelconque me donnerait-il plus de connaissance de sa cause que celui d’une couleur, ou d’un son, ou d’une douleur interne ? Il n’y a nul motif de le penser. […] Voilà donc encore le toucher passif reconnu aussi incapable que les autres sens de nous faire soupçonner l’existence des corps. […] Supposons pour un moment que nous ayons la faculté de nous mouvoir comme nous l’avons, mais sans que les mouvements de nos membres produisent en nous aucune sensation interne […]. J’éprouve bien, si l’on veut, de la part de ce corps [externe], l’effet que nous nommons résistance ; mais cette résistance n’est point pour moi une opposition à ce que nous appelons mouvement […]. Si vous ajoutez à cette faculté de nous mouvoir, la circonstance que chaque mouvement de nos membres produise en nous une sensation interne, vous verrez naître un nouvel ordre de choses […], une sensation que nous avons nommée sensation de mouvement. […] C’est déjà beaucoup, mais ce n’est pas encore tout […]. Il faut donc, pour rendre cette découverte inévitable, appeler encore à notre aide, une autre de nos facultés ; et c’est la faculté de vouloir.[51]
La notion de sens musculaire (ou, mieux encore, de « sensation du mouvement »)[52], formulée par Tracy, n’a rien à voir avec la connaissance ou la vision extérieure de notre corps en mouvement, mais consiste plutôt en ce que l’individu ressent en bougeant volontairement son propre corps. Il s’agit d’une sensation musculaire pure et intentionnelle, qui relève exclusivement de l’intériorité du sujet.
 Dans L’nfluence de l’habitude, Biran présente un exposé exhaustif sur le toucher en tant que composition d’impressions tactiles, sensations de mouvements et volonté, au sein du chapitre susmentionné sur l’influence de l’habitude sur les perceptions. C’est précisément dans ces pages qu’il explique comment se réalise le passage de la sensation à la perception en ce qui concerne l’appréhension de l’espace, rompant ainsi de manière décisive avec les positions empiristes sur la perception spatiale. Selon lui, ce passage s’effectue lorsque les organes sensoriels commencent à développer leur propre motilité. Par exemple, dit-il, les nouveau-nés n’apprennent à discerner visuellement les objets que lorsqu’ils acquièrent la capacité de contrôler les mouvements des yeux, de sorte que la vision n’est plus floue ; elle devient distincte[53]. L’observation des nouveau-nés montre alors que le sens du toucher actif et kinesthésique est encore plus important que la vue elle-même dans la perception de l’espace. Ce type de toucher présente une priorité logique et évolutive :
Dans L’nfluence de l’habitude, Biran présente un exposé exhaustif sur le toucher en tant que composition d’impressions tactiles, sensations de mouvements et volonté, au sein du chapitre susmentionné sur l’influence de l’habitude sur les perceptions. C’est précisément dans ces pages qu’il explique comment se réalise le passage de la sensation à la perception en ce qui concerne l’appréhension de l’espace, rompant ainsi de manière décisive avec les positions empiristes sur la perception spatiale. Selon lui, ce passage s’effectue lorsque les organes sensoriels commencent à développer leur propre motilité. Par exemple, dit-il, les nouveau-nés n’apprennent à discerner visuellement les objets que lorsqu’ils acquièrent la capacité de contrôler les mouvements des yeux, de sorte que la vision n’est plus floue ; elle devient distincte[53]. L’observation des nouveau-nés montre alors que le sens du toucher actif et kinesthésique est encore plus important que la vue elle-même dans la perception de l’espace. Ce type de toucher présente une priorité logique et évolutive :
Les enfants apprennent d’abord assez lentement à distinguer quelques objets à la vue ; il faut que l’organe ait acquis le degré de consistance nécessaire pour pouvoir se fixer et qu’il exerce ensuite aux divers mouvements que nécessite la vision distincte. Or, cette époque coïncide avec celle où le tact lui-même commence à avoir assez de force et d’adresse pour empoigner les corps et parcourir leurs surfaces ; et sûrement il n’y a point de perceptions nettes à différentes distances, ni de jugement sur ces distances, qu’après que l’enfant a marché lui-même, ou a souvent été transporté vers les divers objets.[54]
Lors des premières explorations du monde, on assiste, selon Biran, à un « développement simultané de la motilité simple et de la faculté perceptive »[55], ce qui révèle que ces deux facultés partagent la même origine. Les notions de surface étendue, de figure, de distance, etc., sont des perceptions et non des sensations, puisqu’elles impliquent l’exercice conjoint de l’impressionnabilité de l’organe des sens (surtout le toucher, mais aussi la vue) et de la motilité. Si l’adulte ne voit pas le lien étroit entre les impressions et les mouvements, c’est parce que l’habitude, tout en rendant la perception de plus en plus distincte, tend à nous rendre invisible la partie active de ce processus[56]. La sensation des mouvements, essentiellement impliquée dans la perception de l’objet extérieur, passe alors inaperçue, ce qui nous trompe sur la nature réelle d’une telle perception. Contrairement à cette croyance erronée, les perceptions du monde extérieur sont, comme nous l’avons dit, doubles. Elles sont constituées à la fois d’impressions et de sensations de mouvements.
Contrairement à d’autres penseurs empiristes qui s’étaient penchés sur le problème de Molyneux avant lui, Biran a l’opportunité de fonder son analyse de la perception spatiale sur un élément ultérieur. En 1728, le médecin et chirurgien anglais William Cheselden avait opéré avec succès un aveugle-né atteint de cataracte, lui rendant ainsi la vue à l’âge adulte. Grâce à Cheselden, l’expérience de pensée de Molyneux devenait enfin une réalité. L’aveugle de Cheselden, une fois la vue recouvrée, déclarait voir tous les objets comme s’ils se trouvaient sur le même plan[57]. Le témoignage de l’aveugle opéré de la cataracte semblait donc pencher en faveur de ceux qui avaient répondu négativement à la question de Molyneux et impliquait aussi (bien que de nombreux penseurs remettront en cause la validité de cette conclusion) que l’appréhension de l’espace dérive toujours de l’expérience et n’est jamais immédiatement perçue par les sens. Biran partage cet avis et ajoute davantage que
C’est, sans doute, principalement par l’absence des habitudes de mouvement propres à l’organe [de la vue], que les aveugles-nés, quelque temps après avoir subi l’opération de la cataracte, ne peuvent encore voir que très confusément ; ils doivent faire un certain effort […] lorsqu’ils veulent tourner ou mouvoir leurs yeux.[58]
Or, si ce mélange d’impressionnabilité et de motilité est propre à toutes les perceptions, seul le sens du toucher nous permet d’accéder à une connaissance primitive de l’objet extérieur et de la notion d’espace. En effet, en bougeant notre corps, Biran affirme que nous rencontrons deux formes de résistance : 1/ l’organe résiste à notre volonté (les muscles du bras, par exemple, nous empêchent de bouger librement notre bras dans tous les sens) ; 2/ l’objet résiste à notre organe (la table, par exemple, empêche mon bras de poursuivre son mouvement)[59]. Ces deux formes de connaissance résultent d’un mouvement et d’une résistance correspondante ressentie par le sujet, dans sa volonté ou dans son organe. Ce qui signifie que la notion d’extension spatiale est toujours dérivée de l’expérience. Cependant, une autre conclusion découle de cette idée : il existe deux notions d’espace dérivées de l’expérience, à savoir l’étendue des objets extérieurs et l’étendue du corps propre. Il est intéressant de s’attarder brièvement sur ces deux formes d’espace.
3.1 L’espace du corps propre : la localisation des sensations
Selon Biran, il existe une compréhension immédiate et primordiale de l’extension interne de notre corps, à savoir le sentiment subjectif de l’existence qui se réalise dans l’aperception interne immédiate[60]. Cette sorte d’auto-conscience corporelle, qui n’implique pas encore la conscience claire et le raisonnement (elle se présente plutôt comme une sorte de sphère inconsciente de l’être humain), est ce que Biran appellera dans certains ouvrages cénesthésie[61], et qui rappelle, d’une certaine manière, le « sentiment confus de l’existence » déjà évoqué par Condillac[62]. Toutefois, cet « espace interne » n’est pas encore un véritable espace, dans la mesure où il se présente sous la forme d’une sensation (et non d’une perception), et parce qu’il lui manque une condition nécessaire à l’appréhension de la spatialité : l’articulation de l’espace en régions, figures et lieux. Pour avoir une représentation objective de l’extension du corps, il faut en localiser les parties, et une telle localisation implique nécessairement la motilité, c’est-à-dire le toucher actif.
À cet égard, l’observation d’un médecin de l’École de Montpellier, Rey Régis, joue un rôle non anodin dans la définition de l’espace corporel et est citée à plusieurs reprises par Biran[63]. Dans Histoire naturelle et raisonnée de l’âme, Régis écrit :
Ayant vu un malade qui paraissait paralysé de la moitié du corps, après une attaque récente d’apoplexie, je fus curieux de savoir s’il lui restait quelque sentiment et quelque mouvement dans les parties affectées : pour cela je pris sa main sous la couverture de son lit ; je pliai et pressai fortement un de ses doigts, ce qui lui fit jeter un cri : en ayant fait autant à chaque doigt, il sentit chaque fois une douleur très vive, mais il ne savait où le rapporter. […] Cette observation m’a fait soupçonner que, dans ces sortes de paralysies, l’âme perd la connaissance ou le souvenir de sa force motrice, de la proportion de son effort au mouvement requis ; elle oublie surtout la façon dont il faut appliquer son effort justement à l’organe qu’elle a en vue.[64]
Là où le corps a perdu sa motilité mais pas sa sensibilité, l’âme perd la connaissance de sa force motrice et de l’effort nécessaire à l’action. Biran est conscient de l’assonance qui existe entre la réflexion de Régis et la sienne, et il ne manque pas de le souligner. Si l’exemple médical « curieux » raconté par Régis peut effectivement lui apprendre quelque chose, il lui permet d’appréhender le lien entre motricité et sensibilité, et de comprendre ainsi à quel point le rôle de la motricité est central dans la localisation des sensations. Biran cite pour la première fois l’exemple de Régis dans le mémoire sur la Décomposition de la pensée, où il écrit, dans une note de bas de page, que
La nécessité d’une influence motrice, ou d’un effort actuel exercé sur des parties sensibles, pour que les impressions faites sur ces parties puissent y être directement rapportées, me parait confirmée par un fait curieux rapporté dans un ouvrage peu connu […] par M. Rey Régis. […] L’auteur conclut que, dans des paralysies de ce genre, l’âme perd la connaissance ou le souvenir de sa force motrice, […] ce qui revient à dire que le sujet de cet effort moi perd l’idée ou le sentiment immédiat de celui des termes particuliers de son application qui se trouve organiquement lésé. Et si tous les termes partiels, ou le corps en masse était dans le même état, toute aperception ne se trouverait-elle pas complètement suspendue, comme dans le sommeil, quoique l’affectibilité passive put subsister ?[65]
Le cas de l’hémiplégique, en éclairant le rôle de la motricité dans la localisation des sensations, montre comment on passe de l’espace indistinct du corps vivant à la compréhension de l’espace réel du corps propre[66]. L’extension corporelle, avec ses articulations et ses parties, devient un objet de perception pour le sujet dans la mesure où celui-ci est doté non seulement de sensibilité mais aussi de motilité. Selon Régis, la localisation n’est possible que par l’exercice conjoint et simultané des impressions et des sensations de mouvement. C’est pourquoi, pour Biran, l’espace est toujours le résultat d’une expérience, n’est jamais immédiat, et nous devient familier au moment où l’habitude obscurcit le rôle du mouvement volontaire dans l’appréhension de l’espace.
3.2 L’espace de l’extériorité : la relation entre impressions visuelles et tactiles
La notion d’espace extérieur permet d’approfondir la question soulevée au début de l’article lors de la discussion des implications théoriques du problème de Molyneux, à savoir la relation entre les données visuelles et tactiles. La question, posée par plusieurs penseurs, et résolue par eux de manière différente, était la suivante : dans la perception spatiale, est-il possible de concevoir ces deux séries d’impressions comme étroitement liées, au point qu’on puisse appliquer automatiquement les notions acquises par le sens du toucher aux images visuelles et vice versa ?
Biran s’attelle à son tour à la tâche difficile de comprendre la relation entre la vision et le toucher dans l’appréhension de l’espace au fil des pages de L’influence de l’habitude. Plus précisément, ce problème s’inscrit dans la question de la perception des objets tridimensionnels : les trois dimensions d’un objet extérieur sont-elles connues immédiatement par le sens du toucher ou par le seul sens de la vue, ou dépendent-elles de l’association entre la vue et le toucher ?[67] La première option, beaucoup plus proche de la position innéiste, se fonde sur la conviction que les sensations tactiles et les sensations visuelles, considérées indépendamment les unes des autres, possèdent des propriétés extensives et renferment donc d’emblée une certaine idée de l’espace[68]. Comme nous l’avons rappelé initialement, la position innéiste de Leibniz soutenait que l’aveugle-né était capable de distinguer immédiatement le cube de la sphère parce qu’il constatait qu’il n’y avait pas de points et d’angles distincts dans la sphère. Ces points et ces angles sont conçus comme des éléments d’extension, déjà porteurs d’une idée d’espace, et pourtant ils sont capables d’offrir immédiatement à la raison un indice de la figure de l’objet tridimensionnel. D’ici, la possibilité d’une traduction immédiate des impressions visuelles en impressions tactiles, et vice versa ; une traduction rendue possible par l’existence d’une relation biunivoque entre les deux séries d’éléments extensifs. La seconde option, plus proche de la position empiriste, repose sur l’idée que les sensations visuelles et tactiles sont intensives, et que ne possèdent donc aucune référence immédiate à la spatialité. En l’absence de référence à la spatialité, les deux séries d’impressions sont essentiellement hétérogènes et leur traductibilité nécessite donc d’un élément supplémentaire qui puisse jouer le rôle d’intermédiaire. Elles ne deviennent extensives que si elles sont associées les unes aux autres à travers une quelque forme de médiation cognitive.
Biran n’hésite pas à soutenir cette dernière option, tout en faisant une remarque intéressante. En effet, il estime que les notions de forme, de solidité et de lourdeur (les qualités premières d’un objet) sont dérivées uniquement du sens du toucher. Mais, encore une fois, non pas du sens du toucher en général, mais de cette forme spécifique, active, de toucher, qui est liée au sens musculaire et à la motilité. Les mouvements successifs, effectués autour de l’objet, nous permettent de comprendre sa forme et sa solidité ; de même, la sensation de résistance, impliquée dans le toucher actif, nous donne l’idée de lourdeur, de légèreté, etc.[69]
Or, même si les qualités premières ne sont perçues que par le toucher, il est évident que la vue nous fournit également une certaine connaissance de l’extension spatiale. Le voyant adulte sait qu’un objet est une sphère et non un cube, même s’il ne le touche pas. Il est également capable de faire des prédictions assez précises sur son poids, sa légèreté, etc. Bien entendu, selon Biran, une telle connaissance n’est pas immédiatement fournie par la vue mais par le toucher actif uniquement. C’est pour cette raison, selon lui, que la réponse au problème de Molyneux ne peut être que négative : l’aveugle, dont la vue est soudainement recouvrée, ne sera pas capable de distinguer un cube d’une sphère avec certitude et immédiatement. Un lien étroit existe toutefois entre la vue et le toucher. S’il est vrai que, pour Biran, la vue n’est pas dotée de qualités extensives, il n’en reste pas moins vrai qu’elle peut accéder à la perception de l’espace en s’associant au toucher actif. Mais quelle est la nature de l’association en jeu chez Biran ? S’agit-il d’une combinaison chimique comme celle qui sera formulée quelques années plus tard par Stuart Mill ? Ou s’agit-il d’une association mentale purement a posteriori, plus proche de la pensée de Hume ? Aucune des deux options précédentes. Biran parle à cet égard de deux systèmes de signes qui sont associés l’un à l’autre par des rapports naturels, c’est-à-dire par habitude :
Les organes du tact et de la vue sont essentiellement liés l’un à l’autre par les rapports naturels de la motilité ; et c’est de là que dépendent surtout la coïncidence parfaite et la transformation réciproque de leurs impressions. Du concours premier et non interrompu des deux perceptions, visuelle et tactile, en résulte une troisième qui tient des deux, mais qui n’est ni l’une ni l’autre isolément. […]
Lorsque l’œil, se confiant […] aux leçons qu’il a reçues du tact, commence à voler de ses propres ailes, et va saisir la couleur à l’extrémité des rayons où la main avait déjà rencontré la résistance, cette impression simple et isolée de couleur suffit pour effectuer dans le centre cérébral […] l’idée de résistance. […] Comme la vue seule croit saisir la résistance dans la couleur, la main à son tour croira embrasser la couleur dans la résistance. Les deux impressions se servent ainsi des signes réciproques […], confondus par l’habitude dans une perception indivisible.[70]
Lorsqu’on parle de la traduction des impressions tactiles en impressions visuelles en termes de systèmes de signes interconnectés par l’expérience, il est inévitable de penser immédiatement à Berkeley. Conçue de cette manière, la réflexion de Biran s’avère finalement être une position d’inspiration berkeleyenne. Au-delà de l’immatérialisme et de l’idéalisme qui sous-tendent la pensée de Berkeley (et qui sont absents de celle de Biran), on a l’impression que cela est bien le cas, et que la définition d’espace donnée par Biran s’inscrit également dans la continuité de la notion de motilité de Destutt de Tracy et de la réflexion de Berkeley sur les signes. Biran ne semble cependant pas être du même avis :
L’habitude nous a fait transporter à la résistance ces images colorées qui flottent devant nos yeux, en identifiant le monde visible avec le tangible. […] L’image visible nous faisant ici la fonction de signe, nous passons de cette image à ce qu’elle représente, […] avec la même rapidité dont [sic] l’habitude nous fait traverser, en lisant les signes écrits, pour arriver aux idées. […] Sur un mot, le langage que la nature extérieure adresse à nos yeux est presque toujours fidèlement traduit par l’habitude dans le langage direct qui s’adresse au tact. Je dis traduit car il s’agit ici de passer d’un système de signes à un autre, et qu’il n’y a pas l’espèce d’analogie que Berkeley a cru trouver entre le langage écrit et le langage parlé.[71]
Le type de traduction que Biran observe dans la perception de la spatialité visio-tactile n’est pas une traduction par analogie, comme le soutient Berkeley, mais une traduction qui repose sur une relation naturelle entre la vue et le toucher. La différence est peut-être plus une question de nuance qu’une réelle opposition, mais elle souligne l’écart que Biran perçoit entre sa propre position et celle berkeleyenne[72]. Pour Berkeley, l’hétérogénéité des impressions visuelles et tactiles reste presque absolue, car elle nécessite une médiation cognitive qui impose, pourrait-on dire de force, une traduction entre les deux systèmes de signes. Chez Biran, au contraire, la traduction se fait naturellement et produit une perception indivisible, capable de combiner véritablement les données visuelles et tactiles. S’il existe toujours une certaine asynchronie entre ces deux systèmes, dans la mesure où le jugement et l’imagination doivent souvent intervenir pour rétablir une correspondance entre ce que la vue voit et ce que le toucher touche[73], leur union par l’habitude n’en demeure pas moins naturelle. C’est le développement évolutif des facultés qui le démontre, puisque, comme nous l’avons vu plus haut, la faculté perceptive commence à se développer au moment où l’individu commence à exercer sa motilité. La perception complexe (à la fois visuelle et tactile, sensorielle et motrice) de l’espace repose alors, chez Biran, sur une complexité qui n’est jamais artificielle, cognitive ou intellectuelle, mais essentiellement naturelle.
Conclusion
La position de Biran concernant la perception spatiale est une position que l’on pourrait qualifier d’« empiriste ». Biran se rapproche en effet de l’empirisme lorsqu’il affirme que l’extension spatiale est une notion acquise par l’expérience, qui n’est pas immédiatement donnée dans la sensation, et lorsqu’il exclut l’intervention d’idées ou de catégories a priori dans la genèse de l’appréhension spatiale du corps propre et de l’objet. Toutefois, sa solution ne correspond pas entièrement à l’approche empiriste dans la mesure où elle ne s’inscrit pas dans l’ensemble des solutions proposées par cette tradition au problème de l’espace. La dette contractée à l’égard de la réflexion de Destutt de Tracy sur le sens musculaire marque, à cet égard, une rupture avec les interprétations classiques du problème par Locke ou Berkeley. Cela signifie-t-il que les arguments de Biran ne sont pas intrinsèquement novateurs ? Biran n’est-il qu’un épigone de la pensée de Tracy ? Répondre par l’affirmative à cette question risquerait de ne pas rendre justice aux subtils arguments de Biran sur le thème de l’espace. L’identification d’une double modalité du toucher est certes un héritage de l’idéologie de Tracy, mais l’utilisation par Biran de ce nouveau concept demeure originale. C’est en effet grâce au double toucher et à son application au problème de l’espace que se dessine le terrain d’action de la pensée biranienne (qui deviendra de plus en plus clair et délimité, de L’influence de l’habitude aux ouvrages successifs). Un terrain d’action qui, à partir de l’empirisme, se déplace dans d’autres directions, en particulier dans la direction de la volonté et de la sphère hyperorganique de l’effort volontaire. La réflexion sur l’espace peut alors être considérée comme une étape de ce parcours et comme l’un des moments qui ont permis à Biran de se convertir définitivement au « biranisme ».
***
[1] Pour approfondir la réception du problème de Molyneux, voir par exemple : M. Degenaar, Molyneux’s Problem. Three Centuries of Discussion on the Perception of Forms, Dordrecht-Boston-London, Kluwer, 1996 ; B. Glenney, « Leibniz on Molyneux’s question », History of Philosophy Quarterly, 2012, 29(3), p. 247-64 ; M. Chottin, Le Partage de l’empirisme : une histoire du problème de Molyneux aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Champion, 2014 ; J. R. Loaiza, « Molyneux’s Question in Berkeley’s Theory of Vision », Theoria, 2017, 32(2), p. 231-47 ; G. Ferretti, B. Glenney (dir.), Molyneux’s Question and the History of Philosophy, London, Routledge, 2020.
[2] D. Diderot, « Lettre sur les aveugles », in Œuvres complètes de Diderot, Paris, Garnier frères, 1875, t. 1, p. 314.
[3] Maine de Biran, Œuvres, éd. par F. Azouvi, Paris, Vrin, t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, éd. par G. Romeyer-Dherbey, 1987, p. 307, 385-6.
[4] À l’exception de : Maine de Biran, Œuvres, cit., t. IV, De l’aperception immédiate, éd. par I. Radrizzani, 1995, p. 258.
[5] Johann Bernhard Mérian, ou Jean-Bernard Mérian (1723-1807), est un philosophe suisse qui a joué un rôle important au sein de l’Académie royale des sciences de Berlin. Il a traduit Hume en France. Dans les années 1770, il a publié une série de rapports sur le problème de Molyneux dans les mémoires de l’Académie de Berlin, rapports aujourd’hui rassemblés dans J.-B. Mérian, Sur Le Probleme De Molyneux: suivi de Mérian, Diderot et l’aveugle, éd. par F. Markovits, Paris, Flammarion, 1984. Dans cet article, nous ferons référence à l’édition originale. Sur Maine de Biran et Mérian, voir : F. Azouvi, « Maine de Biran lecteur de Mérian », in Maine de Biran et la Suisse, éd. par B. Baertschi et F. Azouvi, Lausanne, Neuchâtel, 1985, p. 9-21.
[6] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 385.
[7] J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding (1690), Dublin, W. Sleater, H. Chamberlaine, and J. Potts, vol. I, 1786, p. 107-8. Voir aussi : J. Locke, The Correspondence of John Locke, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 483 ; W. Molyneux, Dioptrica Nova : A Treatise of Dioptricks, in Two Parts, London, Tooke, 1692. Si l’édition française n’est pas précisée, les traductions sont considérées comme étant de l’autrice de l’article.
[8] Cet aspect est bien explicité par Mérian : J.-B. Mérian, « Sur le problème de Molyneux. Premier mémoire », in Nouveaux mémoires de l’Académie royale de sciences et belles-lettres, Berlin, Chrétien Frédéric Voss, 1770, p. 258-267, ici 258.
[9] Une controverse qui aura une longue histoire et qui continuera à se faire sentir (bien qu’avec des variations significatives) jusqu’à la fin du xixe siècle. L’exposé de Hermann von Helmholtz, en 1867, sur l’état de l’art du débat contemporain sur la perception de l’espace – en termes d’opposition entre nativisme (non plus innéisme) et empirisme – est, à cet égard, illustratif (H. von Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, Leipzig, Leopold Voss, 1867 ; trad. fr. par E. Javal, N. T. Klein, Optique physiologique, Paris, Masson, 1867, p. 571).
[10] J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, cit., p. 108.
[11] Ibidem, p. 90, 127.
[12] G. Berkeley, An Essay Towards a New Theory of Vision, Dublin, Aaron Rhames, 1709.
[13] J. Stuart Mill, A System of Logic : Ratiocinative and Inductive. Being a Connected View of the Principles of Evidence, and Methods of Scientific Investigation (1843), London, Longman, Greens, and Co., 1930, livre VI, ch. 4, p. 555-562.
[14] G.W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain (1765), Paris, Flammarion, 1921, livre II, ch. 9, p. 90-6.
[15] W. Hamilton, Lectures on Metaphysics and Logic, Edinburg-London, Blackwood and sons, 1861, t. 2. p. 179. Voir aussi la critique de Stuart Mill à cette position de Hamilton : J. Stuart Mill, An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy, London, Longman, Greens, and Co., 1889.
[16] W. Hamilton, Lectures on metaphysics and logic, cit., p. 179.
[17] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 175-89.
[18] J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, cit., p. 108.
[19] M. Piazza, « Maine de Biran e l’illuminismo scozzese », cit., p. 47-53.
[20] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 177-186.
[21] Ibid., p. 307-8.
[22] J.-B. Mérian, « Sur le problème de Molyneux. Premier mémoire », cit., p. 264-5.
[23] J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, cit., p. 127.
[24] Ibid., p. 127-140.
[25] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 307-8.
[26] Voir par exemple, M. Atherton, Berkeley’s Revolution in Vision, Ithaca, Cornell University Press, 1990.
[27] Plus précisément, la question est de savoir si l’hétérogénéité entre le toucher et la vue, dans l’Essai sur une nouvelle théorie de la vision, établit une hiérarchie perceptive selon laquelle le toucher serait réel et la vue ne le serait pas. Voir, sur ce point, D. Bertini, Note al testo, in G. Berkeley, Trattato sui principi della conoscenza umana, Milano, Bompiani, 2004, p. 460-1. Cette idée d’une supériorité hiérarchique du tact est soutenue, par exemple, par M. M. Rossi, Saggio su Berkeley, Bari, Laterza, 1985.
[28] Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) était un mathématicien, physicien, philosophe et naturaliste français. Il a introduit les idées de Newton en France. La citation (rapportée par Biran dans Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 182) est fidèle – Biran ajoute simplement des italiques et ne signale pas toutes les coupures qu’il a faites sur le texte original –, et elle est tirée de : Maupertuis, Lettres, in Œuvres de Maupertuis, Lyon, Jean-Marie Bruyset, 1768, t. II, lettre IV, p. 231.
[29] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 182.
[30] La question est bien analysée par P. P. Hallie, Maine de Biran. Reformer of Empiricism 1766-1824, cit., p. 22-6.
[31] É. Bonnot de Condillac, Traité des sensations (1754), in Œuvres complètes de Condillac, Paris, Ch. Houel, 1798, t. III, p. 177.
[32] Ibid., p. 56-165.
[33] Ibid., p. 181-191.
[34] Ibid., p. 258-348.
[35] Ibid., p. 186-9.
[36] Ibid., p. 197-204.
[37] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 307.
[38] T. Reid, An Inquiry into the Human Mind. On the Principles of Common Sense (1764), London-Edinburg, Cadell, Longman, Kingaid, and Bell, 1769, p. 91-2.
[39] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 333.
[40] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. XI-3, Commentaires et marginalia : dix-neuvième siècle, éd. par J. Ganault, 1990, p. 31.
[41] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 294.
[42] T. Reid, An Inquiry into the Human Mind, cit., p. 94-8.
[43] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. XI-3, Commentaires et marginalia : dix-neuvième siècle, p. 31.
[44] Aristote, De anima, II.11, 422b20.
[45] Pour comprendre le complexe mélange de questions théorétiques concernant le tact, on peut renvoyer à : F. de Vignemont, O. Massin, « Touch », in The Oxford Handbook of Philosophy of Perception, éd. par M. Matthen, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 294-313.
[46] Aristote, De Anima, II.11, 422b17-424a16.
[47] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. XI-3, Commentaires et marginalia : dix-neuvième siècle, p. 31.
[48] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 340.
[49] P. P. Hallie, Maine de Biran. Reformer of Empiricism 1766-1824, cit., p. 26.
[50] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. XI-3, Commentaires et marginalia : dix-neuvième siècle, p. 13 ; Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 135-6.
[51] A. L. C. Destutt de Tracy, Élémens d’idéologie. Première partie. Idéologie proprement dite (1801), Paris, Courcier, 1804, p. 129-133.
[52] L’histoire du sens musculaire est particulièrement articulée et intéressante. À cet égard, on renvoie à : R. Smith, « The sixth sense : Towards a history of muscular sensation », Gesnerus, 2011, 68(1), p. 218-71 ; R. Smith, The Sense of Movement. An Intellectual History, London, Process Press, 2019.
[53] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 177-8.
[54] Ibid., p. 177.
[55] Ibid., p. 178.
[56] Ibid., p. 178-9.
[57] W. Cheselden, « An account of some observations made by a young gentleman, who was born blind », Philosophical Transactions of the Royal Society, 1728, 35(402), p. 447-50.
[58] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 181.
[59] Ibid., p. 180.
[60] Ibid., p. 54-7.
[61] Pour approfondir cet aspect, voir A. Aloisi, « Coenesthesia or the Immediate Feeling of Existence: Maine de Biran and the Problem of the Unconscious between Physiology and Philosophy », Perspectives on Science, 2023, 32(1), p. 47-69.
[62] É. Bonnot de Condillac, Traité des sensations, cit., p. 23, 115, 173.
[63] Par exemple, Maine de Biran, Œuvres, cit., t. III, Décomposition de la pensée, éd. par F. Azouvi, 2000, p. 139-140 ; t. IV, De l’aperception immédiate, p. 126-8 ; t. V, Discours à la société médicale de Bergerac, éd. par F. Azouvi, 1984, p. 24-5, 89, 174. Selon Paul Janet, Régis peut être considéré comme un véritable précurseur de la théorie de la volonté de Biran (voir : P. Janet, « Un précurseur de Maine de Biran », Revue philosophique, 1882, 14, p. 368-90).
[64] Rey Régis (Cazillac), Histoire naturelle et raisonnée de l’âme, London, 1789, t. I, p. 26-8.
[65] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. III, Décomposition de la pensée, p. 139-40.
[66] Voir à cet égard : F. Azouvi, « Genèse du corps propre chez Malebranche, Condillac, Lalarge de Lignac et Maine de Biran », Archives de philosophie, 1982, 45(1), p. 85-107.
[67] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 184-6.
[68] Il faut préciser que cette formulation du problème de la perception spatiale en termes de possession de propriétés intensives ou extensives par les sensations individuelles n’est pas propre au débat à l’Âge moderne. Cette façon d’aborder le problème de l’espace est plutôt typique du débat ultérieur, notamment de la controverse entre empirisme et nativisme au cours du xixe siècle (notamment chez Helmholtz, Lotze, Stumpf, etc.). Pour approfondir l’évolution de la discussion sur la perception spatiale, voir : G. Hatfield, The Natural and the Normative : Theories of Spatial Perception from Kant to Helmholtz, Cambridge [Mass.], MIT Press, 1990). Cependant, nous avons décidé d’appliquer ces catégories plus contemporaines au sujet qui nous occupe, car elles sont particulièrement utiles pour mettre en évidence les implications d’un tel débat.
[69] Maine de Biran, Œuvres, cit., t. II, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, p. 180-1.
[70] Ibid., p. 185-6.
[71] Ibid., p. 308-9.
[72] Notons qu’il serait tout aussi erroné de faire coïncider la solution de Biran avec celle de Reid concernant la notion de « signes naturels ». Comme nous l’avons mentionné plus haut, selon Biran, l’idée de Reid selon laquelle les sensations sont des signes naturels d’objets extérieurs est une croyance basée sur des jugements a priori présents dans l’esprit humain. Lorsque Biran parle d’une relation naturelle entre les signes, il fait toujours référence à une relation qui s’établit au fil du temps, par l’expérience et l’habitude, et qui n’est jamais donnée a priori.
[73] Ibid., p. 309.








