Introduction : de l’importance nouvelle des réseaux dans l’historiographie
Dans son remarquable La place et la tour, l’historien britannique Niall Ferguson ouvre sa préface par ces quelques mots :
« Nous vivons dans un monde en réseau ; c’est du moins ce qu’on ne cesse de nous répéter. Le mot « réseau », qui n’était pratiquement pas usité avant la fin du XIXè siècle, l’est aujourd’hui à l’envi. Il l’est encore plus en anglais, langue dans laquelle le mot network est à la fois verbe et substantif. […]. Les réseaux informels ont en général un rapport très ambivalent avec les institutions établies, qui confine parfois à l’hostilité. Pourtant, récemment encore, les historiens de métier avaient tendance à ignorer ou du moins à minimiser le rôle des réseaux. Et la majorité d’entre eux continuent de privilégier l’étude des institutions qui produisent et conservent des archives, comme si celles qui ne laissaient pas derrière elles une belle trace de papier ne comptaient pas[1]. »
Ces quelques propos liminaires nous paraissent éclairer de deux manières la parution en 2020 chez Classiques Garnier du remarquable Dictionnaire des philosophes français du XVIIè siècle, judicieusement sous-titré Acteurs et réseaux du savoir[2]. D’abord, en insistant sur l’importance de la notion de « réseau » au sein du vocabulaire et de la conceptualité anglo-saxons, N. Ferguson nous permet de comprendre que ce qui est devenu un lieu commun pour décrire l’époque actuelle peut fort bien s’étendre en amont de celle-ci et servir de fil directeur pour penser des périodes bien antérieures ; c’est du reste ce que N. Ferguson a entrepris dans ses propres recherches et l’on ne s’étonnera donc pas que la première version de ce Dictionnaire ait paru en 2008 en anglais, dans une sphère culturelle peut-être plus spontanément favorable à la réception d’une telle thématique. Le second élément tient à un facteur qui semble contredire le premier, à savoir l’espèce d’amour immodéré des historiens pour les traces écrites et officielles, amour accompagné de son négatif, à savoir du soupçon presqu’instinctif que nourrissent ces derniers à l’endroit des réseaux informels moins soucieux de laisser quelque trace visible et / ou institutionnelle.
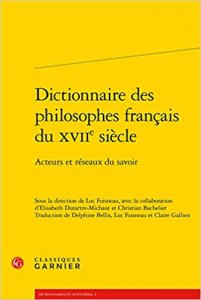
A vrai dire, la contradiction entre les deux éléments semble se résoudre dans la mesure où l’invasion de la notion de « réseau » au-delà de la période actuelle paraît avoir converti les historiens en faveur de ce concept, de sorte que leurs réticences initiales contre les lieux informels se soient quelque peu amenuisées, et ce bien que la France demeure peut-être plus réticente que les Etats-Unis ou l’Angleterre à traiter ce genre de thématiques.
Quoi qu’il en soit des situations respectives de la France et des pays anglo-saxons face à la possibilité d’interpréter les temps anciens selon des logiques de réseaux extérieurs au pouvoir et aux institutions, force est de reconnaître que ce Dictionnaire imposant – 2100 pages – propose au public français une somme impressionnante consacrée à des acteurs que l’on eût jugés insignifiants il y a encore quelques décennies et qui se voient ici réhabilités du fait même que la perspective modifie l’échelle des fonctions. Il s’agit en effet moins de hiérarchiser la qualité des philosophies en jeu que de cartographier les lieux effectifs où se rencontrent philosophes, scientifiques, théologiens, écrivains, alchimistes aussi, et ainsi de rendre presque traçable le devenir autant que la genèse d’une pensée. Luc Foisneau, maître d’œuvre du projet, synthétise ainsi l’esprit de l’ouvrage :
« Le Dictionnaire des philosophes français du XVIIè siècle est né du désir de faire apparaître la richesse d’une histoire intellectuelle que le monument à la gloire de l’esprit cartésien a eu parfois tendance à nous faire oublier. Il procède, par conséquent, de la volonté de faire une place aux multiples acteurs de la scène philosophique française, sans présupposer d’emblée une échelle des grandeurs : la longueur relative d’une notice n’est pas tant l’indice de la considération que la tradition universitaire accorde à un auteur que de la contribution de ce dernier à la vie intellectuelle de son siècle. De fait, nos philosophes ne sont pas des monades sans porte ni fenêtre, mais des acteurs d’un savoir en réseau[3]. »
Par conséquent, si l’on trouve des entrées consacrées aux « classiques » de la Philosophie – Descartes, Pascal, Malebranche, Spinoza, Fénelon, etc. –, on y découvre du même geste les fameux minores qui s’avèrent décisifs dans les débats du Grand Siècle, soit parce qu’ils rendent possibles les rencontres, soit parce qu’ils incarnent des positions qui forcent théologiens et philosophes à leur répondre et à ainsi affiner leurs propres arguments. Cela dessine un Siècle complexe, parcouru de querelles infinies, et d’une richesse plus grande encore que celle que l’on pouvait soupçonner.
A : Structure générale de l’ouvrage
Le Dictionnaire… propose, outre la longue série d’entrées consacrées aux auteurs (ou à certains ouvrages décisifs comme le Traité des trois imposteurs), trois outils de grande portée. Le premier, après l’avant-propos de Luc Foisneau, consiste en huit notices, de 6 à 10 pages chacune, présentant un aspect du XVIIè siècle sous une forme synthétique et claire, permettant de déterminer rapidement les grands problèmes et les grandes querelles qui se jouent au cours de la période envisagée. Depuis l’héritage du cartésianisme jusqu’aux querelles picturales inhérentes à la prééminence du dessin ou de la peinture, en passant par la percée des sciences et la scission du christianisme entre protestants et catholiques, c’est à un bouleversement général que nous convient ces petits textes qui, tous, convergent au fond vers la thèse que défend Anthony McKenna, à savoir que la fameuse « crise » de la conscience européenne identifiée par Paul Hazard[4] commence bien plus tôt que ce qu’affirme ce dernier – donc avant 1680 –, à telle enseigne que s’il est bien une constante du Grand Siècle, c’est précisément celle de son inconstance et de la précarisation rapide de tout ce qui semblait ferme et assuré.
De ce fait, il est à remarquer d’emblée que ce Dictionnaire, envisageant le XVIIè siècle comme une période de querelles intellectuelles, se situe aux antipodes de toute histoire téléologique ou « fléchée » de la philosophie. Loin de ramener à l’unité un siècle complexe, l’ouvrage ouvre au contraire ce dernier à tous les développements subtils et contraires qui se puissent observer. Consciente, cette orientation est assumée par Luc Foisneau qui, évoquant les écueils classiques que rencontrent les grandes fresques, revendique le refus d’une histoire téléologique au profit d’une histoire partant de la vie même des philosophes, « sans préjuger comme le ferait une histoire thématique, d’un ordre des savoirs, d’une orientation métaphysique ou d’un sens de l’histoire, fût-il celui des idées[5]. »
Néanmoins, aussi utile et pertinente soit cette approche, elle ne va pas de soi au regard du siècle envisagé car elle va à l’encontre de la conscience que certains philosophes ont de leur propre démarche. Il n’est en effet pas du tout comparable d’envisager les XIIIè et XIVè siècles selon un réseau universitaire et intertextuel dominé par la scolastique, où les études supposent de commenter des œuvres antérieures – notamment le Traité des sentences de Pierre Lombard – et de traiter de philosophes qui proposent pour beaucoup de tout refonder à neuf, de repenser à nouveaux frais les principes philosophiques – et scientifiques – en s’affranchissant explicitement de ce qui les a précédés. Et cela excède de beaucoup la seule entreprise de Descartes. Autrement dit, le paradoxe de ce Dictionnaire tient à ceci qu’en essayant d’ouvrir à la pluralité des perspectives, des rencontres et des vies effectives, il ferme en partie la porte de la conscience que certains philosophes marquants de cette période ont de leur propre entreprise, et impose de ce fait une lecture extérieure et même lointaine de leurs écrits, n’éclairant donc pas la conscience qu’un Spinoza peut avoir du sens même d’une entreprise comme celle de l’Ethique. Cette réserve ne remet pas en cause l’utilité des perspectives multiples ni du refus d’une histoire téléologique de la philosophie mais amène à interroger les présupposés d’une approche qui, cherchant à éviter de nombreux écueils, finit par rendre inessentielle ce que le philosophe, dans certains cas, croit au sujet de sa propre démarche.
Le second outil, particulièrement impressionnant que propose le Dictionnaire en sus des entrées, est un « Index historique et raisonné » de 350 pages, qui permet d’identifier en un instant les acteurs du Grand Siècle et d’effectuer un jeu de renvois d’une remarquable efficacité.
Enfin, il ne faudrait pas négliger les indications bibliographiques qui parsèment le Dictionnaire à de nombreuses reprises ; chacune des notices précédemment évoquées propose une liste de 5 à 10 ouvrages de référence permettant à qui souhaiterait découvrir tel ou tel domaine précis d’immédiatement cerner les textes fondamentaux cernant le sujet. De la même manière, à l’issue des notices, une petite bibliographie générale présente un aperçu particulièrement utile de la littérature déjà existante sur la vie intellectuelle du Grand Siècle.
Ainsi donc, en plus des entrées dont nous allons parler dans la prochaine partie, s’agrègent trois outils bienvenus, dont l’index qui, à lui seul, constitue un livre entier et un adjuvant précieux pour qui travaille sur la période. Le revers de la médaille est que le volume est massif et peu maniable ; il est quasiment impossible de le laisser ouvert sur un bureau pour lire les deux cents premières pages – ou les deux cents dernières. A cet égard, il nous paraît salutaire que, quelques mois seulement après la parution du Dictionnaire…, une version de poche en deux volumes[6] ait vu le jour, facilitant grandement le maniement de l’ensemble. Nous recommandons donc les deux « petits » volumes, plus aisés à maintenir ouverts et à parcourir que le grand dont la répartition des masses rend parfois difficile la lecture.
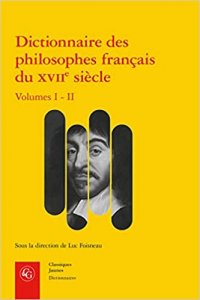
B : Les entrées comme telles
Intelligemment conçues, les entrées s’organisent avec ordre et systématicité. Un premier moment restitue la biographie propre du philosophe, puis détermine le contenu de sa pensée avant de décrire les rencontres et les discussions de celui-ci avec ses contemporains – mais aussi avec ses devanciers.
A l’issue de la notice, une bibliographie en tout point remarquable quant à ses standards se structure comme suit : 1) sont mentionnées les œuvres publiées, avec les dates de publication et les éditions récentes les plus marquantes ; 2) la Correspondance quand elle existe est détaillée selon ses différentes éditions ; 2bis) dans certains cas, les manuscrits ne sont pas publiés, si bien que les manuscrits sont indiqués comme tels mais sans édition ; 3) les textes marquants de l’époque et avec lesquels l’auteur est en dialogue sont eux aussi mentionnés, permettant de disposer des écrits effectifs du réseau de discussion ; 4) sont citées les bibliographies établies autour de l’auteur et 5) les études de référence sont mentionnées.
Lorsque la notice concerne un ouvrage ou une notion, elle se fait plus exclusivement historique et s’attache à décrire la genèse, la diffusion et la postérité de l’ouvrage, notamment quand il s’agit d’un texte clandestin à forte répercussion.
Plusieurs commentaires peuvent ici être formulés. Le premier est que la logique de réseaux inhérente à ce Dictionnaire conduit à consacrer de nombreuses entrées à des acteurs qui ne sont pas au sens propre des philosophes. Prenons ainsi le cas de Guez de Balzac dont la précieuse notice rappelle qu’il est d’abord le créateur d’une langue française classique ; s’il est initialement attiré par une certaine philosophie avant de s’en détourner – le scepticisme fidéiste de Charron – il n’est pas philosophe comme le seraient Descartes ou Malebranche. Certes, son Socrate chrétien de 1652 s’en prend à la raison scolastique mais l’enjeu demeure apologétique et vise à autonomiser la Révélation à l’endroit d’une raison quelque peu ratiocinante, et finalement assez vaine.
Le second commentaire porte sur la bibliographie dont il faut ici saluer l’envergure ; nous entendons par là le fait que, soustrait à toute école de pensée, le présent Dictionnaire ne vise pas à défendre telle ou telle approche de l’histoire de la philosophie – en dépit d’une tendance parfois historiciste. De ce fait, bien qu’une notice absolument neutre ou impartiale soit impossible, force est de reconnaître la neutralité dont la bibliographie de chaque notice fait preuve, notamment par l’indication de commentaires d’inspiration fort différente parmi les études de référence.
C : Remarque sur l’orientation générale de l’ouvrage
A cet égard apparaît une ambiguïté de l’ensemble du volume ; en effet, s’il est vrai que ce Dictionnaire ne choisit pas telle ou telle école, il n’en demeure pas moins qu’il effectue un certain nombre de choix ou, à tout le moins, qu’il établit des refus : appréhender le Grand Siècle sous l’angle des réseaux et donc ménager une grande place à des acteurs d’envergure moindre sur le plan philosophique, c’est évidemment refuser le mythe du philosophe génial qui, seul dans son poêle, révolutionnerait par ses seules forces la philosophie ou reconstruirait à neuf cette dernière ; c’est donc restituer un cadre général de discussion qui substitue l’ensemble à l’élément et relativise la conscience que l’auteur peut avoir de sa propre portée révolutionnaire ; c’est du même geste refuser une lecture immanente des œuvres et ce n’est donc pas, de ce point de vue, une démarche neutre.
Certes, un historien de tendance historiciste répondrait à cela qu’une pensée n’est pas révolutionnaire dans l’absolu et qu’elle ne peut l’être que relativement à un corpus préexistant ou contemporain, lui donnant justement par contraste sa portée révolutionnaire tout comme la singularité d’une œuvre ne prend son sens que par distinction d’avec les autres ; toutefois, une telle réponse ferait fi de la conscience que l’auteur a de son œuvre propre, et présupposerait d’une certaine manière que l’auteur ne perçoit pas – quand il s’imagine singulier – le sens réel de ce qu’il fait, « réel » signifiant ici « contextuel ».
On pouvait donc craindre, au regard de ce parti-pris, que les bibliographies des notices mettent l’accent sur les études privilégiant les approches contextuelles et réduisent la part de celles qui proposent une lecture plus immanente des œuvres ; or,
force est de reconnaître qu’il n’en est rien et que le parti-pris est comme neutralisé par l’éventail intellectuel que proposent les bibliographies de chaque notice dont nous redisons l’excellence et la pluralité.
D : Deux illustrations contrastées
Un des intérêts d’une approche en réseau consiste à identifier des relais ou des maillons quelque peu méconnus du grand public et pourtant essentiels dans leur capacité à transmettre des idées ou des connaissances, notamment par la voie épistolaire, outil décisif de l’efficacité des réseaux. Ainsi N. Ferguson avait-il insisté sur les lettres d’Ismaël Boulliau (1605-1694), figure typique des esprits universels du Grand Siècle :
« Les réseaux de correspondance nous permettent de mieux comprendre l’évolution de la révolution scientifique. Ismaël Boulliau était un astronome et mathématicien français qui s’intéressait aussi à l’histoire, à la théologie et aux études classiques. Sa correspondance est volumineuse : 4 200 lettres pour les années 1632-1693, à quoi il convient d’ajouter plus de 800 autres, écrites par lui ou qui lui étaient destinées, et qui ne sont pas comprises dans les archives de la Collection Boulliau. Elle s’étend aussi très au-delà de la France : aux Pays-Bas, à l’Italie, à la Pologne, à la Scandinavie, au Proche-Orient[7]. »

On ne sera donc pas étonné de trouver pas moins de six pages consacrées à Ismaël Boulliau dans le Dictionnaire, ainsi qu’une abondante bibliographie dont on notera d’ailleurs que l’écrasante majorité des titres sont en anglais. Qualifié de « personnage central de la République des Lettres[8] », il se voit décrit selon « son réseau international [qui] rivalise avec ceux de Mersenne et d’Oldenburg pris ensemble[9]. » Par une ressaisie historique, l’auteur écrit ainsi que « pour l’historien, le réseau de Boulliau représente le moment du passage de la figure de l’érudit à celle du scientifique, du glissement de la conversation savante vers les périodiques scientifiques et les académies financées par l’Etat[10]. » De ce point de vue, Boulliau est emblématique des ces auteurs peut-être sous-estimés dans leur rôle de relais – notamment en France ainsi que l’indique en creux la pauvreté de la littérature secondaire qui lui est consacrée en français –, mais aussi d’auteurs à part entière puisqu’il a publié une trentaine de livres et de traités.
Un second exemple permettra d’envisager un autre aspect de ce Dictionnaire. Nous savons que Descartes avait rédigé le Discours de la méthode en français en grande partie pour connaître une diffusion au sein des salons féminins. Benedetta Craveri, dans une étude désormais classique, avait ainsi décrit les mutations du goût dans la première partie du XVIIè siècle :
« Personne, toutefois, dans le monde des lettres, ne pouvait ignorer que le goût féminin était devenu déterminant pour décréter le succès d’une œuvre, consacrer la réputation d’un auteur ou orienter la production littéraire. Les folliculaires sans scrupules n’étaient plus les seuls à flatter le nouveau public des lectrices. En 1637, pour pouvoir être lu aussi par des femmes, Descartes décidait d’écrire son Discours de la méthode en français, et non en latin[11]. »
Or, en 1637, le salon qui comptait plus que tout autre était celui de Mme de Rambouillet ; même si Descartes n’y fut sans doute pas reçu, on y lut fort probablement le Discours, car c’était vers ce type de lieux qu’était dévolu le choix du français. On se fût attendu à trouver dans le Dictionnaire une entrée consacrée à Mme de Rambouillet (Catherine de Vivonne) mais celle-ci ne fait pourtant l’objet que d’une petite présentation dans l’index et non d’une entrée. Il est vrai que Mme de Rambouillet n’a pas laissé d’écrits à la différence de Madeleine de Scudéry – qui, elle, bénéficie d’une notice – mais il est également vrai que, dans un ouvrage cherchant à intégrer les réseaux, le salon de la rue Saint-Thomas-du-Louvre et celle qui l’animait y eussent trouvé toute leur place.
Apparaît ici, notamment par la différence de traitement que réserve le Dictionnaire à Mme de Rambouillet et Mlle de Scudéry, une interrogation quant aux critères qui permettent de définir une auteur. D’une certaine manière, le propos est ici resté très classique et semble avoir privilégié l’écriture comme critère exclusif de la production d’une œuvre ; pourtant, en interrogeant les réseaux et leur rôle, nous pourrions fort bien considérer que l’auteur connaît une sorte de portée extensive en ceci que si, par exemple, l’importance d’un salon comme celui de Mme de Rambouillet incite Descartes à écrire en français pour y être lu, alors il n’est pas absurde de juger que ledit salon contribue à l’écriture du Discours de la méthode puisqu’il en dicte partiellement la langue. Dans ce cas, il faut peut-être dissocier l’auteur de l’entité qui écrit ; l’auteur est peut-être plus vaste que celui qui tient la plume et l’approche par réseau impose une logique qui devrait remettre en cause le choix de ne retenir que ceux qui ont écrit directement. Certes, en évoquant la notion d’ « acteurs du savoir », le Dictionnaire intègre cette dimension, mais il ne l’intègre que jusqu’à un certain point, dont témoigne là encore la notice consacrée à Mlle de Scudéry qui s’efforce essentiellement de restituer sa pensée à partir de ses écrits bien davantage qu’elle n’envisage de rendre à la « conversation » de son salon toute son étendue.
Conclusion
Ce Dictionnaire est évidemment un événement considérable dans les études dix-septiémistes. Remarquable par la qualité de ses entrées, la diversité de ses contributeurs, et l’envergure constante dont il fait preuve, il se présente d’ores et déjà comme un outil classique et indispensable, aussi bien pour peaufiner un élément d’érudition que pour retrouver une structure générale au sein de la France – et plus généralement de l’Europe – savante.
Abordant tous les champs que permet la philosophie – métaphysique, politique, scientifique, esthétique et même hermétique (pensons à Pierre-Jean Fabre) – il offre un panorama à notre connaissance inédit du Grand Siècle, tant en amont qu’en aval, et accomplit pleinement le projet que lui avait assigné Luc Foisneau, à savoir ne pas ramener le XVIIè siècle aux seules figures de Descartes et Louis XIV.
Naturellement, comme pour toute entreprise de ce type, on peut ergoter en fonction de ses intérêts propres – nous l’avons mentionné pour la relative absence de Mme de Rambouillet – et juger que tel ou tel présupposé y joue un rôle excessif – tel est selon nous le privilège de l’œuvre écrite qui continue d’écraser la conversation dans un Dictionnaire qui assume pourtant de prendre en charge les acteurs et les réseaux du savoir. Mais ces quelques réserves ne doivent pas masquer la vive admiration que nous nourrissons à l’endroit de cette entreprise, ni la reconnaissance à l’endroit des auteurs dont les notices harmonisées selon des règles strictes ainsi que l’esprit de synthèse tout comme la libéralité dans les choix bibliographiques sont à saluer avec grand enthousiasme.
[1] Niall Ferguson, La place et la tour. Réseaux, hiérarchies et lutte pour le pouvoir, Traduction Christophe Jaquet, Paris, Odile-Jacob, 2019, p. 9.
[2] Luc Foisneau (dir.), Dictionnaire des philosophes français du XVIIè siècle. Acteurs et réseaux du savoir, Paris, Classiques Garnier, 2020.
[3] Ibid., p. 23.
[4] Paul Hazard, La crise de la conscience européenne (1680-1725), Paris, LGF, 1994.
[5] Luc Foisneau (dir.), Dictionnaire…op. cit., p. 24.
[6] Cf. Luc Foisneau (dir.), Dictionnaire des philosophes français du XVIIè siècle, 2 volumes, Paris, Classiques Garnier, 2021.
[7] Niall Ferguson, La place et la tour, op. cit., p. 111-112.
[8] Dictionnaire… op. cit., p. 324.
[9] Ibid.
[10] Ibid., p. 325.
[11] Benedetta Craveri, L’âge de la conversation, traduction Eliane Deschamps-Pria, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2005, p. 48.








