La philosophie politique et l’histoire judicieusement sous-titré « De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la philosophie » de Leo Strauss est un recueil de quinze articles dont certains sont inédits en français. Ils ont été réunis par l’éditeur dans un livre qui se veut le pendant de Droit naturel et histoire dont deux chapitres sont d’ailleurs repris ici. L’intention qui préside à ce recueil est sensiblement la même que dans l’ouvrage majeur de Strauss : il s’agit de dénoncer la modernité et son relativisme historique, l’« opinion selon laquelle toute pensée est fondée sur des présuppositions absolues qui varient selon les cultures, des présuppositions qui ne sont pas contestées et qui ne peuvent être contestées dans la situation à laquelle elles appartiennent et qu’elles » constituent « . »[1] Strauss au contraire affirme l’existence « de critère(s) invariable(s) pour juger des actions ou des pensées humaines. »[2]
Dans cet ouvrage Strauss fait donc feu de tout bois contre l’historicisme sous toutes ses formes. Du point de vue théorique, il n’y a pas grand-chose de nouveau mais tous les arguments contre le relativisme sont remarquablement exposés : depuis l’argument platonicien selon lequel il est nécessaire que toutes les situations politiques possèdent une essence commune (p. 52) à la dénonciation du passage d’une relativité de fait à un relativisme de droit (pp. 105-107) en passant par ce que l’on nomme le paradoxe du relativisme (pp. 63-64 ; 392). Ce dernier consiste à dire que dans la mesure où le relativisme affirme que tout est relatif, cette doctrine est tout sauf relative et se contredit donc elle-même. L’intérêt n’est donc pas tant dans les arguments avancés que dans les analyses proposées pour les soutenir.
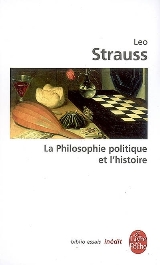
Dans cette perspective, les deux premiers chapitres partagent la même intention, ils sont consacrés à réfuter les objections à l’idée que la philosophie politique ait une portée universelle. L’objection historiciste consiste à dire que toutes les réponses aux questions philosophiques sont nécessairement historiquement conditionnées. A cela Strauss va opposer que l’historicisme est par nature incapable de se conformer aux critères de l’exactitude historique tout simplement parce que la pensée antique est non historique. En effet, le concept d’histoire a lui-même évolué. De la qualification d’une démarche humaine, celle d’enquête, il s’est mis à qualifier des événements (p. 35). C’est la raison pour laquelle la philosophie politique est anhistorique. La connaissance historique est un préalable mais elle n’est pas constitutive de la philosophie politique ( p. 40 ).
Le troisième chapitre est plus original et nous présente l’existentialisme comme une version radicale de l’historicisme. En effet, l’existentialisme est présenté comme une réaction excessive au scientisme (pp. 73-74). Strauss y affirme notamment que l’existentialisme repose sur une angoisse, un malaise dont il laisse entendre qu’ils sont propres à l’homme d’aujourd’hui et ne lui sont donc pas essentiels ( pp. 82-83 ). Un excès de rationalisme aurait eu pour contrepartie l’essor du relativisme, lequel engendre le malaise dont se nourrit l’existentialisme : « l’existentialisme est la réaction d’hommes sérieux devant leur propre relativisme. »[3] C’est le chapitre 7 qui nous fournira l’explication la plus claire de son rejet de l’existentialisme : celui-ci affirme que toutes les actions humaines n’ont d’autre fondement qu’une décision humaine libre c’est-à-dire sont historiques, raison pour laquelle il a pour corollaire le rejet d’une philosophie politique absolue alors que ce même historicisme doit nécessairement se présenter comme appartenant à un moment privilégié de l’histoire : « La pénétration historiciste est la connaissance ultime au sens où elle révèle toute la pensée antérieure comme radicalement imparfaite sur le point décisif et au sens où il n’y a aucune possibilité d’un changement légitime dans l’avenir, qui rendrait obsolète la prise de conscience historiciste ou qui pour ainsi dire la rendrait conditionnelle. En tant que connaissance absolue, elle doit nécessairement appartenir au moment absolu de l’histoire. »[4]
Le quatrième chapitre intitulé « La nature et les contradictions de l’historicisme » est une nouvelle traduction du premier chapitre de Droit naturel et histoire. Strauss y retrace la naissance de l’historicisme et tâche de le situer vis-à-vis d’autres doctrines et notamment du scepticisme. Strauss s’efforce d’y montrer que l’historicisme est paradoxalement une doctrine dogmatique.
Mais ce qui est peut-être le plus remarquable dans ce livre comme dans toute l’œuvre de Strauss d’ailleurs, c’est sa conception furieusement individualiste, pour ainsi dire héroïque, de la pensée. Celle-ci est d’ailleurs thématisée dans ce quatrième chapitre dans lequel ce qui est de l’ordre du collectif est renvoyé à l’opinion alors que la vérité procède de la connaissance privée (p. 109). Cette conception héroïque se traduit doublement : d’une part par le fait que Strauss raisonne en termes de grands penseurs comme lorsque toute la discipline historiographique est ramenée à quelques auteurs (p. 363) ou encore lorsqu’il brosse de grandes fresques philosophiques qui se résument à quelques noms de philosophes soigneusement distingués de ceux qui ne sont que des « savants »[5] ( cf. chap. 3, 8 et 15) ; et d’autre part, par le fait que Strauss est amené à attribuer à ceux-ci toutes les qualités, nous offrant ainsi de la pensée une vision discontinue constituée de quelques grands individus, quelques géants – dont les Français sont, semble-t-il, exclus par principe (cf. p. 81).
A cet égard, on lira plus précisément le chapitre intitulé « Philosophie de l’histoire de la philosophie ». Celui-ci constitue un appel à faire l’effort de comprendre la pensée d’un auteur avant de critiquer ce dernier, c’est-à-dire à lui accorder le bénéfice du doute lorsque celui-ci nous semble commettre une erreur. Certes, on ne saurait que louer ce qui apparaît de prime abord comme de la probité intellectuelle. Et en tant qu’historien des idées, on ne s’étonnera pas de voir Strauss subordonner la critique d’un auteur à sa compréhension. Mais il faut là nous poser la question : pourquoi lisons-nous un auteur ? Ce qui nous intéresse chez un auteur comme Platon, ce n’est pas tant de le comprendre pour lui-même que de savoir ce qu’il a à nous apporter, s’il dit des choses intéressantes pour nous, pour résoudre nos problèmes. C’est donc en dernier lieu la compréhension qui doit être subordonnée à la critique. En outre, la position de Strauss semble grevée par une contradiction : pourquoi faire confiance à Platon si ce n’est que l’on a observé que ce qu’il disait était pertinent ? C’est donc parce que la critique ne l’a pas pris en défaut qu’on lui fait confiance. Mais cet effort de compréhension présuppose la critique.
La pensée de Strauss peut se présenter comme un appel continuel à prendre la pensée du passé au sérieux mais on a parfois l’impression que Strauss fait preuve d’un respect exagéré vis-à-vis des grands hommes du passé comme lorsque pour réfuter l’idée que nous en sachions plus qu’eux, il use de l’argument suivant : on a peut-être oublié des choses que les penseurs du passé connaissaient ; on ne peut donc parler de progrès (p. 168). Ici, ce n’est plus accorder le bénéfice du doute, c’est signer des chèques en blanc. Strauss donne l’impression qu’il est sacrilège de toucher aux grands hommes : « la pensée de Platon ne peut pas devenir un objet pour l’historien. »[6] A ceci, on pourra préférer la conception de Pascal : ce n’est pas manquer de respect aux grands hommes que de prétendre les mettre en défaut comme eux l’ont fait avec leurs aînés, c’est au contraire respecter leur enseignement.
Ceci a pour conséquence que lorsque les Modernes sont en désaccord avec les Anciens, Strauss est alors obligé de présenter les contemporains comme superficiels pour défendre les Anciens contre l’accusation de superficialité et par ailleurs, il est amené à affirmer qu’un grand auteur ne fait rien sans raison. Une apparente contradiction est signifiante. On retrouve ce principe herméneutique assez contestable selon lequel tout a du sens. Ainsi, un grand penseur ne peut pas se tromper ou être incohérent. C’est d’ailleurs à disculper Locke, Machiavel et Xénophon de telles critiques que sont consacrés les chapitres 12, 13 et 14. Ce qui passe pour une incohérence de Locke aux yeux de commentateurs peu perspicaces est pour Strauss une stratégie (p. 346). De la même manière, Strauss nous invite à considérer qu’il faut supposer que Machiavel savait ce qu’il faisait même quand on lit sous sa plume ce qui paraît une contradiction flagrante (p. 353). Dans ces deux cas, Strauss nous invite à lire entre les lignes à partir de contradictions apparentes. On ne peut cependant s’empêcher d’éprouver la sensation que la seule justification de Strauss à sa thèse est que Locke et Machiavel sont de trop grands auteurs pour être incohérents. Le chapitre suivant oppose le « jugement caché et sérieux » de Xénophon à ses jugements évidents. Il s’agit là encore d’exonérer l’auteur : celui-ci a des raisons respectables de tenir des propos choquants. Strauss y distingue entre l’intention vraie d’un auteur et celle qu’il veut donner et affirme sans beaucoup de preuves que Xénophon dissimule sa pensée car il risque la persécution.
Le cinquième chapitre ne fait pas que poser un principe herméneutique ; il constitue une critique de la thèse de l’historien R. G.Collingwood selon lequel la philosophie consiste à connaître l’homme ; l’histoire est la connaissance de ce qu’a fait l’homme. Or l’homme est ce qu’il a fait, donc la philosophie peut être identifiée à l’histoire. Strauss y affirme à plusieurs reprises (cf. pp. 164 ; 177-178) que nous vivons une époque de déclin. Il semble que l’on ait là affaire à un double paradoxe car d’une part Strauss est amené à affirmer que chaque pensée s’est comprise sauf la pensée moderne historiciste qui ne comprend ni le passé, ni elle-même ; d’autre part Strauss a pris grand soin de discréditer le progrès car celui-ci relèverait d’une pensée historiciste. En se faisant le chantre du déclin, Strauss n’en revient-il pas à une conception historiciste, le déclin n’étant jamais que le symétrique du progrès ? C’est précisément à répondre à ce problème que s’emploie le chapitre suivant : Strauss y récuse, d’une manière que l’on peut juger médiocrement convaincante, être un théoricien de la décadence.
Le chapitre intitulé « Définir la Modernité : Modernité et historicisme » s’efforce de saisir l’essence de la Modernité : elle se caractérise par l’affirmation de la toute-puissance de l’homme. Strauss fait remonter la Modernité à Machiavel qui, contrairement aux auteurs anciens comme Platon ou Aristote, fait preuve de réalisme et affirme la possibilité de contrôler la fortune par la force alors que pour les auteurs anciens, l’homme n’était qu’une partie relativement impuissante dans le tout du cosmos. La deuxième vague de la modernité commence avec Rousseau qui rétablit le concept antique de vertu mais en le transformant et qui affirme, selon Strauss, que l’humanité est historique et s’acquiert donc. La troisième vague de modernité est liée à Nietzsche : elle marquée par le tragique de l’existence. Strauss affirme un peu abruptement une thèse trop séduisante pour être exacte, à savoir que ces trois vagues ont donné la démocratie libérale, le communisme et le fascisme
Le chapitre suivant revient sur Rousseau. Il s’agit d’une traduction inédite de la première partie du sixième chapitre de Droit naturel et histoire. Strauss commence par l’affirmation que, sans pour autant être réactionnaire, Rousseau considère que la modernité constitue une erreur radicale et qu’il faut effectuer un retour à l’âge classique. On y voit Strauss lire Rousseau et notamment le Contrat Social d’après le Discours sur les sciences et les arts et le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Strauss y fait à plusieurs reprises de l’état de nature une étape historique et affirme que le Second Discours présente une « histoire » de l’homme[7]. Ces deux points sont très contestables car Rousseau précise bien que l’état de nature « n’a jamais existé ». Pour rendre raison de cette affirmation, Strauss fournit alors une explication assez embarrassée et attribue le caractère hypothétique de l’état de nature à une prudence de Rousseau contre la censure chrétienne. Par ailleurs, on peut également contester avoir affaire à une alternative société / nature mais un schéma ternaire : société dégénérée / nature / société juste, ce qui anéantit l’idée selon laquelle Rousseau prônerait un retour à la nature. Toujours est-il que Strauss présente assez finement l’homme naturel de Rousseau comme infra-humain : pré rationnel, sans morale et sans liberté, ce qui lui fait considérer que Rousseau est à l’origine de l’abandon du droit naturel car si l’homme naturel est infra-humain, alors il n’est plus une référence, une norme et c’est pourquoi le 19ème siècle a cherché une norme dans l’histoire.
Le chapitre suivant consacré à Burke est une traduction elle aussi inédite de la seconde partie du sixième chapitre de Droit naturel et histoire. Strauss présente Burke comme partiellement historiciste car critique d’une nature humaine universelle. Ce dernier en effet met l’accent sur les devoirs et non sur les « droits de l’homme imaginaires ». Selon une conception qui inspirera Bonald, Burke rejette l’universel comme abstraction et identifie le naturel à l’individuel. En ce sens, bien que profondément réactionnaire et prônant un retour à la pensée classique, Burke s’oppose à celle-ci car il défend ce qui est contre ce qui doit être. A ceci, Strauss ne manquera pas d’objecter que ce qui est ne peut être jugé bon que par rapport à un critère transcendant : le droit naturel.
Dans le bref chapitre onze intitulé « L’origine de la modernité : l’opinion de Weber », Strauss expose les thèses de Weber en quelques pages très éclairantes mais y conteste l’opinion du sociologue qui faisait remonter la Modernité à la Réforme dans son célèbre ouvrage L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme.
L’ouvrage se termine par un chapitre consacré à Socrate et intitulé « Revenir à Socrate ». Strauss y propose une explication de l’engouement actuel pour l’historicisme : les philosophes se seraient mis à préférer le particulier à n’importe quel universel en réaction aux excès d’un universel rationnel abstrait de la même manière que le scientisme du 19ème siècle a eu pour conséquence une vague d’irrationalisme. Socrate et Platon étant les représentants de cet universalisme, ils ont été contestés par des auteurs comme Nietzsche et Heidegger et c’est la raison pour laquelle Socrate apparaît comme un problème. Cette thèse qui fait du particularisme une réaction pose néanmoins un problème que Strauss ne mentionne pas, à savoir le fait que les sophistes précèdent Socrate. Par ailleurs, Strauss reprend une nouvelle fois l’argument selon lequel l’historicisme est une doctrine contradictoire. En effet, 1) l’historicisme dit qu’il n’est pas possible de comprendre un auteur du passé comme il s’est compris lui-même. 1’) Par conséquent, on le comprend donc soit mieux, soit moins bien. 2) Or la doctrine historiciste moderne prétend mieux le comprendre sinon elle n’aurait pas de valeur ; elle est donc absolue et contradictoire. Mais cet argument repose sur l’affirmation 1’) qu’il n’y a de différence que hiérarchique. Or ceci est un présupposé de Strauss : ainsi par exemple les philosophes et historiens des sciences Paul Feyerabend et Thomas Kuhn s’efforceront de mettre au point une différence non hiérarchique.
Au final, La philosophie politique et l’histoire est un livre riche et stimulant mais dont il ressort une curieuse impression de monomanie : Strauss lit tout à l’aune de l’historicisme ce qui l’amène à rapprocher des penseurs aussi différents que Hegel et Nietzsche par exemple. De ce point de vue, l’ouvrage n’est certes pas inintéressant mais on peut néanmoins s’interroger sur sa pertinence. En effet, on aurait aimé que Strauss nous montre que la ligne de partage essentielle entre deux philosophies passait par là, ce qu’il ne fait pas. L’écriture de Strauss s’y révèle comme à l’accoutumée claire mais dense : il brasse beaucoup d’idées en peu de mots. On y trouve des passages d’une authentique fulguration où, en quelques mots, Strauss nous dévoile la matière de toute une pensée. Au prix, quelquefois, de certaines approximations ou du moins de quelques expressions malheureuses. La réflexion de Strauss demeure pourtant fort instructive et même si plusieurs chapitres intéresseront plus particulièrement les historiens de la philosophie, les problèmes en jeu ont une portée beaucoup plus large. On y trouve notamment, et ce surtout dans les derniers chapitres, une application de l’herméneutique de Strauss selon laquelle les auteurs dissimulent leurs véritables opinions afin d’éviter la persécution et ne sont donc déchiffrables que par des lecteurs avertis. Il est en revanche un point que l’on peut déplorer : c’est que Strauss se montre toujours aussi irritant dans son mode d’argumentation. Il caricature parfois les positions de ses adversaires pour en venir à bout avec plus de facilité et procède souvent par insinuations mais aussi par affirmations dogmatiques comme lorsqu’on le voit affirmer péremptoirement détenir « la perspective appropriée. »[8]. Mais d’une certaine manière, ce dogmatisme est consubstantiel à sa philosophie. En effet, dans sa lutte contre l’historicisme, Strauss est amené à dénoncer ce postulat relativiste selon lequel « la prétention de n’importe quelle interprétation à être la seule interprétation vraie est insoutenable. »[9] Au contraire, selon Strauss, il existe une et une seule vérité anhistorique, une interprétation finale et définitive : ce que les choses signifiaient pour ceux qui les ont faites. Le travail de l’historien des idées consiste donc à retrouver l’intention derrière les interprétations.
[1] Strauss, Leo, La philosophie politique et l’histoire, Paris, LGF, Livre de Poche, 2008, p. 386.
[2] Ibid. p. 169.
[3] Ibid. p. 89.
[4] Ibid. p. 199.
[5] Ibid. pp. 77-78.
[6] Ibid. p. 177.
[7] Ibid. p. 253.
[8] Ibid. p. 41.
[9] Ibid. p. 56.








