Il peut paraître surprenant de trouver recensé sur un site de philosophie un roman consacré à l’édification de la Grande Arche1 ; pourtant, dans ce récit mené de manière rythmée, apparaissent toutes les étapes de l’élaboration d’un bâtiment contemporain issu d’une commande publique, entremêlant décideurs politiques, architecte, ingénieurs, lobbies et courtisaneries en tout genre, changements de majorités, contraintes des finances publiques, et entêtements des concepteurs. A ce titre, l’ouvrage permet de prendre conscience que rien ne serait plus éloigné de la réalité qu’une représentation imaginant les grandes réalisations contemporaines comme une simple matérialisation d’un projet intellectuel, administrativement rendue possible par le pouvoir politique. C’est bien plutôt à une série d’adversités, de remaniements, voire de reniements, que convie ce roman qui se finira d’ailleurs tragiquement avec la mort de l’architecte principal, Otto van Spreckelsen qui sera appelé « Spreck » tout au long du livre.
Il y a ainsi dans ce récit une réflexion continue sur ce que signifie « concevoir » une œuvre, et ce au sens le plus littéral du terme, c’est-à-dire au sens de « donner naissance » : à bien des égards, Otto van Spreckelsen est mort des douleurs de l’enfantement de ce monument, des revirements auxquels il dut faire face, et de la progressive dénaturation de son projet initial. Et c’est là qu’apparaissent de nombreuses interrogations philosophiques, certes classiques, mais fort bien illustrées par ce cas précis : l’idéalité d’un projet résiste-t-elle à la confrontation avec sa réalisation matérielle ? « Spreck » peut-il encore être perçu comme le concepteur de l’Arche tant son état final s’éloigne de ce qu’il avait initialement conçu ? Qui est le véritable maître d’œuvre de tels bâtiments ? Peut-on déterminer des critères permettant de définir ce que serait la « dénaturation » d’un projet ? Ce sont donc à la fois l’essence d’une œuvre et le rôle de son concepteur qui, tout au long de ce roman, se trouvent mis en question, sondés, sans que l’on ne puisse leur apporter de réponse définitive.
A : Le statut de l’ouvrage
Le livre de Laurence Cossé est assurément un roman ; il en a le rythme, le caractère enlevé et l’agrément. Néanmoins, il ne se réduit pas à cela : il restitue en effet de manière tout à fait fidèle l’élaboration de ce que nous appelons aujourd’hui la Grande Arche, le choix quelque peu baroque de son concepteur, les hésitations de Mitterrand, les contraintes techniques d’ingénierie, les problèmes budgétaires, les querelles intestines, et bon nombre d’autres obstacles qui font de la réalisation de ce projet quelque chose qui parut improbable tout au long de son élaboration tant il dut surmonter d’obstacles.
Nonobstant cette visée, La Grande Arche ne saurait se substituer à l’histoire administrative de l’élaboration de ce projet ; l’ouvrage de François Chaslin, Les Paris de François Mitterrand demeure incontournable et restitue de manière critique l’envers du décor des Grands Travaux.
« Plus qu’aucune autre opération d’urbanisme, écrit ce dernier, la Défense témoignerait, si on pouvait en faire l’histoire, des hésitations de l’État confronté aux décisions d’architecture, de la tentation de marquer un site, une époque, par quelque chose de « grand » et de l’incapacité à choisir, finalement, ou à maintenir durant plusieurs années, face aux aléas de l’économie, aux manœuvres des uns et des autres, aux mouvements de l’opinion, un dessein suffisamment ferme. »2
L’histoire des hésitations et des revirements a donc déjà été faite, mais elle l’a été du point de vue administratif et du point de vue des volte-face du pouvoir politique ; le mérite du roman de Laurence Cossé est de l’enraciner dans le regard d’un étranger – Spreck est danois – qui, progressivement, se sent tout à la fois dépossédé de son œuvre et lésé sur l’ensemble de sa réalisation. L’auteur ne se contente pas de lister les décisions absurdes de l’administration, elle tâche d’évaluer ce que cela put entraîner chez Spreckelsen et quelle signification cela pouvait avoir du point de vue artistique : que signifie le rapport entre l’œuvre et son concepteur lorsque ce dernier s’en trouve à ce point dessaisi ?
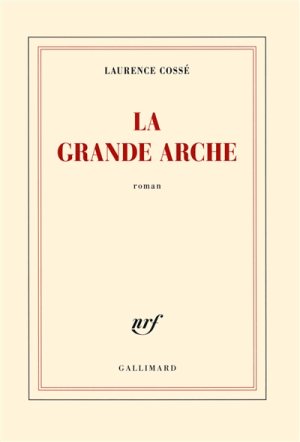
De là ce mélange très hétéroclite qui compose ce roman et qui peut donner, de prime abord, l’impression d’un certain désordre ; s’y mêlent anecdotes curieuses – notamment Spreck se rendant à l’Élysée en sabots devant un Mitterrand mi fasciné, mi exaspéré – restitutions d’arguments techniques toutefois simplifiés, rappels de contextes politiques, réflexions sur la beauté en général avec convocation de Vitruve, promoteurs véreux, subtilités juridiques, etc. Ce désordre apparent constitue pourtant la grande force du livre : c’est justement à même ce désordre, à même ce maelström épais d’aberrations en tout ordre que fut élaboré le bâtiment qui, en dépit de tout cela, sortit de terre et s’impose aujourd’hui au terme provisoire de la majestueuse perspective Est-Ouest de Paris ; ce n’est pas le moindre des mérites de Laurence Cossé que d’en restituer la complexité en entremêlant le sublime de l’idée, la misère de la médiocrité humaine, la sévérité des contraintes financières et juridiques, l’aspiration d’un Président au Symbole et le réalisme nécessaire des ingénieurs.
B : L’Arche avant Mitterrand
Contrairement à une légende savamment entretenue, la Grande Arche n’est pas au sens propre un projet de François Mitterrand ; l’idée de clore la grandiose perspective menant de la Cour Carrée du Louvre à la Défense, en passant par les Tuileries, la Concorde, les Champs-Élysées, l’Etoile, et l’avenue de la Grande Armée date de la présidence de Pompidou. Mitterrand ne fit que reprendre un projet qui ne parvenait pas à trouver son aboutissement.
« Pompidou a hésité, rappelle toujours Chaslin, manquant de conviction. Giscard d’Estaing a louvoyé trop longtemps ; et quand il a enfin tranché, c’était à quelques semaines des élections qu’il devait perdre. Mitterrand, instruit de ces échecs, a joué vite et, conscient que ses successeurs pourraient ne pas poursuivre ce qu’il entreprenait, il a hâté, à la limite du possible, l’effort fourni par l’administration, les concepteurs, les bureaux d’études, les entreprises, afin de créer l’irréversible. »3.
Par ailleurs, l’élargissement de Paris vers ses marges traditionnellement délaissées n’est pas non plus une décision spécifiquement mitterrandienne ; Giscard avait initié le réaménagement de la Villette, Pompidou celui de la Défense et du Front de Seine dans le 15ème arrondissement, si bien que lorsque Mitterrand accéde à la Présidence en 1981, le mouvement d’urbanisation centrifuge de la Capitale était déjà fort implanté. La poursuite de ce mouvement irréversible qu’observaient toutes les capitales européennes fut idéologisée et décrite comme une impulsion en direction des classes populaires, transformant une tendance générale en apparence de décision politique.
Ainsi observa-t-on dès les années 70 une sorte de renforcement des marges des grands axes parisiens, comme s’il convenait de leur donner une ceinture ou, mieux encore, une armature. « La chose est évidente pour l’axe est-ouest Louvre Tête-Défense revivifié à ses deux extrémités : à l’est par la constitution au cœur de la ville, autour du Louvre et de la Seine, d’un ensemble unique de jardins et de musées ; à l’ouest par la construction de l’ « arche de l’humanité » ponctuant la perspective tout en la laissant ouverte sur l’avenir. »4
Le roman de Laurence Cossé rappelle d’ailleurs le contenu du projet décidé sous Giscard qui faillit aboutir s’il n’y avait pas eu de changement de majorité en 1981. Cela s’était accompli dans le contexte du scandale de la Tour GAN qui, avec ses 179 mètres, et son étrange forme de croix grecque, semblait dénaturer la beauté de la perspective royale (Louvre-Défense) sur laquelle chacun avait les yeux tournés le 14 juillet 1974 lors du traditionnel défilé militaire qui coïncidait presque avec l’inauguration de la tour. Le jeune ministre des finances de l’époque – le futur président Giscard – s’en était ému et avait demandé, une fois président, que l’on bloquât désormais la toise à cent mètres.
Au moment où l’on construisait donc la tour GAN, Pompidou consultait pour savoir comment aménager la perspective ; Émile Aillaud, qui avait ses entrées dans le pompidolisme, et qui avait acquis une certaine notoriété grâce au logement social – on lui doit notamment la Grande Borne de Grigny –, avait proposé deux immeubles concaves de 70 mètres de haut, formant un demi-cercle ouvert vers Paris, reflétant la perspective. En concurrence, Peï avait suggéré d’édifier un vaste V. L’Académie d’Architecture critique vertement le projet d’Aillaud, qui dut diminuer la taille de son projet ; Peï échancra son V qui devint un U. Rien ne fut décidé. Sous la présidence de Giscard, une nouvelle consultation est ouverte en 1979 auprès de 10 architectes dont Aillaud. Pei jette l’éponge : « il ne se fait pas au processus d’a-décision à la française. »5 On demande alors un « parti monumental totalement invisible depuis la place du Carrousel jusqu’à l’Etoile, pour préserver la perspective prestigieuse des Champs-Élysées. » Six mois plus tard, une consultation est organisée, avec 23 architectes, les 10 mêmes et les 13 autres. Il faut revenir aux « règles de composition des grands axes classiques ».

En janvier 1981, un projet est retenu, signé Willerval. Ce sont des immeubles miroirs. Le compromis consterne la profession. En février 1981, Robert Lion, patron des HLM, proche des socialistes, publie une tribune dans Le Monde ; il critique le projet de Willerval qu’il qualifie d’ « exercice d’enjolivure » et demande de l’audace. Le 17 septembre 1981, le pouvoir mitterrandien annule le choix de Willeval qui est prévenu par un journaliste et non par l’Élysée. Désormais, ce sera le « groupe des quatre » constitué de Robert Lion, Jack Lang, Paul Guimard (écrivain et journaliste) et Roger Quilliot (ministre de l’urbanisme), qui pilotera le redoutable projet d’édifier un monument sur la perspective. Depuis le lancement de la réflexion en 1972 et l’arrivée des socialistes au pouvoir en 1981, rien n’a donc été décidé en dépit des multiples projets et consultations qui furent lancés : Willerval, qui semblait sur le point de mettre fin aux indécisions, fut congédié sans raisons officielles, et il fallut tout reprendre à zéro.
C : Mitterrand entre en scène
Un des aspects cruciaux du livre est la description minutieuse des choix et des décisions – ou des absences de décision – de Mitterrand, interférant avec les exigences techniques et architecturales du monument. Du pouvoir presque autoritaire en matière de décisions ornementales à la quasi-destitution de son autorité au moment de la cohabitation de 1986, toutes les étapes sont parcourues sous le regard médusé de Spreck qui, en bon danois, ne peut comprendre la dimension monarchique de la Présidence française, ni et encore moins sa subite mise à l’arrêt par la cohabitation.
En outre, on l’a peut-être oublié mais la politique de « Grands Travaux » ne constituait nullement une priorité du programme socialiste de 1981. Nonobstant ce silence, « dès l’été 1981, Mitterrand se saisit de la question et c’est une surprise pour ses proches. »6 Et Laurence Cossé de rappeler : « Il n’y avait pas eu un mot sur les projets urbains d’importance dans le programme électoral socialiste ni pendant la campagne. »7 Ce sera justement l’une des deux lacunes du roman selon nous, à savoir ne pas suffisamment interroger la raison du contraste entre l’absence de mention programmatique de l’entreprise architecturale et l’effervescence d’aménagement de la France lors des deux septennats : pourquoi ne pas en avoir parlé ? Pourquoi ne pas en avoir fait un marqueur du socialisme ? Chaque pouvoir inscrit en effet sa trace dans la pierre et la ville, et il peut paraître très intrigant que cela n’ait pas été revendiqué dès le début. « Il faut reconnaître à Mitterrand le Constructeur, parmi des intentions mêlées plus ou moins narcissiques, d’avoir renoué avec la politique architecturale. »8 Cette absence est d’autant plus étonnante que chacun a en tête la déclaration maintes fois citée de Mitterrand dans La paille et le grain, affirmant ceci : « Dans chaque ville je me sens empereur ou architecte. Je tranche, je décide, j’arbitre. » Publié en 1975, six ans avant la campagne des présidentielles, ce livre indiquait à qui savait lire l’ambition architecturale du futur Président ; le silence de la campagne à ce sujet aurait sans doute pu, à cet égard, faire l’objet d’interrogations plus poussées9.
En 1982, Robert Lion quitte la fonction de Directeur de Cabinet du Premier Ministre. Il devient directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Mitterrand le charge de lancer le programme Tête-Défense et son concours. Il n’est plus question de hauteur maximale et la toise de Giscard est abandonnée. « Il s’agit de bâtir un monument digne de la perspective historique et qui fasse bien plus que s’intégrer dans le quartier d’affaires, qui le conclue et du même coup le structure, lui confère une cohérence. »10
Les choses s’enchaînent alors rapidement et il faut reconnaître à l’ouvrage de vraiment réussir sa mise en intrigue : l’ouverture restitue avec bonheur la stupeur « Dès l’été 1981 Mitterrand s’est saisi de la question. En 1982 il a pris le parti de lancer un concours international. »11 En 1983, c’est Otto van Spreckelsen, architecte totalement méconnu qui n’avait construit que quatre églises, à l’esthétique fort douteuse, qui est retenu. Laurence Cossé restitue très bien la stupeur des participants ainsi que l’atmosphère de courtisanerie après que Robert Lion eut annoncé que le lauréat du concours était le dossier 640. « Il regarde les conseilleurs autour de lui. Tous les visages marquent l’embarras. Lion est bon prince, il met un terme à la torture. Jamais entendu ce nom-là, dit-il. Tous les visages se détendent. Moi non plus, disent en chœur les conseillers. »12
Dès lors, une sorte de malentendu tragique entre le Président et l’Architecte se met en place ; danois, Spreckelsen ne comprend pas bien le système politique français, attribue plus de pouvoir au Président qu’il n’en a réellement. Impassible, Mitterrand sait se montrer attentionné avec l’Architecte mais refuse de prendre parti de manière trop brusque. Devant les difficultés qui s’accumulent, tant techniques que financières, Spreckelsen se fige, refuse que l’on augmente de cinq étages l’Arche pour la surface utile, alors même que le budget initial de 10 milliards de francs augmente en peu de temps de 50 %. Face aux difficultés financières de 1983, l’État décide de ne plus financer l’Arche qu’à un tiers du coût total.

Spreckelsen
A chaque désaccord, Spreckelsen demande l’arbitrage de l’Élysée. Mitterrand ne prend pas parti, dit son admiration mais ne tranche pas. Il l’encourage à rester ferme. « Les jurés étrangers du concours n’avaient pas tort. Quand le président de la République décide du programme, quand il désigne le maître d’ouvrage, quand il choisit l’œuvre et parraine le lauréat, quand il se fait présenter la maquette, montrer les matériaux et qu’il visite le chantier à intervalles réguliers, tout le processus est gauchi, depuis l’avant-projet sommaire jusqu’à la dernière poignée de porte. »13 Malgré cette situation, Mitterrand n’apporte pas dans les faits un soutien inconditionnel à son architecte.
Par ailleurs, le Président aimait le bois et il fallait le manipuler. C’est l’occasion pour Laurence Cossé de rapporter une scène délicieuse où se mêlent courtisanerie, raffinement, et non-dits à partir du témoignage d’un des protagonistes de l’époque :
« « Nous savions tous que le président avait une dilection pour le poirier. Mais nous le connaissions, nous savions aussi qu’en public il ne disait jamais : je veux. Il fallait donc organiser une discussion aboutissant à la solution préférée par lui sans qu’il ait à exprimer cette préférence. En l’occurrence, il était impossible de lui faire dire : je voudrais du poirier, ni de lui dire : connaissant vos goûts, nous avons choisi du poirier. Nous avions donc prévu qu’il y ait plusieurs échantillons de bois, qu’à un moment quelqu’un dise : c’est joli ça, qu’est-ce que c’est ? qu’un autre alors réponde : c’est du poirier, et qu’un troisième renchérisse : c’est vraiment bien, pour que le président puisse conclure en disant je me rallie à votre avis, je trouve également que ce bois conviendrait bien. » »14
On assiste ainsi à des scènes surréalistes où le Président s’humilie face à l’Architecte, prend des décisions arbitraires contraires au bon sens technique, mais refuse in fine de trancher en faveur de ce même Architecte qu’il avait pourtant assuré de son soutien. Plusieurs épisodes rapportés par Laurence Cossé témoignent de cette tragi-comédie : un jour, pour contourner les difficultés techniques, Spreckelsen présente une maquette à Mitterrand, et incite ce dernier, contre tous les usages, à s’agenouiller pour se mettre le menton à hauteur de la table en vue de mieux voir. Au lieu de lever la maquette à hauteur du regard présidentiel, c’est le Président qui doit s’agenouiller en public pour s’abaisser à la hauteur de la maquette. C’est une humiliation politique, le danois Spreck ne comprenant pas que le rapport au pouvoir n’est pas le même en France et au Danemark. « Il ne dit rien mais il a l’air furieux »15, rapporte Laurence Cossé. Un autre épisode en dit long sur le rapport du pouvoir à la décision architecturale : Spreck imaginait la Grande Arche recouverte de marbre ; se posa alors la question de son traitement pour le rendre résistant aux impuretés de l’air francilien. Mitterrand refusa le traitement du marbre, considérant à juste titre qu’il risquait d’en gâcher la patine naturelle. C’était vrai ; mais c’était risqué car l’air parisien est acide, et corrode le marbre. Ce dernier, faute de traitement, ne résista pas longtemps et il fallut rapidement le remplacer à grands frais.
D : La mise à mort d’un architecte
A côté de la Grande Arche, le véritable anti-héros de ce récit tragique est son architecte, Spreckelsen ; danois égaré parmi les salons parisiens, il vogue de malentendus en malentendus, avant qu’un cancer ne l’emporte. Une scène résume à elle seule l’ampleur du quiproquo. Après que Spreckelsen eut été retenu par le jury, l’Ambassadeur du Danemark en France réunit la communauté danoise à sa résidence afin d’honorer le nouvel architecte. Ce dernier est très applaudi ce jour-là, notamment quand il déclare qu’il a construit une maison et quatre églises. C’était vrai, il n’avait construit « que » cela, mais cette déclaration allait faire l’objet d’une mésinterprétation générale. « Les Français ont pris la courte phrase de l’architecte pour une litote. Ils ont compris qu’il avait d’abord construit sa maison, et puis une quantité d’immeubles, d’écoles, de ponts, de tours, de cités administratives, avant de terminer par quatre églises, récemment. Qu’il passe sous silence tous ces bâtiments et ne fasse allusion qu’à la maison de ses débuts et aux églises de la fin leur a semblé d’une rare élégance. C’est le premier malentendu. Ce jour-là, l’ambiance est à l’euphorie et il est pris ç la légère. L’Arche fait l’unanimité. Tout le monde est touché par la puissance et la simplicité du grand portique. »16
A ce malentendu inaugural s’ajoutent des contraintes techniques gigantesques ; sous l’Arche courent les boulevards circulaires et le RER, on ne peut pas la faire reposer sur des fondations classiques ; comment faire tenir une dalle aussi vaste au-dessus du vide ? Comment résoudre le problème de la surface utile des bureaux et assurer un minimum de fonctionnalité à ces derniers ? Où placer les ascenseurs ? « Pour l’Arche, tout est compliqué dès le début. D’abord, les maîtres d’ouvrage sont quatre, l’État, représenté par le ministère de l’équipement (qui s’appelle cette année-là ministère de l’Urbanisme et du Logement (…), l’EPAD, le Centre de la communication et la Caisse des dépôts par l’intermédiaire de sa filiale, la SCIC. Spreckelsen ne voit pas comment travailler dans ces conditions. Il n’arrive pas à comprendre qui est « le client », comme il appelle la maîtrise d’ouvrage à la manière pragmatico-nordique. »17
Avec les arbitrages définitif, Spreckelsen perd sur tout : le marbre de Figaia n’est pas retenu , le nuage en verre non plus. Le sous-toit n’aura pas de caissons à l’antique. On lui donnera l’allure d’une tablette de chocolat. Les façades extérieures ne seront pas tendues de verre. On lui refuse aussi les jardins sur le toit. « A la Défense, il est écrasé. Il va être écrasé. Son œuvre menace de l’écraser. »18 C’est l’histoire de cet écrasement qui est ici restituée dans sa dimension tragique ; mais qui l’écrase ? Tout le monde et personne à la fois. Il est intransigeant, certes, et formé aux principes nordiques, hermétique au désordre français. Soit, mais personne en particulier ne semble lui en vouloir personnellement. C’est un homme perdu, égaré dans un milieu qui n’est pas le sien qui apparaît et qui l’écrase, qui le submerge, qui vide son projet de tout son sens. Mais c’est aussi la terrible réalité qui le combat, la réalité du terrain, des coûts financiers, des aléas politiques, des difficultés technologiques, qui s’impose à lui et que, jusqu’au bout, il ne semble pas intégrer. Il y a quelque chose de terrible de voir cet homme ne pas comprendre ce qui se passe, ne pas comprendre que ce n’est pas à la matière de rompre avec les lois de la physique pour satisfaire son idée, mais à son idée de respecter les lois du monde. Il y a plus que de l’intransigeance, il y a du déni, il y a un enfermement dans l’idée qui se condamne à ne pas pouvoir s’accomplir.
Le plus curieux est peut-être qu’à aucun moment l’illusion ne se dissipera ; plutôt que de s’adapter aux contraintes, il démissionnera en 1986. En toute discrétion. Presque secrètement. C’est un abandon là où il aurait pu prendre acte du réel ; mais jusqu’au bout il le refusera, le niera, au nom de l’idéal.
L’architecte Brigit de Kosmi résume fort bien la situation :
« Il n’avait jamais eu affaire à un si gros truc. Il aurait voulu quelque chose de plus léger. Dans son esprit, tout ça devait rester aérien. Mais faire aérien avec un projet comme le sien, ce n’était pas possible. Ca s’est beaucoup joué sur les dimensions, la taille des poutres, ce genre de choses. Son dessin, c’était un peu du design scandinave, un objet assez simple à concevoir, un peu comme un Rubik’s Cube qu’on met sur la table. Un Cube, ça n’a pas d’échelle, c’est un module. Dans la réalité, l’échelle du chantier le dépassait. » (cité p. 249)
Robert Lion rendra la chose mystérieuse : « il est mort de son œuvre, selon des modalités obscures. » (cité p. 281) Andreu, quant à lui, liera sa mort au refus d’affronter la réalité telle qu’elle est : « La construction, c’est une épreuve. Il a refusé l’obstacle. Du coup, il s’est infligé une épreuve bien plus dure. » (cité p. 281) C’est tout le mérite de ce roman que de mettre en scène cette mort inéluctable née du refus de l’affrontement, née de l’abandon, née du retrait en soi ; se rejoue presque ici le reproche hégélien adressé aux stoïciens dans la Phénoménologie de l’esprit : faute d’affronter le caractère déceptif du monde, le retrait en soi dans la « citadelle intérieure » s’apparente à une fuite devant la vie, dont la mort seule paraît être l’issue. Derrière le drame personnel de cet homme se joue donc quelque chose de tragique, dont les prémisses se font sentir dès les malentendus du départ.
E : Portée symbolique de la Grande Arche
Nous avions évoqué plus haut deux limites du livre de Laurence Cossé ; nous devons ici aborder la seconde d’entre elles, qui porte sur la question symbolique. A plusieurs reprises, celle-ci semble aperçue mais elle n’est jamais développée, malgré les déclarations étonnantes de Spreck :
« Un cube ouvert / Une fenêtre sur le monde / Comme un point d’orgue provisoire sur l’avenue / Avec un regard sur l’avenir. C’est un arc de Triomphe moderne / À la gloire du triomphe de l’humanité. C’est un symbole de l’espoir que dans le futur / Les hommes pourront se rencontrer librement… »
Il y aurait ici de quoi gloser des heures sur cette humanité dont on célèbre le triomphe, sur le fait qu’il s’agisse d’un arc et non d’une arche, d’un lieu de rencontre libre, etc. Mais de tout cela, Laurence Cossé ne parle pas, ou si peu. Certes, elle a pour elle la déclaration de la veuve de Spreck pour qui le Cube n’exprime « ni réflexion métaphysique, ni élucubration philosophique » (cité p. 326). Mais l’absence de réflexion métaphysique ou philosophique n’exclut aucunement la réflexion symbolique qui semble être présente à plus forte raison.
En revanche, la localisation de la Grande Arche comme point d’orgue de la perspective historique courant de la Cour Carrée à la Défense fait l’objet d’une certaine attention, notamment à travers le regard du Président. A plusieurs reprises, l’auteur rappelle en effet que Mitterrand était obsédé par la cohérence de la perspective et par la nécessité que le nouveau bâtiment ne dénature pas cette dernière :
« Personne – à part François Mitterrand – pour s’inquiéter de ce que l’on verra du monument entre les montants de l’Arc de Triomphe. Personne pour noter que la surface utile à l’intérieur du bâtiment est inférieure à ce que le concours exigeait. Il est vrai qu’on ne sait toujours pas en quoi va consister le Centre international de la communication. »19
Ou encore :
« Mitterrand, quant à lui, est toujours poursuivi par son inquiétude. Que verra-t-on de l’Arche des Champs-Élysées ? le toit ne sera-t-il pas trop massif sous l’Arc de triomphe ? Aura-t-il la « très haute qualité architecturale » exigée ? « Je suis comptable de la perspective devant la nation », répète le président. »20
La perspective historique ou royale, parfois appelée la « Voie Napoléon », est en effet l’une des plus symboliques de Paris, voire du monde : résumant à elle seule l’histoire de France, suivant la course du soleil de l’Est vers l’Ouest, elle passe, telle l’antique decumanus, du palais médiéval et renaissant à l’Orient vers les gratte-ciels des temps nouveaux à l’Occident ; en son cœur, à la Concorde, a été crucifiée la Monarchie, tandis qu’au sommet de la coline de Chaillot s’élève l’Arc célébrant les victoires impériales. Sur cet axe, le soleil se lève le 11 novembre et se couche le 8 mai ; il importait donc que l’Arche n’obstruât pas le troublant coucher solaire à travers l’Arc de Triomphe chaque 8 mai, jour où l’on célèbre la fête de l’archange saint Michel, archange protecteur de la France. Bien des ouvrages ont été consacrés à cette perspective, et il aurait peut-être intéressant que Laurence Cossé développât le sens que pouvait revêtir celle-ci pour le Président Mitterrand, non pas pour faire sienne cette signification mais pour rendre intelligible l’inquiétude que nourrissait ce dernier à son endroit.

Curieusement, Laurence Cossé se lance pourtant à un moment donné dans une comparaison entre la Grande Arche et… la Jérusalem Céleste. Le motif de ce rapprochement peut sembler mince : les deux formes ont en commun d’être cubiques. Or, on est en droit de se demander pour quelle raison, parmi toutes les réalités cubiques qui existent, l’auteur pense spécifiquement à la Jérusalem céleste dont on admettra aisément qu’elle n’est pas la première image qui vient à l’esprit ; notre hypothèse est qu’elle a lu ce rapprochement chez Dominique Setzepfandt, auteur d’un remarqué Mitterrand, Grand Architecte de l’Univers, dans lequel il fait de la Grande Arche une Jérusalem céleste inversée21. C’est là une plongée en eaux troubles, car non seulement le rapprochement est plus qu’hasardeux mais, de surcroît, il eût été justifié de préciser les raisons réelles de ce lien, ce qui est absent. Le résultat est donc quelque peu perturbant car, lorsque la symbolique est évidente – celle de la perspective –, l’auteur n’en dit presque rien, mais lorsque les analogies sont faibles, elle décide soudainement de les soumettre au lecteur derrière ce qui se veut être une licence poétique.
Conclusion
La réserve précédente portant sur la question symbolique ne doit pas occulter le grand plaisir que procure la lecture de cet ouvrage, ni la profondeur de ce dernier ; inscrit au plus près d’une construction monumentale, il rend perceptibles la précarité qui anime les décisions majeures, la versatilité des commanditaires et les contraintes techniques innombrables qui réduisent sans cesse davantage la marge de manœuvre de l’architecte. On sort de ce livre en n’ayant pas vraiment de réponse à la question inaugurale : qui a conçu la Grande Arche ? Celle-ci ne peut guère être référée à une œuvre collective car les contraintes matérielles jouent un rôle plus important encore que les décisions humaines, si bien que l’inerte devient lui-même coproducteur du bâtiment, et c’est peut-être cela le plus déroutant que révèle ce livre.
Le nom même du bâtiment n’est pas clair : Spreckelsen parlait volontiers d’un « cube » mais, aujourd’hui, chacun parle d’une « Arche » et, plus généralement, de la Grande Arche ; or, en toute logique, une arche relie deux points, deux éléments, et est symbole de passage, ce que n’est pas le cube. Ne faudrait-il pas alors se demander si l’intention même du bâtiment, au-delà de sa réalisation technique, n’aurait pas également échappé à son concepteur, comme absorbée par la logique de la perspective royale, constituant ainsi une troisième porte géante, après celle du Carrousel et de l’Etoile ?
- Laurence Cossé, La Grande Arche, Paris, Gallimard, 2016
- François Chalin, Les Paris de François Mitterrand, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1985, p. 155.
- Ibid.
- Jean-Michel Duthilleul, « Le Paris de demain », in Paris, de la préhistoire à nos jours, Paris, Bordessoules, 1985, p. 686
- La Grande Arche, op. cit., p. 24.
- Ibid., p. 27
- Ibid., p. 28
- Ibid., p. 45
- On sait que le très sulfureux Jean-Paul Bourre, analysant sous forme romanesque cette incongruité, en avait conclu que Mitterrand, une fois élu, avait passé un pacte avec une société occulte, monnayant un remède sacré contre le cancer en l’échange du marquage hermétique de Paris ; cf. Jean-Paul Bourre, L’élu du serpent rouge, Paris, les Belles Lettres
- Ibid., p. 47
- Ibid., p. 12
- Ibid.., p. 13
- Ibid., p. 151
- Ibid., p. 152
- Ibid., p. 170
- Ibid., p. 76-77
- Ibid., p. 91
- Ibid., p. 178
- Ibid., p. 77
- Ibid., p. 87
- cf. Dominique Setzepfandt, Mitterrand, Grand Architecte de l’Univers, Faits et Documents, 1995, p. 100








