Le rapport à autrui reste, chez Spinoza, foncièrement paradoxal lorsqu’on le compare au statut qu’il possède dans l’éthique traditionnelle. C’est pourquoi on a pu considérer, de façon contrastée, Spinoza comme un « immoraliste », comme le fait Gilles Deleuze [1], ou, au contraire, reconnaître, comme le défendent, entre autres, René Worms, Sylvain Zac, et Chantal Jaquet, que Spinoza maintient l’ensemble des valeurs humaines[2], ou bien, comme le propose par exemple Andrew Collier, de repérer dans le spinozisme une moralité trans-personnelle[3]. Nous essayerons de montrer que ces interprétations divergentes procèdent des difficultés que Spinoza a rencontrées à réaliser son projet de transformer l’utilitarisme en altruisme rationnel. Du fait que sa philosophie morale se trouve basée sur l’immanence des valeurs, elle n’est pas parvenue à surmonter l’égoïsme individuel lié à la puissance du conatus propre à chacun. En ce sens, nous analyserons les notions spinozistes d’imitation, de coopération et d’homme libre, ainsi que l’aspiration de ce dernier à demeurer toujours juste, de bonne foi et honnête.
La nature de l’altruisme spinoziste
 Rappelons d’abord que, si Spinoza semble avoir repris la notion aristotélicienne de φιλία[4], son utilitarisme n’a toutefois pas conservé les notions fondamentales de l’Ethique à Nicomaque, bien qu’il ait tenté de les appliquer à la communauté des individus rationnels[5]. Aristote associe toujours la recherche du bonheur (εὐδαιμονία), défini comme but suprême de l’action humaine[6], à l’amitié ou à l’amour (φιλία), qui visent directement le bien d’autrui[7]. Tout en différenciant le bonheur du plaisir, qui n’est qu’un devenir[8], Aristote oppose l’individu, qui vise au bien parfait, à celui qui, se suffisant à lui-même (αὐτάρκεια), finit par s’isoler de ses parents, de son conjoint, de ses amis et de ses concitoyens[9]. Aristote différencie également entre l’amitié basée sur l’utilité, l’amitié fondée sur le plaisir, et l’amitié procédant de la vertu qui est la seule amitié parfaite, car elle existe de façon absolue[10]. Cette amitié permet à l’homme de considérer autrui pour ce qu’il est en soi. Aristote souligne que « l’amitié basée sur l’utilité disparaît en même temps que le profit (qu’on a pu en tirer) : car ces amis ne s’aimaient pas l’un l’autre, mais n’aimaient que leur intérêt »[11]. Dans le sillage d’Aristote, Spinoza affirme que la recherche du bien d’autrui reste bien une condition nécessaire à l’établissement d’une communauté amicale car, comme il le précise à Blyenberg, « il n’est rien que je place au-dessus des relations amicales avec des hommes aimant de tout cœur la vérité (Nullas ex omnibus rebus, quae in potestate mea non sunt, pluris facio, quam cum Viris veritatem sincere amantibus foedus inire amicitiae) »[12]. De même, l’Ethique pose que, si « deux individus, entièrement de même nature, se joignent l’un à l’autre, ils composent un individu plus puissant que chacun pris séparément (individuum componunt singulo duplo potentius) », car « rien n’est plus utile à l’homme que l’homme (homini igitur nihil homine utilius) »[13]. Spinoza ajoute que la convenance entre les hommes permet de conserver leur être : « il n’est rien, dis-je, que les hommes puissent souhaiter de mieux pour conserver leur être, que de convenir tous en tout (nihil inquam homines præstantius ad suum esse conservandum optare possunt quam quod omnes in omnibus ita conveniant) »[14].
Rappelons d’abord que, si Spinoza semble avoir repris la notion aristotélicienne de φιλία[4], son utilitarisme n’a toutefois pas conservé les notions fondamentales de l’Ethique à Nicomaque, bien qu’il ait tenté de les appliquer à la communauté des individus rationnels[5]. Aristote associe toujours la recherche du bonheur (εὐδαιμονία), défini comme but suprême de l’action humaine[6], à l’amitié ou à l’amour (φιλία), qui visent directement le bien d’autrui[7]. Tout en différenciant le bonheur du plaisir, qui n’est qu’un devenir[8], Aristote oppose l’individu, qui vise au bien parfait, à celui qui, se suffisant à lui-même (αὐτάρκεια), finit par s’isoler de ses parents, de son conjoint, de ses amis et de ses concitoyens[9]. Aristote différencie également entre l’amitié basée sur l’utilité, l’amitié fondée sur le plaisir, et l’amitié procédant de la vertu qui est la seule amitié parfaite, car elle existe de façon absolue[10]. Cette amitié permet à l’homme de considérer autrui pour ce qu’il est en soi. Aristote souligne que « l’amitié basée sur l’utilité disparaît en même temps que le profit (qu’on a pu en tirer) : car ces amis ne s’aimaient pas l’un l’autre, mais n’aimaient que leur intérêt »[11]. Dans le sillage d’Aristote, Spinoza affirme que la recherche du bien d’autrui reste bien une condition nécessaire à l’établissement d’une communauté amicale car, comme il le précise à Blyenberg, « il n’est rien que je place au-dessus des relations amicales avec des hommes aimant de tout cœur la vérité (Nullas ex omnibus rebus, quae in potestate mea non sunt, pluris facio, quam cum Viris veritatem sincere amantibus foedus inire amicitiae) »[12]. De même, l’Ethique pose que, si « deux individus, entièrement de même nature, se joignent l’un à l’autre, ils composent un individu plus puissant que chacun pris séparément (individuum componunt singulo duplo potentius) », car « rien n’est plus utile à l’homme que l’homme (homini igitur nihil homine utilius) »[13]. Spinoza ajoute que la convenance entre les hommes permet de conserver leur être : « il n’est rien, dis-je, que les hommes puissent souhaiter de mieux pour conserver leur être, que de convenir tous en tout (nihil inquam homines præstantius ad suum esse conservandum optare possunt quam quod omnes in omnibus ita conveniant) »[14].
Cependant, malgré ces textes apparemment altruistes, d’autres passages de l’Ethique permettent d’en montrer les limites, et de préciser ainsi le statut de l’altruisme spinoziste. Rappelons que, dans le De Mente, Spinoza introduit les notions qui sont communes aux corps (quod omnibus corporibus commune)[15], et dans le De affectibus, les « propriétés communes de l’esprit (mentis communes proprietates)[16]. Il note qu’il est absurde de penser que ce qui est commun avec nous (quod nobiscum commune) puisse être mauvais (mala)[17], car en tant qu’ils vivent sous la conduite de la raison (ex ductu rationis vivunt), les hommes conviennent (conveniunt) nécessairement en nature[18]. Or, cette thèse a été diversement interprétée par les commentateurs. Selon Diane Steinberg, le fait de posséder quelque chose en commun implique qu’une propriété commune à deux individus ne saurait être une source de conflit entre eux. Steinberg interprète Ethique IV, 30 « Nulle chose ne peut être mauvaise par ce qu’elle a de commun avec notre nature (Res nulla per id quod cum nostra natura commune habet, potest esse mala) », de la manière suivante : si X possède la propriété A, qui est commune à Y, alors X ne peut être malfaisant vis-à-vis de Y, puisque X ne saurait porter atteinte à la qualité A qu’il possède en commun avec Y. C’est pourquoi, dans la mesure où X tend à préserver A, dont les caractéristiques sont communes avec Y, son conatus, c’est-à-dire sa puissance d’agir, s’accorde nécessairement avec celui de Y[19]. Au contraire, Jonathan F. Bennett souligne que deux choses ou deux individus qui se ressemblent restent malgré tout distincts, et donc ce qui leur est commun n’est nullement capable de neutraliser leurs conflits d’intérêts[20]. Lorsque deux individus devenus rationnels agissent davantage conformément à leur propre nature, moins on ne saurait les distinguer, car les caractéristiques qui leur sont communes tendent alors à devenir identiques. En fonction du Principe des Indiscernables, que Spinoza formule dans Ethique I, 4 et Ethique I, 5 Démonstration[21], on peut comprendre que c’est seulement dans la mesure où deux individus deviennent une seule personne, que ce qui est utile à l’un devient réellement utile à l’autre, augmentant alors conjointement leur puissance d’agir. Autrement dit, comme le formule Spinoza, lorsqu’ils conviennent en tout, « les esprits et les corps de tous composent pour ainsi dire un seul esprit et un seul corps (quod omnes in omnibus ita conveniant ut omnium mentes et corpora unam quasi mentem unumque corpus componant) »[22]. Cependant, ce cas limite reste un pur idéal entièrement inaccessible, puisque, selon Spinoza, l’être humain est toujours en proie aux affects par lesquels les individus diffèrent nécessairement entre eux. De ce fait, on ne saurait isoler entièrement une nature, qui serait commune aux hommes, de la réalité passionnelle propre à chacun, et donc leur identité qui n’est jamais complète mais seulement partielle, en raison de leurs différences spécifiques.
La notion d’altruisme se trouve déterminée par celle de semblable. Rappelons que l’Ethique mentionne les idées semblables que nous formons (ideas formemus similes)[23], ainsi que l’affect semblable (simili affectu) à celui qu’éprouve autrui[24], sans toutefois employer le terme « similarité ». Concernant les relations humaines, Spinoza décrit ce qui est commun avec notre nature (natura commune habet)[25], et l’action rationnelle de chacun, tout en étant au service de l’utile, permet d’en faire bénéficier tous les autres individus qui agissent d’une manière similaire. Pour Spinoza, le fait de vivre sous la conduite de la raison entraîne nécessairement la réalisation d’actions qui sont bonnes et « par conséquent pour tout homme (consequenter unicuique homini) »[26], et il qualifie ces actions de « piété (pietatem) »[27]. Cependant, comme le souligne Michael Della Rocca, une telle similarité entraîne des conséquences totalement invraisemblables. En effet, le fait de partager une nature rationnelle commune avec d’autres individus ne peut être limité à ceux qui sont co-présents, mais elle doit aussi logiquement s’appliquer à tout être rationnel, quelle que soit la distance géographique qui sépare ces individus. Le bénéfice lié à cette rationalité commune ne concernerait pas seulement les êtres qui sont proches et contemporains, mais également l’ensemble de l’humanité rationnelle visée par une telle similarité, incluant même les individus déjà décédés[28]. C’est pourquoi, on a pu contester la thèse de l’identité des êtres qui conviennent en nature, pour lui substituer celle de la compatibilité des effets produits par la convenance entre les individus. Ceux-ci ne s’accordent pas du fait qu’ils deviennent le même individu, mais seulement en raison de la similitude des puissances qui sont liées à leurs propriétés communes. Ces propriétés, lorsqu’elles s’accordent entre elles, sont alors bénéfiques pour ces individus, mais lorsqu’elles s’opposent, elles constituent alors des sources de conflits[29]. Essayons de préciser cette question à travers l’analyse de la notion d’imitation.
L’imitation des affects, autrui et les neurones miroirs
 Pour Spinoza, l’imitatio se trouve à la source de toute bienveillance (benevolentia) à l’égard d’autrui, et elle engendre le « désir de faire du bien à celui qui nous fait pitié (cupiditas benefaciendi ei cujus nos miseret) »[30]. Il précise d’une part, que la pitié est l’imitatio qui se rapporte à la tristesse (tristitiam)[31], et d’autre part, que l’homme qui vit sous la conduite de la raison s’efforce, autant que possible, que « la pitié ne le touche pas (ne commiseratione tangatur) »[32]. Lorsque la pitié procède du désir, elle s’appelle émulation (æmulatio), et « elle n’est rien d’autre que le désir d’une certaine chose qu’engendre en nous le fait que nous imaginons que d’autres, semblables à nous, ont le même désir (quod alios nobis similes eandem cupiditatem habere imaginamur) » [33]. C’est pourquoi l’émulation, qui constitue une loi de l’activité humaine, est toujours au service du conatus[34].
Pour Spinoza, l’imitatio se trouve à la source de toute bienveillance (benevolentia) à l’égard d’autrui, et elle engendre le « désir de faire du bien à celui qui nous fait pitié (cupiditas benefaciendi ei cujus nos miseret) »[30]. Il précise d’une part, que la pitié est l’imitatio qui se rapporte à la tristesse (tristitiam)[31], et d’autre part, que l’homme qui vit sous la conduite de la raison s’efforce, autant que possible, que « la pitié ne le touche pas (ne commiseratione tangatur) »[32]. Lorsque la pitié procède du désir, elle s’appelle émulation (æmulatio), et « elle n’est rien d’autre que le désir d’une certaine chose qu’engendre en nous le fait que nous imaginons que d’autres, semblables à nous, ont le même désir (quod alios nobis similes eandem cupiditatem habere imaginamur) » [33]. C’est pourquoi l’émulation, qui constitue une loi de l’activité humaine, est toujours au service du conatus[34].
Comme le souligne R. J. Delahunty, le fait de percevoir un comportement spécifique d’autrui n’implique pas toujours un processus d’imitation du comportement observé, afin de faire du bien à autrui. Il peut même entraîner un comportement réactionnel opposé, comme la défense, dans le cas, par exemple, de situations jugées dangereuses. De plus, ce que l’on perçoit des émotions d’autrui ne constitue qu’une infime partie des mécanismes complexes déterminant les émotions individuelles, et ces mécanismes ne sont jamais directement observables. D’une façon générale, les comportements d’autrui renvoient à une série de processus physiologiques complexes qui, pour une large part, échappent à l’observateur[35].
Spinoza a bien envisagé le fait que l’imitation puisse entraîner des frictions sociales, lorsque les individus, qui sont par ailleurs susceptibles d’éprouver de la pitié, cherchent à utiliser l’imitation d’une façon négative, en devenant, par exemple, « envieux et ambitieux (invidos et ambitiosos) »[36]. Mais Spinoza semble malgré tout convaincu que l’imitation constitue, du moins pour les hommes qui ne sont pas gouvernés par la raison, le moteur principal de la socialité[37].
On a pu rapprocher la conception spinoziste de l’imitation, d’une part de la théorie de la « mimésis » de René Girard, et d’autre part de la découverte des « neurones miroirs ». Concernant la notion de mimésis, Gabriel Tarde avait soutenu, dans une perspective évolutionniste, que l’imitation se trouve au fondement même de l’harmonie sociale[38]. De même, la psycholinguistique a montré l’importance de l’imitation pour l’acquisition du langage[39]. Cependant, selon Girard, le mimétisme commande d’abord une situation de rivalité portant sur un objet de désir commun, et il n’implique nullement l’altruisme, comme le pensait Spinoza. En effet, les adversaires, en fonction du renforcement de la rivalité, qui s’accompagne d’une hostilité mutuelle, se ressemblent de plus en plus[40]. La réciprocité, qui résulte de la mimésis, est en même temps source de violence car chaque individu devient l’« obstacle-modèle de l’autre », du fait que chacun pose son propre désir comme étant primordial[41]. ’est pourquoi, la plupart du temps, l’imitation n’est pas au service de la coopération, au sens spinoziste du terme ; au contraire elle oppose les ambitions qui sont similaires car, d’une façon générale, la mimésis, se trouvant liée au désir, débouche automatiquement sur le conflit[42].
Concernant le rapport entre la notion spinoziste d’imitation et la théorie des « neurones miroirs »[43], qui a elle-même été rapprochée de la thèse de René Girard[44], rappelons que cette théorie est née des modèles empathiques issus, notamment, des travaux de Giacomo Rizzolatti et de Vittorio Gallese [45]. Ces chercheurs ont mis en évidence, dans le cortex pré-moteur ventral du macaque, plus précisément dans les aires F4 et F5, l’existence de neurones moteurs, dits « neurones miroirs », qui se trouvent activés au moment de l’observation d’une action intentionnelle ou d’une expérience émotive réalisée ou présentée par un autre singe. L’existence de tels neurones miroirs a été également établie chez l’homme[46]. La théorie des neurones miroirs a permis de déterminer la base neurobiologique du sentiment de propriété, stimulé, chez l’animal, par l’observation d’un autre animal qui s’approprie un objet[47].
Cependant, les projections anthropologiques et sociales de la théorie des neurones miroirs doivent être nuancées. Comme l’ont noté Pierre Jacob et Marc Jeannerod, l’activation du système des neurones miroirs est purement biologique et elle ne présente aucune caractéristique sociale. Le macaque qui cherche, par exemple, à s’emparer d’un fruit, n’a nullement l’intention de communiquer une quelconque information pratique à ses congénères. De plus, la base neurale de la cognition sociale humaine est d’abord d’ordre perceptuel et non moteur. Le fait d’observer une action, et de la comprendre, n’implique pas en retour l’exécution de cette action par son observateur. Ainsi par exemple, en cas de menace, il semble souvent plus adapté de fuir que de menacer à son tour l’individu menaçant. De nombreuses interactions sociales font intervenir des procédés communicationnels à distance, qui ne passent pas par des réactions motrices corporelles. Jacob et Jeannerod ont souligné, qu’au moment où un sujet observe, voire imite, les mouvements d’un autre individu, il est peu probable qu’il puisse reproduire, dans son registre neuro-moteur, l’ensemble des déterminations intentionnelles et sociales qui ont accompagné l’action préalablement produite par l’individu observé[48].
Le dilemme du prisonnier
A la thèse spinoziste, concernant l’intérêt que les individus ont à coopérer, R. J. Delahunty a objecté le dilemme dit du prisonnier, décrit en 1950 par Albert W. Tucker[49]. Ce dilemme montre que dans certaines situations, la coopération entre les individus va à l’encontre de l’intérêt de chacun[50]. Il décrit le cas de deux prisonniers qui, ayant perpétué ensemble un crime, se trouvent incarcérés dans des cellules séparées, sans pouvoir communiquer entre eux. A la proposition faite par les enquêteurs d’une remise de peine au cas où chacun dénoncerait l’autre, les deux prisonniers se trouvent face au choix de couvrir son camarade (en coopérant avec lui), ou de le dénoncer, en bénéficiant alors d’une remise de peine. Chaque prisonnier, craignant que l’autre va en fait le dénoncer, fera alors le choix, qui lui semble le plus « rationnel », de dénoncer son complice, car aucun des deux n’a le moyen de convaincre l’autre de coopérer[51]. Selon Steven Barbone, l’objection de Delahunty ne saurait s’appliquer à la communauté éthique, décrite par Spinoza dans le De Servitute Humana, dans la mesure où ce dilemme ne concerne qu’une situation se trouvant orientée par des actes (act-oriented), et non, comme celle proposée par Spinoza, orientée par des règles (rule-oriented). Il en veut pour preuve le texte d’Ethique IV, 37, Scolie II, affirmant : « pour que les hommes puissent vivre dans la concorde et s’aider, il est nécessaire qu’ils cèdent de leur droit naturel, et s’assurent mutuellement de ne rien faire qui puisse tourner au détriment d’autrui (nihil acturos quod possit in alterius damnum cedere) »[52]. Nous ne pensons pas que cette objection soit vraiment pertinente, et ce d’abord, parce que la « rule orientation » est une notion normative, subsumant sous des classes générales, des actes moraux qui sont toujours particuliers[53]. Or Spinoza refuse l’idée de norme, même si elle se trouve impliquée par la notion d’exemplar, introduite dans la Préface à Ethique IV[54]. Ensuite, Barbone ne cite pas la seconde partie du Scolie, qui modère le projet de société idéale que Spinoza vise à promouvoir, en soulignant que c’est par la « loi que la société peut s’affermir (igitur lege societas firmari poterit) ». Du fait que la raison ne peut réprimer les affects, la société doit alors juger du bien et du mal (bono et malo judicandi), et assurer ainsi son autorité par « des menaces (minis) »[55]. En effet la raison, secondaire par rapport au désir, doit toujours s’y adapter, sans jamais pouvoir le transformer réellement[56]. L’éthique spinoziste, se voulant orientée par des règles (rule-oriented), se trouve en fait guidée par des actes (act-oriented), qui restent toujours particuliers, dépendant à la fois du désir propre à chacun et des contraintes sociales. La thèse de Spinoza se trouve ainsi démentie par le dilemme du prisonnier, montrant que l’utilité peut consister à ne pas coopérer avec les autres individus, et ce, tout en faisant pleinement usage de la raison. On a pu souligner que ce dilemme concerne uniquement l’état de nature, où le choix porte sur l’intérêt propre à chacun, sans jamais se soucier ni d’autrui ni du bien collectif[57]. Il pourrait ainsi illustrer la parole de l’insensé tel qu’il se trouve présenté par Hobbes, disant en son cœur qu’il n’y a point de justice, « que la conservation et la satisfaction de chacun relevant de son propre soin, il ne peut y avoir de raison pour laquelle chacun ne ferait pas ce qu’il estimerait avoir à faire pour y parvenir »[58]. Rappelons que, selon Amartya K. Sen, le dilemme du prisonnier se limite à deux individus, mais que, concernant un groupe, il est possible d’appliquer ce qu’il appelle l’assurance problem. Ce dernier décrit le fait que dans une communauté, chaque individu attend des autres qu’ils agissent comme lui, en réalisant la chose généralement jugée comme étant bonne (right thing), puisque chaque membre du groupe social comprend qu’il est de son intérêt d’agir d’une façon semblable[59].
Nous pensons que le principe d’Amartya K. Sen s’oppose précisément au dilemme du prisonnier, dans la mesure où il présuppose un état contractuel, alors que ce dilemme concerne l’état de nature. Hobbes avait décrit l’état de nature comme une époque « où les humains vivent sans autre sécurité que celle procurée par leur propre force ou leur propre ingéniosité »[60], et il posait alors la nécessité de passer du jus naturale à la lex proprement sociale. La première désigne la liberté de faire ou de ne pas faire, alors que la seconde détermine et contraint[61].
Précisons, comme le montre Alain Caillé, que le seul moyen pour résoudre le dilemme du prisonnier reste celui du don, tel que l’a théorisé Marcel Mauss. Porteur de gratuité, le don est susceptible de « sceller l’alliance qui profitera à tous, et donc, au bout du compte, à celui qui aura pris l’initiative du désintéressement »[62]. Cela implique une confiance mutuelle entre des individus, non motivés par l’utilité, qui donne aux membres de la communauté la possibilité de poser une référence transcendante, leur permettant de structurer leurs comportements de façon optimale[63]. Or, comme nous l’avons déjà souligné par ailleurs à propos de son nominalisme, le rejet spinoziste de l’élément tiers[64], que Hobbes maintenait au titre de puissance commune se trouvant au-dessus des contractants[65], interdit d’accéder véritablement à ce que Lacan a défini comme l’ordre symbolique. Cet ordre, que Hobbes concevait précisément comme lex, constitue la condition sine qua non d’accès à la réalité et de l’établissement de la socialité véritable[66]. C’est la notion spinoziste de conatus qui permet de rejeter celle de transcendance des valeurs morales[67].
Rappelons que Pierre Bourdieu, qui s’est attaché à appliquer au domaine sociologique la notion de conatus social comme principe déterminant la plupart des conduites économiques[68], a analysé, dans cette perspective, la dynamique du don. Il dénonçait alors l’illusion altruiste partagée tant par le donateur que par le donataire, du fait que chacun vise à un « donnant-donnant, qui représente l’anéantissement de l’échange de dons »[69]. On a pu remarquer, à l’encontre de cette thèse, que le don n’est pas un acte de crédit ou d’instauration d’une dette, dans la mesure où, au-delà de l’échange des biens et de sa durée, persiste l’individualité réelle des personnes concernées par le potlatch. Alors qu’un contrat de crédit se termine lorsque ses conditions financières se trouvent réalisées, la relation humaine inaugurée par un échange de dons ne prend jamais fin avec la contrepartie reçue[70].
Selon Spinoza, la communauté d’intérêts permet de renforcer la puissance d’agir de ses membres, et de ce fait, elle favorise par là-même le passage de la convenance au bon. Ainsi dans Ethique IV, 31, Spinoza précise : « En tant qu’une chose convient avec notre nature, en cela elle est nécessairement bonne (Quatenus res aliqua cum nostra natura convenit eatenus necessario bona est) »[71]. Dans cette proposition, Spinoza passe, sans déduction préalable, d’une considération descriptive concernant la classe des choses convenant entre elles, ce qu’Ethique IV, 29, Démonstration caractérisait comme ayant « quelque chose de commun avec nous (quæ aliquid commune nobiscum habet) »[72], et qui, appartenant à une même classe, est d’ordre extensionnel, à la considération axiologique d’être nécessairement bon, qui relève d’une propriété d’ordre intensionnel[73]. Comme nous l’avons montré par ailleurs, un tel passage n’est pas légitime. Il repose sur l’usage ininterrogé du terme quatenus (comme dans la Proposition 31d’Ethique IV, que nous venons de rappeler) qui rend problématique toutes les transitions, opérées par l’Ethique, de l’ordre extensionnel à l’ordre intensionnel[74], et dont procède également celle de l’utile au bon.
La notion d’égoïsme chez Hobbes et chez Spinoza
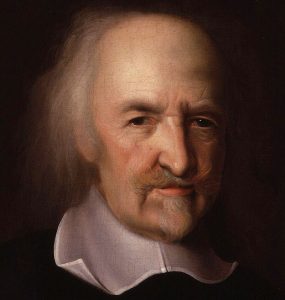 Spinoza a repris la notion d’égoïsme telle qu’elle se trouve exposée dans les écrits de Hobbes, auteur qu’il lisait dans les années 1660 au moment où il a commencé le projet de l’Ethique[75]. L’impact, notamment du De Cive et du Léviathan, sur la rédaction du Tractatus Theologico-Politicus a été largement reconnu[76]. Il convient de préciser la nature de l’emprunt possible que Spinoza aurait fait à Hobbes, concernant notamment la notion d’égoïsme. Dans The Elements of Law, Hobbes montre que « les hommes visent à la domination, à la supériorité et à la richesse privée, qui sont distinctes pour chacun, et engendrent des querelles »[77]. Dans le De Cive, il précise que dans l’état de nature règne le brigandage, la violence, la guerre et la pauvreté[78]. Si Hobbes a souvent été considéré comme le promoteur de l’intérêt de soi en tant que moteur de la pratique humaine[79], on a cependant pu observer une évolution de sa pensée. En effet, Hobbes cherchait, notamment dans le Léviathan, à canaliser la puissance propre à chacun au sein d’une structure étatique où les hommes s’unissent par consentement[80]. Comme le souligne F. S. McNeilly l’importance de ce qu’il est convenu d’appeler l’égoïsme psychologique de Hobbes s’est estompée à partir du Léviathan, du fait que la notion de plaisir n’a plus le rôle central qu’elle avait dans son précédent système de pensée[81].
Spinoza a repris la notion d’égoïsme telle qu’elle se trouve exposée dans les écrits de Hobbes, auteur qu’il lisait dans les années 1660 au moment où il a commencé le projet de l’Ethique[75]. L’impact, notamment du De Cive et du Léviathan, sur la rédaction du Tractatus Theologico-Politicus a été largement reconnu[76]. Il convient de préciser la nature de l’emprunt possible que Spinoza aurait fait à Hobbes, concernant notamment la notion d’égoïsme. Dans The Elements of Law, Hobbes montre que « les hommes visent à la domination, à la supériorité et à la richesse privée, qui sont distinctes pour chacun, et engendrent des querelles »[77]. Dans le De Cive, il précise que dans l’état de nature règne le brigandage, la violence, la guerre et la pauvreté[78]. Si Hobbes a souvent été considéré comme le promoteur de l’intérêt de soi en tant que moteur de la pratique humaine[79], on a cependant pu observer une évolution de sa pensée. En effet, Hobbes cherchait, notamment dans le Léviathan, à canaliser la puissance propre à chacun au sein d’une structure étatique où les hommes s’unissent par consentement[80]. Comme le souligne F. S. McNeilly l’importance de ce qu’il est convenu d’appeler l’égoïsme psychologique de Hobbes s’est estompée à partir du Léviathan, du fait que la notion de plaisir n’a plus le rôle central qu’elle avait dans son précédent système de pensée[81].
A Jarig Jellesz, qui lui demandait de préciser en quoi sa doctrine politique diffère de celle de Hobbes, Spinoza a répondu : « cette différence consiste en ce que je maintiens toujours le droit naturel (ego naturale Jus semper sartum tectum conservo) ; le droit du souverain se mesure à la puissance (mensuram potestatis) » [82]. Ainsi, Spinoza pensait qu’on ne pouvait jamais sortir complètement de l’état de nature, et que toute structure sociale se constitue à partir du jeu concurrentiel des conatus. En ce sens, pour Spinoza, le droit naturel possède une signification différente de celle qu’elle avait chez Hobbes, car il y ajoute la théorie des passions, qui détermine le droit lui-même[83]. Frédéric Lordon a précisé, dans une perspective spinoziste, que le conatus, tout en étant un « self-interest », est plus fondamental que l’intérêt utilitariste, qui n’en est qu’une forme historique particulière[84]. En conséquence, Spinoza n’était pas en mesure de surmonter l’égoïsme propre à l’état de nature, comme le montre l’abandon de la théorie du contrat (contractus), telle qu’elle se trouve encore exposée dans le TTP[85]. Le transfert des droits, tel qu’il apparaît dans cet ouvrage, relève d’une théorie contractualiste qui a été élaborée en l’absence de la conception définitive du conatus et de la théorie des affects, basée sur l’imitation[86]. A l’époque de la rédaction du TTP, ces notions manquaient encore, et elles seront présentées dans la troisième et la quatrième parties de l’Ethique[87]. Ayant réfuté les aspects contractualistes qui semblent encore persister dans le TP, Alexandre Matheron souligne que, nulle part dans cet ouvrage, Spinoza laisse entendre que la société politique est d’origine contractuelle. Il insiste sur le passage du TP, III, 6, affirmant que la société civile « s’institue naturellement (naturaliter instituitur) »[88].
Après avoir identifié la vertu et la puissance (Per virtutem et potentiam idem intelligo)[89], Spinoza pose que « le souverain droit de nature permet à chacun de faire ce qu’il juge servir à son utilité (summo naturæ jure facere licet quod ad ipsius utilitatem conferre judicat) »[90]. En conséquence, aucune vertu ne saurait primer (potest prior) le conatus[91]. Lorsque la raison seule nous commande d’agir, nous sommes bien guidés par la connaissance vraie de ce qui convient à chacun, mais elle vise seulement à réaliser notre intérêt personnel. C’est alors, comme le précise Matheron, que notre « bonne conscience » d’être utile aux autres, lorsque nous ne songeons d’abord qu’à nous, en vient à exprimer le postulat de l’économie politique, dont relève entièrement la notion spinoziste d’utilité : « Que chacun soit un bon égoïste calculateur, et le bien commun sera ipso-facto assuré »[92]. L’autre homme, en tant qu’il est rationnel, constitue le moyen indispensable pour servir notre intérêt. Du fait de la considération de « l’utile propre (proprium utile) », qui est liée à celle de « l’utile commun (commune utile) »[93], nos semblables feront alors « ce que nous voulons, en agissant comme bon leur semble, car ce qui leur semblera bon le sera vraiment et le sera pour tous »[94]. Comme l’a souligné Matthew J. Kishner, le rapport conflictuel des conatus exprime précisément le fossé, que Spinoza n’a jamais réussi à combler, entre l’intérêt propre à chacun et le souci d’autrui[95].
C’est pourquoi, les commentateurs ont largement reconnu la place de l’égoïsme dans l’éthique spinoziste[96]. L’égoïsme constituerait ainsi la seule valeur « éthique » que l’on puisse dégager de son système, du fait qu’il se trouve prescrit par la raison elle-même, faisant de la vertu la prémisse de ce qui constitue une véritable éthique égoïste[97]. Cette référence à l’égoïsme se reflète dans toute conception de l’éthique se réclamant de Spinoza, comme le fait, par exemple, Robert Misrahi. Cet auteur définit l’éthique en général comme le « mouvement d’un individu réel et concret, déployant son être vers l’obtention d’une plus grande satisfaction et d’une meilleure plénitude dans la vie de son désir »[98]. Contrairement à sa signification traditionnelle, une telle définition de l’éthique, ne se référant qu’à la seule satisfaction de l’individu, ne mentionne aucune considération pour autrui. Cependant, s’il existe, chez Spinoza, ce qu’on a pu appeler une « pensée de la pensée de l’autre »[99], autrui, constituant un simple moyen, reste au service de l’égoïsme propre à chacun. L’altruisme spinoziste est toujours motivé par l’intérêt personnel, et il ne vise jamais le bien d’autrui considéré pour lui-même. Sur ce point, Spinoza a pu s’inspirer de la maxime de Hillel qu’il connaissait, appelant conjointement au souci de soi et à celui d’autrui. Mais Spinoza n’a mis en avant que la première partie de cette maxime : « Si je ne me soucie point de moi, qui le ferait à ma place ? », et il rejetait le contenu de sa seconde partie : « si je me soucie (uniquement) de moi, que suis-je ?) »[100].
Le spinozisme et les normes
Spinoza a cherché à identifier l’action vertueuse et l’action rationnelle en stipulant, dans Ethique IV, 24, qu’agir absolument par vertu (ex virtute absolute agere) permet à chacun de conserver son être sous la conduite de la raison (ex ductu rationis agere). Il précise que le fondement de cette conduite consiste à « rechercher son propre utile (proprium utile quærendi) »[101]. Cependant, dans Ethique IV, 18, Scolie, Spinoza avait d’abord opéré un passage non déduit entre le simple fait d’agir sous la conduite de la raison, qui est de nature pratique et psychologique, c’est-à-dire de rechercher son propre utile « sous la conduite de la raison (ex ductus rationis) », à l’action, de type axiologique, qui s’opère « selon ce que dicte la raison (rationis dictamina) ». Et Spinoza les identifie au moyen de l’expression : « voilà ce (Haec illa) »[102]. Il passe ainsi d’une proposition constative (agir en utilisant sa raison dans la recherche de l’utilité), qui est d’ordre extensionnel puisque l’utile se réfère à une réalité objective dont l’individu peut tirer profit, à une proposition prescriptive (rationis dictamina), qui est d’ordre intensionnel. En effet, la prescription appartient à la catégorie des propositions que John L. Austin qualifiait d’éthiques, qui sont d’ordre illocutoire et donc intensionnelles[103].
La distinction que nous venons de souligner commande, semble-t-il, celle que propose Steven Barbone entre un égoïsme psychologique et un égoïsme moral. Le premier dérive de la constatation que nous sommes conduits par notre nature à rechercher notre avantage, alors que le second est normatif, et il prescrit ce que nous devons (should) rechercher en fonction de notre seule utilité[104]. Bien que Barbonne prétende que Spinoza ait dérivé le second type d’égoïsme du premier, l’auteur de l’Ethique n’a jamais justifié un tel passage, comme nous venons de le souligner à propos d’Ethique IV, 18, Scolie. Spinoza ne montre pas non plus comment la raison peut être prescriptive à partir du conatus, et il ne précise pas ce qu’elle prescrit exactement[105].
Les commentateurs se sont opposés sur le statut de la normativité chez Spinoza. Selon Edwin Curley, l’Ethique indique des préceptes de conduite visant à maximaliser la puissance d’agir de chacun. Ainsi Spinoza, d’une part se situerait dans le droit fil du Léviathan, et d’autre part il préfigurerait les préceptes hypothétiques de Kant concernant les règles d’habileté (Geschicklichkeit)[106]. Donald Rutherford soutient, toutefois, que Spinoza rejette la notion de normativité proprement dite, dans la mesure où la raison relève d’abord du conatus. De ce fait, le dictat de la raison constitue seulement un moyen rationnel et cognitif pour réaliser le désir, mais sans jamais enjoindre aucune norme de conduite proprement dite, et sans exiger que l’agent puisse agir d’une façon autre que celle par laquelle il se trouve nécessairement déterminé à agir pour son seul bénéfice. Cependant, tout en se gardant de prescrire des voies à suivre, Spinoza a cherché à définir les objectifs qu’il convient d’atteindre[107]. Ainsi, la raison ne demande rien contre la nature, et elle exige que chacun s’aime lui-même, recherche son utile, aspire à tout ce qui amène l’homme à une plus grande perfection, et absolument (absolute) parlant, que chacun s’efforce, autant qu’il est en lui de « conserver son être (conservare conetur) »[108]. De même, les choses que l’homme désire sont définies comme bonnes dans la mesure où elles ont pour but de favoriser la jouissance de la vie de l’esprit, au moyen de l’intelligence (mentis vita fruatur, quae intelligentia definitur)[109]. Ainsi peut-on comprendre que les aspects apparemment normatifs de l’Ethique ne concernent que les buts et les désirs qui doivent favoriser la persévérance dans l’être, et les moyens d’augmenter la puissance d’agir de l’individu[110]. Mais dans tous les cas, la raison reste purement cognitive et elle ne prescrit aucune règle pratique. Nous nous efforçons par la raison (ex ratione conamur) uniquement à comprendre (quam intelligere)[111]. Précisons également que Spinoza emploie le terme norme (norma) dans un contexte essentiellement immanent, soit d’ordre épistémologique : la vérité est norme d’elle-même (veritas sui sit norma)[112], ou soit d’ordre fidéiste et scripturaire : la vraie norme de détermination de la foi (veram normam fidei)[113], mais jamais dans un sens politique ou dans un sens proprement éthique, car un tel emploi aurait alors une connotation « normative » et transcendante qu’il rejetait[114].
L’ambition et l’interaction sociale
Spinoza souligne que les « hommes aspirent par nature à la société, et ne peuvent jamais l’abolir complètement (statum civilem homines natura appetere, nec fieri posse, ut homines eundem unquam penitus dissolvant) »[115]. De ce fait, chaque individu se trouve obligé de valoriser ses semblables, dans la mesure où il a toujours besoin de se sentir valorisé par eux. La valorisation dépend d’abord des affects ; ainsi, la modestie (modestia) se présente comme une ambition (ambitio)[116], qui entre elle-même dans le registre de la gloire (gloria)[117]. Spinoza précise également que l’ambition constitue le « désir excessif de la gloire (immodica gloriæ cupiditas) »[118]. Dans le De Liberta Humana, il demande que son usage soit droit (recto usus), et « non à son abus (non de ipsius abusu)[119]. D’une façon générale, l’ambition représente l’effort de faire, ou de ne pas faire quelque chose, « pour la seule raison de plaire aux hommes (ea sola de causa, ut hominibus placeamus) »[120]. Pierre Macherey a souligné le caractère narcissique de l’ambitio, terme qu’il traduit par « désir d’être bien vu », consistant à nous aimer nous-mêmes à travers le regard d’autrui, et lorsqu’il devient démesuré ce désir peut entraîner des troubles mentaux[121]. L’ambitio reste cependant irréductible, car elle constitue le « désir par lequel tous les affects se trouvent alimentés et renforcés (cupiditas qua omnes affectus foventur et corroborantur)[122]. Alors que chez Hobbes, l’ambition possède une connotation péjorative[123], elle est, pour Spinoza, le véritable ciment communautaire, que présupposent toujours les motivations d’ordre utilitaire. Alexandre Matheron identifie l’ambition à l’exigence de reconnaissance de l’homme par l’homme, et il la situe en un lieu originel où l’égoïsme et l’altruisme devraient coïncider[124]. Toutefois, une telle coïncidence semble problématique dans la mesure où personne ne peut faire table rase de son propre système de valeurs, qui reste toujours déterminé par l’intérêt de chacun, et de ce fait, ne peut donc que rarement s’accorder avec celui des autres individus. L’ambition risque toujours de mettre l’altruisme au second plan, en ne le prenant en considération que s’il peut être utile et ne pas contredire l’intérêt de l’individu ambitieux[125].
On a pu comprendre l’interaction éthico-sociale spinoziste comme constituant une forme de relationnisme, et en tant que telle, elle s’opposerait à l’égoïsme proprement dit. Elle permettrait de concilier la force du conatus, la liberté individuelle et l’intérêt d’autrui, dans le cadre d’une autonomie relationnelle. Ainsi, selon Aurelia Armstrong, l’individu spinoziste possède toujours une dimension sociale, en dehors de la quelle il ne saurait développer ses capacités naturelles. Sur le modèle des relations du tout à ses parties, tel qu’il se trouve notamment développé dans la Lettre 32 à Oldenburg, Armstrong repère une convergence, d’ordre éthique, entre le spinozisme et le féminisme. Tout en considérant l’influence sociale comme la condition nécessaire à toute autonomie, et en rejetant l’auto-suffisance, il serait ainsi possible de combiner la notion d’autonomie individuelle avec une vision du soi ancrée socialement dans des structures relationnelles. C’est dans l’économie complexe de telles relations que la femme trouverait son être authentique[126]. Cependant, concernant l’approche relationniste, on peut remarquer que l’ordre relationnel n’est pas nécessairement éthique, comme le montre, par exemple, la réalité de la violence, et plus particulièrement celle la violence conjugale, qu’on a pu précisément étudier dans une perspective spinoziste[127]. Concernant l’interprétation féministe du spinozisme, rappelons l’insistance, dans le TP, XI, 4, avec laquelle Spinoza prône l’inégalité sexuelle ; ce que W. N. A. Klever a qualifié de « page noire (zwarte bladzijde) » du spinozisme[128]. Spinoza tente en effet de justifier la condition inférieure des femmes par le fait qu’elle dérive de leur faiblesse naturelle, les empêchant ainsi d’avoir « par nature un droit égal à celui des hommes » (foeminas ex natura non aequale cum viris habere jus)[129].
Précisons que, si le spinozisme a pu apparaître comme étant capable de promouvoir un pur désintéressement intellectuel et moral, c’est parce que le conatus, aussi individuel qu’il soit, « suit de l’éternelle nécessité de la nature de Dieu (ex æterna necessitate naturæ Dei sequitur) »[130]. C’est donc la vie de Dieu qui détermine ce qu’il y a de positif dans le conatus[131]. Or, pour Spinoza, Dieu se réciproque entièrement avec la nature elle-même[132]. De ce fait, le conatus ne saurait dépasser le naturalisme où il s’inscrit, et il ne semble donc pas en mesure de surmonter l’égoïsme consubstantiel à chaque individu. La valorisation exclusive de l’immanence du conatus ne permet donc pas à l’homme de trnascender l’ordre imaginaire des déterminations naturelles, afin d’accéder à l’ordre symbolique, que nous avons mentionné précédemment, et qui constitue, selon Lacan, le réquisit de l’éthique véritable[133].
Le conatus et la coopération humaine
Spinoza rapporte le terme conatus, d’une part à l’esprit seul, et d’autre part à l’esprit associé au corps, mais jamais au corps considéré pour lui-même[134]. Dans le TP, II, 11, Spinoza explicite la « puissance de l’homme » comme devant être rapportée « plutôt à la puissance de l’esprit, qu’à la vigueur du corps (humana potentia non tam ex corporis robore quam ex mentis fortitudine aestimanda est) »[135]. Mais dans tous les cas, Spinoza pose la puissance de l’homme, se définissant par la raison, comme le produit des désirs qui sont toujours bons (semper bonæ sunt)[136]. Une telle puissante doit être inscrite dans le champ social, puisque « les hommes ne peuvent guère se maintenir en vie ou cultiver leur esprit sans le secours les uns des autres (quod homines vix absque mutuo auxilio vitam sustentare et mentem colere possint) »[137]. De plus, la puissance de l’homme doit être rattachée à la notion d’utilité, caractéristique de l’intersubjectivité : « là où les hommes seront le plus utiles les uns aux autres, c’est quand chacun recherche au plus haut point son propre utile (tum maxime homines erunt sibi invicem utiles cum maxime unusquisque suum utile sibi quærit) »[138]. Cependant, d’un point de vue sémantique Spinoza, qui maintient toujours le droit naturel[139], voit à la fois une continuité et une identité entre l’ordre intensionnel du désir spécifique à chacun, qui ne peut être substitué salva veritate à celui d’un autre individu, et l’ordre des classes communautaires culturelles, qui reste extensionnel[140]. Alexandre Matheron a souligné l’interférence entre ces deux points de vue différenciés, qui présentent chacun des sinuosités et des lenteurs auxquelles on se confronte toujours, dans la mesure où le conatus reste toujours individuel, alors que la Raison est universelle. Matheron pose la question de savoir : « comment dès lors … admettre sans réticence leur identité foncière ? »[141]. Comment l’utilité recherchée par chacun peut-elle s’accorder avec celle, visée par la communauté, des individus rationnels ? La puissance intensionnelle propre à chacun, et la communauté rationnelle, d’ordre extensionnel, ne sauraient donc être identifiées[142].
Spinoza a lui-même envisagé des situations conflictuelles liées à une communauté d’intérêts. Il constate que « Les hommes peuvent discorder en nature, en tant qu’ils sont dominés par des affects qui sont des passions (Homines natura discrepare possunt quatenus affectibus qui passiones sunt, conflictantur) »[143]. Spinoza fait alors l’hypothèse selon laquelle, ils « peuvent être contraires les uns aux autres (possunt invicem contrarii) »[144]. Il précise, dans le Scolie, que c’est lorsque deux personnes « aiment la même chose, et par conséquent conviennent en nature, qu’elles se portent tort l’une à l’autre (ex eo quod idem amant et consequenter ex eo quod natura conveniunt, sibi invicem damno sint) »[145]. Il rejette toutefois cette dernière hypothèse, puisqu’elle remet en cause la véracité des propositions 30 et 31 d’Ethique IV, ayant posé, d’une part que « Nulle chose ne peut être mauvaise par ce qu’elle a de commun avec notre nature (Res nulla per id quod cum nostra natura commune habet) » [146], et d’autre part qu’« En tant qu’une chose convient avec notre nature, en cela elle est nécessairement bonne (Quatenus res aliqua cum nostra natura convenit eatenus necessario bona est) ». Donc, le conflit entre ces individus ne procède pas du fait qu’ils aiment tous deux la même chose, mais parce qu’on « les suppose discorder en nature (quam quia natura discrepare supponuntur) » [147]. Cependant, Hobbes avait souligné l’importance de l’hypothèse rejetée par Spinoza : « si deux humains désirent la même chose, dont ils ne peuvent cependant jouir l’un et l’autre, ils deviennent ennemis »[148]. En effet, avoir les mêmes intérêts peut être bien plus conflictuel qu’unificateur. Le fait que deux ou plusieurs individus ne puissent profiter simultanément de la même chose, rend ainsi problématique le projet spinoziste de fonder une éthique interhumaine, basée sur la similitude[149]. Il ne fait aucun doute que, dans toute situation de conflits d’intérêts, le dynamisme des conatus suit la formule de Plaute, « homo homini lupus », que Spinoza a connue par le De Cive de Hobbes, et non celle qu’il a lui-même reprise de Cæcilius Statius, « homo homini deum est ». Soulignons que Spinoza n’a pas retenu la fin de la citation de Statius : « si suum officium sciat », (s’il connait son devoir) car, pour lui, l’individu ne connaît que le droit naturel, et il ignore donc tout espèce de devoir[150]. C’est en ce sens qu’on a pu rapprocher le jeu concurrentiel des conatus spinozistes de la notion darwinienne de « struggle for life »[151].
Sur la base du Scolie d’Ethique IV, 34, Matheron a analysé l’objection selon laquelle, avoir les mêmes besoins constitue en fait une source de conflits, entraînant, par exemple, que les individus se battent pour une nourriture devenue rare. Il pense que Spinoza aurait alors répondu que les raisons d’un tel conflit ne peuvent se déduire de la commune nature de ces individus, considérée en elle-même, mais elles résultent seulement des circonstances où ces individus se trouvent, c’est pourquoi, ils ne sont pas enclins naturellement à se nuire[152]. Il est possible d’objecter à cette explication le fait que les hommes étant toujours soumis à leurs passions, la possibilité même de conflit reste inéluctable car elle concerne la nature même des individus en conflit, et pas seulement les circonstances des conflits. En effet, Spinoza a lui-même noté que, restant en proie aux affects, les « hommes peuvent être contraires les uns aux autres (conflictantur, possunt invicem esse contrarii) »[153], et il précise que la soumission aux affects vient du fait qu’ils « peuvent discorder en nature (homines natura discrepare possunt) », et en conséquence « un même homme est changeant et inconstant (unus, idemque homo varius est, et inconstans) »[154]. Le contenu de cette proposition semble rendre quelque peu problématique la distinction, proposée par Matheron, entre la nature commune aux individus et les circonstances contingentes productrices d’affects conflictuels, puisque que Spinoza les a lui-même identifiées. Et ce, d’autant plus, comme le note Julien Busse, qu’on ne peut distinguer, dans le spinozisme, entre la notion de « nature de l’homme » de celle d’ « essence humaine ». La première notion renvoie à la nature humaine en général qui, se rapportant à la classe de tous les humains, est d’ordre extensionnel, alors que la seconde notion est toujours celle d’un individu particulier non substituable à un autre, et elle est donc d’ordre intensionnel. La notion d’essence humaine est d’abord utilisée, par Spinoza, pour penser le rapport de l’homme à lui-même : « c’est pour persévérer dans son être que Pierre fait effort, et non dans l’être de Paul ou de l’humanité »[155]. La nature humaine, telle qu’elle se trouve conçue par Spinoza, est donc profondément sui-référentielle, et nullement altruiste.
On a pu suggérer que, dans le cas de deux personnes mourant de faim, et ne possédant qu’une seule ration de nourriture, il paraît rationnel, dans une perspective spinoziste, que chacun essaye de s’emparer de cette ration. Cependant, la raison peut aussi dicter, mais dans une perspective non spinoziste, que chacun désire que l’autre bénéficie de cette ration unique, puisqu’il en a également besoin. Une autre solution, tout autant rationnelle, serait également de tirer au sort, même si l’un des deux souffrira nécessairement des conséquences de cette solution[156]. Rappelons que l’exemple, suggéré par Hobbes, de deux individus désirant la même chose, se trouve déjà exposé, sous une autre forme, par le Talmud ; précisant alors le cadre d’exercice des impératifs de la responsabilité éthique interhumaine. Il rapporte le dilemme suivant : deux hommes marchent ensemble dans un désert, l’un possède une gourde d’eau, dont la quantité ne peut assurer la survie que d’un seul individu. Ben Petur’a est d’avis qu’ils doivent partager cette eau, même au risque de mourir tous les deux ; Rabbi ‘Aqyb’a soutient que celui qui porte la gourde doit en garder l’eau afin de survivre. Cette dernière opinion peut paraître étonnante, du fait que Rabbi ‘Aqyb’a ait lui-même posé comme principe primordial de la Torah : « aime ton prochain comme toi-même »[157]. Cependant, le Maharsh’a (acronyme de Moreynou ha-Rav Rabbi Shmou’el ’Eydels, 1555-1631) précise que l’opinion de Rabbi ‘Aqyb’a se réfère uniquement au cas où la gourde serait la propriété d’un seul individu, mais si elle appartient effectivement à ces deux personnes, ils doivent alors partager l’eau, même au risque de périr tous les deux[158]. En effet, personne ne peut prétendre que son sang est plus rouge (a plus de valeur) que le sang de son prochain[159]. En ce sens, comme l’exprime Emmanuel Levinas, la responsabilité éthique envers autrui prend le sujet en otage par l’exigence infinie de l’éthique vis-à-vis de son prochain[160]. Contrairement à ce que Spinoza soutenait, une telle responsabilité oblige le sujet à surseoir son « conatus essendi naturel »[161].
La question du passage de l’état d’égoïsme à celui de la liberté altruiste
 Comme nous l’avons souligné précédemment, le Scolie d’Ethique IV, 18 recommande de s’unir aux autres, car « à l’homme rien n’est plus utile que l’homme (Homini igitur nihil homine utilius) », afin que les esprits et les corps parviennent à composer un seul esprit et un seul corps (omnium mentes et corpora unam). En conséquence, les hommes recherchant « leur utile sous la conduite de la raison n’aspirent pour eux-mêmes à rien d’autre qu’ils ne désirent pour tous les autres hommes, et par suite ils sont justes, de bonne foi et honnêtes (justos, fidos atque honestos) » [162], et de ce fait, celui que Spinoza caractérise comme étant proprement un « homme libre, n’agit jamais trompeusement, mais toujours de bonne foi (Homo liber nunquam dolo malo sed semper cum fide agit)[163]. Toutes ces affirmations semblent contredire l’égoïsme utilitaire développé dans le De Affectibus[164]. Afin de comprendre la nature d’une telle contradiction, rappelons que, pour Hobbes, les notions de bien et de mal, ainsi que celles de juste et d’injuste, restaient inconnues dans l’état de nature[165], alors que pour Spinoza, cette situation dépourvue de toutes notions proprement axiologiques concernerait uniquement l’état de l’homme libre. En effet, comme le formule Ethique, IV, 68, « si les hommes naissaient libres, ils ne se formeraient aucun concept du bien et du mal (Si homines liberi nascerentur, nullum boni et mali formarent conceptum) ». Et dans la Démonstration de cette proposition, Spinoza précise que l’homme libre ne possède que des idées adéquates (adæquatas ideas)[166]. Cependant, comme le souligne Pierre Macherey, le groupe des propositions 67 à 73 d’Ethique IV s’inscrivent dans un espace de rationalité hypothétique, et ces propositions doivent être interprétées au conditionnel. Notons également que l’Ethique n’emploie jamais le terme mensonge, mais les expressions : « agir trompeusement (dolo malo) » et « mauvaise foi (perfidiia). L’homme libre ignore ignore ces situations car, dans le cas contraire, cela viendrait à contredire ses idées adéquates. En conséquence, l’individu qui accède à la vraie liberté ne désirera jamais se délivrer d’un danger de mort au moyen de la mauvaise foi. Dans Ethique, IV, 72, Démonstration, Spinoza souligne que si les hommes en venaient à agir trompeusement pour conserver leur être, alors « ils seraient plus avisés à ne convenir qu’en paroles, et d’être en réalité contraires les uns aux autres (hominibus consultius esset verbis solummodo convenire, re autem invicem esse contrarios) »[167].
Comme nous l’avons souligné précédemment, le Scolie d’Ethique IV, 18 recommande de s’unir aux autres, car « à l’homme rien n’est plus utile que l’homme (Homini igitur nihil homine utilius) », afin que les esprits et les corps parviennent à composer un seul esprit et un seul corps (omnium mentes et corpora unam). En conséquence, les hommes recherchant « leur utile sous la conduite de la raison n’aspirent pour eux-mêmes à rien d’autre qu’ils ne désirent pour tous les autres hommes, et par suite ils sont justes, de bonne foi et honnêtes (justos, fidos atque honestos) » [162], et de ce fait, celui que Spinoza caractérise comme étant proprement un « homme libre, n’agit jamais trompeusement, mais toujours de bonne foi (Homo liber nunquam dolo malo sed semper cum fide agit)[163]. Toutes ces affirmations semblent contredire l’égoïsme utilitaire développé dans le De Affectibus[164]. Afin de comprendre la nature d’une telle contradiction, rappelons que, pour Hobbes, les notions de bien et de mal, ainsi que celles de juste et d’injuste, restaient inconnues dans l’état de nature[165], alors que pour Spinoza, cette situation dépourvue de toutes notions proprement axiologiques concernerait uniquement l’état de l’homme libre. En effet, comme le formule Ethique, IV, 68, « si les hommes naissaient libres, ils ne se formeraient aucun concept du bien et du mal (Si homines liberi nascerentur, nullum boni et mali formarent conceptum) ». Et dans la Démonstration de cette proposition, Spinoza précise que l’homme libre ne possède que des idées adéquates (adæquatas ideas)[166]. Cependant, comme le souligne Pierre Macherey, le groupe des propositions 67 à 73 d’Ethique IV s’inscrivent dans un espace de rationalité hypothétique, et ces propositions doivent être interprétées au conditionnel. Notons également que l’Ethique n’emploie jamais le terme mensonge, mais les expressions : « agir trompeusement (dolo malo) » et « mauvaise foi (perfidiia). L’homme libre ignore ignore ces situations car, dans le cas contraire, cela viendrait à contredire ses idées adéquates. En conséquence, l’individu qui accède à la vraie liberté ne désirera jamais se délivrer d’un danger de mort au moyen de la mauvaise foi. Dans Ethique, IV, 72, Démonstration, Spinoza souligne que si les hommes en venaient à agir trompeusement pour conserver leur être, alors « ils seraient plus avisés à ne convenir qu’en paroles, et d’être en réalité contraires les uns aux autres (hominibus consultius esset verbis solummodo convenire, re autem invicem esse contrarios) »[167].
Steven Nadler précise que l’homme libre, en visant essentiellement à maintenir la communauté des êtres rationnels, ne fera rien qui irait à l’encontre de la cohésion de cette communauté, et c’est pourquoi il reste capable de surmonter, dans tous les cas, son égoïsme personnel[168]. Cependant, Michael LeBuffe souligne que la proposition 72 d’Ethique IV n’est pas directement normative, mais elle suggère simplement que, lorsqu’un homme libre se trouve dans une situation où il y aurait lieu de mentir, il n’a nullement le désir de le faire. En fait, cet homme reste toujours confronté à des circonstances dans lesquelles il doit comprendre quel type de passion risque de l’affecter, et comment il doit alors y résister afin d’augmenter sa puissance d’agir. Dans tous les cas, le comportement de l’homme libre reste toujours motivé soit de façon rationnelle, soit de façon passionnelle. Rappelons qu’Ethique IV, 59, pose qu’à « toutes les actions auxquelles nous détermine un affect, qui est une passion, nous pouvons être déterminés sans lui par la raison (Ad omnes actiones ad quas ex affectu qui passio est, determinamur, possumus absque eo a ratione determinari) »[169]. Selon LeBuffe, cette proposition n’exclut pas la possibilité que l’action rationnelle puisse être également produite par une passion. C’est précisément le sens des exemples que donne Spinoza dans le Corollaire d’Ethique IV, 63. Ainsi, le fait de manger qui, pour le malade, se trouve motivé par la peur de la mort, relève également du plaisir pour l’homme sain. Pareillement, la même action, par exemple, condamner un accusé, peut procéder ou bien d’une passion, la haine ou la colère du juge, ou bien, de façon rationnelle, être motivé par l’amour du salut public[170]. Toutefois, comme le souligne Jonathan F. Bennett, la liberté de l’homo liber spinoziste implique l’hypothèse d’un être « auto-causé », qui demeure sans affect et sans perception sensitive. Spinoza avait pourtant admis un lien nécessaire entre l’esprit humain et l’imagination, d’où procèdent les affects qui ne manquent jamais de diminuer la puissance d’agir de l’esprit et du corps[171]. Afin d’essayer de surmonter un tel lien nécessaire, Spinoza visait, en envisageant une connaissance intuitive à laquelle parviendrait l’homme libre, à instaurer un état psychique totalement dépourvu d’émotion et d’amour personnel[172]. Or, la nature humaine maintient toujours une forme de passivité indépassable du fait, par exemple, que l’homme soit mortel, et qu’il dépende des objets extérieurs pour pouvoir subsister[173]. De plus, Ethique IV, App. VII, précise que le degré d’activité et d’indépendance de l’homme se trouve déterminé par des interactions naturelles favorables et défavorables, causées par des circonstances extérieures toujours contingentes. Ces interactions ne dépendent donc pas du degré de convenance rationnelle entre les individus, mais de circonstances qui affectent l’homme, sans qu’il puisse en être l’origine[174].
On peut toutefois soutenir que si l’homme libre expérimente des affects passifs, ceux-ci ne sont jamais déterminants quant à ses désirs et à ses passions[175]. De ce point de vue, l’homme libre n’aurait que des affects autonomes, dont il s’attache à déduire, de façon géométrique, les conséquences à partir de prémisses vraies[176]. La béatitude à laquelle il parvient lui donnerait ainsi le « pouvoir de réprimer ses appétits sensuels (potestas libidines coercendi) »[177]. Cependant, selon Geneviève Lloyd, le spinozisme se heurte ici à un paradoxe insurmontable. En effet, l’esprit ne peut transformer toutes ses idées en idées adéquates, qu’au seul prix exorbitant de cesser d’exister. En effet, dans la mesure où, n’étant qu’un mode de la nature, l’esprit ne peut pas plus annuler les idées qui sont liées aux affections du corps, que l’individu ne peut prétendre échapper à la mort[178]. En outre, pour s’affirmer comme telle, la liberté de l’homme alors qualifié de libre, doit s’exprimer, en toute circonstance, dans un choix décisoire, comme celui de ne jamais mentir ; mais la possibilité même d’un tel choix se trouve exclu par le déterminisme spinoziste[179]. Un tel déterminisme exclut également la notion d’agent moral, qui présuppose les idées de liberté, de sujet et de raison délibérée de l’action ; idées qui ont toutes été écartées par Spinoza[180]. Pour toutes ces raisons, Bennett conclut que la possibilité même de l’homme libre reste incohérente dans le cadre du spinozisme[181].
D’un point de vue proprement individuel, on se heurte à la question de savoir comment l’affirmation selon laquelle l’homme libre ne ment jamais, même au prix de sa vie, reste compatible avec l’égoïsme de son conatus ? En effet, accepter de mourir pour ne pas mentir, afin de préserver le bien de la communauté des êtres rationnels, semble contredire le conatus de l’individu libre, puisqu’il cessera de durer, et il ne pourra plus alors continuer à bénéficier du bien de la communauté à laquelle il participe. Une solution possible à cette contradiction serait de faire appel à l’éternité de l’esprit, puisqu’il ne peut être entièrement détruit avec le corps, « mais il en subsiste quelque chose qui est éternel (aliquid remanet, quod aeternum est) »[182]. Comme la « mort est d’autant moins nuisible que l’esprit a une connaissance claire et distincte (quod mors eo minus est noxia quo mentis clara et distincta cognitio major) » [183], on pourrait alors supposer que l’homme libre puisse ainsi se détourner du mensonge, même s’il devait pour cela sacrifier sa vie. Cependant, comme le note Michael Della Rocca, Spinoza n’utilise pas l’argument de l’éternité de l’esprit, afin d’éviter le mensonge[184]. Du fait que le conatus de chacun reste indépassable, la conception spinoziste de l’homme libre reste finalement un rêve impossible à réaliser. L’être humain, en tant que mode fini de la substance infinie, est donc, comme tous les autres modes, déterminé « à exister et à opérer par une autre cause qui, elle aussi, est finie et a une existence déterminée (nisi ad existendum et operandum determinetur ab alia causa quæ etiam finita est et determinatam habet existentiam) », et ce à l’infini (in infinitum)[185]. En raison de ces facteurs extérieurs qu’il ne saurait entièrement maîtriser, en conséquence chacun ne peut réaliser qu’un certain degré de liberté, restant nécessairement éloigné de l’idéal de l’homme libre[186].
Rappelons que si l’Ethique affirme que l’homme libre reste toujours honnête, dans le TTP et dans le TP, Spinoza n’accorde que peu de valeur à la promesse. Il donne alors deux exemples ; celui d’une situation de force majeure (un brigand obligeant à promettre), et celui d’une promesse par rapport à soi-même (s’interdire de manger durant vingt jours). Il précise que personne n’est obligé de respecter sa promesse dans de telles circonstances[187]. L’exemple du brigand vient de Hobbes, distinguant entre une promesse licite, instituée par convention par l’état contractuel, et la promesse illicite, telle qu’elle se pratiquait dans l’état de nature[188]. L’exemple de l’engagement de ne pas manger durant vingt jours se trouve inspiré du Talmud et de Maimonide[189]. Spinoza, qui voyait dans l’état contractuel une simple continuation de l’état de nature[190], ne pouvait donc pas envisager un rapport réel d’obligation vis-à-vis d’autrui, ni un lien de fidélité auquel l’individu se serait engagé si un tel lien s’avérait contredire son intérêt personnel[191].
Nous avons cherché, dans cet article, à préciser les notions spinozistes d’utilitarisme et d’égoïsme, en analysant le projet de Spinoza de promouvoir l’altruisme et le bénéfice communautaire. Nous avons montré que la moralité spinoziste se trouve centrée sur la notion de conatus, qui détermine elle-même sa conception du bien et de la vertu. Spinoza a proposé une éthique de la similitude devant permettre d’assurer le bien commun. Notre analyse des notions de mimésis, de neurones miroirs et de l’exemple du dilemme du prisonnier, a montré que l’action de coopérer n’est pas toujours pour le bien d’autrui. De même, le fait que plusieurs individus puissent désirer la même chose constitue la plupart du temps une source de conflit. Nous avons vu également que la notion d’homme libre reste impraticable et que sa prétention à demeurer toujours juste, de bonne foi et honnête, se trouve contredite pas la théorie du conatus, et de la persistance des passions. C’est pourquoi, Spinoza n’a pas réussi à réfuter ceux qui prétendent que « rechercher son utile est le fondement de l’impiété, et non de la vertu et de la piété (suum utile quærere tenetur, impietatis, non autem virtutis et pietatis) »[192]. Comme Spinoza finira par le reconnaître, vivre d’après la loi exclusive de la raison demeure impossible, sinon à « rêver de l’âge d’or des poètes, c’est-à-dire d’une fable (seculum poetarum aureum seu fabulam somnient) »[193]. En conséquence, son projet de communauté d’êtres rationnels reste un pur idéal impossible à mettre en œuvre.
Jacques J. Rozenberg, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, ayant enseigné dans plusieurs universités françaises et étrangères au titre de « Full-Professor », est Chercheur-Associé au Centre National de la Recherche Scientifique. De formation philosophique, scientifique, psychanalytique et hébraïque, il est l’auteur et co-directeur de publication de 15 ouvrages, ainsi que de nombreux articles, en français et en anglais.
***
[1] G. Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique. Paris, Minuit, rééd. 1981, p.33
[2] R. Worms, La morale de Spinoza : examen de ses principes et de l’influence qu’elle a exercée dans les temps modernes. Paris, Hachette, 1892, pp.166-175 ; S. Zac, La morale de Spinoza. Paris, PUF, Seconde Ed. 1966 ; C. Jaquet, De la morale commune à l’éthique. La positivité du bien et du mal. Philosophique, I, 1998, pp.23-36.
[3] A. Collier, The materiality of morals: Mind, body and interest in Spinoza’s » Ethics. Studia Spinozana. Series 7, 1991, pp.69-93
[4] P. Macherey, Éthique IV: les propositions 70 et 71. Revue de Métaphysique et de Morale. 99, 4, 1994, p.469
[5] Sur la critique spinoziste de l’éthique d’Aristote, cf. H. M. Ravven, Notes on Spinoza’s Critique of Aristotle’s Ethics: From Teleology to Process Theory. Philosophy and Theology. IV, 1, 1989, pp. 3-32.
[6]Aristote, Éthique à Nicomaque. VII, 12, 11152b 22
[7] Aristote, Éthique à Nicomaque. VIII, 1, 1155a 1-30
[8] Aristote, Éthique à Nicomaque. VII, 12, 11152b 22
[9] Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 5, 1097b 8
[10] Aristote, Éthique à Nicomaque. VIII, 3-4, 1156b, 6 – 35
[11] Aristote, Éthique à Nicomaque. VIII, 5, 1157a 10-15 ; E. Peroli, Le bien de l’autre. Le rôle de la philia dans l’éthique d’Aristote. Revue d’éthique et de théologie morale. 4, 2006, pp.11-14.
[12] Spinoza, Lettre 19 à Blyenberg. Carl Gebhardt, Baruch de Spinoza Opera. Heidelberg, Carl Winter 1925, G. IV, 87, trad.franç. In Œuvres Complètes de Spinoza. Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, p.1122. Sur les différents sens de la notion d’amitié chez Spinoza, cf. F. Lucash, Spinoza on Friendship. Philosophia. 40, 2, 2012, pp.305-317.
[13] Spinoza, Ethique IV, 18, scolie. Traduction B. Pautrat. Paris, Seuil, 2010, pp.384-385
[14] Spinoza, Ethique IV,18, scolie, Pautrat, pp.386-387
[15] Spinoza, Ethique II, 37, 38 et démonstration et corollaire ; M. Gueroult, Spinoza II, L’âme. Paris, Aubier-Montaigne, 1974, pp.328-329. Gilles Deleuze souligne que le sens des notions communes est d’abord biologique, et c’est seulement en second lieu qu’elles sont communes aux esprits. Les notions communes à l’esprit dépendent de la composition des corps. G. Deleuze, Spinoza: philosophie pratique. p.127.
[16] Spinoza, Ethique III, 56, scolie, Pautrat, pp.310-311 ; C. Lazzeri, Peut-on se former des notions communes de l’esprit ? Philosophique. 1,1998, 37-52.
[17] Spinoza, Ethique IV, 30, démonstration, Pautrat, pp.400-401
[18] Spinoza, Ethique IV, 35, Pautrat, pp.406-407
[19] Spinoza, Ethique IV, 30, Pautrat, pp.400-401; D. Steinberg, Spinoza’s ethical doctrine and the unity of human nature. Journal of the History of Philosophy. 22, 3, 1984, pp.309-310
[20] J. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics. Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p.301
[21] Cf. D. Garrett, The indiscernibility of identicals and the transitivity of identity in Spinoza’s logic of the attributes, In Y. Y. Melamed (Ed.). Spinoza’s Ethics: A Critical Guide. Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp.12-42
[22] Spinoza, Ethique IV, 18, scolie, Pautrat, pp.386-387
[23] Spinoza, Ethique II, 40, scolie II, Pautrat, pp.176-177
[24] Spinoza, Ethique III, 22, Pautrat, pp.250-251
[25] Spinoza, Ethique IV, 30, Pautrat, pp.400-401
[26] Spinoza, Ethique IV, 35, démonstration, Pautrat, pp.408-409
[27] Spinoza, Ethique IV, 37, scolie 1, Pautrat, pp.41-415. Steven Nadler traduit pietatem par morality et non par piety. S. Nadler, Spinoza’s ‘Ethics’: An Introduction. Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p.243.
[28] M. Della Rocca, Spinoza. London, Routledge, 2008, pp.196-197
[29] A. Sangiacomo, Spinoza on Reason, Passions and the Supreme Good. Oxford, Oxford University Press, 2019, pp.125-126
[30] Spinoza, Ethique, III, Définition des affects, XXXV, Pautrat, pp.340-341
[31] Spinoza, Ethique, III, 27, scolie après démonstration I, Pautrat, pp.256-257
[32] Spinoza, Ethique IV, 50, corollaire, Pautrat, pp.436-437
[33] Spinoza, Ethique, III, 27, scolie après démonstration I, Pautrat, pp.256-257
[34] J. Busse, Le problème de l’essence de l’homme chez Spinoza. Paris, Publications de la Sorbonne, 2009, pp.36-37
[35] R. J. Delahunty, Spinoza-Arg Philosophers. London and New York, Routledge, 1999, pp.240-241
[36] Spinoza, Ethique, III, 32 scolie, Pautrat, pp.266-267
[37] Cf. J. Steinberg, Imitation, Representation, and Humanity in Spinoza’s Ethics. Journal of the History of Philosophy. 51, 3, 2013, p.405, note 60.
[38] G. Tarde, Les Lois de L’imitation. Paris, Alcan, 1890, p.41
[39] Cf. J. Zlatev, Intersubjectivity, mimetic schemas and the emergence of language. Intellectica, 2-3, 46-47, 2007, pp. 123-152
[40] R. Girard, Achever Clausewitz : entretiens avec Benoît Chantre, Paris, Cahiers Nord, 2007, p.112
[41] R. Girard, Critique dans un souterrain. Paris, Grasset, 1976, p.11
[42] R. Girard, La violence et le sacré. Paris, Grasset, 1972, p.205
[43] H. M. Ravven, « Spinozistic Approaches to Evolutionary Naturalism: Spinoza’s Anticipation of Contemporary Affective Neuroscience », Politics and the Life Sciences. 22, 1, 2003, p.72
[44] S. R. Garrels, « Imitation, Mirror Neurons, and Mimetic Desire: Convergence Between the Mimetic Theory of René Girard and Empirical Research on Imitation », Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture. 12-13, 2005-2006, pp. 47-86
[45] G. Rizzolatti et al. « Functional organization of inferior area 6 in the macaque monkey: II. Area F5 and the control of distal movements », Exp. Brain Res.71, 1988, 491–507; V. Gallese et al. « Action recognition in the premotor cortex », Brain. 119, 1996, pp.593-609; L. Fadiga et L. Craighero, « Des actions partagées au fait de la communication : le rôle des neurones miroirs », In N. Franck, C. Hervé et J. J. Rozenberg (Eds.), Psychose, langage et action. Approches neuro-cognitives. Bruxelles, De Boeck Supérieur,2009, pp.191-200.
[46] L. Fadiga et al. « Motor facilitation during action observation: a magnetic stimulation study », Journal of Neurophysiology. 73, 1995, 2608-2611.
[47] Cf. K. Loncarich, « Nature’s Law: The Evolutionary Origin of Property Rights », Pace Law Review. 35, 2, 2014, p.2013 et note 195
[48] P. Jacob, M. Jeannerod, « The motor theory of social cognition: a critique », Trends in Cognitive Sciences. 9, 1, 2005, pp.21-25
[49] A. W. Tucker. (1950), « A two-person dilemma (unpublished notes) », E. B. Rasmusem (Ed), Readings in Games and Information. Oxford, Blackwell Publishers, 1989, pp.7-8.
[50] R. J. Delahunty, Spinoza-Arg Philosophers. p.273
[51] R. Axelrod, Effective choice in the prisoner’s dilemma. Journal of Conflict Resolution, 24, 1, 1980, pp.3-25; More effective choice in the prisoner’s dilemma. Journal of Conflict Resolution, 24, 3, 1980, pp. 379-403. Le dilemme du prisonnier permet, notamment, de décrire la concurrence économique. Cf. D. Parrochia, Qu’est-ce que penser/calculer? Hobbes, Leibniz & Boole. Paris, Vrin, 1992, pp.84-88.
[52] Spinoza, Ethique IV, 37, scolie II, Pautrat, pp.418-419; S. Barbone, Virtue and Sociality in Spinoza. Iyyun. 42, 1993, p.389.
[53] D. K. Clark, R. V. Rakestraw, Readings in Christian Ethics: Theory and Method. Ada, MI, Baker Academic, 1994, p.144
[54] Spinoza, Préface à Ethique IV, Pautrat, pp.352-353. Même si Spinoza ne se réfère jamais à la notion de norme juridique, celle-ci reste centrale dans le TP, qui emploie les termes de loi, de décret, d’interdit et de règle. Cf. M. Lamballais, Spinoza et les normes juridiques. Implications Philosophiques, 2018, http://www.implications-philosophiques.org/ethique-et-politique/philosophie-politique/spinoza-et-les-normes-juridiques/
[55] Spinoza, Ethique IV, 37, scolie II, Pautrat, pp.418-419
[56] P. Macherey, Introduction à l’Ethique de Spinoza. La quatrième partie, la condition humaine. Paris, PUF, pp.130-135 et note 1
[57] A. Levine, The end of the state. London, Verso, 1987, p.195; M. A. Rosenthal, Two Collective Action Problems in Spinoza’s Social Contract Theory. History of Philosophy Quarterly.15, 4, 1998, pp.391-397
[58] Hobbes, Léviathan. Trad. Franç. G. Mairet, Paris, Gallimard, 2000, XV, p.250
[59] Amartya K. Sen, Isolation, Assurance and the Social Rate of Discount. The Quarterly Journal of Economics. 81, 1, 1967, pp.113-114. Pour une comparaison du principe de confiance avec la théorie de Hobbes, cf. M. Parmentier, Hobbes, la coopération et la théorie des jeux. Methodos. 10, 2010. https://journals.openedition.org/methodos/2380
[60] Hobbes, Léviathan, XIII, p.225
[61] Hobbes, Léviathan, XIV, pp.230-231
[62] A. Caillé, Anthropologie du don. Le tiers paradigme. Paris Desclée de Brouwer, 2000 p. 51 ; C.Basualdo, Pour une psychanalyse du don. Revue du MAUSS. 32, 2, 2008, p.148
[63] P. Chanial, Le free rider et le confidence man. Intérêt, confiance et sympathie. Revue du MAUSS. 31, 1, 2008, p.279
[64] Cf. J. J. Rozenberg, Spinoza, le spinozisme et les fondements de la sécularisation. Amazon, 2023, pp.50-51; L. C. Rice, Le nominalisme de Spinoza. Canadian Journal of Philosophy. 24, 1994, p.21.
[65] Hobbes, Léviathan, XIV. Trad.franç. Paris, Gallimard, 2000, p.240 ; A. Matheron, Le « droit du plus fort » : Hobbes contre Spinoza. Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, 175, 2, 1985, p.152.
[66] J. Lacan, Séminaire sur les psychoses. Paris, Seuil, 1981, p.224
[67] S. Zac, Vie, conatus, vertu. Rapports de ces notions dans la philosophie de Spinoza. Archives de Philosophie. 40, 3, 1997, p.419
[68] P. Bourdieu, Sociologie générale. Cours au Collège de France 1981-1983. Paris, Seuil, I, 2015, pp.981-982
[69] P. Bourdieu, L’économie des biens symboliques. Paris, Seuil, 1994, p.180
[70] F. Weber, Présentation de M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. Rééd. Paris, PUF, 2007, p.23
[71] Spinoza, Ethique, IV, 31, Pautrat, pp.400-40I
[72] Spinoza, Ethique IV, 29, démonstration, Pautrat, pp.398-399
[73] Cf. R. S. Hartman, Axiology as a Science. Philosophy of Science. 29, 4, 1962, p.413 et p.429
[74] Nous avons montré l’importance des notions d’extension et d’intension dans la constitution du spinozisme, ainsi que le passage illégitime d’une notion à l’autre. J. J. Rozenberg, Spinoza, le spinozisme et les fondements de la sécularisation, pp.35-41.
[75] E. M. Curley, Behind the Geometrical Method. Princeton NJ, Princeton University Press, 1988 p.119-124; S. Nadler, The lives of the Others : Spinoza on Benevolence as a Rational Virtue. In M. J. Kishner and A. Youpa (Eds), Essays on Spinoza’s Ethical Theory. Oxford, Oxford University Press, 2014, p.44.
[76] W. Sacksteder, How Much of Hobbes Might Spinoza Have Read? The Southwestern Journal of Philosophy. 11, 2, 1980, pp. 25-39; J. Terrel, Le royaume mosaïque selon le De Cive, le Léviathan et le Traité Théologico-politique. In J. Saada (Ed.). Spinoza et les politiques de la parole. Lyon, ENS, 2009, p.135. Rappelons que le De Cive a été publié en 1642, le De Corpore en 1650, le De Homine en 1658, le Léviathan, publié en anglais en 1651, a été traduit en néerlandais en 1667 puis en latin en 1668. Le TTP a été publié en 1670. Cf. A. Pacchi, Leviathan and Spinoza’s Tractatus on Revelation: some elements for a comparison. History of European Ideas.10, 5, 1989, pp.577-593.
[77] Hobbes, The Elements of Law. Natural and Politic. F. Tönnies (Ed.), Oxford, J. Thornton, 1888, p.102
[78] Hobbes, De Cive. Trad.franç. Edition numérique, 2002 Chicoutimi, Québec, p.115
[79] Nagel, Hobbes concept of obligation. The Philosophical Review. 68, 1, 1959, p. 69
[80] Hobbes, Léviathan, X, pp.170-171
[81] F. S. McNeilly, Egoism in Hobbes. The Philosophical Quarterly. 16, 64, 1966, pp. 193-206
[82] Spinoza, Lettre 50 à Jarig Jellesz. G. IV, 238-239, trad.franç. p.1230
[83] P.-F. Moreau, Spinoza l’expérience et l’éternité. Paris, PUF, 1994, p.411
[84] F. Lordon, L’intérêt souverain. Essai d’anthropologie économique spinoziste. Paris, La Découverte, 2006, p.50
[85] Spinoza, TTP, XVI, 16, pp.522-523
[86] A. Matheron, Le problème de l’évolution de Spinoza du Traité Théologico-politique au Traité Politique. In Curley and Moreau (Eds), Spinoza: Issues and Directions: The Proceedings of the Chicago Spinoza Conference. Leiden, New York, Brill, 1990, pp.267-268
[87] C. Lazzeri, Les lois de l’obéissance : sur la théorie spinoziste des transferts de droit. Les Études philosophiques, 4, 1987, pp. 423-424
[88] Spinoza, TP, III, 6, Trad.franç. C. Ramond, Paris, PUF, 2e Ed. 2015, pp.116-117; A. Matheron, Le problème de l’évolution de Spinoza du Traité Théologico-politique au Traité Politique, pp.261-262
[89] Spinoza, Ethique IV, déf. VIII, Pautrat, pp.360-361
[90] Spinoza, Ethique IV, appendice, chap. VIII, Pautrat, pp.480-481
[91] Spinoza, Ethique IV, 22, Pautrat, pp.390-391
[92] A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza. Paris, Minuit, 1969, pp.269-271; H. Wagener, Cupiditate et Potentia: the political economy of Spinoza. European Journal of The History of Economic Thought. 1, 1994, pp.475-493.
[93] Spinoza, Ethique IV, 18, scolie, Pautrat, pp. 386-387 ; P. Macherey, Introduction à l’Ethique de Spinoza. III, La vie affective. Paris, PUF, 1998, pp.384-385, et note 1.
[94] A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, p.270
[95] M. J. Kishner Spinoza’s Benevolence: The Rational Basis for Acting to the Benefit of Others. Journal of the History of Philosophy. 47, 4, 2009, p.566.
[96] Cf. M. Della Rocca, Spinoza, pp.193-199; Egoism and the Imitation of Affects in Spinoza. In Y. Yovel, G. Segal (Eds.), Spinoza on Reason and the Free Man. New York, Little Room Press, 2004, pp.123–147.
[97] W. Frankena, Spinoza’s ‘New Morality’: Notes on Book IV. In E. Freeman and M. Mandelbaum (Eds.), Spinoza: Essays in Interpretation. LaSalle, Open Court, 1975, p.96.
[98] R. Misrahi, La signification de l’éthique. Paris, Synthélabo, 1995, p.77
[99] A. Suhamy, La Communication du bien chez Spinoza. Paris, Garnier, 2010, p.18
[100] Pirkey ’Avot I, 14. Selon A. Wolf, Spinoza avait, dans sa jeunesse, étudié les Pirkey ’Avot. A. Wolf, The Oldest Biography of Spinoza. London, Allen & Ulwil LTD, 1927, note p.43.
[101] Spinoza, Ethique IV, 24, Pautrat, pp.392-393
[102] Spinoza, Ethique IV, 18, scolie, Pautrat, pp.386-387; J. F. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics, p.298 et p.309.
[103] J. L. Austin, How To Do Things With Words. 2nd Ed. Oxford, Oxford University Press 1975, p.2
[104] S. Barbone, Virtue and Sociality in Spinoza. Iyyun. 42, 1993, p.384 note 1.
[105] J. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics, pp.309-310
[106] E. Curley, Spinoza’s Moral Philosophy. In M. Grene (Ed.), Spinoza : A Collection of Critical Essays. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1973, pp.371-373 ; Kant, Critique de la Raison Pratique, trad.franç. J. Gibelin. Paris, Vrin, Rééd. 1974, p.32.
[107] Cf. D. Rutherford, Spinoza and the Dictates of Reason. Inquiry. 51, 5, 2008, pp.485-511
[108] Spinoza, Ethique IV, 18, Scolie, Pautrat, pp.386-387
[109] Spinoza, Ethique IV, Append. V, Pautrat, pp.478-479
[110] M. LeBuffe, From Bondage to Freedom: Spinoza on Human Excellence. Oxford, New York, Oxford University Press, 2010, p.99
[111] Spinoza, Ethique IV, 26, Pautrat, pp.394-395
[112] Spinoza, Ethique II, 43, scolie, Pautrat, pp.182-183
[113] Spinoza, TTP, XV, 3, pp.466-467
[114] Le terme « norma » apparait dans le TIE § 37, 38, 43, 47, 49, 69, 75, 76, 86, l’Ethique I, Appendice de la proposition 36 ; II, 43, scolie et dans le TTP, chapitres VII, IX, XII, XIV, mais ce terme n’est cependant jamais employé dans le TP.
[115] Spinoza, TP, VI, 1, pp.140-141
[116] Spinoza, Ethique IV chap. 25, Pautrat, pp.488-489.
[117] Spinoza, Ethique III, 39, scolie, Pautrat, pp.278-279 ; P.-F. Moreau, Métaphysique de la gloire. Le scolie de la proposition 36 et le « tournant » du livre V. Revue Philosophique de la France et de l’Étranger. 184, 1, 1994, p.63.
[118] Spinoza, Ethique III, Définition des affects, 44, Pautrat, pp.342-343
[119] Spinoza, Ethique V, 10, scolie, Pautrat, pp.518-519
[120] Spinoza, Ethique III, 19, scolie, Pautrat, pp.262-263 ; Ethique III, Définitions des affects, définition 48, Pautrat, pp.344-345.
[121] P. Macherey, Introduction à l’Ethique. La troisième partie, la vie affective. Paris, PUF, 1998, pp.235-237
[122] Spinoza, Ethique III, Définition des affects, 44, explication, Pautrat, pp.342-343
[123] Hobbes, Léviathan, VI, trad.franç. p.131
[124] A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, pp.164-165. La psychopathologie a pu éclairer la dimension profondément narcissique, c’est dire auto-référenciée, de l’ambition liée au désir de reconnaissance. cf. H. Kohut, Forms and Transformations of Narcissism. In A. P. Morrison (Ed.) Essential Papers on Psychoanalysis. New York, London, New York University Press, 1986, p.68.
[125] A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, p.168
[126] Spinoza, Lettre 32 à Oldenburg. G. IV, 171; trad.franç. p.1179; A. Armstrong, Autonomy and the relational individual: Spinoza and feminism. In M. Gatens (Ed.), Feminist Interpretations of Benedict Spinoza. University Park, Pennsylvania State University Press, 2009, pp.43-63; E. Tucker, Power, Freedom, and Relational Autonomy. In A. Armstrong, K. Green & A. Sangiacomo (Eds.), Spinoza and Relational Autonomy. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2019, pp.149-163
[127] Cf. C. Yeomans, Spinoza, Feminism, and Domestic Violence. Iyyun. 52, 2003 p.69
[128] W. N. A. Klever, Een zwarte bladzijde? Spinoza over de vrouw. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. 84, 1, 1992, pp.38-51
[129] Spinoza, TP, XI, 4, trad.franç. Ramond, pp.272-273; H. Sharp, Eve’s Perfection: Spinoza on Sexual (In)Equality. Journal of the History of Philosophy, 50, 4, 2012, p.566.
[130] Spinoza, Ethique II, 45, scolie, pp.186-187; J. Caird, Spinoza. Reed. Edinburgh, London, W. Blackwood and Sons, 1902, pp.235-236.
[131] S. Zac, L’idée de vie dans la philosophie de Spinoza. Paris, PUF, 1963, pp.225-226
[132] Cf. M. Gueroult, Spinoza I. Dieu. Paris, Aubier-Montaigne, 1968, p.267
[133] Lacan, L’éthique de la psychanalyse. Paris, Seuil, 1986, p.84; J. J. Rozenberg, From the Unconscious to Ethics. New York, Peter Lang, 1999, pp.87-88; J. J. Rozenberg, Spinoza, le spinozisme et les fondements de la sécularisation, p.51, p.62, p.415.
[134] S. Winkler, The Conatus of the Body In Spinoza’s Physics. Society and Politics. 10, 2, 2016, pp. 95-114
[135] Spinoza, TP, II, 11, Ramond, pp.102-103, traduction modifiée.
[136] Spinoza, Ethique IV, App. III, Pautrat, pp.476-477
[137] Spinoza, TP, II, 15, Ramond, pp.104-105, traduction modifiée.
[138] Spinoza, Ethique IV, 35, Cor. II, Pautrat, pp.408-409
[139] Spinoza, Lettre 50 à Jarig Jellesz. G. IV, 238-239, trad.franç. p.1230
[140] M. Silverstein, “Cultural” Concepts and the Language‐Culture Nexus. Current Anthropology. 45, 5, 2004, notamment p.634 et p.643
[141] A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, p.258
[142] J. J. Rozenberg, Spinoza, le spinozisme et les fondements de la sécularisation, pp.35-41
[143] Spinoza, Ethique, IV, 33, Pautrat, pp.404-405
[144] Spinoza, Ethique, IV, 34, Pautrat, pp.404-405
[145] Spinoza, Ethique, IV, 34, scolie, Pautrat, pp.406-407. Dans ce cas, Pierre Macherey souligne qu’en voyant quelqu’un jouir de quelque chose dont seulement une seule personne peut disposer, alors « notre générosité spontanée se retourne en volonté d’appropriation exclusive ». P. Macherey, Introduction à l’Éthique de Spinoza- La troisième partie : la vie affective. p.255.
[146] Cf. D. Garrett, The indiscernibility of identicals and the transitivity of identity in Spinoza’s logic of the attributes. In Y. Y. Melamed (Ed.). Spinoza’s Ethics: A Critical Guide. Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp.12-42
[147] Spinoza, Ethique, IV, 34, scolie, Pautrat, pp.406-407, cf. Ethique, IV, 30-31, Pautrat, pp.400-40I
[148] Hobbes, Léviathan, XIII, trad.franç. p.222
[149] J. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics. p.301 et p.306
[150] Plaute, Comédie de l’âne (Asinaria. II, 4) ; Hobbes, De cive, Épître dédicatoire, p.22 ; C. Statius, Fabula incognita. In Scenicae Romanorum poesis fragmenta II, Comicorum Latinorum praeter Plautum et Terentium reliquiae. Leipzig, Ribbeck, 1855 p.265 ; Spinoza, Ethique IV, 35, scolie, Pautrat, pp.410-411.
[151] Cf. J. J.Rozenberg, Bio-cognition de l’individualité. Les philosophèmes de la vie et du concept. Paris, PUF, 1992, pp.119-120; V. Legeay, Spinoza et Darwin, un héritage véritablement conceptuel ? Philosophiques. 45, 2, 2018, pp.445-459.
[152] A. Matheron, Les fondements d’une éthique de la similitude. Revue de Métaphysique et de Morale, 99, 1994, p.490
[153] Spinoza, Ethique IV, 34, Pautrat, pp.404-405
[154] Spinoza, Ethique IV, 33, Pautrat, pp.404-405
[155] J. Busse, Le problème de l’essence de l’homme chez Spinoza. Paris, Publications de la Sorbonne, 2009, p.37
[156] Cf. M. J. Kishner, Spinoza’s Benevolence: The Rational Basis for Acting to the Benefit of Others. Journal of the History of Philosophy. 47, 4, 2009, 560 note 26
[157] Lévitique XIX, 18; Ber’eshyt Rabah, XXIV
[158] Maharsh’a ’al Bab’a Meçy’a 62a
[159] Pesahym 25b
[160] E. Levinas et P. Nemo, Ethique et infini. Paris, Fayard, 1982, p.112
[161] E. Levinas, Altérité et transcendance. Paris, LGF, 2006, p.52
[162] Spinoza, Ethique IV, 18, scolie, Pautrat, pp.386-387
[163] Spinoza, Ethique IV, 72, Pautrat, pp.472-473
[164] M.Della Rocca, Spinoza, p.199
[165] Hobbes, Léviathan, XIII, p.237; Traité de l’homme. trad.franç. Paris, A. Blanchard, 1974, p.13
[166] Spinoza, Ethique IV, 68, et démonstration. Pautrat, pp.466-467
[167] Spinoza, Ethique, IV, 72, Démonstration, Pautrat, pp.472-473
[168] S. Nadler, Spinoza on Lying and Suicide. British Journal for the History of Philosophy. 24, 2, 2016, pp.264-266
[169] Spinoza, Ethique IV, 59, Pautrat, pp.450-451
[170] Spinoza, Ethique IV, 63, scolie II, Pautrat, pp.460-461 ; M.LeBuffe, Spinoza’s Normative Ethics. The Canadian Journal of Philosophy. 37, 3, 2007, p. 390 et note 30.
[171] J. F. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics, p.324; Spinoza, Ethique III, 13, Pautrat, pp.234-235
[172] J. Neu, Emotion, Thought & Therapy: A Study of Hume and Spinoza and the Relationship of Philosophical Theories of the Emotions to Psychological Theories of Therapy. London, Routledge & K. Paul, 1977, pp.81-82
[173] M. J. Kishner, Spinoza on Human Freedom: Reason, Autonomy and the Good Life. Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p.174
[174] Spinoza, Ethique IV, App. VII, Pautrat, pp.480-481
[175] S. Nadler, Spinoza on Lying and Suicide. British Journal for the History of Philosophy. 24, 2, 2016, p.263
[176] H. de Dijn, Naturalism, Freedom and Ethics in Spinoza. Studia Leibnitiana. 22, 2, 1990, p.139
[177] Spinoza, Ethique V, 42, démonstration, Appuhn, pp.238-239 ; Pautrat, pp.560-561
[178] G. Lloyd, Spinoza and the Ethics. London, Routledge, 1996, p.129
[179] Spinoza, Ethique III, 2, scolie, pp.220-223
[180] Cf. K. J. Bender, The ethics of immanence: The metaphysical foundations of Spinoza’s moral philosophy. Sophia. 39, 2000, pp.42-45
[181] J. F. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics, pp.324-328
[182] Spinoza, Éthique V, 23 et scolie, Pautrat, pp.532-535
[183] Spinoza, Ethique V, 38, scolie, Pautrat, pp.552-553.
[184] M. Della Rocca, Spinoza, pp.199-201
[185] Spinoza, Ethique I, 28, Pautrat, pp.64-65
[186] M. Della Rocca, Spinoza, pp.199-201
[187] Spinoza, TTP, XVI, 6, pp.512-513. Dans le TP, III, 17, Spinoza affirme que L’Écriture ne prescrit de respecter ses engagements que d’une façon générale, mais elle laisse au jugement de chacun les cas particuliers, objets d’exceptions (casus singulares, qui excipiendi sunt). Ramond, pp.126-127.
[188] Hobbes, De Cive. Le citoyen ou les fondements de la politique. XVI, p.42 ; Léviathan, XIV, pp.240-241 ; XX, p.323.
[189] Talmud Nedarym 15a ; Maimonide, Hilhot Shvou’ot; V, 20
[190] Spinoza, Lettre 50 à Jelles, G. IV, 238-239, trad.franç. p.1230
[191] Spinoza, TTP, XVI, 6, pp.512-513. Concernant la possible confrontation personnelle de Spinoza à la question du mensonge, Colerus rapporte que sa logeuse lui a demandé si sa propre religion pouvait lui assurer le salut. Cf. Colerus – Lucas, Bibliographies de Spinoza, p.14. La réponse positive de Spinoza, « votre religion est bonne », a donné lieu à des débats portant sur le fait de savoir s’il lui avait ou non menti. J. T. Cook, Did Spinoza lie to his Landlady? Studia Spinozana. 11, 1995, pp.15-37; E. E. Harris, Spinoza Did Not Lie to His Landlady. Studia Spinozana. 12, 1996, 207-210.
[192] Spinoza, Ethique IV, 18, scolie, Pautrat, pp.388-389
[193] Spinoza, TP, I, 5, Ramond, pp.92-93








