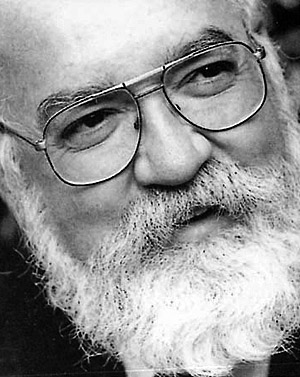Cet article constitue la suite logique de la première partie trouvable à cette adresse.
II. Le problème d’une ontologie du darwinisme étendu : comment individuer correctement les êtres évolutionnaires et cette individuation peut-elle s’appliquer sur un substrat non biologique ?
Avant d’en venir à l’explication des différentes ontologies possibles pour rendre compte de l’évolution culturelle et sociale des hommes en universalisant le paradigme darwinien (sociobiologie, psychologie évolutionniste, etc.), revenons à une philosophie dont l’innocence n’enlève rien à l’intuition géniale, celle de David Hume. Si le siècle de Hume, le XVIIIe, ne connaît pas encore Darwin, nous sommes en terres britanniques et le génie naturaliste est le terreau même de cette culture. L’exemple de la fidélité et de la pudeur est un bon exemple pré-évolutionniste, car il marque les esprits… 1. Hume, en anthropologue avisé, remarque le poids de certaines valeurs sur la condition des femmes. Certes, il n’est pas ethnographe et ethnologue, il n’a pas mené d’études empiriques et variées, mais il a l’intuition philosophique que toute anthropologie doit avoir, pour généraliser les travaux empiriques. Cette intuition géniale est que toute valeur morale ou règle sociale sert l’intérêt de la société elle-même ; l’intérêt de la société servant lui-même l’intérêt de chaque homme en tant qu’il appartient à une espèce sociale ou possède une essence qui ne peut se réaliser qu’au sein de sociétés permettant la division du travail, la spécialisation et l’organisation pour la survie et la vie. Pour expliquer la fidélité des femmes, notamment, Hume insiste sur la peine que doivent endurer ceux qui travaillent pour nourrir autrui (il s’agit en l’occurrence de leurs enfants). Qui travaillerait et prodiguerait moult soins pour une progéniture qui n’est pas la sienne propre, qui ne poursuit pas dans l’avenir sa propre vie ? 2 Contentons-nous du vieux philosophe qui n’est pas confronté à l’objection de l’adoption (cf. note) et qui ferait certainement de ces cas particulier un effet secondaire de la culture 3. Hommes et femmes, en tant qu’animaux, ne s’occupent que de leurs intérêts particuliers et il leur faut l’assurance de travailler et de dépenser de l’énergie pour leurs descendants et non ceux du voisin. Or si les femmes en sont assurées, les hommes le sont bien moins. « C’est de cette observation triviale et anatomique que provient la différence importante qui sépare l’éducation et les devoirs des deux sexes. 4 » L’anthropologie et l’ethnologie qui dressent l’inventaire épouvantable des pratiques pour rendre les femmes fidèles ne diront jamais autre chose. L’histoire et les autres nations comme laboratoires de la philosophie naturelle, voilà le mot d’ordre de notre visionnaire anthropologue du XVIIIe siècle.
Reprenons notre affaire : il y a des valeurs morales, telle que la fidélité, il y a des règles sociales et juridiques, des produits culturels, des mœurs, des croyances, des mythes et religions, etc. Comment expliquer que la vie des hommes soit si éloignée de la vie de n’importe quelle autre espèce animale ? Certes, le dauphin et quelques grands singes ont certainement une conscience plus élaborée que n’importe quel insecte, quelques espèces d’oiseau sont capables d’imitation réelle et non de simple apprentissage social, mais enfin l’évidence est là : l’espèce humaine a une histoire, elle a envahi la nature, l’exploite pour prévenir ses fins, elle utilise un langage symbolique au potentiel illimité, etc. Le saut est incroyable.
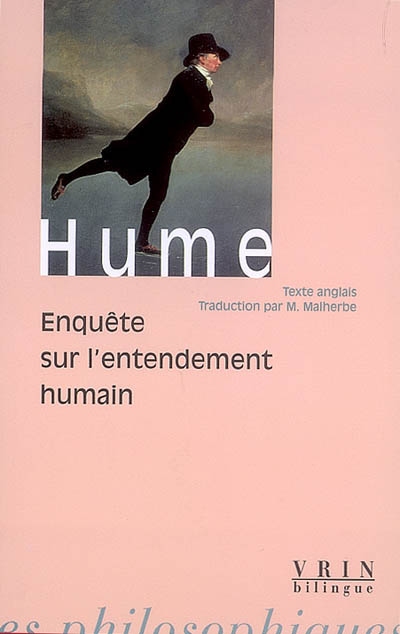
Comment comprendre l’application de l’algorithme darwinien « hérédité, variation, sélection » ? L’évolution des hommes n’est-elle qu’animale et biologique, selon l’idée sociobiologique de lire les comportements et croyances humaines comme comportements adaptatifs compétitifs et sélectionnés parce qu’ils permettraient à leur détenteur de mieux vivre et de plus se reproduire, propageant ainsi le génome conditionnant de tels comportements et capacités cérébrales de croyance ? Cette évolution culturelle n’est-elle que biologique ; la biologie n’explique-t-elle pas simplement l’évolution de l’anatomie mais pas l’évolution des items culturels ? Mais même l’anatomie humaine, comme ce cerveau disproportionné et au prix si coûteux caloriquement : peut-il recevoir une simple réponse biologique ? Car si on admet une évolution culturelle elle-même, c’est-à-dire une vie autonome des idées comme mèmes se répliquant selon le mécanisme néo-darwinien, alors comment comprendre le jeu entre évolution biologique et évolution culturelle ? Les mèmes, en tant que squatteurs d’esprit aveugles à leur véhicule (l’homme et ses intérêts), peuvent-ils faire évoluer l’anatomie de leur véhicule pour leurs besoins propres ?
Ce qui nous semble le problème de fond des différentes interprétations darwiniennes de la culture, c’est de savoir si les « gènes tiennent la culture en laisse », selon l’illustre mot de Edward O. Wilson, ou si la culture a une autonomie propre ; voilà l’antagonisme au sein des compréhensions naturalistes. L’expression de Wilson est d’une importance capitale et constitue un garde-fou pour la pensée essentiel : en effet, il s’agit de garder à l’esprit que l’avantage biologique est apparemment prioritaire et que l’émancipation culturelle n’est pas permise, parce que si un certain comportement dessert son porteur, alors ce porteur ne se reproduira pas. La réplication génétique est égoïste 5, comme Dawkins l’a montré, il ne s’agit pas de trouver belle ou suprême telle ou telle valeur, elle ne sera conservée, aussi belle et transcendante apparaît-elle, que si elle est un avantage pour la réplication. Sociobiologie et psychologie évolutionniste partagent ce postulat fondamental : il faut penser selon la perspective génétique et y revenir. S’il y a des aberrations, des cas étonnants, alors il faut chercher à les expliquer. Ainsi en va-t-il du plus fameux des exemples, que l’on peut à première vue considérer comme un contre-exemple : l’altruisme. C’est l’équation d’Hamilton qui permet de comprendre la sélection parentèle : l’altruisme prend sa source dans l’altruisme familial, c’est-à-dire l’égoïsme génétique familial. En effet, Hamilton découvre la sélection de parentèle qui ne voit plus l’individu comme seul reproducteur de ses propres gènes, car les individus porteurs d’un patrimoine génétique proche de lui augmente sa valeur sélective. La valeur sélective globale d’un individu compte donc sa propre valeur et sa valeur indirecte. L’altruisme est donc défini comme ce qui augmente la valeur sélective indirecte d’un individu.
On voit que pour comprendre certains phénomènes, en apparence contradictoire avec le darwinisme, il faut prendre en compte le darwinisme ontologiquement bien individué et il faut donc découper aux bonnes articulations la vie évolutionnaire, son entité fondamentale et évolutionnairement opérationnelle, c’est le gène. Ainsi, altruisme et comportements sociaux coopératifs deviennent intelligibles. On les comprend comme des sentiments naturels, au sens ici d’innés, capables de guider l’action des individus porteurs de gènes et cherchant à se reproduire. On peut penser que la sélection de parentèle est l’origine de l’efficace du comportement altruiste, origine de la coopération comme comportement sélectif. Voilà comment expliquer l’altruisme au-delà de la proximité génétique, voire même au-delà de la proximité culturelle et du besoin de réciprocité, selon un darwinisme génétique strict étendu à la vie sociale.
Cependant, altruisme ou fidélité, croyances culturelles ou comportements sociaux, il semble que les moyens génétiques soient disproportionnés compte tenu de la tâche. Plus exactement, il semble que le saut soit inexplicable entre les différentes espèces animales avec les moyens qu’elles ont développés et notre espèce avec nos moyens incommensurables à force de degré. Incommensurable parce que nous comprenons mal comment expliquer par la seule réplication génétique le fait exponentiel de la culture, des techniques, des savoirs, des croyances, etc. Comment passer des limites habituelles de la nature, limites que l’on observe dans toutes les espèces, aussi extraordinaires soient-elles, à l’illimité humain, à cette volonté infinie ? Il nous semble que c’est ce constat qui fait la force de la mémétique et les explications pertinentes qu’elle donne de phénomènes que la sociobiologie, la biologie et la psychologie évolutionniste peinent à expliquer : le saut culturel entre notre espèce et les autres espèces, la taille du cerveau humain, les phénomènes de l’altruisme, de l’adoption, de l’abstinence, du suicide, etc. Souvenons-nous de la maxime sociobiologique « les gènes tiennent la culture en laisse », cela veut dire qu’on ne peut pas expliquer l’adoption ou le suicide comme de simples effets pervers de comportements en général sélectifs. Le coût génétique de tels comportements aurait dû les faire disparaître depuis longtemps. Un comportement ne peut pas se propager génétiquement si son porteur adopte une attitude anti-réplicatrice.
Or qu’est-ce qu’une règle sociale, une croyance religieuse, une valeur morale, un usage culturel ? Qu’a-t-on, là ? demande le méméticien. On a là des instructions permettant d’imiter un comportement non inné, des informations destinées à une nouvelle potentialité d’actions. C’est l’intuition rousseauiste, ce qui distingue l’homme et les autres espèces animales, aussi extraordinaires soient ces dernières, ce n’est pas tant la raison, qui effectivement peut s’évaluer sur un continuum et varier de complexité jusqu’à atteindre la rationalité humaine, mais c’est la faculté d’apprendre et de progresser. Ce qu’il y a de réellement incommensurable, au-delà de la rationalité et des sentiments que l’on peut naturaliser dans leurs fonctionnalités plus ou moins complexe, c’est la perfectibilité. Cette perfectibilité, c’est la capacité mémétique par opposition aux simples capacités génétiques. L’espèce humaine est une espèce génétique, aux instincts très nombreux et très puissants, certes, mais le saut qu’il y a entre elle et n’importe quelle autre espèce très évoluée réside dans le saut de l’imitation désindexée du simple apprentissage réalisant ses instincts dans un environnement. L’espèce humaine ne fait pas qu’apprendre à actualiser son potentiel génétique ou à appliquer des instincts généraux à des environnements particuliers, elle crée de nouveaux comportements, elle se code elle-même en quelque sorte. L’information qui structure ses attitudes et actions informe autrement que par la génétique, elle informe par une structure d’action ou de comportement mental, mémétique. C’est sa capacité mémétique qui explique le saut culturel, le saut de moyens limités (la nature dote les animaux de moyens génétiques d’adaptation limités, même si on détecte une capacité de raisonnement ou même symbolique ou technique chez certaines espèces, cette capacité est limitée) à des moyens illimités, à des créations toujours possibles de nouveaux comportements. L’incommensurabilité entre les hommes et les autres espèces ne tient pas tant à leur patrimoine génétique qu’à une deuxième source d’information, radicalement nouvelle et donc bel et bien ontologiquement incommensurable.
Voilà le lieu spéculatif qui a besoin de la mémétique. Pour autant, c’est un lieu spéculatif qui pourrait recevoir d’autres hypothèses. En quoi l’hypothèse mémétique est-elle plus probable ? D’abord, la mémétique poursuit la sociobiologie (ou toute discipline des sciences humaines qui reçoit l’épithète « évolutionniste »), parce qu’elle accepte son efficacité explicative, mais elle en exploite les ratés ou les incomplétudes, elle corrige son réductionnisme. C’est dans sa force à penser ce qui excède le génétique qu’elle va plus loin que la sociobiologie ou que la psychologie évolutionniste: de l’altruisme et de l’adoption au saut incommensurable qu’il y a entre les autres espèces et la nôtre, nous allons voir tout de suite que la mémétique a quelques réponses intéressantes.
Pour la mémétique, le but est donc de montrer que la sociobiologie et la psychologie évolutionniste sont incapables de tout expliquer, et non pas qu’elles sont fausses. Elles constituent, au contraire, de puissantes alliées et compréhensions de l’histoire humaine. Ensuite, en plus de pallier les anomalies d’explication comme tout bon nouveau paradigme qui se respecte, la mémétique propose d’appliquer l’algorithme évolutionniste (hérédité/rétention des information, variation, sélection) sur un second réplicateur – car l’algorithme évolutionniste, comme tout algorithme, est indifférent au substrat, mèmes ou gènes c’est égal. Ce second réplicateur, c’est l’information culturelle ou conceptuelle, c’est le mème en tant qu’il est un concept définissant une action ou une attitude ou une croyance culturelle. On a une source d’information irréductible à une information génétique, car innovant un nouveau comportement au sein de la nature, i.e. le mème ; on a le mécanisme de réplication, i. e. l’imitation ; et on a l’impératif de sélection que Blackmore résume à merveille avec cette petite expérience de pensée : « Imaginez un monde rempli de mèmes, et bien plus de mèmes que de foyers pour les accueillir. Quels mèmes auront plus de chance de trouver un foyer sûr et d’être transmis à nouveau ? » 6. Par différents procédés de sélection, certains mèmes seront plus copiés que d’autres : parce que ces mèmes appartiendront à des gens que nous apprécions plus que les autres, parce qu’ils seront plus utiles, parce qu’ils auront une structure imitative efficace, etc. Ainsi on voit comment des mèmes de coopération peuvent se propager, mais on comprend aussi que certains mèmes morbides peuvent se propager au sein de petits groupes.
En sciences humaines et sociales comme ailleurs, la force d’explication, voire de prédiction d’une théorie, sa capacité en somme à modéliser son objet de manière unifiée et explicative, voilà le critère qui permet de juger d’une théorie. L’idée d’une consistance ontologique propre de la culture est une intuition forte, tout comme l’idée que l’évolution biologique ne saurait rendre compte de l’humanité intégralement et de ses produits culturels et symboliques complexes. C’est pourquoi, nous prenons au sérieux cette hypothèse, certainement encore balbutiante, de la mémétique.
III. La discussion avec Dan Sperber : psychologie évolutionniste contre mémétique
Le grand argument de Sperber à l’encontre de la mémétique concerne le mécanisme de réplication. L’algorithme évolutionniste nécessite une réplication aussi fiable que la réplication génétique, or selon Sperber si on observe la réplication des idées par imitation, celle-ci n’est pas fiable et le taux de mutation est trop élevé pour que l’algorithme évolutionniste soit un modèle pertinent de compréhension de l’évolution culturelle. La réplication fidèle serait un cas limite, une exception dans la diffusion des idées, celles-ci ne cesseraient de se transformer, d’être altérées. Pour qu’une sélection culturelle puisse s’opérer, il faudrait que le taux de mutation soit relativement bas, comme dans la sélection naturelle. La variation nécessaire pour que la sélection s’opère nécessite une variation à un taux relativement bas, si la variation de l’information codée est permanente, on ne peut pas penser un processus de sélection des idées les plus efficaces ou utiles (le critère de sélection importe peu sous ce rapport). L’objection est de Dawkins lui-même : « Le processus de copie est probablement beaucoup moins précis que dans le cas des gènes: il peut y avoir quelque chose qui mute dans chaque copie. 7 »

La stabilité apparente de certaines idées, comme les religions ou encore les contes, doit alors recevoir une explication ; Sperber rend justice au phénomène de stabilité de certaines idées, ou tout au moins, de leur structure ou noyau central par le concept d’attracteur. Certaines idées fortes ont un noyau d’instructions (instructions qui dictent la croyance ou le comportement porté par cette idée) qui est un attracteur, c’est-à-dire que malgré les transformations inhérentes à la propagation de ce type d’idées, il y a une tendance à corriger les transformations afin de revenir au noyau dur, aux instructions essentielles de l’idée. Cela s’explique, pour Sperber, par la structure et le fonctionnement du cerveau. Les idées ou histoires invariantes et transculturelles dans leur noyau et dans leur configuration essentiels répondent à des besoins humains et correspondent à la structure du cerveau. On a là une idée presque kantienne (d’un kantisme naturalisé de type physiologie de la raison pure) : la physiologie cérébrale nécessite a priori certaines questions et certaines réponses. Ce qui explique l’invariance des schèmes généraux mythiques ou fictifs ou religieux ou moraux. L’entendement cherche, par exemple, à connaître les causes des phénomènes observés, la synthèse de la recherche des causes nécessitent de penser une cause unique, cause de tout et cause de soi. On a dans ce fonctionnement universel de la pensée une physiologie de la religion. C’est la neurobiologie de l’organe de la pensée et la biologie du corps qui peuvent expliquer la culture et ses productions. On peut raisonner de la même manière pour le besoin moral, le besoin d’imager des impératifs moraux, des maximes au sein de contes ou de paraboles. Si le détail de la connaissance du cerveau et de sa relation aux idées est éminemment complexe et sujet à expérimentations et théorisations diverses, l’idée centrale est cette génétique des idées corrélée à une génétique évolutionniste des capacités cérébrales. Connaître la structure naturelle du cerveau selon le paradigme de l’évolution naturelle permettrait de comprendre pourquoi certaines idées sont contagieuses, voire très contagieuses (comme une religion ou un conte) et se transmettent avec une certaine efficacité. L’idée d’un noyau dur essentiel qui fonctionne comme un attracteur correspond à l’idée d’une fonctionnalité des idées : servant à certains besoins humains, elles doivent respecter une certaine structure, si bien que si la transmission échoue, elle sera corrigée d’elle-même pour répondre au besoin auquel la structure de l’idée répondait.
L’intuition de Sperber, comme on peut le constater, n’est pas strictement contradictoire avec l’intuition mémétique. Car la mémétique se contente d’expliquer le tissu ontologique propre des idées, en désolidarisant l’idéel et sa logique de l’être biologique ; cette désolidarisation des productions culturelles par rapport à leur substrat cérébral et biologique n’est pas complètement autonome, le degré d’autonomie est à définir et à justifier. Comme Blackmore le montre dans son essai, on peut penser une coévolution : parfois les gènes dictent leur comportement aux idées, car certaines idées sont trop éloignées de nos intérêts génétiques et peuvent finir par disparaître mécaniquement, selon le principe de la sélection naturelle les porteurs de certaines idées meurent avec elles ; parfois les mèmes dictent leur comportements aux gènes, en permettant par exemple une reproduction plus efficace grâce à certains mèmes : le détail de cette coévolution est à connaître. Dennett aime prendre l’exemple du prêtre ou du célibat, voilà un exemple de mème particulièrement répandu dans le temps et dans les cultures qui ne correspond pas à une idée pouvant s’expliquer évolutionnairement, au contraire elle constitue un paradoxe : comment un organisme évolutionnaire peut-il développer une idée anti-génétique et comment celle-ci peut-elle perdurer autant ? Il faut alors penser que l’idée tient en laisse les gènes, qu’elle s’est autonomisée par une logique propre (comprendre cette logique de la culture et des idées humaines, voilà tout l’objet d’une mémétique). Ce type d’anomalies permet de comprendre la pertinence du modèle d’un second réplicateur : le mème.
Avant d’en venir à d’autres arguments méméticiens, rappelons avec Sperber l’argument de Dawkins, cela nous permettra de restituer précisément l’argument de Sperber 8, car celui-ci est plus complexe que la simple critique de la fidélité de l’imitation. Dawkins distingue deux types d’imitations : imiter un cas individuel (par exemple, imiter un dessin en copiant le dessin lui-même) et imiter une instruction (par exemple, imiter un dessin en imitant le procédé, pensez au dessin d’une étoile par exemple). Pour le premier type d’imitation, le phénotype et le génotype sont les mêmes, pour le second type d’imitation le procédé est le « mème génotypique » et les dessins particuliers sont les différents phénotypes. Cela permet de comprendre l’écart entre les imitations et leur degré de fidélité : les mèmes individuels varient comme les phénotypes varient à partir d’un même génotype, la variation de ce type n’est pas une réelle variation. L’argument du taux de mutation n’est pas recevable, car on n’a pas une mutation dans la transmission des mèmes, on a une simple variation de type phénotypique. Que le mème génotypique soit une instruction, et non un individuel, augmente même la fiabilité de l’imitation 9. On peut objecter à Sperber que le substrat mémétique tend à devenir de plus en plus fidèle : langage, écriture, imprimerie, ordinateur, intelligence artificielle. L’information analogue tend à devenir numérique et en cela totalement fiable et fidèle. La sélection naturelle s’applique elle-même aux réplicateurs : gènes et ici mèmes ; cela veut dire que mieux ils stockent et encodent l’information, mieux ils se propagent.
Le deuxième argument de Sperber est de montrer qu’il n’y a pas de génotype culturel et qu’on confond une disposition biologique et une disposition culturelle de type instruction mémétique. Il prend l’exemple du rire : le rire n’est pas copié d’une personne à l’autre, même si le processus de son acquisition est l’imitation, mais il est une disposition génétique déclenchée par l’imitation. Notons d’abord que l’exemple de Sperber n’est pas la transmission d’un mème mais l’apprentissage d’un comportement. Une histoire drôle qui se transmet est un mème, ce mème sera plus ou moins efficace selon plusieurs critères à déterminer. Blackmore répond à cette objection qu’elle supputait par la distinction que nous avons rappelée entre l’imitation qui est un apprentissage social et l’imitation qui est la transmission d’un mème. En effet, elle remarque que l’homme, comme les animaux, activent des comportements instinctifs donc génétiquement codés en imitant ceux qui l’entourent. Mais seul l’homme (avec certaines espèces d’oiseaux) est capable d’imiter quelque chose de nouveau par rapport à la nature. Seul l’homme est plastique, capable d’innover par rapport aux déterminations naturelles. Bien sûr, cela suppose des prédispositions naturelles : pour inventer des histories comiques, il faut avoir la disposition du rire ; pour inventer des théories, il faut être doué de raison. Bref, l’intelligence comme capacité plastique d’innovation est une capacité biologique qui permet l’usage de mèmes. Pour autant, cette capacité d’innover, de transmettre des idées et d’imiter des idées (des idées qui sont des croyances ou qui sont des instructions pour agir) se distingue de l’imitation pour apprendre des comportements innés. L’imitation-activation se distingue de l’imitation-mémétique.
Pour être capable d’imiter, de comprendre ce que sont des instructions, des idées, des mèmes, il faut certes des capacités biologiques que seules les sciences évolutionnistes (biologie, psychologie évolutionniste, etc.) peuvent expliquer. Mais on peut penser que la réalité idéelle a une réalité propre : des caractères abstraits, logiques, symboliques, intentionnels, métareprésentationnels, proprement intelligibles ; sans penser une autonomie totale vis-à-vis du biologique, les critères propres à l’idéel permettent d’en penser une autonomie relative. Cette consistance ontologique du phénomène culturel et idéel est précisément l’objet du mécanisme mémétique. Comme on l’avait dit, les arguments et théories de Sperber ne contredisent pas la théorie mémétique, mais la complètent sur le terrain neurobiologique. Au sein du phénomène culturel, les dispositions neurobiologiques et plus généralement biologiques des organismes humains sont les conditions de possibilité de la vie de l’esprit, mais la venue à l’être de la réalité idéelle impose une réalité irréductible à la neurobiologie sous-jacente. Une idée, quoique nécessitant un esprit réalisé neurobiologiquement (en tout cas, pour sa naissance et en l’état actuel de nos connaissances), n’est pas du même ordre de réalité que l’être matériel, elle est porteuse d’un sens. La discussion, ici, n’est pas de savoir si ce sens est ontologiquement indépendant de son substrat matériel, mais de prendre acte que ses propriétés ne sont pas celle de la matière biologique. Le cerveau est le substrat d’une réalité qui a une logique propre : la pensée. Ce qui explique la transmission des pensée d’un cerveau à l’autre est certainement multifactoriel : la structure et le fonctionnement inné du cerveau ; les besoins humains ; l’utilité ; la beauté ; la vérité ; mais aussi certains caractères propres à une idée, des traits proprement réplicateurs – comme dans les chaines envoyées par mail où l’on voit une structure du mème purement réplicatrice ou comme dans la promesse de l’enfer de certaines religions où on a une menace-pour-la-réplication. Force est de constater que l’humanité développe l’imitation comme moyen de transmission des idées, en plus de l’imitation comme apprentissage social qui permet de former les enfants à leur humanité. On ne peut pas comparer l’imitation de celui qui devient homme avec l’imitation permanente dans la vie des hommes, non pas d’aptitudes innées, mais de comportements, de croyances crées.
L’intuition du méméticien va même plus loin : il y a la logique biologique à l’œuvre, neurobiologique notamment, et la logique de ce que cet organe extraordinaire qu’est le cerveau a créée. Quand le sociobiologiste parle de gènes qui tiennent la culture en laisse, le méméticien l’arrête : parfois la culture tient les gènes en laisse. Les exemples ne manquent pas d’idées ou de mèmes plus généralement (le suicide, l’abstinence de beaucoup de religieux, etc.) qui vont contre les gènes et les tiennent en laisse. Que les mèmes puissent tenir les gènes en laisse constitue un indice de la vie (semi)-autonome de l’esprit et de la culture. Le travail qui revient à la mémétique est un travail sur la coévolution et sur l’explication de phénomènes-anomalies de la biologie : Blackmore l’a bien compris en écrivant quelques chapitres sur le développement du cerveau humain disproportionné par rapport aux autres hominidés que la biologie ne saurait pas expliquer, sur l’altruisme comme paradoxe, etc. Le méméticien convaincra en réussissant à expliquer, avec son modèle, non seulement le devenir culturel mais aussi les paradoxes ou anomalies des explications évolutionnistes de l’homme.
Ce qui pourrait contredire l’intuition du mème comme réplicateur culturel serait une critique de l’imitation elle-même. Sperber remarque que l’apprentissage de la langue par un enfant ne se fait pas par imitation, mais par inférence. A partir de son écoute de la langue, l’enfant déduit des règles. Son cerveau le prédispose à pouvoir repérer des règles de grammaire, c’est-à-dire des règles de construction du langage. L’enfant ne les imite pas, mais est capable de généraliser et d’abstraire des règles à partir de ce qu’il entend. Avec les découvertes sur les neurones miroirs (et même s’il faut rester très prudent quant à l’utilisation de cette découverte), on comprend comment l’enfant ou l’adulte peut imiter, non pas simplement des comportements, mais aussi des intentions, des desseins, des règles. Ce que révèle la structure et le fonctionnement cérébral, c’est l’importance de l’imitation dans la nature de l’homme, dans ce qui le distingue des autres espèces. En quelque sorte, ce qui définit l’homme, c’est sa capacité mémétique, sa perfectibilité. Le débat reste ouvert sur premièrement le degré d’autonomie des objets produits par cette plasticité et cette disposition biologique à la création de caractères acquis pour répondre aux situations de l’environnement, et deuxièmement sur la logique spécifique et les mécanismes conséquents de la vie idéelle. Pour autant, être en contact avec autrui, c’est cérébralement répéter ce qu’il fait, ressent, pense, c’est l’imiter virtuellement, consciemment ou inconsciemment. Quand nous imitons, certes nous déduisons des intentions, voire même des règles du jeu, mais cette déduction n’invalide pas que nous imitions, car ces règles du jeu, ces intentions sont des mèmes, c’est-à-dire des instructions en circulation dans les sociétés que nous pouvons imiter et transmettre, explicitement ou implicitement, volontairement ou malgré nous, de façon consciente ou selon des mécanismes inconscients de la pensée.
Etant donné le caractère intelligent, conscient et intentionnel des véhicules des mèmes que seraient les hommes, Sperber considère que le principe de sélection naturelle ne peut pas s’appliquer. Si les idées sont des réplicateurs, alors comment déterminer les mécanismes de sélection ? Le nerf darwinien de la sélection naturelle semble impossible, car la conscience intentionnelle humaine interfère alors. Que l’imitation soit si consciente est déjà un problème en soi : on peut se demander si la conscience n’est pas postérieure à l’imitation, si elle n’avalise pas des processus cérébraux inconscients. Quel rôle la conscience peut-elle jouer qui soit une réelle interférence dans la vie mémétique de la culture ? Ce rôle-là n’est-il pas déjà réalisé mécaniquement au sein de la complexe biochimie naturelle ? Le procédé de correction d’erreur dans la réplication dont les organismes sont porteurs n’est-il pas déjà l’ébauche du travail que peut opérer l’intelligence consciente sur les réplicateurs ? Quand lors de la réplication de l’ADN, des fonctions mécaniques sont capables de corriger des erreurs, on assiste en effet à une intervention de correction dans le processus de réplication-variation, intervention qui n’empêche pas l’évolution selon l’algorithme darwinien 10.
Sperber, enfin, dans son texte en appelle à des preuves empiriques de la mémétique. C’est effectivement ce à quoi doivent s’atteler les méméticiens pour convaincre. La découverte des neurones miroirs montre l’importance de l’imitation comme processus cérébral qui est sous-jacent à toute relation avec une extériorité, même si la question de savoir si cette découverte peut servir à fonder la mémétique reste très largement ouverte dans les milieux méméticiens et neuroscientifiques. Certes les neurones miroirs montrent en quoi consiste l’apprentissage social. Mais on voit bien que mettre ce processus cérébral au cœur de la pensée, comme condition de possibilité de la perfectibilité humaine, ne saurait rendre compte de la seule capacité à imiter pour activer des processus innés. Ces capacités innées que l’imitation éveille sont capables de produire une réalité ayant une logique propre, voire une autonomie propre. Cette réalité mémétique consiste finalement dans le jeu permanent des idées qui fusent sans cesse, qui s’écrivent, se communiquent, se discutent de plus en plus vite. Quelque chose s’emballe, voire même a une vie propre, l’intelligence artificielle et le net nous mettent souvent face à cette vie propre de la pensée. Rendre expérimentable cette vie et cette logique propre est un défi à relever.
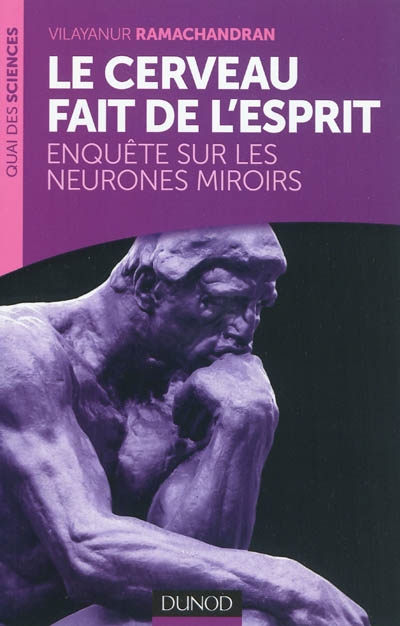
C’est l’intuition de Vilayanur Ramachandran dans son œuvre Le cerveau fait de l’esprit 11 : ce qui a bouleversé l’espèce humaine, ce qui explique cette incroyable ascension, ce destin incompréhensible rapporté aux destins des autres espèces, c’est cette capacité neurale que sont les neurones miroirs, autrement dit le possible support cérébral de réplicateurs idéels qui se transmettent par l’imitation et permettent la perfectibilité. Voilà ce qui seul peut expliquer le bond de l’espèce humaine. Ainsi, explique-t-il, une invention accidentelle, comme le feu ou n’importe quel outil (dans ses prémisses simplifiées), au lieu de se perdre comme erreur se perpétue par l’imitation. Le comportement intelligent, l’innovation, la possibilité de réponses nouvelles à la place de réponses instinctives prédéterminées et fixes, cela est possible parce que nous sommes capables d’imiter celui qui a un comportement différent et nouveau. Nous sommes capables de comprendre les intentions, d’imiter, de transmettre. Une découverte se transmet donc très rapidement. Sperber a raison malgré lui : l’esprit conscient et intentionnel des hommes influe sur le processus darwinien de l’évolution culturel, car ce processus devient lamarckien, les caractères acquis se transmettent horizontalement à travers les populations et non simplement par l’hérédité verticale et aveugle à la valeur de ce qui est transmis. La transmission est rapide, fiable car indexée à ce qu’elle permet, certainement en partie symbiotique car en relation avec un esprit conscient. La vie culturelle de l’humanité pouvait naître et s’emballer d’une manière telle que Dieu semblait s’incarner dans une créature animale et l’habiter d’un esprit dont nul autre animal ne témoignait.
Restera quelque énigme : un Vouloir-vivre semble à l’œuvre une fois réduit le naturalisme à sa structure de base inexplicable naturellement, un fondamentum métaphysique caractérisé par une Volonté en devenir au service d’un élément informationnel ou spirituel ou encore formel, une sorte de « Volonté de Forme ». Mais c’est ici un autre sujet et un autre domaine, celui de la métaphysique.
- David Hume, Enquête sur l’entendement humain, section VII, Vrin, 2008.
- Si certains se piquent de répondre : « nos contemporains adoptent par amour et travaillent donc pour d’autres gènes » et d’y voir une objection au naturalisme, le méméticien sera ravi, car il voit, dans cette aberration de l’amour d’un autre patrimoine génétique que le sien propre, le signe que l’esprit a créé une réalité en concurrence avec la réalité et les intérêts génétiques. Un mème moderne – adopter et aimer les enfants d’un autre – l’a emporté sur le simple intérêt génétique pour de multiples raisons qu’il faudrait inventorier et justifier
- L’argument pourrait être vraisemblablement que si la culture sert par des moyens plus élaborés et symboliques des fins naturelles, elle peut structurellement par cette élévation au symbolique s’en émanciper et produire des valeurs non assignées à la biologie.
- Ibid., p. 189
- Ce sont les mutations génétiques et non les individus qui se propagent. La théorie synthétique de l’évolution garde cet acquis de Dawkins et de la génétique .
- Blackmore, Ibid., p. 255.
- Dawkins, Ibid., p. 257-272.
- Dan Sperber, « An objection to the memetic approach to culture » in Robert Aunger ed. Darwinizing Culture : The Status of Memetics as a Science, Oxford University Press, 2000, pp 163-173.
- D. C. Dennett, « From Typo to Thinko : When Evolution Graduated to Semantic Norms » from Evolution and Culture, edited by Stephen C. Levinson and Pierre Jaisson, MIT Press.
- Pour une argumentation plus serrée, voir l’article de Dennett susmentionné.
- Vilayanur Ramachandran, Le cerveau fait de l’esprit, Enquête sur les neurones miroirs, Dunod, 2011.