La modernité managériale du nazisme
« [Les fonctionnaire du IIIe Reich] ont élaboré, paradoxalement, une conception du travail non autoritaire, où l’employé et l’ouvrier consentent à leur sort et approuvent leur activité, dans un espace de liberté et d’autonomie a priori bien incompatible avec le caractère autoritaire du IIIe Reich, une forme de travail « par la joie » (durch Freude) qui a prospéré après 1945 et qui nous est familière aujourd’hui, à l’heure où l’ »engagement », la « motivation » et l’ »implication » sont censés procéder du « plaisir » et de la « bienveillance » de la structure »[1].
1 – Au cœur du travail de Johann Chapoutot
Parmi les livres qui firent grand bruit en ce début d’année 2020, on compte celui écrit par l’historien Johann Chapoutot, intitulé Libres d’obéir et sous-titré « Le management, du nazisme à aujourd’hui », prenant pour fil directeur, ainsi que l’explicite la quatrième de couverture, le personnage de Reinhard Höhn qui, avant de créer un influent institut de formation au management en 1956, occupa de hautes fonctions sous le régime national-socialiste. La réception médiatique de l’ouvrage, les réactions qu’il suscita, du dithyrambe à l’acerbe critique, risquait d’introduire un biais dans notre travail de recension : c’est la raison pour laquelle nous avons procédé à ce que nous pourrions bien appeler, en termes phénoménologiques, une épochè, une suspension de l’attention au réel transcendant, en ignorant tout de ce qui fut dit ou écrit sur ledit ouvrage, y compris par l’auteur lui-même[2]. « Retour au texte lui-même ! » pourrait ainsi résumer le mot d’ordre méthodologique et herméneutique de la présente note.
Mais commençons par le commencement : qui est Johann Chapoutot ? Johann Chapoutot est un jeune professeur d’Histoire Contemporaine (né en 1978), en poste à Sorbonne Université ; il est reconnu comme un spécialiste du nazisme. Parmi les traits biographiques qui retiennent notre attention et que nous avons relevés dans les différents entretiens et discours recueillis dans le volume Comprendre le nazisme[3], nous garderons en tête les deux suivants : en premier lieu, Johann Chapoutot lit dans le texte l’allemand même quand il est écrit en caractères gothiques, ce qui lui procure l’accès à un nombre incalculable d’archives, de documents, de textes de toutes sortes, etc., si bien que ses différents ouvrages regorgent de sources et de références de première main ; en second lieu, notre historien fut un étudiant en philosophie, et cela se ressent non seulement au style de son écriture, à la place de choix qu’il réserve à la philosophie dans son analyse du nazisme (par exemple, le traitement de Kant par les intellectuels nazis) mais également par une façon de procéder, une méthode, qui ne disjoint pas histoire événementielle, histoire des mentalité et histoire des idées.
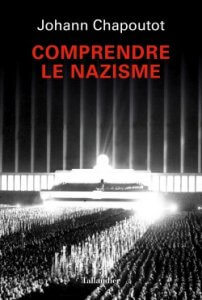
Quel est le point de départ de Johann Chapoutot, dans quel terreau s’origine son raisonnement ? C’est en premier lieu le refus de tomber dans des explications par trop faciles qui nous semblent motiver son travail. Tout d’abord, le scientifique ne peut se contenter, même si, en tant qu’être humain, il ne le comprend que trop bien, du « hier ist kein warum ! » que le garde du camp de concentration (un kapo) adresse à Primo Levi[4] : faire de l’absence de pourquoi le point d’arrêt du raisonnement, c’est de fait aborder l’atrocité nazie d’un point de vue moral voire théologique. En somme, faire endosser au Mal ou à la barbarie la responsabilité de l’horreur. Évidemment, l’absurde peut s’avérer un thème philosophique, métaphysique, particulièrement fécond, mais il ne saurait satisfaire le scientifique qui souhaite rendre un phénomène intelligible en se mettant en quête moins de causes que de raisons d’agir. On sait que Hannah Arendt, dans son commentaire du procès Eichmann, s’écarta également de la tentation morale, et interpréta le comportement de l’accusé comme celui d’un fonctionnaire qui ne faisait qu’accomplir son devoir, obéissant aux ordres et aux procédures sans s’interroger sur leur sens et leur finalité[5]. Et il est vrai que l’outrancière spécialisation du travail conduit à l’irresponsabilité et à l’éviction de la faculté du jugement. Néanmoins, cela ne suffit guère à convaincre Johann Chapoutot qui, plutôt que d’interpréter littéralement les déclarations d’Adolf Eichmann, y décèle une stratégie de défense masquant son adhésion à un système de croyances, à une vision du monde[6]. La bureaucratie ne serait donc pas une explication, mais un alibi permettant de dissimiler une question majeure, massive même, et pour le moins gênante : comment rendre compte que tant d’Allemands (que nous, en tant qu’êtres humains, aurions pu être) aient pu accorder foi et crédit à un programme aussi délirant ?
L’intuition de Johann Chapoutot, qui forme le cœur du vortex autour duquel il ne cesse de tourner dans ses ouvrages successifs, peut se formuler de la façon suivante : les hommes agissent en raison de leur adhésion à un système de croyances, de leur rattachement à une vision du monde, de leur dépendance à ce que Pierre Legendre nomme une « Référence », c’est-à-dire à « l’institution d’un espace où ça sait, où ça sait absolument »[7]. Il en résulte pour l’historien un programme de recherche clairement défini que nous déclinons, de façon arbitraire, en quatre étapes qui ne cessent, bien sûr, de se chevaucher : tout d’abord identifier le cœur de la doctrine nazie, ensuite mettre en lumière ses origines intellectuelles, puis révéler ses stratégies de légitimation et enfin montrer leur conversion en un système normatif qui régit l’action quotidienne. L’historien, quant à lui, le résume de la façon suivante : « Pour savoir quoi faire, comment agir et pour quelles raisons vivre, tout un corpus nazi de textes, de discours et d’images s’élabore qui enjoint à se tourner vers ce qu’il y a de plus concret, de plus intime, de plus tangible : dans un contexte où les idées se contredisent et se valent toutes, où les religions s’anathémisent entre elles, il reste comme recours et référence le sang, la chair, la « race ». La substance biologique a en outre l’avantage de ne pas être strictement individuelle : elle est partagée par les membres d’une même famille, d’une même « communauté », d’une même « race » – membres vivants, morts et à venir. La préservation et le développement de cette substance offrent une fin claire et aisément compréhensible, constituent une communauté et donnent un sens à la vie de l’individu »[8].
2 – Retour sur un itinéraire de recherche
S’il nous semble avoir mis le doigt sur le fil directeur de l’œuvre de Johann Chapoutot, il est à présent nécessaire de revenir, même brièvement, sur les différentes étapes de sa trajectoire, sur ses publications successives, afin de saisir comment l’ouvrage Libres d’obéir s’inscrit dans une continuité de recherche et de réflexion, et ne constitue aucunement un « coup » médiatique ainsi que sa réception mouvementée pourrait le laisser accroire.
Dans Le nazisme et l’Antiquité[9], l’historien s’attelle à étudier la mobilisation de l’Antiquité gréco-romaine par les intellectuels du régime nazi : pour ces derniers, il ne s’agit pas tant de montrer qu’ils seraient les héritiers d’une haute civilisation, que d’établir que cette dernière fut toujours déjà germaine ; car c’est en effet du tronc nordique que découlent les branches indiennes, iraniennes, grecques ou encore latines. Dans le cas présent, la stratégie de légitimation a par conséquent ceci de particulier qu’elle ne recherche pas des ancêtres ou des antécédents qui, par les traces qu’ils auraient laissées dans l’histoire, revêtiraient une forme d’autorité ou d’aura dont pourrait bénéficier l’héritier. Non, bien plutôt, elle consiste à renverser la généalogie par l’ontologie, c’est-à-dire à poser le Nord comme Origine, c’est-à-dire l’enfant comme parent, dont toute culture digne de ce nom serait tributaire. La reconstitution de cette nouvelle histoire ouvre alors la voie à l’appréciation de la fidélité ou de la conformité à la vision du monde nazie : d’une part à travers la recherche d’exemples de hérauts de la parole germaine – le cas de Platon est ici exemplaire –, d’autre part à travers la mise en évidence des phénomènes de corruption de la norme originelle – la contamination de Rome par le (judéo-)christianisme est érigée en symbole de la décadence.
Si ce premier ouvrage explore minutieusement la création d’un discours savant de légitimation de la vision du monde nazie, les suivants prennent quant à eux pour objet la conversion de ces textes en un ensemble normatif ayant pour objectif de régir les comportements et les représentations du peuple allemand : « Peu à peu, nous nous sommes orienté vers une étude globale de la normativité nazie. Ce projet impliquait de prendre en compte non seulement les sources dont le contenu et la visée étaient explicitement éthiques, mais aussi tous les autres types de discours normatifs, qui, quels qu’ils fussent, exposaient ce qui était normal, disaient ce qui était souhaitable et formulaient ce qui était impératif – tous discours en somme, qui, pour toute occasion, indiquaient ou ordonnaient quoi faire, comment et pourquoi »[10]. Prenons un exemple, celui du droit : dans ce cas précis, le primat de la vie, de sa fluidité, de son élan, a pour corollaire la dévalorisation de l’ensemble des sources écrites – les codes, les traités, les décrets, etc. –, par définition abstraites et coupées du réel, qui figent et fixent les lois dans le marbre au risque de nuire à leur potentiel d’adaptation à l’environnement et à ses mutations. C’est de ce travers issu de la sclérosante tradition romaine et catholique – donc juive – qu’il faut se débarrasser en ressuscitant les pratiques juridiques germaines ; cette opération se déploie plus précisément dans deux directions : d’une part, en supprimant les catégories individualistes du droit romain (« chose », « personne » …) et en accentuant le caractère communautaire du droit nazi (à travers le droit foncier, la modification des règles de l’héritage, etc.) ; d’autre part, en confiant au juge le rôle de « faire vivre le droit »[11] car, devant l’impossibilité (et la contradiction logique qu’il y aurait à le faire) de formaliser un nouveau droit, c’est à lui que revient l’exercice d’interprétation des textes existants à l’aune de la vision du monde nazie. Bien évidemment, d’autres domaines de la normativité sont examinés, que nous ne pouvons qu’évoquer au passage dans le cadre de cette recension : la procréation et la promotion de la polygamie, les relations internationales, la biologie, etc.
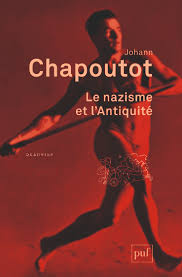
Mais alors : qu’en est-il du management dans les travaux que nous venons de passer en revue ? Il est vrai que les passages qui s’y réfèrent demeurent discrets dans Le nazisme et l’Antiquité, principalement en raison du thème de l’ouvrage. On y trouvera néanmoins mentionnée l’importance logistique de la route, car seul le réseau permet aux troupes allemandes de circuler et de conquérir le monde, tant sur le plan militaire que culturel[12]. Le thème de la performance se trouve par ailleurs indirectement abordé lorsque Johann Chapoutot présente l’insigne rôle que joue le sport dans l’imaginaire nazi (admiration et valorisation du corps grec, organisation des Jeux Olympiques, etc.) : et si l’historien insiste à juste titre sur la passerelle qui relie directement sport et guerre, il mentionne également le pont qui joint sport et travail : « Le sport est érigé en impératif individuel et politique. Il produit des corps sains qui seront utiles à la communauté, dans le travail de la paix, et dans les activités de la guerre »[13]. Mais c’est réellement à partir de La loi du sang que le management fait son entrée dans les écrits de Johann Chapoutot : tout d’abord par la mention très rapide de Reinhard Höhn[14] qui sera le personnage central de Libres d’obéir ; mais surtout par la mise en évidence de la performance comme norme sociale et politique, comme étalon de jugement d’une action et même d’un être humain :
« L’obsession de la Leistung est indissociable de la montée en puissance d’une culture économiste, d’un calcul avantage/cout dicté par la révolution industrielle, par les nouvelles formes de production et d’exploitation du « capital humain » ou de la « ressource humaine ». […] La Volksgemeinschaft (communauté du peuple) est donc, parce qu’elle est une Kampfgemeinschaft (communauté de combat), une Leistungsgemeinschaft (communauté fondée sur le principe de performance et de productivité) »[15].
De ce point de vue, la performance revêt un double statut : d’une part ontologique, car elle permet d’assurer le départ entre les êtres dignes de vivre et ceux qui ne le sont guère ; d’autre part politique, car elle fonde une pratique de la justice selon laquelle chacun reçoit son dû en fonction de sa productivité[16]. Pour résumer, « les nazis, et c’est en cela qu’ils participent pleinement d’un monde qui est celui de l’Occident depuis la moitié du XIXe siècle – le monde du capitalisme, du colonialisme, de l’impérialisme, de l’eugénisme, du darwinisme social, etc. –, les nazis sont obsédés par l’idée de performance et l’idée de rendement ; le mot est le même en allemand (Leistung) »[17] : de telle sorte que la parution Libres d’obéir venait à point nommé pour approfondir ce qui restait à l’état d’ellipse puis de propos général dans les ouvrages précédents.
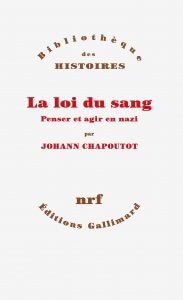
3 – Libres d’obéir : un aperçu général
Nous procéderons désormais en deux temps (points 3 et 4 de notre recension) : nous présenterons tout d’abord le contenu de l’ouvrage, puis nous ferons part de nos enthousiasmes – Libres d’obéir ouvre un champ d’interrogations du contemporain à partir d’une analyse fine et circonstanciée du régime nazi – et de nos déceptions – le livre peine à se hisser à la hauteur des attentes qu’il suscite.
Dans le prologue, Johann Chapoutot procède par induction pour présenter son sujet et en exposer la raison d’être : il s’empare d’un cas particulier, celui de Herbert Backe (« ministre, général de la SS, planificateur en chef du ravitaillement à l’Est »[18]), et observe comment ce dernier s’adresse à ses agents en usant du jargon de la performance, en fixant des objectifs, en exigeant d’eux de l’élasticité dans les méthodes. Or, loin de constituer un cas isolé, le discours de Backe reflète bien plutôt une préoccupation générale des nazis pour l’organisation du travail et la « gestion des ressources humaines » qui justifie à elle seule la présente étude. Mais cette première raison d’être se double immédiatement d’une deuxième, non moins fondamentale : en effet, alors que l’on pourrait croire, en toute logique, que cette conception du travail et du management s’effondra en même temps que le régime national-socialiste, rien ne tel ne se produisit dans les faits et elle poursuivit avec succès son chemin dans le monde de l’après-guerre, si bien que cette judicieuse mise en lumière du passage en contrebande de la vision nazie du management jette un jour nouveau sur les pratiques contemporaines peut-être trop rapidement rapprochées du seul néolibéralisme. Plus particulièrement, cette actualité cachée du nazisme tiendrait, ici encore contrairement aux idées reçues, à la promotion d’une pensée antiautoritaire qui valorise l’autonomie et la prise d’initiative du travailleur.
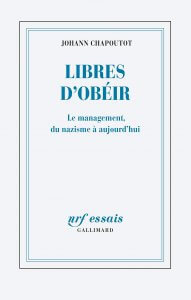
L’introduction laisse alors deviner les deux grands axes de l’ouvrage : d’une part, l’analyse du management sous le régime nazi, d’autre part l’exposition de sa postérité dans la seconde partie du XXe siècle. La question de l’efficacité de l’administration nazie se trouve au cœur du premier aspect : comment faire autant voire plus ou mieux alors que l’empire ne cesse de s’étendre mais que la main d’œuvre, elle, ne s’accroît guère ? Comment optimiser le fonctionnement, comment être productif ? Un mot d’ordre, conforme au vitalisme nazi et à la germanité, indique la voie : que la vie soit en première ligne, qu’elle puisse s’adapter aux circonstances, en d’autres termes, que les agents, impliqués dans leur mission, prennent leurs responsabilités et créent des solutions ad hoc en cessant de recourir à leur hiérarchie. D’ailleurs, cette recherche de souplesse opérationnelle s’accompagne d’un projet de « simplification normative »[19] car les procédures et les règles sinon cadenassent l’initiative du moins ralentissent l’action. Or, qui dit bureaucratie, dit État, et les nazis en prononcent justement la critique à partir de sa provenance romaine : comme l’indique son nom même, l’État est en effet statique, c’est-à-dire incapable de mouvement, de dynamisme, d’élan. Au fond, il est l’anti-vie par excellence, et il est par conséquent logique que les intellectuels du régime tentèrent de substituer à cette instance centralisatrice et surplombante ce qu’ils nommèrent la « polycratie », c’est-à-dire un éclatement du pouvoir en de multiples centres de décision[20]. D’ailleurs, la création d’« agences », chargées d’accomplir leurs missions avec une autonomie de moyens et de fonctionnement, correspond précisément à ce mouvement de décentralisation. Mais il n’est pas seulement question de modifier des structures et des formes organisationnelles : le rapport hiérarchique doit lui aussi faire sa mue : « L’historien Dieter Rebentisch a, dès les années 1980, bien perçu et souligné que le IIIe Reich renonçait peu à peu à l’ »administration » (Verwaltung), par trop romaine et française, pour entrer résolument dans un âge managérial, celui de la Menschenführung fluide et proactive »[21]. La Führung est une mise en rapport directe avec le Führer, qui passe par l’adhésion à une vision et qui fait fi des médiations institutionnelles par trop rigides : mais cette modalité de la direction des hommes ne saurait, sauf cas exceptionnel comme celui du Führer en chef, être naturelle. Les hommes ont par conséquent besoin d’être formés, et c’est à ce moment précis du raisonnement que le personnage de Reinhardt Höhn entre en scène.
Donnons ici quelques éléments biographiques : né en 1904, Höhn sera un étudiant en droit et en économie membre d’une organisation de la droite nationale (l’Ordre Jeune-Allemand). Il adhère au NSDAP le 1er mai 1933 puis à la SS au mois de juillet de la même année ; il intègre alors le Sicherheitsdienst (le « SD », service de renseignement et de maintien de l’ordre de la SS) au sein duquel il est en charge d’étudier les différents « espaces de vie » des Allemands, des universités aux administrations en passant par les entreprises. Il a obtenu son doctorat en droit en 1927, son habilitation en 1934, ses différents travaux accordent une place centrale au concept de Gemeinschaft (« communauté ») qui constitue, à ses yeux, la seule réalité. Il est élevé par Himmler, en 1939, au rang de colonel avant de devenir général en 1944. Quels sont donc les liens entre Reinhard Höhn et le management ? Ils deviennent visibles après la guerre, ainsi que le décrit Johann Chapoutot : « En 1953, on le retrouve ainsi au poste de directeur de la Société allemande d’économie politique (Deutsche Volkswirtschaftliche Gesellschaft, DVG), une association et un think tank industriel qui vise, dans le contexte de haute croissance, à favoriser les méthodes de management les plus efficaces. Pour « développer et enseigner les formes de gestion des ressources humaines les plus adaptées à notre temps », la DVG décide de créer une école de commerce pour les cadres de l’économie. Dans le contexte du plan Marshall, de l’atlantisme triomphant, des « missions de productivité » outre-Atlantique, il s’agit de former des managers à l’américaine, des leaders polyvalents qui soient distincts de ces spécialistes, docteurs de ceci ou ingénieurs de cela dont raffole l’Allemagne depuis Guillaume II. Le modèle est évidemment la Harvard Business School, qui doit être rédupliquée en Allemagne comme elle l’est en France avec l’INSEAD en 1957 »[22]. Höhn prit la tête de l’établissement jusqu’à sa mort en 2000, le temps de voir passer quelques 600000 cadres à la moulinette des programmes, des concepts et des outils qu’il distilla dans de multiples séminaires et formalisa dans de nombreux ouvrages (plus d’une quarantaine selon Johann Chapoutot).
Comment, alors, caractériser cette méthode dite de Bad Harzburg, du nom de la commune sur laquelle fut implantée l’école ? Fidèle à la vision nazie décrite ci-dessus, Höhn préconise de rompre avec l’absolutisme et l’autoritarisme, qui accompagnaient la naissance de l’État moderne, afin de s’adapter à l’air du temps, à l’esprit de l’époque (die Zeitgeist), et de placer l’individu, ses ressources, sa créativité, au centre du travail. La coopération généralisée doit mettre fin à la lutte des classes, et à toute forme de conflit au sein de la société allemande : il se fait ainsi le chantre de la cogestion, modèle dans lequel patronat et syndicats s’associent pour prendre des décisions au nom de l’intérêt général.
4 – Libres d’obéir : une appréciation critique des apports et des limites
Relevons en premier lieu ce qui nous apparaît comme la principale leçon de l’ouvrage de Johann Chapoutot : contrairement à bien des idées reçues, on ne saurait assimiler nazisme et absolutisme, ou encore nazisme et tyrannie, sans entrer en contradiction avec les discours et les projets des intellectuels du IIIe Reich. Ces catégories échouent en effet à rendre compte d’une vision du monde organiciste dans laquelle le centre nerveux joue certes un rôle prépondérant et central, mais laisse une part d’initiative, d’autonomie et de responsabilité aux membres périphériques. Plusieurs corollaires s’ensuivent : tout d’abord, l’historien insiste sur le souci pour les responsables nazis d’emporter l’adhésion de leurs agents, comme si la simple et mécanique exécution d’une tâche ne suffisait guère à les satisfaire : « Dans le travail, dans la vie économique, comme dans le quotidien politique, le consentement des Allemands fait l’objet d’une attention extrême de la part des dirigeants du Reich »[23]. Évidemment, cela n’est pas sans évoquer le ressort du capitalisme contemporain qui ne laisse pas d’en appeler à la mobilisation des salariés, et, par conséquent, les pratiques actuelles de management orientées vers la captation et la manipulation du désir, ainsi que le mit judicieusement en exergue Frédéric Lordon[24]. « Étonnante modernité nazie […]. Le bien-être, sinon la joie, étant des facteurs de performance et des conditions d’une productivité optimale, il est indispensable d’y veiller »[25], écrit ainsi Johann Chapoutot. Mais l’on aurait ici aimé que l’historien dresse un pont entre la naissance des relations publiques, que l’on doit aux apports successifs de Walter Lippman (Public Opinion paraît en 1922) et d’Edward Bernays (Propaganda paraît en 1928), et la manufacture du consentement telle qu’elle fut pensée et pratiquée par les dignitaires nazis. Il est en outre un deuxième point qui doit retenir toute notre attention : la critique de l’État, de sa lourdeur, de sa centralisation, ne saurait être l’apanage des traditions libérale, néo-libérale, libertaire et anarchiste. Elle fut en effet prononcée et assumée par les responsables du régime national-socialiste qui, en créant des agences, tentèrent de « dégraisser le mammouth », de procéder à une forme de décentralisation destinée à adapter le pouvoir à son environnement. Et l’on reconnaît ici, comme le souligne à juste titre Johann Chapoutot, les pratiques issues du Nouveau Management Public (New Public Management) dont le programme consiste à appliquer les recettes du management issu des entreprises privées aux institutions publiques.
Au total, donc, Libres d’obéir est précieux car il brouille les frontières : il n’est plus possible, après avoir lu ce livre, de faire reposer le diagnostic de l’époque sur les seules épaules du néolibéralisme. Ce serait trop court, trop partial, trop fragmentaire. En d’autres termes, néolibéralisme et nazisme convergent sur un certain nombre d’aspects, plus particulièrement dans le domaine du travail, car ils ne sont que deux manifestations historiques de la société industrielle dont l’ultime Référence se nomme « Efficacité »[26]. Ainsi, comme le note Johann Chapoutot, « l’Allemagne nazie offre un observatoire intéressant pour penser le management et notre modernité »[27]. Il n’est pas le premier à poser cette hypothèse stimulante : chacun à sa manière, Giorgio Agamben et Zygmunt Baumann ont déjà emprunté ce chemin, comme le reconnaît d’ailleurs volontiers l’historien. Mais cette thèse ne doit-elle pas être, au moins dans une certaine mesure, renversée ? Et plutôt que se limiter à considérer l’Allemagne nazie comme un exemple historique utile à la compréhension du management – piste tout à fait stimulante dont nous ne nions pas l’intérêt –, ne serait-il pas tout aussi pertinent de s’enquérir du management, de son histoire, de ses théories, afin d’établir le caractère industriel et managérial du IIIe Reich ?
C’est ici, à notre sens, que le bât blesse et précisément à partir de cette remarque, qui prend l’apparence d’une question rhétorique, que peuvent se décliner les principales limites – et les frustrations qui en découlent – de Libres d’obéir. Cela concerne tout d’abord l’objet même de l’ouvrage ; en la matière, l’auteur nous semble hésiter dans l’énonciation même de sa thèse : s’agit-il en effet de mettre en exergue que le nazisme fut la matrice du management contemporain ou, plus modestement, que sa vision du monde se perpétua dans l’Allemagne de l’après-guerre à travers la formation des cadres ? D’un côté, Johann Chapoutot peut écrire que « le management a une histoire qui commence bien avant le nazisme, mais cette histoire s’est poursuivie et la réflexion s’est enrichie durant les douze ans du IIIe Reich, moment managérial, mais aussi matrice de la théorie et de la pratique du management pour l’après-guerre »[28] ; de l’autre, il affirme que « […] la conception nazie du management a eu des prolongements et une postérité après 1945, en plein « miracle économique » allemand et que d’anciens hauts responsables de la SS en ont été les théoriciens, mais aussi les praticiens heureux, réussissant une reconversion aussi spectaculaire que rémunératrice »[29]. Et si la balance penche du premier côté, comment l’auteur analyse-t-il le rôle de la cybernétique américaine dans la formation du management de l’après-guerre[30] ?
Ce positionnement flou s’accompagne en outre d’un questionnement de nature cette fois-ci historique et anthropologique : si « les leçons des missions de productivité menées depuis les années 1920 par les ingénieurs allemands aux États-Unis ont bien été tirées : il ne faut pas désespérer l’ouvrier, mais lui donner au contraire matière à rêver »[31], alors faut-il en conclure que les responsables nazis ne furent ici que les simples héritiers des intellectuels de la République de Weimar ? Quelle serait alors leur originalité propre ? Et dans leur conception du management, quelle part revient à l’Amérique et quelle part à l’Allemagne ? Par exemple, lorsque Johann Chapoutot affirme que « la Menschenführung vient traduire et germaniser le terme américain de management »[32], sous-entend-il qu’il s’agit d’une importation qui prend la forme d’une imitation ? Dans ce cas, à travers le relais nazi, ce serait tout de même une vision américaine qui se serait imposée…ce qui mènerait tout simplement à contredire la thèse défendue dans le livre.
Répondre à ces questions aurait nécessité de prendre plus au sérieux la question du management, de son histoire, de ses concepts, et de ne pas limiter son étude aux quelques éléments par trop généraux que l’on peut découvrir dans l’épilogue. L’ouvrage comporte quelques mentions, à chaque reprise brèves voire elliptiques, de Taylor, Ford, Fayol ou encore Drucker ; mais il suffit d’ouvrir un ouvrage de théorie des organisations – que le lecteur sera en peine de trouver dans la bibliographie finale – pour savoir que ces auteurs, aussi importants soient-ils, sont loin d’épuiser le corpus gestionnaire. Sans avoir défini de façon précise ce que l’on doit entendre par management, sans le replacer dans le cadre général de la société industrielle et du projet industrialiste, Johann Chapoutot ne s’est pas donné, nous semble-t-il, les moyens de son ambition. Ce que reflète d’ailleurs la taille modeste de l’ouvrage (170 pages en format poche) qui contraste avec les attentes suscitées par les questions soulevées.
[1] Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, Paris, Éditions Gallimard, « nrf essais », 2020, p. 20.
[2] J’ajoute cette note de bas de page alors que la rédaction de la recension est achevée. Parmi les échos médiatiques rencontrés par le livre de Johann Chapoutot, on trouve, sans souci d’exhaustivité : https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/01/16/libres-d-obeir-de-johann-chapoutot-le-nazisme-est-il-soluble-dans-le-management-d-entreprise_6026052_3260.html, https://www.lefigaro.fr/histoire/johann-chapoutot-les-nazis-agissaient-en-managers-avec-une-conception-du-travail-non-autoritaire-20200123, https://www.franceculture.fr/histoire/johann-chapoutot-le-nazisme-une-multitude-de-centres-de-pouvoir-qui-sont-autant-de-petites, https://www.nouvelobs.com/idees/20200202.OBS24268/nazisme-et-management-pourquoi-johann-chapoutot-ne-franchit-pas-le-point-godwin.html.
[3] Johann Chapoutot, Comprendre le nazisme, Paris, Tallandier, 2018.
[4] Ibid., p. 113-114. Cf. Primo Levi, Si c’est un homme, Paris, Éditions Julliard, 1988, p. 38. Traduction française de la sentence du kapo donnée par Primo Levi : « Ici, il n’y a pas de pourquoi ! ».
[5] Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Enquête sur la banalité du mal, trad. Anne Guérin, Paris, Éditions Gallimard, « folio histoire », 2002.
[6] Johann Chapoutot, La révolution culturelle nazie, Paris, Éditions Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 2017, p. 215-228.
[7] Pierre Legendre, Leçons II. L’empire de la vérité. Introduction aux espaces dogmatiques industriels, Paris, Fayard, 2001 ? p. 38.
[8] Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris, Éditions Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 2014, p. 22-23.
[9] Johann Chapoutot, Le nazisme et l’Antiquité, Paris, Presse Universitaires de France, « Quadrige », 2012.
[10] Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, op. cit., p. 25.
[11] Ibid., p. 173.
[12] Johann Chapoutot, Le nazisme et l’Antiquité, op. cit., p. 353.
[13] Ibid., p. 269.
[14] Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, op. cit., p. 149.
[15] Johann Chapoutot, La révolution culturelle nazie, op. cit., p. 80. On trouve déjà cette phrase, énoncée sous une forme similaire, dans La loi du sang. Penser et agir en nazi, op. cit., p. 220.
[16] Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, op. cit., p. 253.
[17] Johann Chapoutot, Comprendre le nazisme, op. cit., p. 38.
[18] Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, op. cit., p. 13.
[19] Ibid., p. 27.
[20] Ibid., p. 38.
[21] Ibid., p. 60.
[22] Ibid., p. 87. On peut compléter ici le propos de Johann Chapoutot en indiquant que les Institut d’Administrations de l’Entreprise (IAE), véritables écoles de commerce universitaires, furent créés dans la même décennie. Et quel était le modèle de Gaston Berger à l’origine de cette initiative ? Harvard, bien sûr.
[23] Ibid., p. 70.
[24] Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique Éditions, 2010.
[25] Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, op. cit., p. 74.
[26] Voir sur ce point : Pierre Musso, La religion industrielle. Monastère, manufacture, usine : une généalogie de l’entreprise, Paris, Fayard, « Poids et Mesures du Monde », 2017.
[27] Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, op. cit., p. 129.
[28] Ibid., p. 16.
[29] Ibid., p. 19.
[30] Pour cette question, nous permettons de renvoyer le lecteur à nos propres travaux, par exemple : Baptiste Rappin, Au fondement du Management. Théologie de l’Organisation, Volume 1, Nice, Éditions Ovadia, 2014.
[31] Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, op. cit., p. 72.
[32] Ibid., p. 62.








