Le dernier livre de Jocelyn Benoist, intitulé Logique du Phénomène, paraît un peu moins de deux ans après Le bruit du sensible 1. Dans ce précédent ouvrage, Jocelyn Benoist y développait une philosophie du sensible exempte de tout recours aux notions de phénomène et d’apparaître. Pour un lecteur de la tradition phénoménologique une telle dissociation peut paraître bien difficile à concevoir, et par bien des aspects, Logique du phénomène offrira une clé indispensable à la clarification de ce point. Encore une fois, chose bien difficile à concevoir pour tout lecteur nourri à la seule phénoménologie, et à la doctrine de l’apparaître qui lui est constitutive – quelles qu’en soient les variantes -, rien dans le concept de perception n’implique constitutivement celui de phénomène ou d’apparaître.
Le projet de Jocelyn Benoist n’est cependant, en aucun cas, de nous convaincre que la perception n’est jamais de l’ordre de l’apparaître, il s’agit bien plutôt de se demander à quelles conditions se rattache l’usage de la notion d’apparaître. Aussi est-ce à une utilisation en roue-libre, métaphysique au mauvais sens du terme, c’est-à-dire entièrement affranchie des conditions sous lesquelles un concept revêt le sens qu’il a, que Jocelyn Benoist critique la phénoménologie, et soyons plus précis, la phénoménologie contemporaine, puisque, comme nous le verrons, Jocelyn Benoist n’oublie jamais de rappeler que les grands auteurs de la tradition, Husserl compris, n’ont jamais négligé de soumettre les notions de phénomène ou d’apparaître qu’ils mobilisaient aux conditions sous lesquelles leur recours pouvait tout simplement prendre sens. Loin de dédouaner la tradition, il s’agit pour Jocelyn Benoist de montrer comment, néanmoins, les déplacements, voire les distorsions, que les grands auteurs de la tradition, depuis Platon jusqu’à Husserl en passant par Kant (tournant essentiel), ont fait subir aux conditions d’emploi de la notion de phénomène, ouvrent inéluctablement la voie à l’émergence d’une nouvelle sorte de phénoménologie se caractérisant par une omission pure et simple, quand il ne s’agit pas d’une fautive négligence, des conditions d’usage du concept de phénomène.
A partir de là, il devient possible de comprendre la perplexité du philosophe contemporain, phénoménologue, lorsqu’il lui est dit que le concept de perception n’implique aucunement ceux d’apparaître et de phénomène. Et c’est bien de cette perplexité dont il s’agit de le libérer, en lui montrant par quelle histoire lui est parvenu le concept moderne de phénomène qu’il manipule, lequel, se révèle, au regard de cette histoire, ne plus pouvoir encore le moins du monde aller de soi :
« Se demander pourquoi on qualifie les choses, ou certaines choses, de « phénomènes », c’est assurément dénaturaliser ce qui est tenu pour une évidence par au moins une bonne part de la philosophie contemporaine (…) il faut donc réapprendre à l’entendre comme problématique pour en mesurer la portée : sous quelles conditions cela a-t-il un sens de dire d’une chose qu’elle « apparaît » ? » 2.
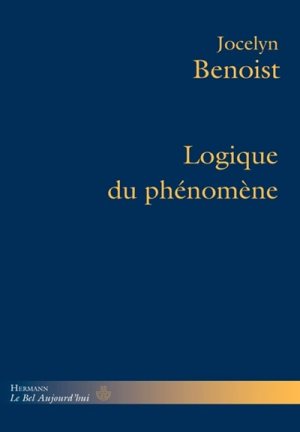
Le programme d’agrégation de philosophie de l’année 2015 a donné à Jocelyn Benoist l’occasion d’écrire la genèse critique de la notion moderne, absolutisée, de phénomène en remontant jusqu’à Anaxagore, c’est-à-dire au moment fondateur où la notion de phénomène fait son entrée en philosophie et ouvre ainsi le chemin d’une histoire qui n’est autre que celle d’une lente et progressive dégrammaticalisation – ou absolutisation – de la notion de phénomène. Dans la présente étude, nous proposons de concentrer notre approche sur les trois grands moments charnières de la démonstration : celui consacré à Platon, puis à Kant et enfin à Husserl.
1. Platon et la grammaire
La critique de l’absolutisation de la notion d’apparaître que propose Logique du phénomène s’inscrit dans l’horizon d’une réhabilitation explicite de Platon : « Bien avant Wittgenstein, et comme tout vrai philosophe après lui (il en fixe la norme), Platon sait qu’un terme ne vient jamais seul. La source de la métaphysique au sens péjoratif du terme (…) tient précisément dans leur isolation » 3.
Selon une lecture scolaire, Platon aurait opposé aux « phénomènes » le registre des vraies choses, proprement intelligibles et transcendantes. La phénoménologie, au XXeme siècle, aurait proposé, dans un geste de retournement du platonisme, une réhabilitation du phénomène en tant qu’élément où se déploient les vraies choses – les fameuses « choses mêmes ». On a pu ainsi décrire la phénoménologie, suivant une formule paradoxale, comme un platonisme du sensible. Sans remettre en question le fond de cette lecture, Jocelyn Benoist rappelle que le cœur de l’opposition se trouve ailleurs : la phénoménologie est plutôt un platonisme qui en aurait oublié la leçon fondamentale, à savoir : « pas de phénomène sans grammaire, toute phénoménologie, en son fond, est phénoméno-logie, ce qui veut dire qu’il n’y a « phénomène » que sous le préalable du logos » 4.
Ce point de méthode éclaire la critique platonicienne de la position des sophistes. Protagoras dans le Théétète distord la grammaire de l’apparaître, et celle de l’être par la même occasion, en rabattant la seconde sur la première. Sous l’effet d’une telle distorsion, ne respectant plus les conditions d’usage des termes, nous aboutissons à l’idée d’une relativité du phénomène étendue à l’être:
« Telle m’apparaît chaque chose, telle elle est pour moi, et telle elle t’apparaît à toi, telle à nouveau elle est pour toi » 5.
Le geste de Protagoras conduit à cette aberration grammaticale qu’est non pas un phénomène-relatif (parfaitement grammatical) mais, ce qui est tout autre chose, un être-relatif : « normalement le verbe être semble appeler un emploi absolu : une chose est tout court. Faire ainsi la syntaxe de l’être relative, c’est lui faire une extrême violence : la renverser, puisque son fonctionnement normal est de ne pas être relative »6.
Or, fort de cette distorsion de la grammaire de l’être, il est possible, et c’est ce que Socrate indique, qu’il faille entendre bien autre chose de la part de Protagoras et de la position sophistique en général : non pas la contamination de la relativité du phénomène à l’être, mais plus radicalement la remise en question radicale de toute idée d’être. C’est ce que Socrate suggère, nous rappelle Jocelyn Benoist, lorsqu’il prétend dévoiler la « doctrine secrète » des sophistes – celle pour les initiés : « le mot être est à éliminer de partout » 7. Une telle éradication du mot être a cependant des conséquences dévastatrice pour l’ensemble de notre usage ordinaire du langage – et c’est bien ce à quoi veut nous conduire Protagoras. Car c’est la référence extra-linguistique de nos mots aux choses que la sophistique cherche à supprimer, autrement dit, rien d’autre que le renvoi de ces derniers à un être « en soi et par soi ». S’il est parfaitement légitime de dire que la table m’apparaît bancale alors qu’en réalité, elle est stable, il ne devient possible de dire de la table qu’elle est bancale seulement pour moi que si que le mot table ne renvoie plus à une unité référentielle qu’un autre pourrait viser à son tour en disant que la table dont je parle est en fait stable – et qu’elle ne fait que me paraître bancale parce que le mouvement de mes jambes, supposons, la fait bouger sans arrêt. A la prétention de l’interlocuteur de référer à la même table, possibilité constitutive du mot table et du langage en général, Protagoras répondrait qu’en l’absence de quoi que ce soit comme la même table, il faudrait bien plutôt dire qu’elle est bel et bien stable pour lui et bancale pour moi. La relativisation de l’être c’est-à-dire l’éradication pure et simple du mot être conduit à ériger le phénomène en mesure exclusive du vrai et à prôner, pour cette raison, que c’est à chacun sa vérité. Il serait tout aussi vrai que la table est stable pour mon interlocuteur (mais est-il encore possible de parler ici d’interlocution sans identité référentielle du langage ?) qu’elle est bancale pour moi.
La critique sophistique consisterait à rejeter ni plus ni moins l’implication référentielle du langage ordinaire, en prônant l’idée d’un langage privé plus conforme à nos intentions linguistiques. L’idée serait que lorsque je parle de la table je parle de la table pour moi, là où le langage ordinaire impliquant un rapport de nos mots à une référence externe à ma subjectivité ouvre le champ à une illusoire table en-soi dont il y aurait lieu de discuter (est-elle réellement ainsi (telle qu’elle m’apparaît) ou non ?). C’est bien la possibilité d’une intervention critique (« tu te trompes elle n’est pas bancale c’est toi qui gigotes sans arrêt ») qui se trouverait de la sorte annulée dans la mesure où celle-ci repose sur la possibilité de déployer un autre discours sur la même chose. Cette dernière étant réduite par les sophistes à une illusion, un pur effet de langage, il ne faudrait plus dire que la table qui m’apparaît bancale est en réalité stable mais que pour moi elle est bancale là où pour toi elle est stable. Aussi, comme le souligne Socrate, « ceux qui tiennent ce discours, il leur faut instituer une autre langue » 8. Une telle institution viserait l’établissement d’un langage qui, à rebours du langage ordinaire – compromis dans l’illusion référentielle –, s’en tiendrait à l’identification d’une « référence simplement donnée » 9, purement subjective (l’objet pour-moi, rien de plus), d’un langage de l’apparaître, c’est-à-dire d’un langage purement phénoménologique. Or c’est bien à la conclusion qu’un tel langage aussitôt n’en serait plus du tout un, que, suivant Jocelyn Benoist, la critique salutaire de la sophistique par Socrate aboutit : « Ce n’est pas assez dire que ce langage n’est pas « notre langage ordinaire ». Ce n’en est pas un autre non plus. Il ne s’agit tout simplement pas d’un langage au sens où nous entendons ordinairement ce mot. Le fantasme agité ici est celui de la sortie du langage. Cependant, il prend la figure d’une « autre langue », non donnée parce qu’elle ne peut pas l’être : autre non pas parce qu’alternative et résidant dans on ne sait quel univers sémantique possible et non exploré, mais parce qu’autre au langage même » 10.
Pour un tel langage, où la référence à tout être en-soi aurait disparu, il ne reste plus pour objet que l’apparaître. Or, « un tel point de vue, cependant, est oublieux de sa propre grammaire. On ne prend pas congé de l’être ainsi. La référence à l’être – la référence tout court – fait partie de la grammaire de l’apparaître et en est une condition logique » 11. Que signifierait la mobilisation du terme « apparaître » (la table m’apparaît bancale) qui ne permettrait pas de se demander si les choses sont bien comme elles apparaissent (où il serait impossible de me voir rétorqué : « la table t’apparaît bancale, certes, mais elle ne l’est pas » ou de se demander : « mais cette table est-elle vraiment comme elle m’apparaît ? ») ? Une fois sevrée d’une telle possibilité constitutive, c’est la notion elle-même d’apparaître qui serait tout simplement vidée de son sens et employée indument : « il n’y a d’apparaître que là où il y a quelque chose pour apparaître et depuis l’être de cette chose qui apparaît, l’être, en bonne grammaire, précédant l’apparaître »12. A ce compte, la doctrine phénoménologique ne s’y était, quant à elle, pas trompée, et bien loin de verser dans la sophistique, persiste salutairement en elle ce que Jocelyn Benoist appelle « une vocation fondamentalement ontologique » : « cela non pas parce que la doctrine phénoménologique « vraie » serait celle qui prétend établir des résultats à caractère ontologique, mais tout simplement parce que le discours de l’apparaître est inintelligible sans référence à un être. Les deux termes font système » 13.
C’est là l’une des leçons fondamentales du Théétète : dès que l’on raisonne sur l’expérience sensible en termes d’apparaître (phainesthai) « alors il est inévitable de faire une place à la possibilité de mal sentir. Avec l’idée d’apparaître, c’est une fondamentale normativité qui a été introduite dans le sensible. En réalité, on y a introduit l’être comme norme. Si quelque chose « apparaît », la question se pose inévitablement de savoir s’il apparaît bien ou mal, à savoir tel qu’il est » 14.
Raisonner sur le sensible en termes d’apparaître c’est aussitôt ouvrir un espace d’évaluation, autrement dit, pouvoir se demander si la chose apparaît convenablement (apparaît comme elle est vraiment) ou non (n’apparaît pas comme elle est vraiment): « tenir le discours de l’apparaître, c’est en effet poser la question de savoir s’il en est bien ainsi, si les choses sont bien ce qu’elles semblent. Sinon on ne dirait pas qu’elles le semblent ». La mise au jour du traitement grammatical de la notion de « phénomène » par Platon, permet aussitôt de prendre toute la mesure de la radicalité de son geste philosophique. Celui-ci consiste, en effet, dans un recours non simplement occasionnel et local à la notion de phénomène mais dans sa généralisation à l’ensemble du sensible. Pas d’épreuve sensible qui ne soit, pour Platon, l’épreuve d’un apparaître. Ce qui veut donc dire, dès lors que le monde sensible est assimilé à un monde phénoménal, qu’il ne peut y avoir d’épreuve sensible sans l’intervention d’une norme, laquelle n’est jamais le phénomène d’une norme – requérant une norme à son tour – mais bien plutôt la norme du phénomène: « Le phénomène n’est que par rapport à une norme, et il ne peut pas être norme de lui-même, sa norme constitutivement le dépasse (comme telle, elle n’« apparaît » pas, en tout cas pas dans le même mouvement, il n’y aurait pas de sens à dire qu’elle « apparaît ») telle est la structure logique que Platon dégage pour le « phénomène » en l’instituant comme concept philosophique (…) la question est alors de savoir comment l’ensemble des choses sensibles ont pu, dans l’architecture platonicienne, apparemment se voir attribuer intrinsèquement le statut de « phénomènes », selon un geste qui a si profondément marqué le concept qu’il est devenu à peu près impossible de l’en séparer. Après tout, pourquoi les choses sensibles auraient-elles spécialement à « apparaître » ? Et, inversement, pourquoi auraient-elles le monopole de l’apparaître ? (…) Comment le sensible a-t-il pu devenir « phénomène » en général, et même « le phénomène » par excellence ? » 15. Assimiler les choses sensibles à des phénomènes c’est leur assigner des conditions logiques bien précises – c’est les placer sous l’empire de la norme. Or si Platon est parfaitement conscient des implications de son geste, en revanche, l’histoire moderne de la notion de phénomène en viendra peu à peu à oublier les conditions logiques sous lesquelles Platon place la notion de phénomène. Celle-ci, en effet, n’a de sens, que si tout ne peut pas être reconduit à la phénoménalité – et au premier chef la norme depuis laquelle cela a un sens d’identifier un objet sensible à un phénomène. On voit donc bien que d’un point de vue strictement platonicien cela n’aurait aucun sens de tout traiter en termes d’apparaître, autrement dit, d’universaliser la notion de phénomène. La pensée moderne à la fois hérite incontestablement du geste de Platon – par la centralité à la notion de phénomène qu’elle accorde – et oublie sa leçon fondamentale : pas de phénomène sans norme, pas de phénomène sans cet au-delà du phénomène qu’est, en l’occurrence, l’Idée :
« le génie philosophique de Platon est d’adosser son invention philosophique – l’invention de la philosophie même – à la grammaire la plus ordinaire qui soit de l’apparaître : à des situations où il y a bien lieu de dire que quelque chose apparaît et où, par construction, l’apparition en question peut être légitimement mesurée à l’être de cette chose. Pour faire du sensible en général un phénomène par principe, il faut partir de cas non litigieux, de phénomènes au sens le plus ordinaire du terme » 16.

Aussi à rebours de la mauvaise métaphysique qui se caractérise par son oubli des conditions auxquelles la notion de phénomène est assignée – la phénoménologie contemporaine, plus métaphysique en ce sens que la métaphysique qu’elle prétend dépasser – il faudra reconnaître, formule surprenante et abyssale, ce que Jocelyn Benoist appelle « ce qu’il peut y avoir d’irréductiblement et positivement métaphysique dans la logique même » 17, à savoir la nécessaire transcendance des normes : « ce n’est jamais dans la réalité donnée comme telle que je trouverai la norme. Celle-ci suppose toujours un pas au-delà » 18.
La question reste de savoir, dès lors, comment il a été possible de passer de l’invention platonicienne du phénomène, fondée sur la grammaire ordinaire de la notion, à la lente et progressive autonomisation du phénomène vis-à-vis du cadre normatif posé par Platon et qui lui est pourtant fondamentalement constitutif. Comment a-t-on pu, sinon par une omission totale de la leçon platonicienne, absolutiser la notion d’apparaître, sans soupçonner le moins du monde tout ce que contenait de non-sens un tel geste théorique ?
2. Kant et le platonisme « sans les mains »
La philosophie kantienne représente un moment charnière dans l’histoire de la notion de phénomène, où s’élabore son entente proprement moderne. L’approche kantienne du phénomène est désignée par Jocelyn Benoist, parodiant la célèbre formule de Péguy, comme un « platonisme sans les mains », au sens d’une philosophie de l’apparaître exempte des contraintes grammaticales qui avaient été mises au jour par Platon.
Ce qui caractérise la théorie kantienne du phénomène n’est autre que l’altération considérable qu’elle fait subir à la clause de relativité du phénomène. Cette clause, présente aussi bien chez Platon que chez Aristote, signifie tout simplement qu’il n’est pas de phénomène qui n’apparaisse pas à quelqu’un. Une telle thèse de relativité est transformée par Kant en une thèse bien différente, celle de la subjectivité du phénomène : « Dire que le phénomène est subjectif ce n’est pas dire qu’il est « relatif à un sujet ». C’est dire qu’il est le sujet lui-même (…) le « sujet » des modernes n’est vraiment « sujet » que s’il est absolu – et donc ne porte pas avec lui le poids de ces relations réelles qui constituent un sujet. Il n’est rien d’autre, à la limite que sujet de la phénoménalité – elle-même arrachée aux relations réelles qui lui donnaient un sens » 19. En ce sens, Jocelyn Benoist identifie dans l’émergence contemporaine de phénoménologies a-subjectives moins tant une rupture, comme ces dernières le prétendent, avec le sujet au sens moderne, que le terminus ad quem d’un geste de déréalisation du sujet dont le sujet moderne était déjà le produit : « l’« asubjectivisme » proclamé des post-modernes n’est que le subjectivisme des modernes conduit jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au bout de la déréalisation du sujet (…) les choses ne peuvent être dites « apparaître » si ce n’est à quelqu’un. Le geste des modernes consiste à effacer cette relativité en faisant de l’instance à qui les choses sont « données » ou « apparaissent » un absolu, comme si elle-même ne devait pas être déterminée par ses relations avec des choses réelles et toujours aussi comme une chose réelle parmi d’autres » 20.
La question se pose alors de savoir comment il a été possible de passer de la relativité du phénomène à son devenir subjectif. Un tel pas est clairement franchi par Kant dont la philosophie constitue une étape cruciale dans l’histoire de la notion de phénomène, c’est-à-dire dans l’édification d’une entente toujours plus a-grammaticale de celui-ci. Cependant, une première clarification s’impose : le réalisme de la chose en soi (rien qui n’apparaisse sans quelque chose qui apparaisse) ne représente-t-il pas un cas exemplaire de respect de la contrainte grammaticale suivant laquelle « le phénomène est toujours, en son fond, la manifestation de quelque chose qui n’a rien de subjectif. Ce qu’il faudra bien appeler : un être » 21 ? En effet, la phénoménalité du sensible ou la reconduction du sensible au phénoménal – geste dont on doit à Platon la paternité -, suppose, en bonne logique, qu’il y ait bien « quelque chose qui se manifeste à travers lui, et plus encore : où cette chose peut être pensée dans sa transcendance par rapport à son apparaître sensible » 22. Or, la référence à l’être n’est pas encore suffisante pour satisfaire l’usage correct de la notion de phénomène ou d’apparaître. Encore faut-il, en effet, « que la chose qui apparaisse apparaisse à quelqu’un » 23. Respectant parfaitement la nécessité d’un récepteur au phénomène, Kant déplace pourtant le statut qui lui revient dans la perspective traditionnelle, aristotélicienne : « ce récepteur, au lieu d’être déterminé suivant la table des catégories aristotélicienne, donc d’être circonscrit dans sa réalité, se voit fait générique et, en quelque sorte, déréalisé. Le modèle, pourtant, au départ, est bien celui d’un récepteur réel » 24. Première enfreinte, donc, à la logique du phénomène : le devenir anonyme – sujet transcendantal – de la figure réceptrice qui représente, nous l’avons vu, une dimension constitutive de la notion de phénomène. Pour autant, Jocelyn Benoist souligne fortement que la formalité du sujet kantien n’est pas sans porter avec elle une sorte de rappel, en écho, de la logique du phénomène déployée naguère par Platon et Aristote. En quoi consiste ce rappel? C’est que, certes, le phénomène kantien n’apparaît pas à quelqu’un en particulier mais à une subjectivité en général, laquelle, toutefois, n’est pas n’importe quelle subjectivité, mais bien la nôtre – nous, humains :
« la forme que le sujet prête au phénomène est en effet, c’est un point essentiel finalement assez souvent ignoré des commentateurs, contingente. Il y a lieu à une exposition transcendantale, et non seulement une exposition métaphysique, des concepts d’espace et de temps, car pour des êtres dont la sensibilité est spatio-temporellement structurée, comme nous, il est nécessaire que les objets apparaissent dans l’espace et dans le temps de la façon dont ils le font et les lois de la spatio-temporalité ont une portée objective : à travers cet apparaître, c’est bien leur être même qui est déterminé. Cependant, il s’agit tout de même d’une exposition, et non d’une déduction, contrairement à ce qui se passe eu égard aux structures de l’entendement (…) il est possible d’agiter spéculativement (métaphysiquement, d’où l’« exposition métaphysique ») l’idée d’un être pensant fini dont la sensibilité serait structurée différemment de la nôtre, suivant d’autres formes. Le concept de sensibilité n’implique pas à lui seul la spatio-temporalité. Celle-ci est un fait contingent, qui renvoie à la constitution métaphysique particulière de notre subjectivité »
25. En ce sens, la logique du phénomène semble respectée : « il n’y a d’apparaître, en effet, que celui qui apparaît à un type défini d’être » 26. Elle a été, cependant, fortement altérée, et il n’est pas sûr, à terme, que la logique du phénomène supporte le subjectivisme que les modernes lui imposent.
Le dispositif transcendantal procède ainsi en deux temps où à la violation de la grammaire du phénomène succède le rétablissement in extremis de celle-ci dans un cadre renouvelé. Tentons d’y voir plus clair. Jocelyn Benoist montre le geste accompli au § 3 de l’Esthétique Transcendantale où Kant, dans une critique de Locke, généralise le modèle des qualités secondes à toutes qualités sensibles (premières et secondes), impliquant ainsi, par exemple, que l’on cesse de tenir la rose pour un objet indépendant de la variabilité des impressions qu’il peut éveiller en chacun de nous, « une chose commune et non une simple chose privée » 27 : Kant précise, en effet, que « cet « objectif » auquel l’analyse traditionnelle opposait la subjectivité du phénomène en tant que relativité à un sujet est lui-même phénoménal » 28. Il y aurait dès lors la rose qui paraîtrait rose pâle à un tel et d’un rose tirant plutôt vers le parme à un autre (en fonction de l’inclinaison de la rose par rapport à la lumière du soleil, supposons), et, au-delà de ces deux paraîtres privés, un paraître commun que serait la rose elle-même. Or « une telle généralisation de l’apparaître annule ou en tout cas relativise, fait descendre en aval, la distinction usuelle entre l’être et le paraître : celle-ci devient un partage interne à l’ordre du paraître, en quelque sorte entre un paraître commun et un paraître privé. Cependant, cette généralisation a un coût et celui-ci s’avère logiquement exorbitant. Kant en est parfaitement conscient : en l’effectuant, on a complètement altéré le sens du paraître » 29. En effet, que signifie une telle idée de paraître commun ? « Pourquoi dirions-nous que le mur nous « paraît » droit s’il « paraît » droit à tout le monde ? Alors personne ne dira qu’il « paraît » droit, mais tout simplement qu’il l’est » 30. Ce qui sauve la doctrine d’une violation intégrale de la logique de l’apparaître n’est autre que le réalisme de la chose en soi qu’elle maintient : « le sensible ne peut être dit « phénomène » que relativement à une « chose en soi ».
Encore une fois, le réalisme de la chose en soi constitue une pièce fondamentale du dispositif critique : la « phénoménalité » du sensible y est entièrement suspendue. S’il n’y a pas de « chose en soi », il n’y a plus aucun sens à dire celui-ci « phénoménal » » 31. Entre Platon et Kant, l’opposition de l’être et du paraître se modifie en opposition entre le phénomène et la « chose en soi ». Or la seconde opposition est une version considérablement affaiblie de la première, à la limite de l’agrammaticalité, puisque, avec elle, il n’est tout simplement plus possible de sortir du plan de l’apparaître. Nous restons aveugles à la chose en soi, nous ne pouvons nous rapporter qu’à des phénomènes en tant que choses inscrites dans les formes de notre sensibilité que sont l’espace et le temps. Or, Jocelyn Benoist montre qu’il n’y a peut-être pas grand sens à désinscrire la chose en soi de la spatio-temporalité – découvrir par ce biais qu’elle peut être reçue via d’autres formes de la sensibilité que l’espace et le temps – pour, dans un second temps, déterminer comme phénomènes ce à quoi nous nous rapportons en tant que choses inscrites dans ces formes subjectives particulières que sont l’espace et le temps. Outre le fait que ce geste d’assignation d’une limite à la subjectivité humaine « n’est énonçable qu’en la dépassant. Le phénomène, on commence à le comprendre, ne se dit que de l’extérieur » 32, il rend impossible de considérer ces choses qui nous sont présentes dans l’espace et dans le temps autrement que comme des phénomènes. Ce qui ne va certainement pas de soi : « S’il est nécessaire que les objets de la perception « apparaissent dans l’espace », comme dirait ce genre de philosophie, eh bien, c’est qu’ils sont spatiaux, cela fait partie de leur grammaire. Il n’y a rien de plus à dire. Pourquoi, alors, les dire « apparaître » ? » 33. Or, évidemment, l’argument qui prévaut ici, afin de justifier que l’on qualifie de phénomènes ce qui est donné dans l’espace et dans le temps, est bien celui de la contingence de ces formes de la réceptivité que sont, en nous, l’espace et le temps. Mais un tel argument ne tient que s’il est possible de se représenter la possibilité d’une sensibilité différente de la nôtre (et de réduire du même coup notre sensibilité à une variante de la sensibilité en général). Seulement, souligne Jocelyn Benoist, « il faut remarquer que cette sensibilité, outre qu’elle demeure complètement irreprésentable pour nous, n’en est une que par dérivation : c’est par déformation du concept de la sensibilité, par définition spatiotemporelle, qu’on obtient alors l’idée d’autres sensibilités, formellement différentes. Cette idée, loin de relativiser le concept en question, le suppose : elle y est relative » 34. On voit donc que l’opposition entre le phénomène et la chose en soi déplace considérablement la logique du phénomène, impliquant, quant à elle, l’opposition de l’apparaître et de l’être. Reste alors à se demander ce qui dans le dispositif kantien peut remplir le rôle de la norme – constitutif, nous l’avons vu, pour l’intelligibilité de tout traitement du sensible en termes de phénoménalité : « En effet, pour que le discours de l’apparaître ait pleinement sens, il faut, que, d’une façon ou d’une autre, soit déterminé ce qui est censé apparaître. Il faut, en d’autres termes, que l’apparaître ait une norme. Or la Critique a une réponse quant à la question de savoir ce que peut être cette norme : elle a pour nom « objet » » 35. Il n’est pas d’apparaître qui ne soit apparaître de quelque chose, autrement dit, depuis lequel il ne soit possible de se demander si une chose en particulier est ou non donnée et/ou bien ou mal donnée, autrement dit, s’il s’agit d’un apparaître vrai ou d’une apparence. Cette dernière distinction suppose une norme. Il n’est pas d’apparaître vrai qui ne soit la satisfaction d’une norme (l’apparaître est ainsi normal : je perçois la chose comme elle est), et d’apparence qui n’en soit le défaut (l’apparaître est anormal : je ne perçois pas la chose comme elle est). Or, ce qui place l’apparaître sous l’empire de la norme (ici de l’objet) et donc le constitue à proprement parler comme apparaître, ce sont les concepts : « jamais les phénomènes ne pourraient être déterminés comme apparaître de quoi que ce soit, à tort ou à raison, sans les concepts » 36. Autrement dit, les intuitions (en elles-mêmes aveugles) ne deviennent apparaître – c’est-à-dire nécessairement apparaître de quelque chose que sous l’effet de la synthèse de l’entendement – autrement dit, de l’application des catégories aux intuitions sensibles. Il est donc vrai que Kant malmène la logique du phénomène lorsqu’il libère un sens pour l’apparaître sans confrontation possible à la chose en soi – limite fondamentale que Kant appelle « finitude ». Il n’en demeure pas moins que Kant ne s’en affranchit, cependant, que pour la redéployer à un autre niveau, c’est-à-dire dans les limites de cette finitude : « dans les limites de cette finitude, la grammaire traditionnelle du phénomène, loin d’être annulée, fonctionne pleinement (…) Il faut se garder de ne retenir qu’un seul côté de la construction kantienne » 37.
Les catégories conditionnent donc la possibilité de l’apparaître en tant qu’il est constitutivement apparaître de. Or, comme le souligne Jocelyn Benoist, « une cause, comme telle, n’apparaît pas, mais ce qui apparaît apparaît nécessairement selon le principe de causalité ». On assiste ainsi à un « nécessaire dépassement du phénomène dans le mouvement même de sa détermination comme phénomène » 38. Mais un tel dépassement, constitutif de la phénoménalité en tant que toute phénoménalité est placée sous une norme, n’a pas manqué, historiquement, d’être sujet à polémique. Comme Jocelyn Benoist l’avait indiqué précédemment dans une formule très impressionnante reconnaissant « ce qu’il peut y avoir d’irréductiblement et positivement métaphysique dans la logique même » 39, il faut voir dans le dépassement des phénomènes par leur détermination catégoriale chez Kant, un aspect de cette dimension métaphysique propre à la logique du phénomène, donc au respect scrupuleux de cette dernière. Or, c’est bien cette part métaphysique (à entendre comme dépassement du phénomène) à l’œuvre, autrement dit l’Analytique transcendantale, que d’aucuns reprocheront à Kant, exigeant dans un geste critique qui se voudrait plus critique encore que celui de Kant, d’affranchir les phénomènes kantiens de leur structure catégoriale – c’est-à-dire de toute métaphysique. Telle est la marque de fabrique de ce mouvement philosophique que l’on appelle le positivisme : ne s’en tenir qu’aux phénomènes sans les dépasser par des déterminations catégoriales extrinsèques et au premier chef, la causalité. Or « le point aveugle d’une telle perspective est qu’elle veut ignorer les conditions sous lesquelles seulement il peut y avoir un sens à dire que ce que nous disons nous apparaître « apparaît » » 40. Dire, comme Auguste Comte, que « tout est relatif » c’est aussitôt, sous couvert d’une approche de la phénoménalité purement relative, rétablir un des absolutismes les plus massifs qui soient: celui du sujet : « Plutôt que du renoncement à toute forme d’absolu, il s’agit bel et bien de l’exposition d’un absolu, du seul absolu possible, certes, mais qui n’en est que plus absolu. Celui-ci est nécessaire pour articuler la relativité de « l’apparaître » » 41. Sous prétexte de nous libérer de toute métaphysique, le positivisme nous y reconduit puisque la relativité des phénomènes n’est accessible que si l’on présuppose, d’une présupposition qu’aucune justification par le phénomène ne justifie, puisqu’il en est la condition –, le sujet comme un absolu. Autrement dit, prétendant libérer le kantisme de son présupposé métaphysique, et s’établir comme philosophie sans présupposé, le positivisme en affirmant ne s’en tenir aux seuls phénomènes, en rétablit forcément un, et non des moindres. De sorte que la gageure du positivisme – n’en rester qu’aux phénomènes – paraît en tant que telle impossible, et ce néanmoins pour de bonnes raisons, car il n’y a jamais quoi que ce soit comme la possibilité de ne s’en tenir qu’aux phénomènes. Cette idée est simplement agrammaticale, elle constitue un non-sens.
A ce titre, Nietzsche ne s’y était pas trompé en dénonçant l’absolutisme du positivisme et par là, son relativisme dogmatique : « en prétendant aplanir tous les absolus, le positivisme nous a reconduit au présupposé le plus absolu, et, comme tel, le plus métaphysique – le moins gagé phénoménalement – qui soit » 42. On ne peut qu’inviter le lecteur à se rapporter au très beau commentaire proposé par Jocelyn Benoist sur le passage où Nietzsche formule sa fameuse critique du relativisme positiviste, en tant que relativisme problématique, proprement dogmatique, enraciné, malgré qu’il en ait, dans une métaphysique qui n’est autre que celle de la subjectivité.
Toutefois, la critique frontale de Nietzsche n’a pas mis fin, semble-t-il, à l’illusoire aspiration à ne s’en tenir aux phénomènes sans autre présupposition. La phénoménologie par bien des aspects cherchera, non sans amendements théoriques, à rétablir le programme positiviste et comme le formule sans ambages Jocelyn Benoist : la phénoménologie est « fille du positivisme » 43 :
« Elle reprend les phénomènes orphelins du positivisme, qui présentait la figure d’une forme de platonisme exsangue – réduit aux « ombres » – pour les enrichir et leur donner une vie propre, les constituer en nouvel absolu » 44
Tout le problème, Jocelyn Benoist nous l’a montré avec Platon, est qu’il n’y a pas de réalité sensible comprise comme phénomène sans cet autre au phénomène que constitue sa norme. Le positivisme, quant à lui, prétend s’exonérer du dualisme platonicien, et ainsi parler des phénomènes pour eux-mêmes, comme si les phénomènes avaient une vie autonome par rapport à l’empire des normes. Aussi est-ce pourquoi Jocelyn Benoist parle d’un « platonisme exsangue – réduit aux « ombres » » ou encore des « phénomènes orphelins du positivisme ». Benoist souligne que Nietzsche n’avait pas oublié de nous mettre en garde, en rappelant, en parfaite cohérence avec la logique du phénomène, que l’abolition du monde vrai conduit nécessairement à l’abolition simultanée du monde des phénomènes. C’est pourquoi les phénomènes orphelins du positivisme n’en sont en réalité plus du tout. Comment la phénoménologie peut-elle dès lors se réclamer du positivisme, c’est-à-dire se définir elle-même comme une « science des phénomènes » « en un sens conforme à l’exigence de rigueur positiviste : rien que les phénomènes » 45, sans aussitôt se nier comme « phénoménologie » – puisque, comme nous le fait voir Jocelyn Benoist, le mot d’ordre du positivisme (« rien que les phénomènes ») dissout l’idée même de phénomène ?
Comment, autrement dit, la phénoménologie parviendra-t-elle, en tant que platonisme du sensible, à éviter que l’immanentisme qu’elle hérite du positivisme ne sombre dans un platonisme hors conditions, autrement dit, dans une métaphysique (au mauvais sens du terme) du phénomène ? S’il n’y a pas de phénomène sans norme et dans la mesure où, nous avons vu, avec Platon, que les normes constituaient un plan transcendant par rapport au plan des phénomènes, comment la phénoménologie héritant des phénomènes orphelins (sans normes) du positivisme pourra-t-elle se dire phénoméno-logie ?
Par l’internalisation – ou immanentisation – des normes :
« afin que les phénomènes tiennent par eux-mêmes, il faut leur réinternaliser cette normativité qui en est constitutive. Plutôt que de l’expulser du plan des phénomènes, faits « phénomènes nus », et d’en faire quelque chose de purement conventionnel, comme le positivisme, la phénoménologie prétend trouver cette normativité dans les phénomènes eux-mêmes, en faire leur structure interne » 46.
Jocelyn Benoist : Logique du phénomène. Partie II
- J. Benoist, Le Bruit du sensible, Paris, Cerf, « Passages », 2013. Cf. également le volume édité par D. Cohen-Levinas et R. Moati (eds) Lire Le Bruit du sensible, Paris, Hermann, à paraître
- J. Benoist, Logique du phénomène, (abrévié LP), p. 7
- LP, p. 36
- LP, p. 35-36
- Platon, Théétète, 152 a, cité par J. Benoist LP, p. 37
- LP, p. 37
- Théétète, 157b, cité par J. Benoist (LP p. 36
- Théétète, 183b, cité par J. Benoist (LP, p. 42
- LP, p. 43)
- LP, p. 42
- LP, p. 43
- LP, p. 90-91
- LP, p. 44
- LP, p. 49
- LP, p. 54-55
- LP, p. 56
- LP, p. 62
- Ibid
- LP, p. 89
- LP, p. 90
- LP, p. 91
- LP, p. 93
- Ibid
- Ibid
- LP, p. 95
- LP, p. 96
- LP, p. 99
- Ibid
- LP, p. 99-101, nous soulignons
- LP, p. 100
- LP, p. 101-102
- LP, p. 106
- LP, p. 104
- LP, p. 106
- LP, p. 107
- LP, p. 112
- LP, p. 111-112
- LP, p. 112
- LP, p. 62
- LP, p. 113
- LP, p. 114
- LP, p. 115
- LP, p. 120
- Ibid
- LP, p. 122
- LP, p. 120-121








