Présentation de l’ouvrage
Dédié à l’un des participants, Guy-Félix Duportail, mort d’une crise cardiaque le soir suivant son intervention, l’ouvrage dirigé par Jocelyn Benoist et Véronique Decaix réunit les actes du colloque qui s’est déroulé les 23 et 24 mars 2018 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’ouvrage en lui-même s’inscrit dans un champ si problématique et complexe que nous croyons nécessaire, et même profitable, de faire un long, très long prologue, avant de le présenter. En effet, c’est là l’une des nombreuses vertus de la publication de ces actes de colloque : ils poussent au débat de fond sur des problématiques qui n’ont peut-être jamais été mises au jour depuis l’estrade de la philosophie canonique, même accompagnée des énoncés de l’histoire de l’art.
Il s’agit d’un ouvrage qui a déjà fait parler de lui, avant même qu’il ne paraisse : à la fois parce que c’est un colloque dont l’objet est particulier, à la croisée de bien des champs, en même temps parce que c’est un sujet éminemment actuel. La licorne est une figure de l’imaginaire et, ce faisant, elle appartient à l’histoire ou au naturalisme, tout en appartenant aussi à l’Antiquité, au Moyen Âge et aux modernités, et encore à l’esthétique, à la psychologie ou à la politique. Élément particulièrement significatif, elle appartient enfin aux conflits entre toutes ces grandes plaques tectoniques de la pensée humaine, en tant qu’elle incarne l’affrontement, par exemple, entre fantasme naturaliste et démarche zoologique, ou entre l’apologie religieuse et la défense d’une morale en soi. La licorne est un support sur lequel se cristallisent des enjeux complexes et par lequel s’incarnerait même une branche entière de la grande phylogénie des sciences : la philosophie de la culture.
Il s’agirait de considérer ici la culture, non pas prise comme un sujet ludique — c’est-à-dire pour ce qu’elle serait —, mais prise pour ce qu’elle fait, c’est-à-dire pour ce dont elle témoigne. Le présupposé de la phrase précédente pourrait être d’apparence anodine mais une telle phrase se révèle immédiatement très lourde de conséquences. À ce titre il nous faut tenter de l’affilier à ce dont elle dépend : qu’est-ce qui existe, quand la licorne existe ? Quelles seraient les catégories de cette existence ? Pourquoi est-ce que le fait d’étudier la licorne oblige à réfléchir au statut de la culture, d’un point de vue philosophique ? La licorne, en tant que figure d’un ou des imaginaires, pose donc une double question : celle du statut du possible de l’existence d’un objet[1], et celle de la constitution d’un objet culturel[2]. La licorne existe et n’existe pas, et le problème de son existence et de la définition des conditions de cette (in)existence suspend le paradoxe de la possibilité double et simultanée[3]. Ainsi, faudrait-il in fine suspendre le point de la réalité de la licorne, et ce sera le sens de la conclusion de la plupart des contributions. Entérinant l’impératif de cette suspension, Véronique Decaix valide cet objet d’étude dès l’ouverture de sa propre contribution à partir de l’argument de son intemporalité ; justifiant par là même la cohésion de tout l’ouvrage, depuis l’histoire de l’art comme depuis la philosophie :
« Enquêter sur la licorne n’est pas tâche aisée. Comparée aux chimères, centaures et lycanthropes, elle peut se targuer d’une inaltérable longévité dans l’imaginaire populaire. Elle demeure toujours un objet d’engouement dans les mèmes et autres GIF qui foisonnent sur internet. Bien qu’elle apparaisse partout, on ne saurait la trouver nulle part. Cette existence paradoxale, entre la multiplicité de ses représentations et son absence réelle, est précisément ce qui vient attirer la fascination qu’elle exerce. Si on cherche à présent à comprendre les raisons de cette licorne mania qui sévit aujourd’hui, il faudrait peut-être en chercher l’origine en remontant le temps, jusqu’au Moyen Âge, où ce motif va progressivement se cristalliser.
Cela peut paraître étonnant, mais pour un esprit médiéval, la licorne existe bel et bien. En effet, à cette époque, elle est omniprésente : dans les blasons et armoiries, dans les tapisseries, les éléments de décors architecturaux. Les poètes louent ses propriétés contradictoires : sa férocité et son caractère indomptable, sa pureté et sa noblesse. Les preuves de son existence s’arrachent à prix d’or : les étals des vendeurs ambulants et des apothicaires regorgent d’onguents, de poudres et d’amulettes dont la valeur antidotique est censée soigner toutes sortes de maux, des migraines aux empoisonnements. Les puissants brandissent sa corne, étendard de sa réalité, autant que signe ostentatoire de leur richesse : le roi d’Angleterre, le roi de Pologne, le Pape, la basilique de Saint-Denis en possédait une, Saint-Marc de Venise, deux, conservées au trésor avec les reliques de saints. Bref, au Moyen Âge, la licorne ne fait pas tapisserie. Même si certains affirment ne l’avoir vue qu’en peinture, il ne s’agit cependant pas seulement d’un motif purement imaginaire, vivant dans les toiles, qui n’existerait que dans les représentations. Cette croyance tenace a la vie longue, si bien qu’à la fin du XVIe siècle, lorsque le scepticisme d’Ambroise Paré vient à force d’arguments, par la raison, l’expérience et l’autorité, réfuter les vertus curatives de sa corne et par là instiller le doute jusqu’à l’existence même de la licorne, il déclenche une vive controverse. À l’aube de la modernité, la licorne a toujours ses partisans.[4] »
C’est précisément cette « existence paradoxale », entre présence des représentations et absence réelle, que l’ouvrage va décomposer pour étudier le statut, ontologiquement, d’une inexistence empirique : c’est un ouvrage de pleine métaphysique, extrêmement précis et adroit dans son genre, et les questions que cette posture soulève nous paraissent mériter une longue préparation des lecteurs à la saisie de ces articles qui, pour tous pédagogiques et bienveillants qu’ils soient, restent parfois hors de portée du profane. Il nous paraît que la recension pourrait aider à la perception d’enjeux passés sous ellipse par un ouvrage très technique qui, rappelons-le, compte déjà quinze contributions, introduction et tapisserie incluses, pour un total de trois-cent quatre-vingt-dix pages, table des matières exclue.
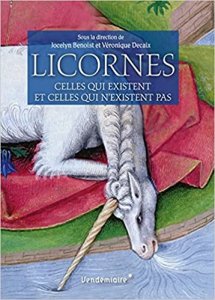
Bien sûr, dans notre post-modernité bien entamée, nous pourrions écrire avec ironie que « nous ne sommes plus des enfants » et, ce faisant, dire avec Jocelyn Benoist comme nous ne croyons plus au Père Noël. Dès lors, la licorne n’a plus guère de partisans sérieux pour défendre bec et ongles son existence empirique, comme Jocelyn Benoist définira le critère de l’existence. Mais, comme il l’écrit si justement :
« Il n’y a pas de licornes », disons-nous, d’après Markus Gabriel, aux enfants. Mais leur disons-nous une telle chose ? Il n’y aurait de sens à le leur dire que si les enfants croyaient qu’il y avait des licornes — et dans ce même sens où ils y croiraient. Le croient-ils, cependant ? Ils croient certainement qu’il y a une licorne dessinée dans le livre, ou dans le dessin animé qu’ils viennent de voir, pour paraphraser Markus Gabriel. Ce sens-là, cependant, ne semble pas donner lieu à une rectification. Ces licornes existent certainement, au sens où elles sont censées exister, ni plus ni moins : dans le dessin animé, ou sur la page du livre. Alors pourquoi nous croirions-nous obligés de préciser aux enfants que « les licornes n’existent pas » ? En quel sens croient-ils donc qu’elles existent alors qu’elles n’existeraient pas ? Peut-être en un sens pas très différent de celui dans lequel, dit-on, ils croient au Père Noël ; mais les enfants croient-ils au Père Noël ? Ou plutôt, encore une fois, en quel sens y croient-ils ?
Lorsque le philosophe approche une question aussi délicate que celle du sens de l’existence du Père Noël pour les enfants, avec ses instruments de boucher qui sont ceux de la logique formelle, il ne peut échapper à un certain sentiment d’inadéquation et, s’il lui reste deux sous de bon sens, il esquive. Le Père Noël des philosophes, celui qui existe ou n’existe pas, n’est guère plus le Père Noël que le Dieu des philosophes n’est Dieu — si Dieu existe. Mais il se pourrait que la question des licornes ne se révèle pas plus facile.[5] »
Cet alignement de la problématisation de l’existence des licornes sur celui de l’existence du Père Noël, ou de Dieu, montre bien que le statut de l’existence de créatures dont on ne peut définitivement établir le caractère empirique réouvre la grande plaie qui a longtemps fait saigner la philosophie — pendant les deux derniers tiers du XIXe siècle au moins, préparant le règne du positivisme et de la science qui consacrèrent le XXe siècle aux règnes conjoints de la barbarie et de la boucherie. Nous tenons à souligner ici la très belle formule de Jocelyn Benoist qui parle des « instruments de boucher » de la logique formelle. Peut-être est-il désormais temps, en 2021, d’envisager, pour saisir les figures de l’imaginaire, la possibilité d’instruments qui appartiendraient à la pratique d’une phénoménologie esthético-formelle — en droite ligne de la même origine, mais interprétées et construites par un réseau parallèle. Afin d’embrasser l’amplitude de cet ouvrage, il nous faut d’abord préciser le contexte extrêmement technique de la parution de ce livre et tenter de faire, de façon aussi concise que possible, un peu d’histoire de la philosophie.
La lourde toile de fond derrière le travail sur les licornes
La question de « réel » (ce qu’on pourrait considérer comme étant le « sous-jacent » de l’en-soi) a été requalifiée par le postkantisme (à partir de Jacobi) : y a-t-il une « réalité fondamentale » (ce dont l’impossible connaissabilité est appelé le noumène, comme pensée négative[6]) derrière ce que les êtres humains perçoivent du monde (le pour-moi des choses, le phénomène) ? Différentes grandes écoles sont nées des propositions de résolution, jamais définitives, de cette question. Pour ne parler que des grands victorieux de l’idéalisme allemand, disons que les grands systèmes de Fichte et de Hegel, à partir de celui de « Jean-Baptiste Kant »[7] ont nommé, peut-être jusqu’à l’épuisement, le problème de la relation entre le sujet et l’objet. Survient alors l’immense système husserlien qui neutralise la scission entre le sujet et l’objet. C’est un résumé taillé au hachoir, mais il permet, comme toute simplification, de cartographier le problème. N’est-ce pas d’ailleurs le « fond de l’affaire », que d’admettre ou de refuser comme toute description pourrait bien n’être qu’une représentation, et non la chose qu’elle représente[8] ? La description d’un objet de la connaissance est-elle autre chose qu’un point de vue sur cet objet ? Ne peut-elle pas dépasser la partialité du point de vue et prétendre à saisir la totalité du connaissable de l’objet ? Est-ce que l’approche théorique peut atteindre le noumène en le déduisant à partir de ses phénomènes ? Ce sont des questions qui pourraient vraisemblablement ne pas être liées au statut de la licorne. Mais de deux choses l’une : comment aborder un objet imaginaire en philosophie, sinon par son rapport au réel ou, à tout le moins, par le rapport de ce qu’elle dit du réel ? Et la deuxième, en tant qu’objet culturel, c’est-à-dire en tant qu’objet arraché à tout enjeu de réalité empirique, comment est-ce que la philosophie pourrait se saisir des implications et des perspectives ouvertes par la licorne ?
Les néokantiens de Marbourg se spécialisèrent dans une reprise de Kant tournée du côté des théories de la connaissance : la question du noumène pourrait ne pas être soluble. Non pas qu’il n’existerait pas[9], mais qu’il constituerait un « horizon » à atteindre qui, comme tout horizon, recule à mesure qu’on avance vers lui, simultanément au fait qu’on avance parmi les éléments qui étaient jusqu’alors parties de l’horizon. Autrement dit, la connaissance n’est pour eux plus une méthode de discrimination entre « vrai » et « faux », mais une exploration de la complexité phénoménologique à l’intérieur même de la trajectoire par laquelle le phénomène doit être étudié — permettant par exemple de concevoir la licorne sous le double statut de son existence et de son inexistence, plutôt que de trancher entre les deux.
Ainsi donc selon les énoncés des néokantiens, la philosophie de la culture, par exemple dans l’étude des imaginaires, permettrait d’étudier les modes d’étude des phénomènes eux-mêmes, qui mènent jusqu’aux noumènes qui, rappelons-le, ne sont pas décrétés inexistants ou incertains, mais, selon la restriction humaine de la finitude, appartiennent au domaine de l’indéterminable en tant qu’ils sont des objets infinis — infinis comme le sont les horizons.
La licorne, tambour des figures de l’imaginaire
Il nous semblait nécessaire d’établir la toile de fond des problématiques que soulève, d’un point de vue très technique, la rencontre entre les figures de l’imaginaire et la philosophie. En un sens, la collusion entre l’histoire de l’art et les théories de la connaissance, mais prise d’un point de vue phénoménologique. C’est aussi à ce titre que l’ouvrage nous paraît à la fois nécessaire et admirable. Comme nous allons y revenir, le travail collectif est remarquable par la plupart des différents éléments qui le composent, autrement dit par ce qui s’y trouve mais, chose rare, il est aussi remarquable par ce qui ne s’y trouve pas, et dont il désigne l’infinie possibilité : celle d’une raison infinie dans la ‘pratique’ de l’étude des conditions formelles. Par la saisie successive des philosophes, comme on peut aujourd’hui par exemple contempler deux-mille ans de tradition platonicienne, l’histoire des idées est un bel exemple de ce qui pourrait le plus se rapprocher de la fameuse raison infinie, idée au contact de laquelle bien des philosophes ont déclaré l’humanité finie. Mais peut-on conclure si rapidement à la finitude de la raison humaine, dès lors qu’on la considère dans son activité collective ? L’histoire littéraire, par exemple, est-elle finie, si l’on considère son début avec l’épopée de Gilgamesh, c’est-à-dire il y a presque quatre-mille ans (dans la forme dont nous en disposons, ce qui ne dit rien de son antériorité) ? Ainsi, certes, stricto sensu, la littérature humaine contient un nombre fixe de performances littéraires, et quoique le nombre de celles-ci croisse chaque jour, on peut établir des ordres d’idée. Mais une telle quantité, que nous ne nous amuserons même pas à tenter d’évaluer ici, n’est-elle pas l’une des expériences les plus proches de l’infini que nous puissions faire ? Étendons l’analogie à la philosophie : la glose sur le criticisme kantien n’est-elle pas une forme de raison infinie, dépassant chacun de ses intervenants mais les englobant tous par le processus des réponses, des correctifs, des défenses et l’historicité même de leur édification doctrinaire ? Qui pourrait prétendre en retracer l’histoire entière sans que l’immensité des détails rende impératif des raccourcis et des schématisations ? Comme décrire l’histoire de la postérité du criticisme kantien sans renoncer à autre chose qu’à en faire une représentation ? Autrement dit, cette sorte d’illustration de ce que pourrait être la raison infinie est nécessairement réductible en termes finis pour être assimilable.
C’est ici que des considérations d’apparence très ou trop techniques en philosophie retombent directement sur les formes des imaginaires. En effet, comment aborder l’imaginaire d’une figure, comme celle de la licorne par exemple — mais aussi comme celle de n’importe quelle autre figure, quelle que soit son origine disciplinaire —, en considérant le caractère infini de son usage, de ses sources, de sa forme et des mutations de sa forme, du caractère même de sa mutabilité, qui peut différer dans le temps et les contextes ? Il nous semble que la licorne comme objet spécifique est ici abordé dans ses caractéristiques générales : à la fois du point de vue du cas particulier de la licorne, et de celui de la catégorie « des licornes », c’est-à-dire de l’espèce[10] des créatures de l’imaginaire. C’est donc un acte fondateur, triplement fondateur : en ce qu’il part de la phénoménologie « traditionnelle » (i.e. husserlienne) pour poser des questions que se pose depuis déjà un siècle une phénoménologie moins traditionnelle[11] ; par la stature des intervenants, donnant à la licorne tout crédit scientifique sur son étude ; par le bilan des besoins épistémologiques qu’il dresse. Car, comme l’écrit Guy-Félix Durportail, le statut de la réalité d’une forme symbolique est avant tout d’ordre grammatical :
« Par suite, à la question brutale de savoir si les licornes existent, il me faut répondre avec Freud que leur statut est celui d’un substitut imaginaire — un fétiche — dont la fonction est de suppléer à une absence terrifiante dans la réalité. L’être imaginaire de la licorne n’est donc pas l’existence au sens prégnant du terme, c’est-à-dire l’être validé par une opération aléthique. C’est le concept lacanien de réel, qui, selon moi, exprime au mieux cette situation où un élément de la réalité est rejeté hors du sens et perd du même coup toute chance de validation de son être. Cet élément est irrémédiablement séparé de son contexte initial et se trouve finalement condamné à l’errance dans l’imaginaire, sous les traits d’un fétiche. Du réel à l’imaginaire, la pente s’avère glissante lorsque le symbolique est défaillant. Autrement dit, le rapport à la réalité est grammatical ou n’est pas. Non pas au sens où les objets n’existeraient pas indépendamment des mots, mais au sens où nous devons réellement parler, c’est-à-dire où nous devons réussir à symboliser la réalité selon les règles du jeu de langage qui sont appliquées. Bref, nous devons réussir à dire quelque chose et non pas rien, afin que notre rapport à la réalité ne se déforme pas à la manière des « montres molles » de Salvador Dalí ![12] »
Dès lors que l’adéquation entre le sens symbolique et sa lisibilité dans le système de la connaissance en vigueur n’est plus (« lorsque le symbolique est défaillant »), les figures de l’imaginaire telles que la licorne quittent le champ des fonctions immédiates pour rejoindre l’ordre des fétiches, des supports universalisants, des outils de compensation. Le statut de la forme symbolique est ici placé au cœur de l’évolution de la licorne qui doit être mobilisable pour dire quelque chose et non pas rien, pour que son usage ait un sens. Car tout le problème de la relation au réel peut être reporté sur le problème des capacités du langage — c’est d’ailleurs la conclusion du Tractatus de Wittgenstein[13]. À cette conclusion, nous opposerions volontiers, comme intercalant, une philosophie des imaginaires préfigurée pour nous par l’article de Cassirer, sur le Sujet et la construction du monde des objets[14]. Or donc nous apparaît-il que la méthode d’une tradition alternative, issue de Cassirer, contemporain de Husserl[15], pourrait nous donner une emprise autre sur l’imaginaire comme production culturelle, ainsi que sur ses figures. Le troisième volume de la Philosophie des formes symboliques de Ernst Cassirer s’intitule à juste titre La phénoménologie de la connaissance (après Le langage et Le mythe) et défend une philosophie pratique, dans le sillage kantien, s’attachant à l’étude de la culture comme recueil des universaux à partir desquels saisir les conditions formelles de l’homme — et par le fait même, préparant le « pas anthropologique » que franchit peu après celui que nous considérons comme son descendant direct, Hans Blumenberg[16]. Replaçant ainsi l’activité culturelle dans le spectre d’une « philosophie de la culture ». Reconstituer les principes formels et dialectiques de cette tradition mériterait un livre en soi (en tant que c’est une tranche de raison infinie dérivant du criticisme) et permettrait de proposer de quelle façon l’interprétation des Paradigmes pour une métaphorologie, de Hans Blumenberg[17], inscrivent en fait son auteur dans la co-paternité (au moins avec Cassirer) d’une analyse phénoménologique par une herméneutique qui soit aussi structuraliste. On trouverait alors là de puissants matériaux pour l’étude des imaginaires, en droite ligne depuis le criticisme kantien, mais passant par le néokantisme — c’est-à-dire ignorant le postkantisme pour la plus grande part, préférant Maïmon à Jacobi, et préférant Schelling à Hegel[18].

La question téléologique des imaginaires
Depuis le début du XXIe siècle les figures de l’imaginaire polarisent l’attention et les philosophes eux-mêmes commencent à s’y intéresser. Depuis l’essor de l’internet et le développement des possibilités formelles et de la diversité médiatique, où la culture comme pragmatique de l’être et du devenir se décentralise, se déconcentre[19], les figures de l’imaginaire, telles que la licorne, les vampires ou le diable lui-même, sont propulsées au premier rang des outils de l’activité de l’esprit. La licorne, surtout, a pris un essor formidable avec internet, et c’est tout le sujet de la contribution d’Anne Besson[20], dont nous pourrions peut-être déplorer qu’elle soit si courte. Mais enfin, que l’on se contente de songer à la grande visibilité des super-héros ces soixante-dix dernières années, et des imaginaires auxquelles ils appartiennent, pour constater que les modes d’exploration des champs du possible, à la fois dans ses dimensions esthétique, politique et morale, n’ont pas cessés d’être vigoureux ou signifiants. De sorte que ne pas les étudier reviendrait probablement à faire l’impasse sur tout un pan de la visibilité de notre propre conscience de sujets post-modernes. Les super-héros dont la fresque en vingt-trois épisodes cinématographiques vient de se terminer après onze ans de diffusion[21] a battu des records de rentabilité financière, prouvant par ce fait même l’actualité des imaginaires et de leur hyperactivité. Nous pensons d’une manière générale que les énoncés prétendant que « l’époque a plus que jamais besoin des imaginaires » procèdent d’une erreur de jugement, mélangeant l’imaginaire et l’objectivité. Toute époque est toujours le désenchantement de ses générations les plus savantes et l’émergence de nouvelles générations qui s’affirment. La déploration de la perte de sens, et la conviction que les imaginaires viendraient « compenser » cette perte, appartient justement à l’activité même des imaginaires[22]. Des imaginaires récurrents dont on peut observer la manifestation au moins depuis Platon et plus explicitement encore par Polybe. Les formes téléologiques remplies par les imaginaires pourraient bien n’avoir pas beaucoup bougé depuis le fondateur de l’Académie, et se seraient contentés de changer de support au travers des âges.
Que l’on choisisse de l’aborder du point de vue de l’allégorie, de la spéculation, du symbolisme, de l’histoire, de la philosophie, ou même de la performance ludique, la question de la place de l’imaginaire dans l’activité de l’esprit permet de réunir des préoccupations théoriquement éclatées entre bien des disciplines : le problème posé par le sens et la fonction téléologiques des imaginaires[23]. Licornes, Celles qui existent et celles qui n’existent pas décompose donc autant de formes possibles à l’étude de ce télos, parfois sur un mode descriptif, souvent sur un mode analytique, entre philosophie et historiens de l’art. Ce très long prologue posé, nécessaire tant la question des imaginaires a longtemps été ignorée[24], nous pouvons en venir à la licorne en elle-même.
[1] — Voir dans l’ouvrage, la contribution de Nicholas Stang, « Les licornes de Kant », pp. 103-128.
[2] — L’ouvrage a choisi de porter une attention plus particulière sur la première de ces deux étapes, se concentrant donc sur le statut du possible de l’existence d’un objet, plutôt que sur les conditions formelles de constitution d’un objet culturel.
[3] — Il s’agit là du sens dialogue entre Jocelyn Benoist et Markus Gabriel, à la fois dans leurs contributions et dans les postures qu’ils donnent à l’ensemble de l’ouvrage — nous en reparlerons avec la référence au concept du « non-aristotélisme », dans le livre de Alfred Korzybski, cf infra, note 5. Ce serait en fait la question d’une licorne de Schrödinger pour trancher la question de l’existence (ou non) de la licorne.
[4] — Véronique Decaix, « Pourquoi y croire ? », pp. 179-180.
[5] — Jocelyn Benoist, « Où existent-elles ? », pp. 26-27.
[6] — Le noumène serait l’objet de l’intuition qui n’est pas issu de la sensibilité : « Mais si j’admets des choses qui soient simplement des objets de l’entendement, et qui pourtant peuvent être données, comme telles, à une intuition, bien que ce ne soit pas à l’intuition sensible (donc coram intuitu intellectuali), de telles choses s’appelleraient des noumènes (intelligibilia). La supposition de tels noumènes s’appuie sur le fait que l’entendement limite la sensibilité en lui montrant que ses objets ne sont que des apparitions (des phénomènes) des choses, auxquels quelque chose doit correspondre qui n’est pas en soi phénomène ; car « phénomène » indique déjà une relation à quelque chose qui doit être un objet indépendant de la sensibilité. » AK IV, 163-164, Rudolf Eissler, Kant-Lexicon, Paris, Galimmard, 1994, article « noumène », pp. 745-746. On voit bien là tout la force d’une problématisation des objets culturels à partir du criticisme kantien.
[7] — « Fichte est selon Jacobi le Messie de la philosophie moderne parce qu’il a achevé ce que Kant n’a que commencé : parce que sa doctrine de la science a d’abord désigné avec une parfaite clarté à la fois la voie purement immanente et le but immanent de tout savoir. « Et ainsi — en ces termes s’adresse-t-il à lui — je vais plus loin et d’abord je vous proclame à nouveau, avec plus de zèle et de force que jamais, le roi des Juifs de la raison spéculative. De manière comminatoire j’invite les entêtés à vous reconnaître comme tel et à ne considérer le Saint Jean Baptiste de Köningsberg [=Kant] que comme votre précurseur. » Car Fichte a accompli, sur le terrain de l’idéalisme, ce que Spinoza avait vainement cherché sur celui du réalisme. », Cassirer, Les problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, 3. Les systèmes postkantiens, Paris, Cerf, 1999, pp. 32-33.
Notons ici que Fichte lui-même écrivit de Maïmon : « J’ai pour le talent de Maïmon — écrit-il à Reinhold — un respect sans bornes ; je crois fermement, et suis prêt à le démontrer, qu’il a de fond en comble renversé la totalité, dirais-je, de la philosophie kantienne telle qu’elle a été jusqu’ici couramment comprise, y compris par vous. Et il a fait tout cela, sans que personne ne le remarque et alors qu’on le regarde de haut. Je pense que les siècles à venir se moqueront amèrement du nôtre. », cité par Cassirer, Ibid., p. 113.
Pourquoi Maïmon a-t-il pu sombrer dans l’oubli historique ? L’usage qu’en fait Hermann Cohen lors de la fondation de l’école des néokantiens de Marbourg signale peut-être la renaissance de Maïmon à une nouvelle visibilité, notamment à la faveur d’une philosophie de la culture qui permettrait de dépasser le « scepticisme » auquel Maïmon pensait condamnée sa résolution du système kantien. Mais, pour nous, la tradition naît dès la CRP de Kant, certes, dès la doctrine des anticipations de la perception, mais se développe en contre-pieds de la lecture jacobine par l’ouvrage de Maïmon, Essai sur la philosophie transcendantale, Paris, Vrin, 2000 pour la traduction française.
[8] — C’est le fond du petit livre de Alfred Korzybski, Une carte n’est pas le territoire, prolégomènes aux systèmes non aristotéliciens et à la sémantique générale, Paris, Éclat, 1997 pour la première édition française. Les liens entre ce livre et tout un pan des imaginaires sont très forts, et notamment Le monde des non-A de l’auteur canadien de science-fiction Alfred E. Van Vogt. La fondation de la « sémantique générale » ouvrait donc de nouveau champs d’expérimentations noétiques : dans la science comme dans la fiction. Comment discriminer entre elles, du point de vue des théories de la connaissance ? C’est l’une des façons d’aborder la brillante contribution de Markus Gabriel, La possibilité d’une licorne, pp. 283-310.
[9] — C’est une erreur de beaucoup de leurs détracteurs que de le croire, même si, de toute façon, « les néokantiens » ne s’illustrent pas par leur homogénéité doctrinaire de ce point de vue-ci. Même si le recul historique a nuancé bien des positions d’Alexis Philonenko, parfois lapidaires, il n’en demeure pas moins que la plupart de ses lectures du néokantisme étaient très fines, comme, sur la question de l’objet des néokantiens, qui n’a jamais été, selon lui, de contester la vérité, comme précisément ce n’était par leur point, pour plus à ce propos, voir Alexis Philonenko, L’école de Mabourg, Paris, Vrin, 1989, et en particulier pp. 26-31.
[10] — Nous renvoyons par cela à la conclusion de la contribution de Nicholas Stang, Les licornes de Kant, et spécifiquement pp. 127-129.
[11] — Il s’agit des travaux probablement initiés en tout premier lieu, dans le domaine de l’histoire de l’art, par Aby Warburg, le célèbre historien de l’art, dont la trajectoire rencontre assez vite celle du néokantien Ernst Cassirer qui, à son contact, ou peut-être même dès avant, incline légèrement sa trajectoire. Paraissent alors les trois volumes de son grand système, La philosophie des formes symboliques. Pour lire au sujet de l’autonomie doctrinaire de Cassirer, voir l’excellent article de Muriel van Vliet, « Déformation » des conceptions kantiennes et hégéliennes de la forme : morphologie ou structuralisme chez Ernst Cassirer ?, in Jean Seidengart (dir.), Science et philosophie de la culture chez Ernst Cassirer, 2013, pp. 141-164.
[12] — Guy-Félix Duportail, « La loi de la licorne », pp. 272-273.
[13] — Wittgenstein conclut que l’on ne peut rien dire qui soit juste, aussi faudrait-il ne rien dire du tout.
[14] — Dans cet article, Cassirer (constructiviste) propose de voir le langage comme l’espace de construction de la conscience qui ne peut s’édifier dans la pure abstraction de l’idée, et ne peut s’établir que dans la confrontation à la nécessité de nommer les différentes étapes de composition du monde des objets. Contrairement au silence préconisé par Wittgenstein, il faut selon Cassirer tâtonner pour atteindre. Voir Ernst Cassirer, Le langage et la construction du monde des objets, in Essais sur le langage, pp. 39-68, pour une sélection, en français, parmi les articles réunis dans le Journal de psychologie de 1933, Paris, Minuit, 1969.
[15] — Husserl jugeait d’ailleurs remarquable les deux premiers volumes du problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, de Cassirer, et rejettera la démarche à partir du troisième volume, consacré aux postkantiens.
[16] — Voir à ce sujet le brillant article de Jean-Claude Monod, « « L’interdit anthropologique » chez Husserl et Heidegger et sa transgression par Blumenberg », Revue germanique internationale [En ligne], 10 | 2009, mis en ligne le 26 novembre 2012, consulté le 22 juin 2021. URL : http://journals.openedition.org/rgi/336 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rgi.336
[17] — Comme l’écrit Guy-Felix Duportail dans l’extrait que nous venons de citer, Blumenberg écrit dans La raison du mythe, Paris, Gallimard, 2005 pour l’édition française, comme le mythe est une réponse à l’effroi du monde, et la nécessité d’une économie noétique pour inscrire la place de l’homme dans un cosmos pacifié. Le langage et le mythe sont donc intrinsèques l’un à l’autre dans l’activité de la téléologie qui sous-tend la quête de connaissance — et passeraient par des objets de focalisation particulièrement denses, « graves » (nous y reviendrons) : des fétiches. C’est-à-dire des figures des imaginaires.
[18] — Il suffira, connaissant les travaux de Blumenberg, de lire Patrick Cerutti, La philosophie de Schelling, Paris, Vrin, 2018, pour s’en convaincre.
[19] — Nous pourrions parler d’une dissolution des institutions de centralisation à la faveur d’un éclatement. Par exemple, dans une structure socio-politique qui s’y prêterait, l’école unique publiques serait à bien des égards moins efficiente que ne le seraient les ressources disponibles sur internet.
[20] — Anne Besson, Une icône de la pop-culture, pp. 233-243.
[21] — Vingt-trois films du même univers en onze ans (2008 avec Iron Man 1 et 2019 avec Spider-Man : Far from Home, donné comme un épilogue après la mort de Anthony Stark, alter ego de Iron Man) est une performance unique à ce jour que la série des James Bond ne dépasse qu’en multipliant le nombre d’années (vingt-cinq films entre 1962 et 2021).
[22] — Il ne serait vraiment pas inintéressant de concevoir philosophiquement l’histoire comme le terrain d’une confrontation qui, ainsi qu’un pendule, oscille d’un extrême à l’autre, et par lequel les imaginaires précèdent les travaux plus rigoureux, scientifiques ; imaginaires qui, pourtant, sont signifiants et gagnent à ne pas être ignorés pour la compréhension d’une époque. Une expression aussi connue que « L’histoire est écrite par les vainqueurs » n’encourage-t-elle pas à donner du crédit à un tel affinement du phénomène historique ?
[23] — Substance et fonction est le titre de l’ouvrage de Ernst Cassirer livrant une première version des préoccupations qui prendront toute leur ampleur dans les trois volumes (plus un) de la Philosophie des formes symboliques.
[24] — Les figures de l’imaginaire ne sont jamais étudiées en soi, comme objets d’une catégorie qui serait la philosophie de la culture, mais toujours dans le contexte d’une pluridisciplinarité. Comme l’écrivit Patrick Cerutti à propos de la philosophie de l’histoire, pour la pratique de laquelle il faut être à la fois philosophe et historien, la philosophie de la culture exigerait de ses explorateurs qu’ils soient à la fois philosophes, historiens de l’art, théoriciens de l’art, et qu’ils maîtrisent l’histoire de chacune des disciplines dans laquelle se glisse la figure étudiée. Les exemples d’ouvrages homogènes mais pluridisciplinaire réunissant pour chacun des actes de colloques qui étudient les imaginaires sont nombreux.








