Eléments de philosophie réaliste1 est un ouvrage de synthèse écrit en miroir à Concepts, publié en 2010 et également recensé sur actu-philosophia 2. Jocelyn Benoist, à la suite d’études sur la phénoménologie naissante dans le contexte autrichien du début du XXe siècle, s’est attaché, dans ses précédents ouvrages, à dégager les conditions de possibilité d’une phénoménologie réaliste – en exhibant, dans Les limites de l’intentionnalité, la nécessité de penser une intentionnalité contextualisée, et ne pouvant jouer qu’au sein d’une telle contextualisation, en réexaminant, dans Sens et sensibilité la conception que la phénoménologie se fait du réel et en mettant en particulier en exergue son silence constitutif. Dans Concepts et dans le présent ouvrage, cette phénoménologie réaliste dont le langage et le terrain semblent enfin conquis est développée sur ses deux versants : celui de l’appartenance des concepts au réel, de leur poids de réalité constitutive, d’une part, de la façon dont cette appartenance peut être déclinée à partir des thématiques de l’intentionnalité, du contexte, de la perception, etc., explorées auparavant par l’auteur d’autre part. La complémentarité des deux ouvrages est forte, car une philosophie du réel est tout autant une philosophie de l’esprit, et réciproquement, une philosophie de l’esprit ne peut être qu’une philosophie réaliste, le réel étant « conceptuellement » « ce par rapport à quoi celui-ci [notre esprit] dans ses attitudes et ses contenus, a seulement un sens ».
Benoist trace ainsi les contours d’une phénoménologie réaliste dont le caractère (cela est souligné par Raoul Moati dans sa recension de 2010) est analytique. Comment le réel pose-t-il question à la phénoménologie ; au sein de quels problèmes celui-ci joue-t-il ? Il ne s’agit pas d’une phénoménologie du réel – la démarche de l’auteur n’est pas du tout de chercher à caractériser des phénomènes selon lesquels le réel se manifesterait ou révélerait de façon originaire ou éminente – mais bien d’une analytique phénoménologique dans la mesure où la problématique directrice de l’ouvrage est plutôt de comprendre comment parler du réel et de la façon dont nous lui appartenons. Si le réel n’a pas, pour l’auteur, à être saisi – ni saisi dans sa phénoménalisation, dans les structures sous-jacentes à sa phénoménalisation – il n’en reste pas moins le problème de la phénoménologie. Le réalisme d’ailleurs n’a lui-même de sens qu’au sein d’une phénoménologie et le réalisme métaphysique souffre précisément d’une a-contextualité, qui, l’ouvrage va le montrer, ne s’explicite qu’en une phénoménologie. Un tel réalisme ne relève cependant pas, précise Benoist du tournant de l’ordinaire qui souffre paradoxalement de la façon dont il tend à « pré-déterminer l’ordinaire », à exclure de l’ordinarité un ensemble de pratiques et de phénomènes qui en relèveraient pourtant de plein droit. En un sens, « l’extraordinaire appartient tout aussi bien à l’ordinaire » et le rôle paradigmatique du faire mathématique chez Wittgenstein 3, invite justement à considérer avec plus de subtilité la dimension « praxique » comme constituante de l’intelligibilité de ce qui semble le plus commun aussi bien que de ce qui semble le plus éloigné. L’ordinarité, s’il faut la définir positivement, ne qualifie que ce caractère engagé, et, corrélativement, l’infondement structurel4 de toute expérience, de toute phénoménalité, qui ne se joue qu’en de tels engagements, qu’en de telles mises, n’a de sens qu’en eux.
Le glissement ou la redéfinition des problématiques phénoménologiques classiques et la dérive de ses objets les plus précieux ne fait pas, précise l’auteur, quitter à sa démarche le champ de la phénoménologie. La pratique de Benoist est phénoménologique en ce sens qu’il s’agit bien de laisser quelque chose du réel se dire, mais en prenant garde à la façon dont il se manifeste dans le discours. Cette phénoménologie n’a pas comme projet premier l’étude de la structure du phénomène, dans l’horizon des articulations de la manifestation vers lesquels Husserl a orienté sa phénoménologie, surtout avec son tournant transcendantal, cette focalisation sur le phénomène ayant plutôt redoublé (un transcendantaliste dirait : constitué sur un autre plan) des structures qui sont celles de la pensée et de l’action dans leur exercice, et qu’il faut plutôt exposer comme telles que redoubler par de nouvelles structures qui n’en sont que l’image et finissent par recevoir la tâche de fonder ce qu’elles redoublent seulement. L’auteur manifeste à ce titre son intérêt pour les recherches de Jean-François Lavigne5 sur les impensés de la démarche husserliennes et les décisions souterraines qui ont orienté celle-ci dans une direction à laquelle il s’agit de trouver des alternatives. Deux façons d’appréhender la phénoménologie peuvent alors être distinguées. Ainsi, « (…) certains philosophes consacrent toute leur énergie à prouver que nous avons ce que nous avons et comment il peut être possible pour nous de l‘avoir ; d’autres réputent une telle démarche inutile et confuse et pensent que le véritable enjeu de l’analyse conceptuelle – qui est le vrai nom de la philosophie – est de nous aider à comprendre ce que d’une façon ou d’une autre (et de façons en vérité très diverses) nous faisons de ce que nous avons »6
C’est, répétons-le, à partir de la façon dont le réel est rencontré, investi, joué qu’il peut le mieux être pris en compte par l’enquête phénoménologique. A ce titre, l’auteur (il s’en est en particulier expliqué dans Concepts) substitue le paradigme de « l’avoir » (emprunté à Conrad Martius et à Scheler) à celui de l’accès (ou celui de l’être) : il est plus juste en effet de dire que nous avons le réel, car l’« (…) appréhender comme « l’avoir » c’est précisément le déceler comme ce que nous ne justifions pas parce que contextuellement, ça n’a pas de sens de le justifier » 7 C’est une erreur que de penser qu’il faudrait d’une façon ou d’une autre « rejoindre » le réel, comme si on en était d’abord séparé. Il faut considérer au contraire qu’on « a » le réel (et pas on y est, la nuance est importante), mais qu’il se révèle à nous selon ce qu’on en fait (ou ce qu’on y fait) ; si le réel est toujours déjà là, intentionnalité, contextualité, conceptualité, perception n’ont plus à le révéler, à en ouvrir la manifestation ou l’intelligibilité, mais constituent des modes de description des façons dont on s’y insère8. Cette appartenance, précisons-le, ne doit pas être comprise comme dialectique – comme si le réel était ce qui résistait, s’opposait, faisait encontre, alors qu’il ne fait précisément encontre qu’au sein d’une perspective elle-même située en lui. Nous n’avons le réel qu’en ce qu’en un autre sens nous ne l’avons pas, mais les termes d’anonymat ou d’indifférence que l’on tend à utiliser d’ordinaire sont eux-mêmes trompeurs, l’anonymat, l’indifférence ne constituant, à leur tour, que des dimensions qui ne prennent sens qu’au sein d’un rapport par ailleurs individué et actif.
A : La représentation
Les tentatives de dépassement de la représentation (par exemple dans la réflexion de Mc Dowell) en conservent le plus souvent les présuppositions sans expliquer ce qui la conditionne comme figure de la pensée. Si la représentation n’a pas à nous donner le réel, elle appartient pourtant à la façon dont nous avons celui-ci : paradigmatiquement, la représentation est ce en quoi nous comptons une chose pour la même ou non. Il appartient ainsi au concept de réel qu’on ait celui-ci dans une représentation : le réel a sens à partir de sa représentation (et réciproquement, la représentation a sens sur fond du réel), mais c’est une erreur de chercher à connecter ou reconnecter « ontologiquement ou transcendantalement » deux dimensions qui ne sont que deux pôles appartenant à la « grammaire » descriptive du rapport au réel, et dont la disjonction est purement formelle. C’est en tant que portrait de Hegel que le portrait de Hegel est mauvais : il rate ce qu’il représente en tant qu’il est appréhendé comme « visant à représenter ». La représentation est structurellement représentation de quelque chose et ne se déploie que parce qu’on a les choses. Ainsi, souligne Benoist, c’est en quelque sorte toujours du réel que la fiction parle : la force d’une chimère, c’est paradoxalement son caractère réel, elle n’est chimère qu’en ce qu’elle se détache comme impossible dans le réel qui souligne sa réalité en proclamant son irréalité.
B : L’intentionnalité
L’intentionnalité demeure un outil prégnant de la phénoménologie benoisienne, mais elle perd toute prétention fondatrice : il y a intentionnalité en ce que notre rapport au réel est le plus souvent déterminé, qu’il met en jeu un sens. Or, « L’idée de « sens » telle que nous l’avons présentée est celle d’une identification de la chose à laquelle nous nous rapportons. Se rapporter à quelque chose selon un certain sens, c’est se rapporter à cette chose comme telle et telle – que ce soit du reste son identité numérique ou son identité générique qui soit en question »9.
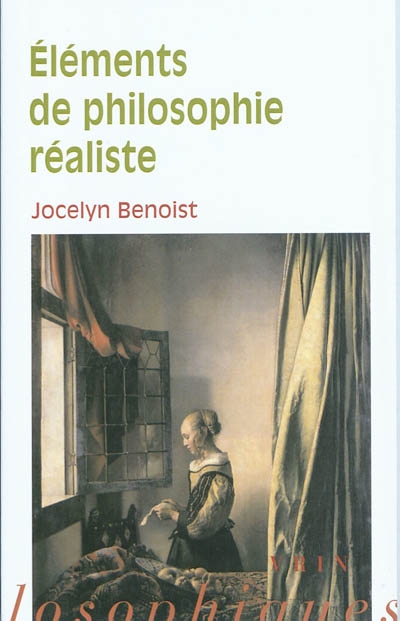
Il est tout aussi insatisfaisant de mettre cette identification au compte de l’intentionnalité que de poser que, d’une façon ou d’une autre, le réel « s’identifie lui-même » L’identification est un mode de manifestation, et non une chose qui s’ajoute. Si l’être intentionnel paraît impossible à congédier sans qu’on puisse jamais établir les « droits qu’on le croit réclamer », ni concevoir un réel dégagé de toute représentation au sein duquel on ancrerait dans un deuxième temps l’intentionnalité 10, c’est bien que celle-ci « (…) est le simple fait que, en chaque occurrence où est posée la question de savoir ce qu’il y a, la réponse qui peut être donnée à cette question est indissociable d’un certain point de vue. »11 L’intentionnalité traduit la structure de conditionnalité réelle constitutive de toute relation déterminée : certains points de vue sont pertinents pour rendre compte de ce qui circonscrit le réel d’une situation, d’autres non. En résumé, « Ouvrir l’intentionnalité c’est ouvrir l’être. » Il s’agit bien en quelque sorte d’élaborer une ontologie, mais qui tienne compte de l’intentionnalité comme structure grammaticale de la question ontologique. Il n’est, répétons-le, pas de prise sur le réel sans un engagement déterminé avec lui, qui n’est pas l’objet de cette prise, mais son corps même ; à rebours cependant, il ne faut pas penser non plus que le monde serait fait « d’objets indéterminés », ontologie minimale qui ne ferait à nouveau que reproduire la séparation du réel et de la façon dont nous l’avons. Il est certes de l’essence de la représentation d’admettre un certain bougé (autrement elle ne représenterait et donc ne qualifierait rien) mais ce bougé lui est intrinsèque, ne révèle, une fois encore, aucune indétermination ontologique. De la même façon d’ailleurs (bien que Benoist reconnaisse sa dette envers Merleau-Ponty), on ne peut pas dire, parlant du perçu, que celui-ci est d’emblée déterminé ou indéterminé : détermination ou indétermination sont déjà des façons de se situer par rapport à lui, de le questionner, l’indétermination est indétermination par rapport à quelque chose qui pourrait l’être, etc. Or s’il y a bien dans l’intentionnalité cette structure de dépli du réel, celui-ci se manifeste de la façon dont une action s’insère en lui ; le réel est ce en quoi mon action s’insère, qui la précède, la déborde, mais aussi ce en quoi elle joue. C’est précisément dans cet écart, cette non-adhérence du réel avec lui-même qu’il joue comme réel. Le réel se prend d’une certaine façon. Il répond : ni résistance, ni même indifférence, sinon, comme on l’a dit plus haut, résistant et indifférent par rapport à des perspectives. Ainsi, Benoist propose une version très intéressante de la figure de l’écart, du dépli, posée avec l’intentionnalité, élargie par Heidegger, étudiée jusqu’à extraction de sa structure métaphysique (Marion) ou transcendantale (Richir) la plus épurée, structure qui est celle du phénomène et de la phénoménalisation12
C : Le contexte
La notion de contexte n’intervient qu’en réponse à la prétention à une certaine généralité, pour limiter ou pour qualifier celle-ci. Si on veut proposer une première définition du concept, on dira qu’on désigne par contexte toute donnée extérieure d’interprétation. L’opposition (de Searle) entre faits bruts et faits institués ne semble pas pertinente à l’auteur pour rendre compte de la contextualité : les faits sont bruts ou non relativement à la structure d’un contexte et à ce qu’il définit. L’exemple ensembliste proposé est instructif sur sa conception de la contextualisation : pour établir des lois sur les ensembles (ici, pour définir l’additivité de deux ensembles), on ne part pas de leur définition abstraite (en elle-même purement formelle), mais on la déploie en « cas » à partir desquels on remonte au générique. On pourra noter qu’il décrit, dans un autre texte13, la théorie des catégories ( qui relève moins de l’étude de structures mères que des façons dont une structure s’articule à ses élément, les parentés des structures par rapport à ce qu’elles font) comme une illustration insigne de cette manipulation mathématique.
Pourquoi cependant, pourrait-on se demander, Benoist préfère-t-il la notion de contexte à celle de monde, plus utilisée par la phénoménologie continentale ? Quelques différences intéressantes sont à noter entre les deux concepts, et s’avèrent très instructives sur la vision de la pratique phénoménologique qu’elles révèlent en creux. L’essentiel nous semble ici qu’il n’y a pas et ne peut pas avoir de phénoménalité du contexte. Le contexte est conçu comme un outil de cadrage. A l’inverse du « monde », dont l’horizontalité est à la fois fermeture et ouverture, qui est habilité d’une infinité potentielle, le contexte est un point d’arrêt (ananke stenai). Il cadre, réduit, enserre, et s’il est toujours aussi ouvert et plastique, cette ouverture n’est précisément pas celle de l’horizon : elle est degré de liberté, insaturation relative, mais pas aspiration ou inspiration. Le contexte n’est pas en prise dans ce qu’il contextualise, même s’il peut être lui-même exposé par un autre contexte. Il ne fait pas partie de ce qui est représenté : il faut poser, exposait Benoist dans Sens et sensibilité, un silence constitutif du contexte.
D : La perception
L’idée de perception appartient constitutivement à l’idée de réel, mais ce n’est pas pour autant, que le réel « commence par elle ». La perception est une des figures de la préséance de la réalité. Le principal problème de la tradition phénoménologique (et au-delà, de toute la tradition philosophique) est de formater par trop la conception qu’elle s’en fait à partir de la cognition, et de tenter de lui conférer une valeur épistémique. De façon caractéristique, est-il souligné, la perception n’a pas à être vraie ou fausse : c’est une contextualisation du perçu auquel on pose alors une question qui fait paraître en lui la possibilité de sa validité ou de son inadéquation à une visée. Certes, c’est sur la base de la perception que les choses sont connues, mais c’est une erreur de dire que c’est la perception qui les sait. La dimension de « révélation » qu’on tend spontanément à accorder à la perception est à lier à une forme « d’ipséité constitutive du perçu », mais cette ipséité n’a justement rien d’une identité, ni non plus de la donation d’un sens ou d’un contenu, sous quelque forme que ce soit. Ce qui fait l’absoluité du perçu, c’est bien qu’on ne peut pas s’en évader, qu’il s’impose, même s’il ne s’impose pas comme un « cela », ni n’impose d’abord aucun « cela » ; même s’il s’impose de différentes façons, s’il y a de la variation au sein de ce qui s’impose.
La question de ce qui fait le contenu intrinsèque de la perception – sa structure interne, pure – est de fait une question mal posée. Il n’y a pas (pour adopter la terminologie de Wittgenstein) a priori un « voir » plus originel que l’autre : je ne vois pas plus purement une tache blonde qu’une étudiante en philosophie (ou que Natacha !). Selon le contexte, ce que je vois peut être mieux décrit par l’une ou l’autre formule. L’opposition du « voir » et du « voir comme », au fond ne veut rien dire dans la mesure où l’on voit toujours quelque chose. On ne peut, là encore, parler du voir que depuis un contexte dont il fait partie, par rapport auquel ce qu’il voit est défini : le voir n’a pas de sens tout seul – ou plus exactement, on ne peut pas (ça n’a tout simplement pas de sens) de tenter d’élaborer une forme pure du voir dans le cadre phénoménologique. On ne parle du voir, ou plus généralement, de la perception, que depuis « autre chose » ; on parle de la perception depuis ce que la perception ne détermine pas, le contexte. C’est déjà parler de la perception depuis un certain contexte que de vouloir en expliquer les lois. Certes, il y a (sans doute) un rapport au moins neurologique entre structures perceptives et structures cognitives, mais au sens phénoménologique justement, c’est déjà contextualiser un sens de la perception que de la restreindre ainsi : il s’agit par exemple d’isoler un sens ophtalmologique de la vue qui n’en est qu’un des sens.
Cela ne veut pas dire pour autant que la perception soit indéterminée, qu’il y ait une indétermination en elle : la perception est toujours déterminée d’une certaine façon, mais cette détermination est contextuelle. Contrairement à ce qu’on entend souvent, « (…) les flèches de Müller-Lyer sont en réalité parfaitement mesurables, comme n’importe quel trait ; simplement cette mesure ne rend-elle pas compte d’un aspect de ce perçu qui peut être important pour nous esthétiquement (nous l’utilisons dans un dessin), psychologiquement (nous le trouvons déroutant), etc. Ensuite, il faut souligner que ce qui peut passer à ce niveau pour une indétermination, renvoie en fait bien plutôt à une autre détermination : les flèches de Müller-Lyer ne deviennent positivement « ni égales ni inégales » précisément que si nous les regardons d’un certain point de vue. « En elles-mêmes », il faudrait plutôt dire qu’elles sont ce qui est égal si on le considère sous un certain point de vue, ce qui ne l’est pas (sans, toutefois, être pour autant « inégal » à proprement parler) si on le considère sous un autre. » 14 Il n’y a en d’autres termes pas de phénoménalisation de l’indétermination : là aussi, l’indétermination elle-même l’est toujours par rapport à autre chose.
E : La pensée
Dans son chapitre sur la pensée, Benoist reprend et précise des analyses détaillées dans Concepts. La pensée est caractérisée par sa généralité : penser, c’est se rapporter à quelque chose sous l’horizon de la généralité, ce qu’il vaut comprendre de façon large, car la tradition a aussi reconnu l’existence de concepts singuliers (par exemple, la montagne la plus haute, etc.) On s’est toujours demandé dès lors comment celle-ci pouvait se rapporter à des objets singuliers, et à des objets singuliers pris dans leur singularité. Que veut-on dire d’ailleurs par penser la singularité ? Il ne faut pas, tout d’abord, confondre la capacité de la pensée à construire la singularité (par exemple en posant les critères selon lesquels un objet sera identifié ou choisi dans une liste) avec sa capacité à se rapporter à elle, à capturer une singularité qu’elle n’a pas faite. A proprement parler, penser la singularité, ce n’est pas même penser une singularité exemplaire qu’on « universaliserait » par-là (une Vienne, un Rastignac, etc.), mais la singularité de l’objet visé en tant que telle, la singularité tant et en tant que singularité : penser ce qu’est être Rastignac (ou être Sarkozy, pour reprendre l’exemple donné).
Pour dénouer le problème, il faut voir que la généralité de la pensée prend un double aspect : il s’agit bien d’une part de la généralité de ce qu’on pense de quelque chose, mais il s’agit aussi, et c’est peut-être encore plus important, de la répétition du fait de penser quelque chose de quelque chose. Le fait pour une chose d’être pensé a quelque chose de commun à chaque fois où elle est pensée : la généralité du singulier pourrait être comprise comme sa possible ré-occurrence d’une pensée à l’autre. Plus simplement, résume Benoist, penser le singulier revient à le rendre d’une façon ou d’une autre disponible, mais cette disponibilité n’épuise pas pour autant la relation de la pensée au singulier. L’auteur rappelle en effet cette évidence que nous avons non seulement des pensées à propos du singulier, mais aussi des pensées singulières. La singularité de la chose peut elle-même être présente dans la pensée. Le rayon vert que voit Perceval est d’une certaine façon présent dans la pensée par laquelle incessamment il revient à son apparition puisque c’est précisément cette unicité de l’expérience, le fait qu’elle se soit produite, et produite une seule fois qui en fait le caractère obsédant. La philosophie, note Benoist, tend spontanément à poser une distinction trop nette entre pensée et réel. La pensée philosophique bute à ce point sur ce qui n’est qu’un fait : il y a une présence de la singularité dans la pensée, comme si la philosophie n’avait fait que développer le fantasme d’une pensée qu’il n’y aurait pas à penser. « Comme si ce qu’il y avait le plus proprement réel à penser, ce qui donne à la pensée son terme « réel », était justement ce qu’on ne peut pas penser. »15 16
F : Le social
Quel est en fait, demande enfin l’auteur, le mode de réalité de ce qu’on appelle le social ? Faut-il le comprendre comme un mode de réalité particulier ? Pour Benoist, on perçoit aussi bien au sens propre les choses sociales que le reste (au sens de la perception contextualisée développé plus haut). Ainsi, « Si nous percevons des choses sociales, c’est qu’il y en a » 17. Pourquoi dès lors mettre particulièrement le social en exergue comme tel ? Qu’a-t-il de particulier ? Le social apparaît comme surajouté, mais cette idée même de la postériorité du social sur un naturel est en fait simpliste. Tout autant les approches qui font du social quelque chose qui peut être abstrait – quelque chose d’annexe – que celles qui tendent de montrer que les objets sociaux sont aussi des objets réels (mais d’un type particuliers) se leurrent, car elles présupposent une spécificité qui n’a elle-même pas lieu d’être. Le social n’a de sens que sur fond de sa réalité. « L’erreur, une fois de plus, c’est de vouloir constituer le social, alors qu’on raisonne dans des termes qui le supposent partout. »18. Benoist précise même que « Là où l’être humain perçoit, c’est, immédiatement, en tant qu’animal rationnel. De ce point de vue, on pourrait dire que c’est donc son animalité (et non sa rationalité en tant que pensée comme extérieure à cette animalité) qui distingue l’animal humain des autres animaux. Sa rationalité est son animalité. »19.
La problématique du « tiers », cet autre potentiel qui hanterait la relation simplement intersubjective est fondamentalement ambiguë. En effet « Le tiers, en un sens, formule de la non-présentabilité du social (dans la relation intersubjective), devient alors, en un autre sens, suivant une réversibilité typique de ce genre de problématique transcendantale, la figure de ce qui constitue pourtant sa possible donnée : comme si, en dernier ressort, je pouvais trouver la société quelque part, de façon à requalifier mes relations intersubjectives, toujours potentiellement soupçonnées de ne pas être sociales, comme sociales. »20. Comme si, là encore, il fallait surajouter une altérité virtuelle à la relation que je peux avoir avec autrui pour qualifier celle-ci comme proprement sociale. Au contraire, en tant qu’humain, ma perception du monde est immédiatement et constitutivement une perception sociale, ma relation à l’autre ipso facto relation sociale. Ainsi, si la société est aussi un spectacle, c’est qu’elle est d’abord une réalité : en d’autres termes, il n’y a pas de distance du social mais de la distance au sein du social.
G : Le sujet ou la subjectivité ?
Parmi les conséquences à tirer de l’orientation présentée par Benoist dans l’ouvrage, la principale nous semble la dissolution du thème de la conscience, qui nous paraît nécessairement conduire à une mise en relief parallèle de celui de la subjectivité. Les problématiques ouvrent en effet des configurations dans lesquelles un sujet est d’une façon ou d’une autre impliqué ; il s’agit davantage ici d’une « instance sujet », en quelque sorte d’un sujet au sens lacanien, non assignable hors de la disposition à laquelle il appartient) Quelque chose est ainsi en esquisses comme une architectonique des sujets et de la façon dont les situations (ou non situations) le font intervenir.
H : Réalisme et transcendantalisme
On risquera enfin une ouverture en remarquant que la contrainte grammaticale qui fait de la phénoménologie une analytique de la façon dont peuvent se dire les façons « d’avoir le réel » ne nous semble pas intrinsèquement opposée à ce que rencontre et révèle une perspective transcendantale – indépendamment, précisément, des chemins choisis pour cette rencontre. Précisons que nous n’entendons pas le transcendantalisme comme une recherche de « conditions de possibilités », mais plutôt comme une quête « conditions de pensabilité ». Un tel transcendantalisme, qu’on peut qualifier de transcendantalisme-réflexif, entend dégager les dimensions qu’il faut nécessairement poser lorsqu’on entreprend de penser le réel à partir du rapport que nous avons à lui. Traditionnellement, cette explicitation a été considérée comme déductive (ce que l’approche de Benoist interdit), mais un certain nombre de phénoménologues contemporains (en particulier Marc Richir) 21 pratiquent une autre forme de transcendantalisme, qu’on peut qualifier de descriptive/constructive, et qui rencontrent des structures de pensées proches de celles qu’exhume l’analyse grammaticale à laquelle procède Benoist.
Certes, ce type de similitude n’est en soi pas surprenant puisqu’il s’agit précisément pour Benoist de montrer que la phénoménologie a eu tendance à constituer les structures en question comme des instances alors qu’elles ne relevaient que des contraintes inhérentes à la pensée elle-même. D’un autre côté cependant, l’évolution de la phénoménologie transcendantale vers une analytique du « phénomène » en tant que structure procède de la même volonté de saisir « comme telle » la contrainte phénoménologique pour l’exposer dans son sens propre – hors, donc, de toute ontologisation. 22 L’analyse grammaticale n’est certes pas transcendantale parce qu’elle ne se soucie pas (et n’a pas à se soucier) de s’assurer d’elle-même, de se redoubler pour fonder son propre statut comme discours, mais elle rencontre la perspective transcendantale dans sa volonté d’exposer « structurellement » l’intentionnalité, le phénomène, la perception, comme outils que la pensée pose et emploie pour rendre compte de la façon dont nous avons le réel, plutôt que comme réalités. Le transcendantalisme, ici, n’est en effet pas autre chose que la tentative, poussée à son point ultime, de se donner l’intelligibilité comme telle, l’intelligibilité exposée en son principe même, dans sa lumière comme intelligibilité, alors que l’analytique de Benoist se situe d’emblée au sien d’une intelligibilité latente, située, intriqué au réel en laquelle il s’agit de s’orienter.
Certes, une fois encore, c’est – pour Benoist – un faux problème de se demander en quoi l’intelligible est intelligible. Pour autant, tout aussi bien, celui-ci insiste tout aussi bien sur le fait que la pensée est lestée de réalité. La phénoménologie est possible, risquerons-nous, précisément parce que cette charge de concrétude de la pensée la met « en frottement » avec elle-même, lui permet par-là, en quelque sorte, de se perdre et de se reprendre, bref, de jouer avec elle-même. Or ce sont précisément ces « structures » – charge d’affectivité et de concrétude de la pensée, écart de l’expérience vis-à-vis d’elle-même – que fait, en dernière instance, émerger Marc Richir. On peut, chez les deux auteurs, déceler au moins cela de conciliable que c’est d’une certaine façon la possibilité qu’a la pensée de « s’expérimenter elle-même » – précisément parce qu’elle est aussi concrète – qui donne le point de départ de la phénoménologie, qui prend la mesure de cet « au-dehors » au-dedans de la « pensée » que celle-ci rencontre parce qu’il est en elle –et elle en lui) sans pour autant pouvoir « se le donner ».
- Jocelyn Benoist, Eléments de philosophie réaliste, Vrin, Paris, 2011
- https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article258
- Soulignons si besoin au passage que la présence de Wittgenstein est très nette tout au long de l’ouvrage (ainsi d’ailleurs que celle de Strawson dont Benoist semble prolonger, en phénoménologie, le projet d’une logique philosophique informelle et descriptive)
- « La contingence du donné alléguée ici n’est pas la possibilité du non-donné, à côté du donné, mais la fragilité fondamentale du donné qui le fait immaîtrisable, d’être ce pur surgissement sans raison aucune qui est le fond même d’expérience par rapport à laquelle peut se déployer notre raison (…).», écrivait d’ailleurs déjà l’auteur dans L’idée de phénoménologie, p. 68
- Rappelons que Benoist a été lui-même dans d’autres ouvrages un historien du Husserl autrichien, des hésitations de la phénoménologie naissante, non encore thématisée comme telle, se cherchant en circulant autour d’une série de problèmes (signification, intentionnalité, plasticité des modalités intentionnelles, etc.
- p. 10
- p. 8
- Remarquons qu’en évitant le verbe être, Benoist prend ses distances par rapport aux figures heideggériennes ou merleau-pontyennes qui ont tendance à ré-impliquer l’intentionnalité dans le réel même, comme si la manifestation était une nécessité ontologique, une sortie de soi de l’être
- p. 48
- Qu’y a-t-il d’ailleurs de plus « représenté », note l’auteur, que cet univers physique sur lequel on entend forger le concept d’être en soi ? Et d’ailleurs, cerne-t-il vraiment ce qu’il y a de plus réel ? (parler d’un parallélépipède en dit par exemple beaucoup moins que de parler de Bible à propos d’un livre, et la physique ne constitue qu’un mode de description, pas forcément le plus pertinent.
- p. 54
- Comme l’étudient, selon des perspectives différentes, Claudio Majolino, Alexander Schnell ou Laszlo Tengelyi), mais structure justement ici délestée de ce que le concept de phénomène a encore de trop « contemplatif » dans la façon dont il est thématisé.
- « Mettre les structures en mouvement: la phénoménologie et la dynamique de l’intuition conceptuelle. Sur la pertinence phénoménologique de la théorie des catégories. », Rediscovering Phenomenology (Kerszberg, Patras, Loi)
- p. 117
- p. 120
- Notons au passage que, d’une façon très différente, ce « qu’ » qui vient caractériser la singularité dans ce qu’elle a de pensable, en ce que, pour le dire dans une autre langue, quelque chose d’elle se révèle, caractérise également, en tant que structure, la relation du Dasein aux possibles dans lesquels il s’assume, ou, plus encore, chez Marion, la structure de « fait accompli » du phénomène tel qu’il se donne. Comme on y reviendra plus loin, il semble bien qu’à travers la pluralité des discours, certains « points de frictions » insistent – comme une sorte de fond caché de la phénoménologie sans lequel elle ne pourrait advenir, mais qu’elle ne veut qu’embrasser selon des perspectives très différentes.
- p. 143
- p. 161
- p. 154
- p. 161-162
- qui usent de ce qu’Alexander Schnell caractérise comme constructions phénoménologiques, cf. Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive, https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article205
- Nous avons eu l’occasion, avec notre recension d’Accéder au transcendantal de Jean-François Lavigne (https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article297) de nous inscrire en faux par rapport à une conception qui fait du transcendantalisme l’obstacle à l’appréhension d’une phénoménalité enfin saisie en elle-même, sans écran : la conversion transcendantale permet selon nous au contraire à un tel type d’approche une meilleure prise sur le mode de validité de son propre discours, c’est-à-dire du statut de ce qu’elle énonce. L’approche de Benoist, demeurant au plus proche du langage « ordinaire », n’a pas ce type de besoins.








