A : Les éditions de Corlevour
La recension de ce petit ouvrage de Jérôme de Gramont1 consacré à Maurice Blanchot est d’abord pour nous l’occasion de découvrir cette petite maison d’édition que sont les éditions de Corlevour (http://www.corlevour.fr/), situées à Clichy.
Le catalogue est vaste, comprenant de la poésie, des essais d’esthétique, des essais littéraires, ainsi que de la philosophie et de la théologie. Cette maison d’édition publie la revue Nunc qui rassemble toutes ces dimensions des éditions de Corlevour. Plusieurs numéros ont été consacrés à des philosophes français contemporains chrétiens et phénoménologues, comme Jean-Luc Marion (n° 16) et Jean-Louis Chrétien (n°8).
La première chose que nous pouvons constater lorsque l’on tient en main le livre de Jérôme de Gramont est qu’il s’agit d’un bel objet. La couverture est sobre, le papier est épais et de qualité, l’ouvrage est composé de cinq « cahiers » collés qui ne se détachent pas malgré plusieurs lectures et pour un prix tout à fait correct. Le logotype des éditions placé sur la couverture est composé de deux cercles enfermant la devise évangélique « servir plutôt qu’être servi » enfermant elle-même quatre lettres « R », « G », « d », « C ». Les deux premières sont les initiales de l’éditeur, Réginald Gaillard, les deux dernière renvoient au nom de la maison d’édition « de Corlevour ».
B : L’auteur
L’auteur de l’ouvrage, Jérôme de Gramont, est maître de conférence à l’Institut catholique de Paris 2 et ses centres d’intérêt sont très nombreux, puisqu’il a publié sur Kant, Platon, Kierkegaard, Nietzsche, Aristote, Derrida, Henry, Husserl, Heidegger, Ricoeur et maintenant Blanchot. On peut tout de même dire, nous semble-t-il, que l’auteur est à rattacher au courant de la phénoménologie chrétienne, et même catholique, celle d’auteurs comme Jean-Louis Chrétien, Jean-Luc Marion, celle qui, principalement au Cerf, tente de penser le rapport entre phénoménologie et théologie, dans le sillage de Jean Greisch, Philippe Capelle ou Emmanuel Falque. On pourra écouter5, ce qui le rattache à l’athéologie d’un Georges Bataille avec qui il noua un long dialogue, et aussi quand on sait que Blanchot fut longtemps, surtout après mai 68, rattaché à bien des auteurs français non seulement non-chrétiens, mais même par certains côtés antichrétiens, comme Deleuze, Foucault ou Derrida.
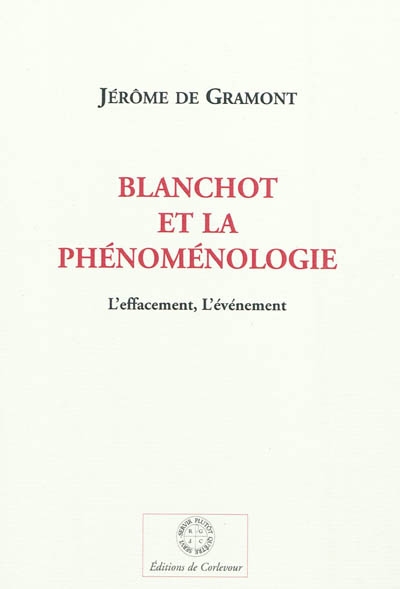
L’intérêt pour l’œuvre de Blanchot nous semble prendre sa source dans un questionnement à propos de l’appel. En effet, les premiers mots de l’auteur, qui suivent une citation de Blanchot, sont les suivants : « Quel est cet appel qui, au moment même où il a lieu, semble sceller et notre naissance et notre disparition ? » (p. 9). Or, le HDR de Jérôme de Gramont soutenu en 2011 s’intitule L’appel et l’affect. Recherches à partir de Kant et la phénoménologie. Si nous n’avons pu consulter ce travail, puisqu’il n’est pas encore publié, nous pouvons supposer que c’est la structure d’appel qui l’intéresse tout particulièrement chez Blanchot et justifie cet intérêt : l’appel de l’œuvre, c’est là, au fond, le thème sous-jacent qui relie entre eux les cinq chapitres du livre et les deux termes du sous-titre ((« L’effacement, L’événement »), cet appel constituant un événement qui exige l’effacement.
C : Intention, origine et forme de l’ouvrage
La publication d’un ouvrage sur Blanchot écrit par un universitaire spécialiste de philosophie est en soi un événement tant elle est rare. Les livres sur Blanchot nous semblent pouvoir être ramenés à trois catégories.
1. D’abord, des ouvrages portant sur les œuvres littéraires de Blanchot, ainsi que ses critiques littéraires d’autres auteurs comme Mallarmé, Kafka ou Rilke. Il s’agit souvent de thèses de doctorat de littérature. Intéressantes par bien des côtés, elles passent à côté de la dimension proprement philosophique de l’œuvre de Blanchot et du dialogue souvent implicite avec Hegel, Nietzsche, Heidegger, Sartre ou Levinas, ce qu’on ne peut leur reprocher puisque ce n’est pas là leur objet.
2. Ensuite, il y a les ouvrages qui prennent au sérieux la dimension philosophique de l’œuvre de Blanchot et qui ont été écrits par des philosophes qui l’ont accompagné intellectuellement. Nous pensons aux études consacrées à cet auteur par Levinas, Foucault, Derrida ou Nancy. Ces approches consistent souvent moins à étudier Blanchot pour lui-même qu’à penser avec Blanchot, ou à l’occasion d’un dialogue avec Blanchot, mais ces ouvrages sont plutôt à rattacher à la pensée de leurs auteurs respectifs. Même si un ouvrage comme Parages est important, il nous semble par bien des côtés être avant tout un exercice de pensée tout derridien qui en dit plus sur Derrida que sur Blanchot, et qui ne s’efface pas devant l’auteur à expliquer.
3. Enfin, la troisième tendance, la plus intéressante à nos yeux, consiste à lire Blanchot comme un philosophe à part entière et à l’étudier comme on étudierait n’importe quel auteur contemporain, mais surtout à l’étudier dans son rapport à la phénoménologie et en tant que phénoménologue. Le premier ouvrage de ce type, excellent, est celui de Marlène Zarader, L’être et le neutre : à partir de Maurice Blanchot, dont Jérôme de Gramont se revendique à de multiples reprises (« l’ouvrage, excellent, de Marlène Zarader » pp. 25-26, note 2), ce qui nous permet sans difficulté de le rattacher à cette troisième catégorie d’ouvrages sur Blanchot, le titre, Blanchot et la phénoménologie, indiquant bien qu’il s’agit de rattacher l’auteur à la tradition phénoménologique.
Un avertissement indique page six la provenance des textes qui composent l’ouvrage. Il s’agit de cinq leçons prononcées en janvier 2002 à Beyrouth, puis remaniées pour être à nouveau prononcées à Bogota en août 2010. Ces cinq leçons consistent chacune à rattacher Blanchot à un auteur de la tradition phénoménologique, dans l’ordre : Husserl, Sartre, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas. La présence de Heidegger après Sartre peut surprendre, dans la mesure où l’organisation des autres noms semble bien suivre un ordre chronologique. Mais précisément, c’est selon cet ordre que Heidegger vient après Sartre, car Jérôme de Gramont ne relie pas dans ce troisième chapitre Blanchot au Heidegger de Sein und Zeit, mais à celui d’après-guerre, donc postérieur au rapprochement avec L’imaginaire de Sartre opéré dans le second chapitre. Les cinq conférences semblent avoir été données cinq soirs de suite et l’auteur les publie telles quelles, en conservant ce statut et ce style oral, de sorte que l’on trouve à de multiples reprises des formulations qui semblent inviter le lecteur à lire l’ouvrage en cinq jours, un peu comme les méditations de Descartes correspondent chacune à une journée. Ainsi, des invitations à lire les textes : « Retenons une page… » (p. 12), « Regardons ces pages… » (p. 13). Une reprise de ce qui a été dit : « Revenons à notre question… » (p. 13), « Disons-le à nouveau… » (p. 14), « Il n’est pas inutile de revenir au… » (p. 41). Une adresse aux auditeurs/lecteurs : « Vous l’aurez reconnu… » (p. 17). Un rappel du caractère quotidien de chaque leçon : « cet appel que nous avons nommé hier… » (p. 33), « Au soir du deuxième jour… » (p. 49), « ce seront nos trois motifs de ce jour… » (p. 61), « revenons vers la question qui fut la nôtre au premier jour » (p. 121), « ç’aura été la leçon de ce jour » (p. 122), etc.
Pourquoi une telle forme, et convient-elle à Blanchot ? L’avertissement de la page 6 indique qu’il s’agit d’un « petit volume que la patience eût retenu sinon pendant des années, peut-être plus ». En effet, la parole de Blanchot est obscure, au sens où peut l’être celle d’Héraclite, une obscurité non point contingente mais essentielle, puisque l’obscur est ce que tente d’approcher cette pensée sans l’arracher pour autant à son obscurité en le rendant clair. C’est pourquoi la parole de Blanchot est désespérante pour tout commentateur, et jamais nous n’arrivons à la ramener à un ordre des raisons ou à des idées claires et distinctes. Ecrire sur Blanchot, c’est se confronter à l’obscur et au confus, à ce qui n’a pas véritablement de nom, à ce qui n’est ni l’un ni l’autre, neutre, qui est toujours en-deçà des mots, à ce qui n’est approché par des mots que pour autant qu’ils soient immédiatement retirés et raturés (X sans X, comme l’a identifié Derrida), donc à l’indicible. Ecrire sur Blanchot, c’est précisément faire l’expérience de l’écriture telle que la décrit Blanchot, par exemple dans le premier article de L’espace littéraire : être livré à l’interminable, l’incessant, l’infini, dans une insatisfaction où l’œuvre à venir vient sans cesse sans jamais arriver, livré à l’impossible. L’écrivain, nous dit Blanchot, est l’insomniaque dont la main est victime de préhension persécutrice, il ne peut plus cesser d’écrire, selon une prolixité stérile qui récrit sans cesse, qui ressasse éternellement sans jamais aboutir dans l’œuvre. Et pourtant, il y a des œuvres. Le livre de Jérôme de Gramont est bien là et nous le lisons. C’est, nous dit encore Blanchot, que l’écrivain doit faire taire cette parole qui le saisit, il doit mettre un terme à l’interminable, faire cesser l’incessant, la main qui n’écrit pas se saisissant du stylo pour lui imposer le silence. Un livre sur Blanchot doit bien obéir au même processus : il faut lui imposer un terme, un point final, même si tout n’a pas été dit, même s’il n’est peut-être pas à la hauteur des espoirs de l’auteur. L’expérience vers laquelle fait signe cet avertissement de l’auteur est donc toute blanchotienne.
Nous aimerions y ajouter ce que Blanchot décrit à propos de la lecture dans un autre chapitre de L’espace littéraire : si l’écrivain est voué au tourment d’une écriture interminable, toujours inachevée, et condamné à un échec certain, le lecteur est celui qui, par l’innocence de sa lecture, son « Oui » léger, achève l’œuvre en voyant que cela était bon. Il la débarrasse du poids d’angoisse en la débarrassant de son auteur, le volume n’atteignant son achèvement qu’en étant impersonnifié, selon les mots de Mallarmé. En achevant ainsi l’œuvre par la lecture, que pouvons-nous dire de cette forme ? Qu’elle nous semble convenir à Blanchot. L’ouvrage est court, un peu moins de 150 pages, mais Blanchot est précisément un écrivain du dire peu, allant toujours vers le raccourcissement de ses œuvres, vers l’article, puis le fragment. L’ouvrage est une parole orale, puisqu’il s’agit de cinq conférences. Mais précisément Blanchot va toujours plus dans le sens d’une parole plurielle, à partir de L’entretien infini, et même plus tôt dans les récits, où deux personnages se font face, ce qui est une manière de trouver une parole qui ne soit plus la parole de l’Un et du Même, une parole qui accueille l’Autre en soi en se dédoublant, et Jérôme de Gramont insiste à plusieurs reprises sur ce dédoublement. Parole orale donc, mais qui accueille aussi la parole de l’Autre en soi, puisqu’il ne s’agit pas d’exposer la pensée de Blanchot comme une parole une et identique à elle-même, mais comme étant à chaque fois en dialogue avec un autre (« ouvrir le dialogue » p. 10) et comme accueillant cet autre en soi dans cette parole plurielle, qu’il s’agisse de Husserl, Sartre, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas. Enfin, le fait que chacune des conférences lance des pistes de rapprochement, saute d’un rapprochement à l’autre, sans forcément les développer, peut être rapproché de l’exigence blanchotienne de discontinuité et du fragmentaire. Le fait que ces conférences n’aient pas été retravaillées en vue d’un ouvrage proprement écrit et systématique comprenant sections, parties et chapitres nous semble donc conforme à leur objet. De ce point de vue, c’est non seulement un ouvrage sur Blanchot, mais aussi bien un ouvrage blanchotien à de nombreux égards, reprenant souvent son style d’écriture. Ceux qu’irrite ce lyrisme obscur ne pourront pas aimer cet ouvrage, c’est certain, mais ceux qui l’aiment seront réjouis de voir comment il peut féconder le commentaire sur Blanchot. C’était déjà plus ou moins le cas dans Parages, de Jacques Derrida, lorsque dans « Pas », il commentait Blanchot sous la forme d’un entretien entre deux voix impersonnelles, l’une masculine, l’autre féminine, comme dans la plupart des récits blanchotiens.
D : Blanchot et Husserl
Rapprocher Blanchot de la phénoménologie, puisque c’est l’ambition de l’ouvrage indiquée dès son titre, ne peut pas ne pas passer par un dialogue avec Husserl, le fondateur. Mais la chose n’est pas aisée, car Blanchot n’a écrit aucun article à son sujet, alors que ceux sur Sartre ou Levinas abondent, et l’on doit se contenter de quelques indications marginales. La démarche avait pourtant été tentée par Marlène Zarader dans L’être et le neutre : à partir de Maurice Blanchot, et Jérôme de Gramont renvoie à ces analyses pour s’y inscrire et les prolonger. Partant de l’appel de l’œuvre qui retentit et auquel répond celui qui écrit, l’auteur indique que cela implique d’emblée un abandon : « abandon de tout ce qui constituait auparavant notre expérience (effacement), mais abandon aussi à ce qui maintenant nous requiert (événement) » (p. 9). Dans ce « de » et ce « à » nous pouvons reconnaître aisément le double mouvement de l’épochè phénoménologique husserlienne en tant que double mouvement d’abstention de quelque chose (l’attitude naturelle) qui est aussi une reconduction à quelque chose (l’ego transcendantal), ce qui justifie pleinement la lecture de Blanchot à partir de la phénoménologie.
Après un court rappel biographique, l’auteur présente rapidement la manière dont il va à chaque fois aborder ces dialogues de l’écrivain avec les phénoménologues, à savoir à chaque fois selon trois motifs. Ici, une inquiétude pourrait saisir le lecteur : pourquoi trois ? S’agit-il de reconduire la parole de Blanchot au trois moments dialectiques au sein d’une totalité ? Rien ne serait plus anti-blanchotien quand on sait son souci, hérité de Levinas, d’une rupture de la totalité, de l’Un, de la continuité, et son souci du fragmentaire comme d’une parole d’emblée et à jamais multiple qui ne se laisse pas totaliser. « Cinq leçons, et à chaque fois trois motifs » (p. 10), écrit l’auteur, et il faut ici comprendre ce que signifie un motif, bien qu’il ne le précise pas. Le motif est manifestement une métaphore picturale pour penser le rapprochement entre deux auteurs de manière analogique au rapprochement entre deux peintres. Il s’agit de trouver un motif chez Blanchot, un autre chez un phénoménologue, et de voir dans quelle mesure ils peuvent se recouper et s’exclure. Nul moment dialectique donc, mais bien le découpage d’un motif, donc l’introduction d’une discontinuité, chaque motif lançant à chaque fois comme une piste de rapprochement que le lecteur peut développer pour lui-même.
Le premier motif, « Acheminement vers la question phénoménologique » (p. 11), laisse provisoirement de côté Husserl pour justifier l’abord de l’œuvre de Blanchot par la phénoménologie, puisqu’il s’agit d’abord d’une œuvre de critique littéraire. Pour cela, l’auteur part du mythe fondamental pour Blanchot qu’est celui d’Orphée descendant aux Enfers, qui lui permet de décrire l’expérience de l’écriture confrontée à l’impossibilité de l’œuvre, mythe duquel part Jérôme de Gramont dans ce premier chapitre, mais mythe aussi sur lequel il conclut son ouvrage dans un appendice. Orphée est celui qui se confronte à la nuit, qui tente de la ramener au jour et échoue sans cesse, qui se tient donc en rapport avec ce qui se dérobe, ce qui se dissimule et n’apparaît qu’en tant qu’il est ce qui se dissimule. On voit déjà là un ancrage phénoménologique, mais d’une phénoménologie toute particulière, puisqu’elle ne sera pas phénoménologie du phénomène constitué, mais plutôt de ce qui rompt avec le régime de la phénoménalité, ou de ce qui ne se phénoménalise qu’en se refusant à l’apparition et en la troublant, ce qui permettra de rapprocher Blanchot de Heidegger et surtout de Levinas. Les deux autres motifs tentent un rapprochement et un éloignement avec Husserl. Rapprochement d’abord, par le motif blanchotien de l’effacement, qui rejoue la réduction phénoménologique. Mais éloignement, ensuite, car cette réduction ouvre le domaine de ce qui se refuse à toute constitution par un ego transcendantal, un Dehors absolu qui n’est nullement réductible à un simple corrélat intentionnel de la conscience.
La fidélité à l’entreprise de la réduction, d’abord, que l’auteur rapproche de l’effacement blanchotien dans toutes ses dimensions, rapprochement effectué par Blanchot lui-même dans une page de L’entretien infini souvent citée où l’écriture est décrite comme « un surenchérissement ironique de l’épochè » (EI, 449). C’est que l’écriture est une réduction qui efface le Je au profit de l’impersonnel, l’anonyme, un « Ca écrit » sans que personne ne contrôle ce processus en première personne, l’écriture inspirée n’étant pas un pouvoir dont on dispose. Elle est aussi une réduction qui efface le monde, celui qui est constitué par une subjectivité transcendantale et ses pouvoirs aussi bien que celui ouvert par le projet d’un Dasein, pour laisser béer le Dehors, la nuit, où toute chose est réduite à une image, un simple reflet hors-sens sur lequel nous n’avons plus de prise mais qui nous saisit dans le regard de la fascination et ne nous lâche plus.
C’est ce dernier motif de l’ouverture à un Dehors absolu, qui n’est nullement relatif à des actes donateurs de sens d’une subjectivité transcendantale, qui marque l’éloignement avec Husserl, la phénoménologie blanchotienne portant sur « les confins de la phénoménalité : ce qui déborde l’intentionnalité » (p. 23), et ne peut donc qu’être tirée vers Heidegger et Levinas.
E : Blanchot et Sartre
Les points de rapprochement pour faire dialoguer Blanchot et Sartre sont multiples, nous avons tenté de le montrer ailleurs6, ces deux auteurs ayant écrits l’un sur l’autre et s’étant mutuellement inspirés même si c’est essentiellement pour s’opposer. L’intention de ce chapitre ne saurait donc être de faire le tour de ce dialogue mais de l’éclaircir sur un point précis : la question de l’imaginaire dans l’ouvrage sartrien du même nom et sa reprise critique par Blanchot dans l’appendice de L’espace littéraire intitulé « Les deux versions de l’imaginaire ».
Jérôme de Gramont montre comme la caractérisation de l’image comme néantisation a particulièrement frappé Blanchot et comment on peut trouver ici l’origine de ses développements sur le regard qu’est la fascination. De ce point de vue, il prolonge les analyses qu’avait esquissées Manola Antonioli à ce sujet dans L’écriture de Maurice Blanchot. Fiction et théorie. L’auteur perçoit bien ici ce qui sépare d’entrée de jeu Sartre de Blanchot : la néantisation sartrienne est un acte de la liberté, un pouvoir, quand l’exposition à l’image dans la fascination est pour Blanchot un effacement de soi dans le mourir impersonnel où nous ne pouvons plus pouvoir : « Sartre pose l’affirmation plus grande (la liberté) et Blanchot la négation (la mort) » (p. 36). Cette dernière formulation nous semble ambigüe, car la liberté sartrienne est néantisation, donc aussi négation, et la mort chez Blanchot étant double, elle peut aussi être entendue comme ce pouvoir de néantisation, de sorte qu’une proximité est possible ici par-delà l’apparente opposition, mais il faudrait dire que Blanchot ressaisit l’image sartrienne comme étant une version d’un imaginaire double.
L’auteur relit ici les pages que Blanchot consacre à l’image telle qu’elle s’offre à la fascination, telle qu’elle ouvre le Dehors neutre, en tant qu’elle est analysée à partir du cadavre, qui est l’image par excellence, ce qui donne lieu à un rapprochement avec l’article de Levinas paru en 1948 dans Les temps modernes, « La réalité et son ombre », où ce dernier prétend déjà à maints égards dépasser les analyses sartriennes comme le fera Blanchot. Le point de rupture peut être décrit comme le second versant de l’imaginaire : là où Sartre voit dans l’image le pouvoir de néantisation de la subjectivité, image qui vient après la chose pour la montrer absente, ce qui est le premier versant de l’imaginaire, l’autre image revient en-deçà de la chose dotée de sens, dans un rapport où nous n’avons plus de pouvoir sur elle, où elle apparaît pour elle-même hors-monde, second version de l’imaginaire qui appartient à l’effacement de soi et du monde décrit par le premier chapitre.
Le second motif tente un autre rapprochement grâce à l’insistance sartrienne sur la différence qu’il y a entre imaginer et percevoir, que l’auteur traduit ici en « imaginer, ce n’est pas voir » (p. 44) afin de rapprocher cette idée de l’affirmation blanchotienne selon laquelle « parler, ce n’est pas voir », véritable leitmotiv des premiers articles de L’entretien infini. Le rapprochement est hardi, moins évident que le premier, mais aussi moins convainquant à nos yeux. D’abord, si Sartre insiste tant sur cette différence entre image et perception, il nous semble que c’est déjà le cas de Husserl dans les Ideen I, lorsqu’il les différencie par les notions de présentation et de présentification. Et quand Blanchot affirme que parler n’est pas voir, il s’agit avant tout d’un dialogue avec le Levinas de Totalité et infini, le visage étant parole mais se refusant à la saisie intentionnelle d’un voir prétendant le constituer en objet relatif à la subjectivité transcendantale et ainsi reconductible à la totalité qu’il ne pourrait, dès lors, pas briser. Jérôme de Gramont cite une formule de Sartre selon laquelle les mots ne sont pas des images pour justifier ce rapprochement, mais il nous semble que cette formule, loin d’être blanchotienne, en le rejoignant sur l’idée que parler ce n’est pas voir, est bien plutôt antiblanchotienne, Blanchot s’efforçant de décrire dans le premier article de L’espace littéraire la manière dont les mots perdent par la littérature leur sens d’outils de communication pour revenir à leur état sauvage d’image, pure sonorité, écho impersonnel que le poète veut faire parler. Le langage est image pour ce premier Blanchot, et si Jérôme de Gramont insiste ici sur la manière dont il rompt avec le privilège traditionnel accordé à la vue dans la pensée occidentale, il nous semble qu’il faudrait ici périodiser la pensée de Blanchot. A l’époque de L’espace littéraire, il évoque encore le rapport au neutre comme un regard fasciné, donc un rapport de vision, même si c’est une vision paradoxale où ce qui apparait est que tout a disparu, donc apparition de la dissimulation comme telle. Il nous semble que c’est seulement après la lecture de Totalité et infini, donc sous l’influence de Levinas, qu’il dénie progressivement au vocabulaire de la vision la capacité à dire ce rapport au Dehors pour lui préférer ce parler qui n’est pas un voir.
Le troisième motif insiste sur l’éloignement : Sartre décrit une image et une œuvre qui ne se donnent que sur fond de monde, alors que Blanchot tente de décrire à travers l’expérience de l’image une rupture avec le monde qui est ce qu’il appelle le Dehors, où l’œuvre trouve son origine. De ce point de vue, Sartre reste proche de Husserl quand Blanchot est tiré vers Levinas et le problème de l’extériorité, celle là-même qui donne à Totalité et infini son sous-titre.
F : Blanchot et Heidegger
La présence de Heidegger dans l’œuvre de Blanchot est patente, aussi bien celui de Sein und Zeit que le dernier Heidegger, à la fois concernant la problématique de la mort, de l’être, de l’affectivité, du temps, de l’oubli, de l’attente, concernant la figure de Hölderlin, ou bien le rapport du poète et du penseur. Sans doute chaque livre consacré à Blanchot, ou presque, tente ce rapprochement, de manière plus ou moins heureuse, et Jérôme de Gramont n’y coupe pas. Mais ce qui est intéressant est que sa démarche ne fait ici nullement double emploi avec les analyses que l’on peut lire par exemple chez Marlène Zarader, puisqu’il laisse entièrement de côté le rapport à Sein und Zeit pour se concentrer sur le Heidegger d’après-guerre.
Le rapprochement semble évident : il s’agit dans un cas comme dans l’autre d’un projet analogue, « approcher ce qui se retire » (p. 59). Mieux, viser le retrait de ce qui se retire, révéler ce qui se retire en son retrait, à savoir l’être pour Heidegger, quand Blanchot tente de son côté de faire apparaître la dissimulation comme dissimulation, selon les mots de L’espace littéraire, ou encore de découvrir l’obscur dans son obscurité même, selon ceux de L’entretien infini. Le parallèle est intéressant : tous les penseurs sont, d’après Heidegger, attirés vers l’être qu’ils tentent de dire mais qui se dérobe à leur parole, comme tous les écrivains, selon Blanchot, sont attirés vers le Dehors, la nuit qu’ils tentent de dire mais qui se dérobe aussi à leur parole, étant l’en-deçà de tout langage. Dans un cas comme dans l’autre, une structure d’appel auquel il faut répondre en veillant : l’appel de l’être d’un côté, qui est appel à penser, l’appel de l’œuvre de l’autre, qui est appel à écrire.
Le premier motif de rapprochement est donc cette commune impossibilité de dire l’essentiel. Comme il y a oubli de l’être qui n’est nullement une faute de l’homme mais le fait de l’être lui-même, selon Heidegger, il y a ce manquement, cet échec de l’œuvre, Orphée se tournant vers Eurydice et la perdant à chaque fois, mais selon une nécessité que nul ne peut lui reprocher, car elle est son destin, selon Blanchot. L’inachèvement de Sein und Zeit pourrait être relu à partir de cette expérience blanchotienne, suggère l’auteur sans creuser cette piste qui nous semble tout à fait intéressante. Heidegger, écrivant Sein und Zeit, serait lui-même livré à l’interminable, l’incessant, à la prolixité stérile d’un du désœuvrement où l’auteur échoue à faire œuvre et où Orphée perd Eurydice. Piste intéressante à laquelle nous aimerions ajouter que pourtant il y a œuvre, Sein und Zeit est bien là, et on pourrait voir dans l’idée blanchotienne selon laquelle c’est la légèreté et l’innocence de la lecture qui l’achève un achèvement possible pour Sein und Zeit. A cette différence près que Blanchot évoque avant tout l’œuvre et la lecture littéraires, quand celle de 1927 est avant tout théorique et même très technique. Jérôme de Gramont cite ici fort justement les passages de L’espace littéraire où Blanchot est le plus heideggérien, allant jusqu’à appeler « l’être » ce qu’il appellera le Neutre. Cependant, il nous semble qu’on pourrait ici creuser cette relecture en la mettant en rapport avec la traduction française de la conférence De l’essence de la vérité, tant le vocabulaire heideggérien de Blanchot dans L’espace littéraire, comme la dissimulation, le mystère, l’erreur, l’errance, le non-vrai, nous semble y trouver sa source principal.
Le second motif tente un rapprochement concernant un possible tournant d’époque. Blanchot tente d’interpréter, comme Heidegger l’a tenté aussi, le mot de Hölderlin rattachant les poètes au temps de détresse, celui des dieux enfuis. L’expérience littéraire, si elle est rupture avec le monde, avec le jour, l’est tout autant avec le temps, puisque l’écrivain est livré au temps de l’absence de temps, à savoir le recommencement interminable, incessant, d’une parole neutre à laquelle il faut pourtant mettre un terme pour qu’il y ait œuvre. Cela autorise un rapprochement avec la problématique heideggérienne du nihilisme dans la mesure où l’écrivain fait l’expérience du rien, de l’absence de sens. Seulement, nous poserons une question à propos de ce rapprochement : s’agit-il vraiment du même nihilisme ? Ce dernier correspond chez Heidegger à l’histoire de l’être, et plus précisément à l’accomplissement de la métaphysique dans le triomphe de la subjectivité étendant sa puissance technicienne sur l’étant. Le nihilisme a un sens éminemment historique chez Heidegger, même s’il s’agit d’une histoire bien particulière. A l’inverse, il ne nous semble pas que l’expérience du Dehors ou de la nuit visée par Blanchot ait cette signification dans la mesure où elle est justement une rupture avec l’histoire, puisque rupture avec le monde. Le nihilisme dont parle Heidegger est historique et mondain quand l’expérience approchée par Blanchot ne l’est pas et ce Dehors ou cette nuit approchés dans le mourir ne nous semble pas propre à notre époque, car il est l’immémorial, et Blanchot use peut, en définitive, du mot de nihilisme.
Conformément aux chapitres précédents, si les deux premiers motifs tentent un rapprochement, le troisième marque un éloignement : l’être de Heidegger n’est pas le neutre de Blanchot, et l’auteur souligne ici fort justement cette distance de Blanchot à l’égard d’un certain fétichisme de la langue heideggérien, son jeu sur les étymologies, par exemple. A travers le mot être, Heidegger pense trouver un mot adéquat pour dire ce qui est à penser, là où le Neutre blanchotien signifie une inadéquation foncière, un ni-ni qui refuse tout nom.
G : Blanchot et Merleau-Ponty
Le quatrième chapitre tente un rapprochement particulièrement original dans la mesure où même si Merleau-Ponty et Blanchot se sont lus, le nombre d’occurrences de leur nom dans leurs œuvres respectives est bien mince. Un article de Blanchot de 1971 lui est consacré mais n’a pas été repris en volume de son vivant. Merleau-Ponty cite une fois Blanchot dans La prose du monde. Et pourtant, il pourrait bien y avoir là une « proximité inavouée » (p. 84), un « dialogue presque secret » (ibid.), tant Merleau-Ponty s’est efforcé de décrit une expérience muette, un retour à ce qui est déjà là avant le langage, le retour aux choses telles qu’elles sont vécues avant d’êtres dites et pensées, ce qui correspond très précisément à ce que Blanchot fixe comme tâche à la littérature, qui revient à ce Dehors neutre d’avant le monde, à la nuit d’avant le jour, à la présence hors-sens des choses en leur image antérieure à toute donation de sens, à toute donation d’un nom qui nie la chose concrète, la rose réelle, au profit de son idée, l’absente de tout bouquet.
Le premier motif montre comment Merleau-Ponty cherche, pour dire une vérité, une certaine forme d’effacement que l’on trouve chez Blanchot. La parole du penseur ne doit pas être la sienne, elle parle comme une voix impersonnelle qui ne vient pas de lui. Il s’agirait ainsi de résoudre le paradoxe consistant à amener au langage les choses « d’avant les mots, dans leur surgissement brut, à l’état sauvage » (p. 86). Nous reconnaissons ici sans peine un paradoxe tout blanchotien qui est au cœur de sa pensée de la littérature : Orphée doit descendre vers Eurydice mais il semble qu’il doive nécessairement la perdre. L’être sauvage correspond bien au Dehors, au neutre, à la nuit, et l’exigence d’une parole impersonnelle est celle que Blanchot reconnaît en l’écrivain, puisqu’il n’écrit pas mais Ca écrit en lui, selon une parole immémoriale impersonnelle. Posons une question tout de même : s’agit-il du même impersonnel dans les deux cas ? Dans L’entretien infini, Blanchot distingue l’« impersonnalité basse »7 de l’impersonnalité haute, la première désignant un en-deçà de la personne (« nous ne sommes pas au-dessus de la personne, nous sommes au-dessous » 8), quand la seconde désigne un au-delà de la subjectivité traditionnel en philosophie, comme l’Idée platonicienne, hégélienne, ou encore l’illéité levinassienne. Il reviendrait à la littérature d’approcher cette impersonnalité basse quand la philosophie dépasserait le personnel par le haut. Peut-être alors Merleau-Ponty serait un philosophe exceptionnel en cela qu’il aurait rejoint la littérature contre tout idéalisme.
Le troisième motif creuse ce rapprochement à propos de la notion du dernier Merleau-Ponty qu’est la chair du monde. Cette notion semble évoquer quelque chose de très proche du neutre, du Dehors, de la nuit, et Jérôme de Gramont cite une autre formule qui évoque aussi « cet anonymat inné de Moi-même » (p. 93) qui semble bien évoquer l’impersonnel du Il blanchotien. De la même manière que Blanchot n’aura cessé d’approcher ce Dehors comme un en-deçà des mots qui exige de raturer tout ce qu’on en dit selon le neutre, le ni-ni, on trouve cette insistance chez Merleau-Ponty sur l’idée que le nom même de chair est en quelque façon impropre et ne peut avoir de nom adéquat : « Puisqu’il s’agit d’un nom pour ce qui n’en a pas – l’anonymat du monde, ou le mien – nous pouvons bien imaginer que d’autres noms, tout aussi impropres, peuvent le remplacer. Par exemple celui de Neutre » (p. 94).
H : Blanchot et Levinas
Le cinquième et dernier chapitre aborde ici un rapprochement qui va de soi. Les deux hommes sont proches de par leur amitié qui remonte à leurs études de philosophie à Strasbourg, mais aussi par leurs œuvres. Levinas a écrit un Sur Maurice Blanchot et marqué sa proximité avec cette pensée dans plusieurs entretiens. Quant aux livres de Blanchot, ils renvoient très souvent en notes à De l’existant à l’existant et Le temps et l’autre, puis L’entretien infini consacre plusieurs articles à Totalité et infini, et tout le début de L’écriture du désastre consiste dans une lecture d’Autrement qu’être, et l’auteur en a bien conscience : « C’est un chapitre immense que celui du dialogue de Maurice Blanchot et d’Emmanuel Levinas, puisqu’il engage le tout de l’une et de l’autre de ces deux œuvres » (p. 110). Ce rapport est un passage obligé de toutes les études sur Blanchot, et les actes d’un colloque international à ce sujet on été publiés en 2007. Jérôme de Gramont évoque tous ces travaux mais laisse étonnamment de côté celui d’Arthur Cools, Langage et subjectivité : Vers une approche du différend entre Maurice Blanchot et Emmanuel Lévinas, paru chez Peeters en 2007.
Le premier motif consiste à montrer que l’un comme l’autre tente d’approcher l’Autre, le Dehors. Pour cela, Jérôme de Gramont voit chez l’un comme chez l’autre une volonté de « se dégager de la pensée de l’Être (Heidegger) » (p. 111). Pourtant, nous nous demandons si Blanchot n’est pas malgré tout plus proche de Heidegger que de Levinas, car il n’hésite pas à écrire au début de L’entretien infini qu’en un sens, le Neutre est l’être même : « Devrions-nous donc dire : l’impossibilité est l’être même ? Assurément nous le devons ! » 9. Sans doute pas l’être au même sens que Heidegger, car ce n’est pas l’être qui serait éclaircie du sens, ouverture, vérité et histoire, mais un être comme obscurité, nuit, non-sens, « qui ne se rend à aucune ontologie » 10. Mais être tout de même, et il nous semble chez l’un comme chez l’autre que cet être est indépassable n’appelle aucune transcendance, là où Levinas est essentiellement un penseur de la transcendance, de l’au-delà de l’être, qu’il s’agisse du Neutre ou du Seyn. Jérôme de Gramont montre bien comment Blanchot et Levinas sont proches en leur refus de l’Un, du Même, du Tout, afin de valoriser l’extériorité, le Dehors, l’Autre absolu, l’étranger. Il est vrai que Blanchot reformule sa pensée en des termes franchement levinassiens à partir de L’entretien infini et que « le dernier chapitre d’Autrement qu’être a pour titre « Au dehors », titre blanchotien s’il en est » (p. 111), mais nous nous demandons : est-ce bien du même Autre et du même Dehors qu’il s’agit ? Comme le montre bien Jérôme de Gramont, il se pourrait bien que ce qui intéresse le plus Blanchot chez Levinas, et même Levinas chez Blanchot, soit toutes les descriptions qui tournent autour de la notion d’il y a. Pour l’un, il s’agit de veiller cet il y a qui est lui-même l’Autre, le Dehors, l’absolu, quand pour l’autre il est le mal (« l’être, c’est le mal », écrit Levinas dans Le temps et l’autre), qu’il faut fuir vers l’Autre, vers le bien au-delà de l’être.
L’auteur rejoint finalement ce constat, dans lignée des analyses de Marlène Zarader, mais il veut cependant leur ajouter « deux remarques à titre de correctif » (p. 114). Tout d’abord, Levinas souligne dans certains passages la possible confusion de la transcendance de Dieu avec le remue-ménage de l’il y a. Cela est vrai, mais il nous semble que cette confusion n’est nullement souhaitable pour Levinas, et il faudrait faire intervenir ici la notion d’illéité qui apparait dans l’article « La trace de l’autre », dans En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, mais notion que Blanchot n’a justement jamais reprise à son compte. L’autre remarque consiste à affirmer qu’il y a un rapprochement de Blanchot à l’égard de Levinas concernant la question de l’éthique, et un certain tournant éthique de sa pensée, tout particulièrement dans L’écriture du désastre, et l’auteur cite ici une formule de ce dernier ouvrage à propos de la responsabilité pour autrui. Cela est vrai, sans doute, mais il nous semble qu’il y a là aussi une grande distance entre Blanchot et Levinas, même sur la question de l’éthique, dans la mesure où Blanchot ne reprend pas, par exemple, à son compte, la notion pourtant essentielle de visage, et surtout où autrui n’est pas porteur de la trace de Dieu. On peut ajouter aussi que le rapport à autrui comme face-à-face a lieu pour Blanchot dans la nuit, dans le Dehors, donc dans la neutralité en-deçà du monde, non par une transcendance qui serait une ouverture à un au-delà de l’être, son modèle pour penser le rapport à autrui étant Orphée et Eurydice qui se rencontrent aux Enfers, ou encore Tristan qui dans la nuit saute vers la couche d’Yseult. Le rapport blanchotien à autrui serait sans doute celui que refuse avec force Levinas dans l’appendice à Totalité et infini à propos de l’Eros, à savoir le féminin, non pas celui qui habite la demeure, mais le féminin qui est obscène nudité et matérialité, où Levinas souligne bien que s’y signale un retour de la nuit de l’il y a. Enfin, concernant les formulations de L’écriture du désastre, nous ne croyons pas que Levinas pourrait les reprendre à son compte, car elles relèvent d’une lecture en grande partie critique d’Autrement qu’être, la responsabilité pour autrui étant chez Levinas une élection qui me singularise à l’extrême quand elle est au contraire selon Blanchot une destitution radicale de la subjectivité au profit de l’impersonnel, une rencontre d’autrui analogue à la rencontre de la mort. Au fond, il nous semble qu’il faudrait lever une équivoque qui porte sur la transcendance, ce que ne fait pas ici l’auteur, à savoir que chez Levinas, la transcendance est, fort classiquement, une transascendance (ce terme a une occurrence dans Totalité et infini), un dépassement vers l’au-delà, quand elle est chez Blanchot une transdescendance (ce terme a une occurrence dans L’écriture du désastre), rétrogradation dans l’en-deçà du monde où se révèle une radicale interdiction de l’au-delà, le fameux « pas au-delà ».
Le second motif est original, il consiste à montrer comment l’exigence d’un autrement dire chez le dernier Levinas correspond aussi à l’interrogation blanchotienne. On retrouve chez l’un et chez l’autre « cette commune manière d’écrire où jouent à la fois l’audace de dire et la nécessité d’effacer ce qui vient d’être dit » (p. 119). En effet, la distinction entre le Dire et le Dit, selon laquelle le Dire doit constamment se dédire pour ne pas se figer dans le Dit et approcher l’autrement qu’être semble très proche de l’exigence blanchotienne du Neutre qui n’est à chaque fois ni l’un ni l’autre, X sans X, exigeant de retirer immédiatement ce qui a été avancé.
Le troisième motif tente un rapprochement à propos de la question de la veille, que Levinas développe dans une étude de De Dieu qui vient à l’idée. Mais ici aussi, comme pour le premier motif, nous aimerions nous demander s’il s’agit bien de la même veille. Comme l’écrit Jérôme de Gramont, cette veille est un rapport à l’autre « qui déborde toute intentionnalité » (p. 122), où il y a « plus de lumière dans l’œil que son état ne peut accueillir », selon une formule de Levinas citée à la même page. Il s’agit donc d’un au-delà de l’intentionnalité par excès de lumière, de sens, mais la veille blanchotienne, puisqu’elle porte sur le sens absent, nous semble bien plutôt porter sur un défaut radical de lumière, à savoir la nuit, l’obscur, l’abîme, donc constituer un en-deçà de l’intentionnalité qui serait plutôt à rapprocher de l’insomnie anonyme et horrifiante que Levinas décrivait dans De l’existence à l’existant.
Conclusion
L’ouvrage s’ouvrait sur l’appel de l’œuvre et le mythe d’Orphée, il s’achève par une sorte de retour à son point de départ, puisqu’un court appendice est intitulé « Le mythe d’Orphée ». A-t-il été prononcé lors des cinq conférences à Beyrouth et Bogota, ou s’agit-il d’un ajout postérieur pour la publication de l’ouvrage ? Cela n’est pas précisé et il nous semble percevoir un changement dans le style qui nous fait pencher plutôt pour la seconde possibilité. Articulé en trois moments, « Le regard d’Orphée », « La parole d’Orphée » et « Le livre d’Orphée », il fait le point sur le développement de ce mythe dans L’espace littéraire, Blanchot le signalant lui-même comme le centre de son livre. Seulement, le rapport de Blanchot à la phénoménologie, puisque c’est le titre du livre, n’est plus tout à fait évident ici.
L’ouvrage était parti d’une question portant sur l’appel de l’œuvre, un appel qui est un événement qui demande l’effacement, conformément au sous-titre du livre. La question « pourquoi répondre à cet appel ? » a scandé les cinq conférences comme un leitmotiv et, comme s’en rend compte l’auteur à la fin de l’ouvrage, « n’aura fait peut-être que s’épaissir » (p. 121). C’est qu’en effet, l’étude de Blanchot aura montré que cette question est sans réponse, celui qui répond à cet appel, celui qui veille, l’écrivain, ne le faisant de toute façon pas librement, mais étant saisi par une nécessité qui le dépossède de tout pouvoir, de lui-même et du monde, pour le livrer à l’impossible, à l’impersonnel, au Dehors.
Signalons pour terminer trois coquilles. P. 6 : « els » pour « les ». P. 74 : « voilà de dont il s’agit » pour « voilà ce dont il s’agit ». Et p. 96 : « il faut l’entendre aussi comment un nouveau » pour « il faut l’entendre aussi comme un nouveau ».
Précisons enfin le public auquel l’ouvrage s’adresse. Stimulant mais difficile, il n’est pas une initiation à la pensée de Blanchot, pas plus qu’à la phénoménologie, et nécessite donc une connaissance ne serait-ce que minimale des œuvres des auteurs étudiés pour pouvoir être apprécié.
- Jérôme de Gramont, Blanchot et la phénoménologie. L’événement, l’effacement, Corlevour, 2012
- cf.http://www.icp.fr/fr/Recherche/Les-enseignants-chercheurs-de-l-Institut-Catholique-de-Paris/Jerome-de-Gramont
- ici3 le court entretien accordé en 2011 à Radio Vatican à propos de son chemin en philosophie.
L’intérêt de Jérôme de Gramont pour Blanchot, cet auteur somme toute marginal et minoré en philosophie, n’en est que plus étonnant, quand on sait que cet auteur, loin d’être un penseur de l’ouverture à Dieu, est celui qui tente de penser cette vérité que « rien est ce qu’il y a et d’abord rien au-delà »4L’écriture du désastre, p. 117
- cf. « « Ecrire, lire, d’après Blanchot », in L’écriture et la lecture, des phénomènes miroirs ? L’exemple de Sartre, dirigé par Natalie Depraz et Noémie Parant, Cahiers de l’ERIAC n°2, PURH, 2011.
- L’entretien infini, p. 175
- Ibid.
- L’entretien infini, p. 66
- Ibid., p. 67.








