*
« Je n’estime pas ces originaux-là ; d’autres en font leurs connaissances familières, même leurs amis. Ils m’arrêtent une fois l’an, quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres, et qu’ils rompent cette fastidieuse uniformité que notre éducation, nos conventions de société, nos bienséances d’usage, ont introduite. S’il en paraît un dans une compagnie, c’est un grain de levain qui fermente, qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite, il fait approuver ou blâmer ; il fait sortir la vérité, il fait connaître les gens de bien, il démasque les coquins ; c’est alors que l’homme de bon sens écoute, et démêle son monde ».
Diderot, Le Neveu de Rameau
*
Issu d’un travail de mémoire universitaire, le livre de Jean-Marc Mandosio, Le Discours de la méthode de Denis Dierot, 1 est un réjouissant petit essai sur le plus turbulent philosophe des Lumières. Le système diderotien est présenté par Mandosio dans tout ce qu’il a de paradoxal, d’instable et de surprenant. L’auteur montre comment, chez Diderot, la philosophie n’est plus recherche méthodique de l’ordre des pensées, mais art délibéré de provoquer le désordre dans l’esprit. C’est de cette façon que les Lumières peuvent triompher : en secouant les habitudes de pensée, les dogmes, les superstitions, qui endorment l’esprit. Le rôle du philosophe est de mettre les certitudes en danger, au risque assumé de ne rien offrir de plus que la vision d’une nature désordonnée et d’une raison frayant avec la folie. De ce fait, Diderot apparaît à la fois comme un anti-Descartes, un anti-métaphysicien et, peut-être, un anti-philosophe.
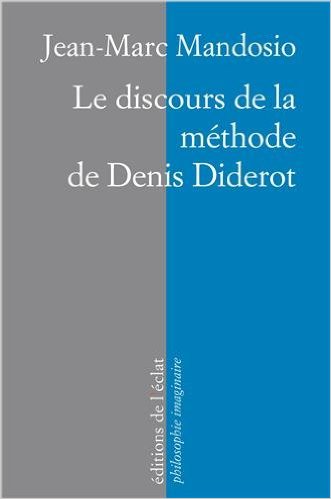
Diderot est tout d’abord l’adversaire de la présentation méthodique des pensées, selon l’ordre des raison : un tel ordre ennuie le lecteur, en lui présentant des idées déjà démontrées et certaines. A cela, le philosophe oppose un art de la séduction et de la persuasion, par lequel on entre furtivement dans l’âme de son lecteur, de sorte que celui-ci se retrouve pris dans le mouvement des pensées avant même de les avoir comprises. Le texte doit donc être volontairement désordonné afin de dérouter le lecteur, de le surprendre, de l’étonner, pour que la pensée naisse en lui en même temps qu’elle naît dans le texte qu’il lit.
« Pour Diderot, une philosophie inventive ne sépare pas la forme d’expression et la chose exprimée ; la nature même de la pensée, ce flux désordonné, se révèle seulement lorsqu’on dispose ses idées pêle-mêle sur le papier. La philosophie méthodique, en revanche, distingue forme et fond, recherche et savoir » (page 15). Ce désordre n’est pas un simple manque d’ordre, une incapacité à clarifier ses pensées ; au contraire, ce désordre est voulu, recherché pour lui-même dans la composition, afin de donner à une conversation, un dialogue, un récit, l’apparence de la spontanéité, du surgissement imprévu des pensées. Or, rien n’est plus artificiel et plus difficile à produire que le naturel. Mais en procédant de la sorte, le philosophe ressemble dangereusement au sophiste, car il se met à user de paradoxes, d’illusions et de tromperies pour parvenir à ses fins. Si elle s’en distingue in extremis, c’est que son intention est opposée : « Le premier paradoxe est celui du sophiste. ll sert à montrer que toutes les opinions se valent, que rien n’est vrai et que l’on peut prouver n’importe quoi ; il répand le scepticisme pour instaurer la tyrannie de l’opinion, seul point de repère subsistant dans les esprits gagnés par le relativisme. S’il commence par ébranler les certitudes, c’est finalement pour mieux rassurer.
Le second paradoxe est celui du philosophe : il renvoie dos à dos les opinions et leur dénie toute valeur probante, défait l’esprit de ses habitudes pour établir le vrai sur un terrain plus solide que celui de la coutume. Il ne s’en tient pas au scepticisme, étape nécessaire mais qui doit laisser place à une nouvelle exigence : l’inquiétude que suscite le paradoxe philosophique ne se soigne pas par un retour aux habitudes » (page 22.).
Diderot veut détruire les dogmes et les superstitions religieuses. Mais, se heurtant à la censure, il doit déjouer celle-ci et donc ruser pour faire passer ses idées, comme en contrebande. Pour rejeter la métaphysique et la religion, il s’appuie sur la science expérimentale, qui va permettre de démystifier la nature, et donc de découvrir, en-deçà des systèmes théologiques, la vraie nature de celle-ci : une nature « dédivinisée » (Gai Savoir, §109), pour reprendre l’expression de Nietzsche. Mais parce qu’il garde une vue d’ensemble sur la nature, Diderot retrouve la métaphysique, mais en la mettant à une plus juste place : de discours premier, elle doit devenir simple auxiliaire des sciences. « Un système de l’univers : voilà ce que ne doit pas être l’idée de nature. L’esprit systématique est un dévoiement du véritable esprit philosophique qui consiste dans le bon usage de la raison en tant que faculté auxiliaire de la pratique. Procédant d’une métaphysique mal entendue, qui inverse l’ordre légitime de l’élaboration théorique (toujours seconde par rapport aux phénomènes), l’esprit de système bâtit de vastes constructions spéculatives qui ne stimulent pas la recherche mais la freinent » (page 41). « Diderot considère que tout ce qui existe est un produit de la combinaison des éléments. Ce que sont ces éléments, ce n’est pas à lui de le dire ; le rôle du philosophe dans cette affaire est d’éclairer les fondements, les présupposés du travail scientifique, non d’en dicter à l’avance les résultats, contrairement aux voeux des faiseurs de systèmes » (page 44.). Il resterait alors à savoir en quoi le philosophe peut éclairer les fondements des sciences, et dans quelle mesure ces dernières pourraient avoir encore besoin de s’arrimer à une métaphysique. Une chose est certaine chez Diderot : le rêve d’un système complet de la nature apparaît pour ce qu’il est, un simple rêve, dont il convient de se réveiller pour constater l’autonomie et la pluralité des sciences, que rien ne pourra ramener à l’unité. Le vouloir serait freiner leur développement, en exigeant d’elle qu’elles se ramènent à un ordre prédéfini, et généralement prédéfini par le métaphysicien.
La nature n’est alors plus une entité surplombant la diversité des choses, mais un simple mot, qui désigne la totalité de ce qui existe, et rien de plus. Moniste, Diderot tient qu’elle est entièrement matérielle et qu’elle forme un seul grand individu. A terme, on pourra donc selon lui tout expliquer par la matière seule et tout ce qui relève de l’esprit pur, détaché de la matière, ne sera plus que reliquat de métaphysique ancienne, désormais inutile et même nuisible aux progrès des connaissances : « Les scientifiques n’ont affaire qu’à la combinaison des éléments : ils opèrent sur la matière, sans se préoccuper de cette res cogitans qui n’est qu’une invention de métaphysicien » (page 44). Dans la nature, tout change sans cesse, mais tout se tient en même mot, de sorte qu’un système du mobilisme reste pensable, mais ce système de connaissance porte sur l’accidentel, le hasardeux, l’imprévisible, car cette totalité nous dépasse de beaucoup, en extension et en durée. L’Encyclopédie, qui voudrait décrire tout, apparaît donc comme un projet démesuré, indéfini. Et plus on en écrit, plus on peut en écrire, comme le montre l’exemple du chevalier de Jaucourt, emporté dans ce flux débordant du savoir, qui jamais ne parvient à circonscrire la richesse débordante du réel 2. Diderot lui-même succombe à cette hybris et se perd dans les méandres infinies du monde -un peu comme aujourd’hui on peut se perdre dans la navigation de Wikipédia, à force de passer d’une page à l’autre et effectuer sans arrêt un coq à l’âne par simples clics sur des liens hypertextes !
« Le temps fait s’effondrer le rêve d’un savoir cumulatif. A notre échelle de durée, nous croyons constater des régularités alors même que le temps fait son office et que ce qui paraît revenir de façon cyclique est déjà à chaque imperceptiblement différent. A une échelle beaucoup plus grande, le raisonnement par induction devient impossible : on ne peut plus extrapoler ce qui sera à partir de ce qui a été. L’idée que tôt ou tard les lois de l’univers seront découvertes et ramenées à leur principe premier n’est donc qu’une aimable illusion » (page 55). On peut tout à fait pratiquer les sciences en se passant de l’assurance que la nature est prédisposée à être connue, et que les limites de notre entendement sont les siennes. Trop riche, trop contradictoire, trop complexe, la nature est de plus toujours en train de se renouveler, de se recréer. Il est donc improbable qu’on puisse jamais en épuiser le contenu. Il serait même vain de vouloir en définir quelques grands principes dans un système : « Pour Diderot, il s’agit de rassembler les connaissances éparses ; pour Hegel, c’est le concept fondamental de l’objet de chaque science qui est déterminant […] Diderot n’aurait pu souscrire à une telle entreprise, qui constitue de son point de vue, une régression vers les vues dogmatiques qui avaient présidé aux projets de ses prédécesseurs, comme l’Encyclopaedia d’Alsted. Loin d’être un dépassement de l’Encyclopédie de Diderot, celle de Hegel représente précisément ce qu’il s’était efforcé d’éviter » (pages 56-57).
Ce n’est qu’en s’intéressant aux choses qu’on peut espérer apprendre quelques secrets de cette grande nature si peu ordonnée. Mais il serait inutile pour Diderot de définir a priori les règles du rapport de l’esprit au réel. Pour cela, il faudrait déjà avoir la moindre idée de ce qu’il y a dans la nature ! Il sera toujours prématuré de s’intéresser aux conditions de l’expérience possible. Pour connaître, il faut au contraire vivre et répéter des expériences, et développer l’esprit de finesse dont parle Pascal, afin de saisir les relations subtiles qui unissent les choses. Comme le montre Mandosio, cela peut commencer par un intérêt pour n’importe quoi, comme la recette de compote d’abricots verts (citée page 16) :
«* Compote d’abricots verds. Prenez des abricots verds ; remplissez un chauderon d’eau à demi ; jettez-y des cendres de bois neuf ou gravelées ; faites faire à cette lessive sept ou huit bouillons ; mettez-y vos abricots ; remuez-les avec l’écumoire. Quand vous vous appercevrez qu’ils quitteront le noyau, mettez-les dans de l’eau froide, maniez-les, nettoyez & passez dans d’autre eau claire. Faites bouillir de l’eau dans une poele ; jettez-y vos abricots que vous tirerez de l’eau claire. Quand ils seront cuits, vous ferez fondre dans une poele une quantité de sucre clarifié, proportionnée à celle des abricots : cependant vous laisserez égoutter vos abricots entre des serviettes ; vous les tirerez de-là pour les jetter dans le sucre ; vous les y laisserez bouillir doucement ; bientôt ils verdiront : alors poussez le bouillon ; remuez, écumez, laissez refroidir, & serrez » (Encyclopédie, article Abricot).
« La recette fait la part belle au doigté », commente Mandosio, « à l’esprit de finesse. Elle dit ce qu’il faut faire, mais le moment est laissé à notre appréciation : il faut s’apercevoir ; faire bouillir sept ou huit fois ; il faut constater la cuisson, mais seule l’habitude peut nous avertir qu’ils sont cuits ; bref, tout se joue sur la frontière incertaine entre le trop et le pas assez, sur un savoir-faire mi expérimental, mi-intuitif » (page 16). A l’extrême opposé de l’axiomatique, qui définit les règles général du savoir par démonstration, la recette de cuisine touche l’expérience singulière au plus près. Elle nous rappelle que la science est un métier, qui s’apprend aussi sur le tas et qui ne peut pas être défini seulement par quelques normes générales.
De plus, il n’y a pas de limite a priori à l’extension de la méthode expérimentale : « Diderot rêve d’une expérimentation étendue à l’univers entier, qui supprimerait la distinction entre le laboratoire de la nature et le laboratoire de l’art. Non seulement on pourrait fabriquer tous les hybrides et les chaînons manquants que l’on voudrait, mais la réalité du flux perpétuel serait elle-même prouvée de manière très concrète » (pages 92-93). C’est peut-être ici que la spéculation diderotienne rencontre ses limites, qui sont celles du relativisme épistémologique en général. Cette expérimentation sans méthode a quelque chose de feyerabendien avant l’heure (Mandosio parle d’un anarchisme de la connaissance chez Diderot) : tout est bon pour connaître, pourvu qu’on supplée les défauts du bagage théorique par une attention accrue à l’expérience. Seulement, le propos de Diderot ne peut manquer de soulever un problème : comment peut-il y avoir encore expérience si aucun cadre théorique ne permet d’en cerner a minima les contours ? Comment même distinguer encore la connaissance de l’illusion, le savoir du délire, la réalité du rêve ?… Déjà « post-moderne » à sa façon, Diderot exprime bien les limites d’un empirisme pur, détaché de tout cadre théorique prédéfini.
Mais c’est aussi parce qu’il ne cherche pas à définir une véritable méthode expérimentale : il veut briser les vieux schèmes hérités de Descartes et de la scolastique, écarter toute spéculation a priori, mais il ne propose pas de nouveau modèle de la connaissance. Il n’est pas vraiment épistémologue mais plutôt anti-métaphysicien. Il en reste à ce moment « dionysiaque » de toute recherche, marqué par l’incertitude, les tentatives, les ratés, mais il omet le moment « apollinien » de la mise en forme et en ordre. Avec lui, l’esprit d’invention, indispensable à la découverte, ne se distingue alors plus vraiment de l’esprit visionnaire ni des hallucinations prophétiques, car Diderot ne définit pas de véritables normes de la recherche. L’heuristique apparaît comme quelque chose de tout à fait irrationnel, une sorte de génie offert à certains, qui ne doit rien à la recherche patiente et à l’effort. Cet esprit invention est un « je-ne-sais-quoi, cette intuition que tout le monde n’a pas, mais que ceux qui la possèdent à des degrés divers mettent en oeuvre spontanément, sans même avoir à y penser car elle est pour eux une seconde nature. L’effort apparaît comme l’antithèse du génie, et les grandes découvertes se présentent comme le fruit du hasard et d’une activité inconsciente plus que du labeur opiniâtre » (page 115).
Et c’est pourquoi, en brisant les normes, Diderot met la philosophie directement en danger : « méthodique, le discours philosophique ne transmet que des connaissances mortes ou inutiles ; non méthodique, il montre que la connaissance suit des voies mystérieuses » page 119). Le penseur est aussi bien un inspiré, un rêveur, un fou. Diderot va très loin dans l’expression de ces pensées chimériques, où la nature ne se distingue plus tellement de l’imaginaire et où rien ne ressemble plus au faux que le vrai. Alors, le dialogue ne connaît plus de fin, il ne débouche sur aucune certitude, et les paradoxes ont le dernier mot. Mais ceux-ci ne risquent-ils pas alors de devenir nos nouvelles certitudes, quand les anciens dogmes ont été balayés ? Les hommes pourraient s’habituer à tenir pour vrai n’importe quel paradoxe pourvu qu’il aille contre le sens commun, de sorte que la superstition ressurgirait par où on croyait la chasser. Elle brillerait en plus par ses formules contradictoires, plus séduisantes aux yeux de certains que les bonnes vieilles leçons hérités de la tradition. « La méthode, utile pour critiquer les systèmes, est mystificatrice quand elle se met à en fabriquer […] Tout discours qui prétend dire le dernier mot sur une question est forcément un discours mystifiant » (page 132). Mais alors, en affirmant que le désordre est le dernier mot quant à la nature des choses, Diderot ne nous a-t-il pas mystifié depuis le début ?
Il est certain que pour lui, le rôle du philosophe n’est pas de fournir des certitudes mais de les briser, et de voir jusqu’où l’on pourra s’en tenir à la fragilité et à la précarité de notre savoir, peut-être comme l’a proposé aussi Nietzsche. Comme nous ne sommes qu’une partie de la nature instable, nous ne pouvons pas échapper à l’instabilité de notre situation. Pour Diderot, on ne peut donc savoir d’avance si notre savoir sera toujours incertain -ni même délimiter précisément ce qui est savoir et ce qui ne l’est pas ! Seulement, l’idée de désordre est plus stimulante pour l’esprit car elle l’habitue à être dans l’inconfort. Elle l’empêche certes d’espérer trouver rapidement le dernier mot. Mais c’est en agitant les opinions que le philosophe, semblable en cela à Socrate mais aussi au neveu de Rameau, « fait sortir la vérité ».
Voici donc un excellent essai qui réserve des surprises et des trouvailles presque à chaque page et qui nous donne envie de lire et relire Diderot, cet « hippogriffe » 3 de la philosophie.
- Jean-Marc Mandosio, Le Discours de la méthode de Denis Diderot, éditions de l’Eclat, 2013.
- « Ne craignez pas qu’il s’ennuie de moudre des articles : Dieu le fit pour cela. »
Diderot, à propos de Louis de Jaucourt (lettre à Sophie Volland du 25 novembre 1760). - Voir l’Essai sur le mérite et la vertu, partie seconde, section troisième.








