« Nous risquons de deux manières de méconnaître un grand auteur, écrit Deleuze. Par exemple, en ignorant sa profonde logique ou le caractère systématique de son œuvre. (Nous parlons alors de ses «incohérences» comme si elles nous donnaient un plaisir supérieur.) Et aussi, en ignorant sa puissance et son génie comiques, d’où l’œuvre tire généralement le maximum de son efficacité anti-conformiste. (Nous préférons parler des angoisses et de l’aspect tragique.) En vérité, l’on n’admire pas Kafka si l’on ne rit pas souvent en le lisant. Ces deux règles valent éminemment pour Rousseau » [« [Jean-Jacques Rousseau, précurseur de Kafka, de Céline et de Ponge », repris in L’Île déserte et autres textes, Minuit, 2002.[/efn_note].
Il est vrai que Rousseau est par excellence l’auteur dont on tire un « plaisir supérieur » à souligner les incohérences et les contradictions, aussi bien dans sa vie (l’auteur d’un traité d’éducation qui abandonne ses cinq enfants) que dans son oeuvre (la croyance naïve en la bonté naturelle de l’homme, l’oxymore que constitue la notion de « volonté générale » etc.). Pour le lire sérieusement, on devrait mise sur le fait que ce n’est pas l’auteur qui se contredit mais nous qui le comprenons mal. Rousseau lui-même a assez protesté de la cohérence de son oeuvre contre ses détracteurs.
Toutefois, il se pourrait que même si la recherche des contradictions d’un auteur soit justifiée, quand bien même elle serait mal intentionnée, puisqu’on peut toujours chercher la volonté pour de mauvaises raisons. Or, le « sens commun » reproche généralement au philosophe non seulement ses contradictions théoriques, qui sont plutôt affaires de spécialistes, mais surtout les incohérences entre ses paroles et ses actes (alors qu’un commentateur professionnel insistera surtout sur les contradictions théoriques, trouvant en quelque sorte indigne et plat de reprocher au philosophe de dire une chose et de faire son contraire). Ce n’est donc pas nécessairement pour se sentir supérieur à l’auteur qu’on pointera ses insuffisances, mais tout aussi bien pour exiger de lui qu’il respecte ce qu’il prêche.
De plus, même si l’on parie sur la cohérence de l’auteur, on peut se demander s’il y a, bien comme l’affirme Deleuze, un rapport entre l’efficacité anticonformiste d’un auteur, c’est-à-dire sa capacité à secouer nos préjugés et notre soumission, et le caractère systématique de son oeuvre. Plus encore, on peut se demander se demander ce que vient faire l’humour au milieu de cela, selon Deleuze. Il n’y a pas de doute que l’humour puisse être anticonformiste, mais en quoi une pensée systématique serait-elle par là-même intrinsèquement comique ?
Un esprit chagrin, du genre de ceux que Deleuze tance, pourrait du reste faire remarquer que Rousseau était par moment singulièrement dénué de tout sens de l’humour, lui qui dans la Lettre sur les spectacles à d’Alembert, méprisait Molière et tout ce théâtre qui met sous les yeux du bon peuple tant de vices, en l’accusant d’en faire l’apologie. Comment pourrait-il avoir le sens de l’humour, celui qui ne comprend rien à ce point à la vis comica de Molière et qui défend au contraire l’hypocrisie et le conformisme en demandant qu’on cache tous ces vices dont le spectacle pourrait pervertir les spectateurs ? Dans cette lettre, Rousseau est nettement dans le camp de ceux qui considèrent que la comédie, loin d’avoir pour fonction de castigare ridendo mores, ne fait que peindre les vices sous un jour plaisant.
Et au cas où l’on voudrait voir du génie comique chez Rousseau, il y aurait encore une contradiction (une de plus !), entre son mépris du théâtre et sa prétention à châtier les moeurs par le rire.
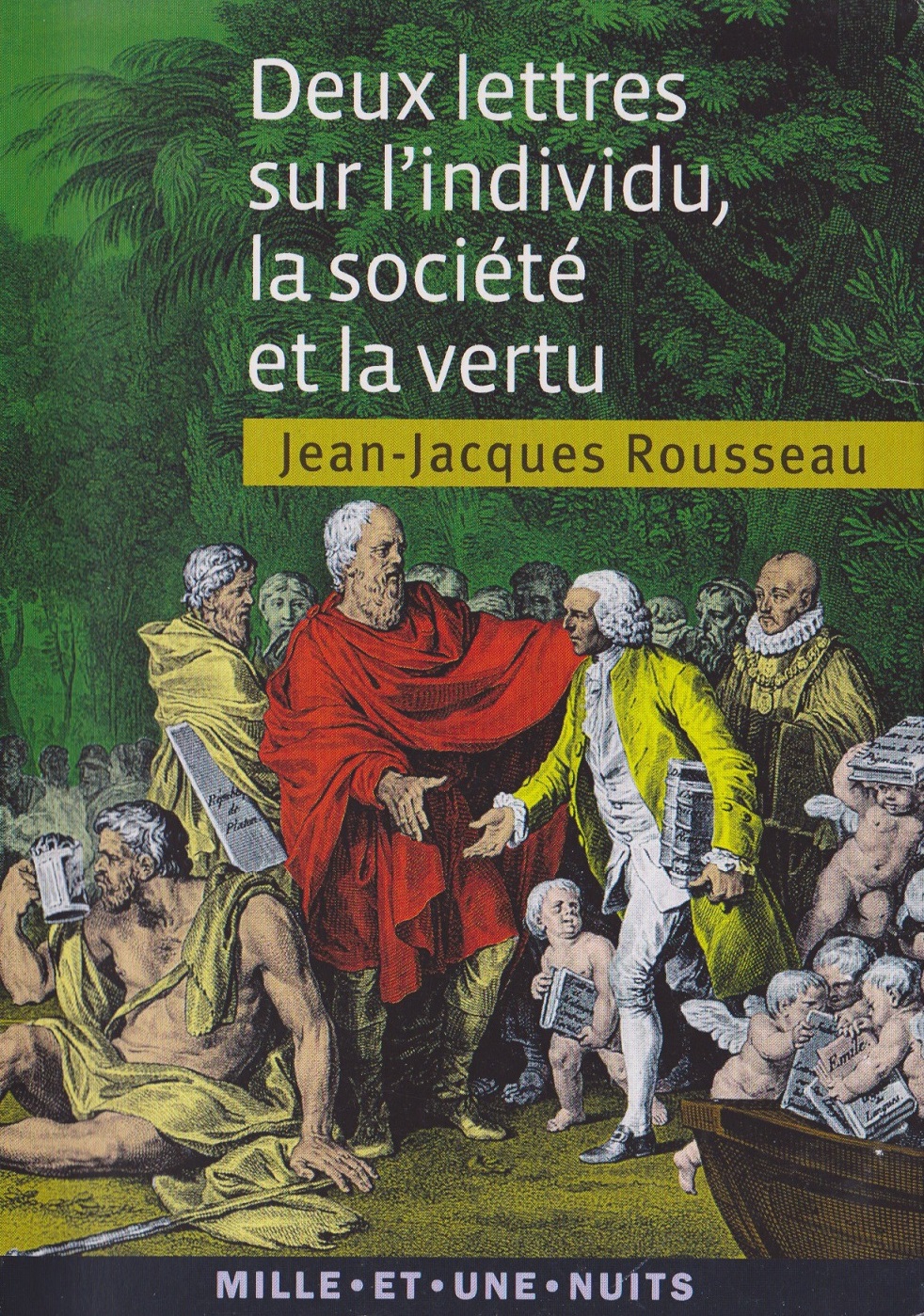
La réponse pourrait évidemment être que Rousseau reproche essentiellement à Molière de ne pas faire ce qu’il faudrait faire et que lui, Jean-Jacques, va vraiment faire, à savoir dénoncer pour de bon la corruption de l’homme en société, sans complaisance, en battant donc Molière sur son propre terrain. Il reste, même dans ce cas de figure, que Rousseau aurait totalement mécompris Molière en lui prêtant un esprit conformiste et complaisant avec les vices de son temps, en faisant donc de lui une sorte de Tartuffe, un comble ! Et il semble bien que ce soit le cas dans la lettre à d’Alembert, où indéniablement la critique portée à Molière porte à faux [Sur la mauvaise foi de Rousseau dans sa lecture de Molière, voir [cet article de René Pommier. A la décharge de Rousseau, on peut mentionner qu’il a reconnu plus tard s’être laissé emporter : « Plein de tout ce qui venait de m’arriver, encore ému de tant de violents mouvements, le mien [mon cœur] mêlait le sentiment de ses peines aux idées que la méditation de mon sujet m’avait fait naître ; mon travail se ressentit de ce mélange. Sans m’en apercevoir, j’y décrivis ma situation actuelle ; j’y peignis Grimm, Mme d’Epinay, Mme d’Houdetot, Saint-Lambert, moi-même » (Confessions, livre X).[/efn_note] : Rousseau ne veut pas voir la méchanceté et l’égoïsme des pères, seulement l’ingratitude des fils.
Dernière difficulté soulevée par le propos de Deleuze : si on admet qu’il y a dans le rire une puissance anticonformiste, on peut se demander si le rôle du philosophe est de nous faire rire. Est-ce vraiment sa vocation ? Est-il seulement capable de rivaliser avec le génie comique d’un Molière ? Or, si on suit Deleuze, il semble bien que oui et de fait, l’histoire de la philosophie nous présente plus d’un auteur aux dons franchement comiques, tel Platon mettant en scène ses sophistes ridicules, à Nietzsche et ses sorties fracassantes contre la plupart des philosophes avant lui etc. Il est en fait peu d’auteurs qui n’atteigne, dans leurs meilleurs moments, à une certaine puissance comique, du seul fait de dénoncer les insuffisances et les bassesses de l’homme, ce qui a toujours été le moteur du rire. Mais il resterait à éclaircir, en suivant ce que dit Deleuze, le rapport entre la « profonde logique » d’un auteur et son « génie comique ». Comment se fait-il que, du simple fait qu’il soit logique, le propos d’un auteur acquiert une puissance comique ? Autrement dit, pourquoi la vis logica est-elle immédiatement une vis comica ?
La solitude absolue
La publication récente de deux lettres méconnues de Rousseau 1 permet d’apporter des éclaircissements sur les soulevés par le texte Deleuze : à la fois la drôlerie de l’auteur et la cohérence profonde de sa pensée.
La première est une « Lettre à Philopolis » de 1755, qui constitue une réponse assez cinglante à un détracteur, très caractéristique de la manière de Rousseau quand il est piqué dans sa susceptibilité exacerbée. L’objection qui lui est faite porte sur le second Discours : s’il était dans la nature de l’homme de vivre à l’état de nature, pourquoi Dieu l’en aurait-il fait sortir ? Et si au contraire, Dieu a voulu que l’homme vive en société, pourquoi chercher à le faire revenir à la nature, comme semble y inviter Rousseau ?
La réponse de l’auteur ne se fait pas attendre : « Puisque vous prétendez m’attaquer par mon propre système, n’oubliez pas, je vous prie, que, selon moi, la société est naturelle à l’espèce humaine comme la décrépitude à l’individu, et qu’il faut des arts, des lois, des gouvernements aux peuples comme il faut des béquilles aux vieillards […] L’état de société ayant donc un terme extrême auquel les hommes sont les maîtres d’arriver plus tôt ou plus tard, il n’est pas inutile de leur montrer le danger d’aller si vite, et les misères d’une condition qu’ils prennent pour la perfection de leur espèce » 2.
Rousseau joue sur la métaphore du vieillissement : il était inévitable que l’homme finisse par sortir de l’état de nature, mais les circonstances de cette sortie étaient contingentes. Et en l’état, pour Rousseau, l’homme est comme prématurément vieilli. Comme il ne peut être question de revenir en arrière, il faut des lois pour corriger cette évolution précipitée. Il n’était donc pas contre-nature de voir l’homme s’arracher à sa condition naturelle, et la politique n’a que pour but de réparer les excès de circonstances contingentes, pas d’aller contre la nature même de l’homme.
La seconde lettre est un éloge de la vertu. Rousseau veut la trouver sans passer par une méthode déductive a priori, mais en lui-même et en lui seul, afin d’éviter de se perdre dans les incertitudes des métaphysiciens. « En sondant mes inclinations naturelles, j’ose penser qu’elles sont droites, je crois trouver dans mes désirs l’image de l’homme de bien, et ne puis mieux vous ce qu’il est qu’en vous disant ce que je voudrais être. Je voudrais donc avoir une âme forte pour faire toujours ce qui est juste, et sensible pour aimer toujours ce qui est beau […] » 3. Rousseau montre ensuite que ce désir d’excellence et de courage porte naturellement l’individu vers les autres et qu’elle doit servir de fondement à la société : « Il me semble premièrement que tout ce qu’il y a de moral en moi-même a toujours ses relations hors de moi ; que je n’aurais ni vice ni vertu si j’avais toujours vécu seul, et que je serais bon seulement de cette bonté absolue qui fait qu’une chose est ce qu’elle doit être par sa nature. Je sens aussi que j’ai maintenant perdu cette bonté naturelle, par l’effet d’une multitude de rapports artificiels, qui sont l’ouvrage de la société […] » 4.
Il est remarquable que Rousseau n’oppose pas strictement la bonté de la nature au vice de la société car, dans ce cas, il n’y aurait qu’à, comme y invitait ironiquement Voltaire, retourner brouter de l’herbe et marcher à quatre pattes. Mais à vrai dire, Rousseau ne confond pas la vertu avec cette bonté naturelle qui est dite « absolue » : ici, le terme s’oppose bien à relatif, mais signifie d’abord seule ; libre, mais sans relation, donc libre par simple privation de liens. La bonté absolue est la disposition saine de l’homme solitaire. Mais il est manifeste que Rousseau voit la vraie vertu dans le rapport avec les autres, de sorte que la bonté absolue des origines est bien inférieure à la bonté relative en société 5. L’individu avant la société vit seul, libre de toutes contraintes. Il est dans un état de liberté et de solitude « absolues ». Il est totalement indépendant, mais ne jouit pas d’une pleine et entière liberté, seulement d’une absence de contraintes extérieures. La liberté réelle ne peut être atteinte qu’en société, grâce à la loi positive. L’homme ne peut regretter sa liberté originelle que lorsqu’il se trouve dans une société corrompue, dont il subit les contraintes sans y trouver les conditions d’accomplissement de sa nature.
Ce qui est donc à déplorer n’est pas la perte de la bonté originelle, c’est de n’avoir pas pu trouver une société où celle-ci pourrait véritablement être mise en oeuvre au service des autres, car ce n’est pas être pleinement vertueux que de l’être pour soi seul.
Cette « Lettre sur la vertu » est comme le chaînon manquant entre l’Émile (l’éducation de l’individu privé) et le Contrat social (la constitution du citoyen), alors même qu’elle précède ces deux grands ouvrages. En donnant un fondement éthique à la politique, elle atteste donc du caractère tout à fait cohérent de la pensée de Rousseau, tel que le rappelle Deleuze. De plus, comme on le voit, elle lève plusieurs objections faites contre sa vision de l’homme à l’état de nature et sa proverbiale misanthropie.
Maxence Caron [Voir son article en ligne « [Rousseau sans siècle ».[/efn_note] a insisté sur cette solitude première de l’homme à l’état de nature, pour insister sur sa dimension anarchique et même anarchiste, comme pour suggérer que l’individu peut retrouver cette solitude première, qui est simple absence d’obéissance aux lois, dans un anarchisme qui le placerait au-dessus, ou plutôt à part, des hommes en société. Mais se faisant, il tire Rousseau vers un pessimisme radical quant à la nature humaine et un piétisme non moins radical en matière de religion : la politique est alors impossible, le contrat social est une pure utopie. « L’on retiendra que de cette religion personnelle que Rousseau ne détache pas du christianisme, le rôle est limpide : réconcilier l’homme avec lui-même afin que dans la solitude il puisse écouter avec sérénité la bienveillance de son Créateur lui parler au fond de sa conscience, réconcilier l’homme avec lui-même puisque jamais aucun ordre humain ne le pourra faire. La théologie de Rousseau invalide la portée politique que l’on voulût donner au Contrat social ; elle en souligne le caractère poétique, la primordiale absence d’ambition théorique au profit d’une perspective théorétique ». Il ne reste que le mépris dans le rapport aux autres, Dieu et la musique dans le rapport à soi. En somme, une misanthropie supérieure, spirituelle et solitaire. Néanmoins, cette lettre sur la vertu contredit ce jugement ; elle nous montre un Rousseau qui n’a pas désespéré ni de son désir de vertu, ni de l’intérêt de la société, ni donc de son désir de vivre parmi les autres hommes.
Logique et comique
Cyril Morana, qui réédite ces deux lettres, note que « [c]ontre toutes les lectures fautives de son oeuvre, Rousseau fait une véritable apologie de la vie sociale : certes des abus s’y font jour, mais ce que l’humanité gagne en organisant harmonieusement les rapports des citoyens surpasse infiniment ce qui peut avoir été perdu dans l’existence sociale » 6. Il ne manquerait dans les notes de cette édition que de souligner l’humour ravageur de Jean-Jacques, qui en donne ici une expression éclatante. Plus il est incompris, plus on le dénigre, plus il se sent seul et aux abois, considéré comme un sauvage par les penseurs civilisés, meilleur il est dans la contre-attaque. Son style n’est jamais aussi incisif que lorsqu’il sent qu’il a tout perdu et qu’il ne peut compter que sur lui-même pour se défendre… Il pourrait chanter « je suis le mal aimé » s’il était dans son caractère de se laisser aller à l’apitoiement. Mais au contraire, il mord et attaque d’autant plus férocement qu’on l’a blessé en trahissant ses propos. Dans la suite du cours cité plus haut, Deleuze met en évidence une filiation entre l’humour de Rousseau et l’humour de Céline. Ceux qui trouveraient ce rapprochement incongru, ou inconvenant, pourront se convaincre qu’il est tout à fait pertinent, tant la drôlerie du philosophe genevois mal-aimé a quelque chose d’énorme, d’irrésistible. Par exemple, à son interlocuteur Philopolis qui, plein de « bon sens », lui réplique qu’il n’y a pas lieu de se plaindre et que tout va donc bien, Rousseau rétorque : « Pourquoi faire appeler un médecin quand vous avez la fièvre ? que savez-vous si le bien du plus grand nombre que vous ne connaissez pas n’exige point que vous ayez le transport, et si la santé des habitants de Saturne ou Sirius ne souffrirait point du rétablissement de la vôtre ? […] Enfin, si tout est bien comme il est, il est bon qu’il y ait des Lapons, des Esquimaux, des Algonquins, des Chicachas, des Caraïbes, qui se passent de notre police, des Hottentots qui s’en moquent, et un Genevois qui les approuve. Leibniz lui-même conviendrait de ceci » 7.
A ce sujet, il est remarquable, mais un peu regrettable, que Jankélévitch qui a si abondamment étudié l’ironie 8, montrant dans des analyses virtuoses, subtiles et assez étourdissantes, toute la métaphysique dont elle dépend, n’ait qu’à peine évoqué l’humour, sinon dans les toutes dernières lignes de son livre, comme s’il y avait là quelque chose de trop simple, de trop franc, de trop fort, pour en parler sans être emporté dans un grand éclat de rire.
Or, il ne peut y avoir d’humour sans pensée ; et même, la logique est intrinsèquement comique en tant qu’elle libère l’esprit du carcan de la bêtise et qu’elle tire toutes les conséquences d’une idée et ne la lâche pas avant d’en montrer toute la portée. A l’inverse, et c’est logique !, les penseurs qui renoncent à la logique au nom de la « profondeur » se vouent à l’irrationnel et à l’inconsistance, raison pour laquelle ils sont aussi prétentieux dans leurs intentions qu’ennuyeux dans leurs oeuvres.
Ces deux lettres méritent donc d’être découvertes comme des portes d’entrée dans la philosophie rousseauiste. Dans ces deux lettres, pourtant courtes, Rousseau fait le point très clairement sur les prétendues insuffisances de sa doctrine. Et il est capable de faire pouffer son lecteur, et même de le secouer de rire. Or, c’est une puissance redoutable de savoir déclencher une hilarité irresistible, quand même bien et surtout tout semble perdu :
« Voilà, Monsieur, mes réponses. Remarquez au reste que, dans cette affaire comme dans celle du premier Discours, je suis toujours le monstre qui soutient que l’homme est naturellement bon, et que mes adversaires sont toujours les honnêtes gens qui, à l’édification publique, s’efforcent de prouver que la nature n’a fait que des scélérats » 9.
- Jean-Jacques Rousseau, Deux lettres sur l’individu, la société et la vertu, Mille et une Nuits, 2012, édité par Cyril Morana. Sauf précision contraire, les références dans cet article renvoient à ce livre.
- Page 11.
- Page 25.
- Page 26.
- Je remercie Roland Échinard de m’avoir fait découvrir ce texte et d’avoir signalé ce sens particulier d’« absolu ».
- Page 44.
- Page 16. Je pense aussi à certains passages des Lettres écrites sur la montagne, où Jean-Jacques, perché sur ses sommets hautains, est d’une drôlerie extraordinaire quand il décrit le conformisme et la petitesse du procureur de Genève, auteur de Lettres écrites de la campagne écrites dans le but de chasser le turbulent et immoral philosophe de la bonne ville de Genève. Rousseau n’est pas loin, dans ces lettres, de se prendre pour un Jésus-Christ voué aux crachats de la foule, mais cette mégalomanie latente est toujours contrebalancée par la drôlerie irrésistible du propos. On s’amuse donc plus qu’en lisant le Sermon sur la montagne…
- Vladimir Jankélévitch, L’ironie, réed. 2011, Flammarion, Champs essais.
- Page 20.








