L’esprit nominaliste de l’époque contemporaine
Ils se font aujourd’hui plutôt rares, ces philosophes qui osent prendre publiquement la défense de la tradition philosophique et de la métaphysique ! Jean Grondin fait bien partie de ces rares voix courageuses. Philosophe à l’Université de Montréal, spécialiste reconnu de la pensée herméneutique et plus spécialement de l’œuvre de Hans-Georg Gadamer, Grondin nous donne à lire, à travers les pages de son dernier livre intitulé La beauté de la métaphysique1, un plaidoyer vibrant et fondé en faveur de la métaphysique, mais également de la morale, quoique ce second aspect ne soit que seulement évoqué le temps de quelques lignes, peut-être annonciatrices, qui sait ?, d’une future Bonté de la morale.
Le philosophe part du constat, qu’il prononce à plusieurs reprises, d’une crise de la métaphysique : il est en effet de bon ton, par les temps qui courent, de se démarquer de la tradition philosophique, ou de cette tradition philosophique, à laquelle bien des maux sont reprochés. On l’accuse d’être trop universelle et d’écraser injustement voire d’opprimer les autres pensées ; on l’accable également en raison de son abstraction éthérée. Bref, comme le dit notre auteur, « [notre] époque […] se repaît de réquisitoires contre la métaphysique, prompts à la clouer au pilori au nom d’une meilleure philosophie […] » (p. 97).
Mais quelles sont alors ces autres philosophies qu’il conviendrait de privilégier ? Il s’agit tout d’abord de l’utilitarisme, c’est-à-dire de la production de connaissances utiles, actionnables, prêtes à être déployées sitôt arrivés sur le marché du travail. C’est donc à juste titre que Jean Grondin dénonce « l’utilitarisme ambiant et assourdissant » (p. 12) ainsi que « la recherche d’un savoir qui serait dépourvu d’assises métaphysiques » (p. 78) qui étouffent dans l’œuf l’effort de compréhension du monde, de son ordre et de son sens. Mais le philosophe décèle une autre source de contestation de la métaphysique dans le relativisme postmoderne : qu’il s’agisse des héritiers de l’herméneutique, comme Richard Rorty ou Gianni Vattimo, ou des tenants de la déconstruction, tel Jacques Derrida, tous refusent obstinément la notion d’essence comme vecteur d’appréhension rationnelle du monde. Jugée trop prétentieuse, trop ambitieuse, la métaphysique fait alors place à l’interprétation du texte coupée du sens des choses.
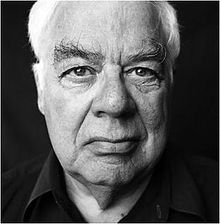
Jean Grondin identifie la racine commune de l’utilitarisme, du relativisme et de la déconstruction dans le triomphe du nominalisme : cette étiologie est pour le philosophe si importante qu’elle parcourt le livre de son début à sa fin, comme en témoignent les nombreuses occurrences du terme (pp. 15, 17, 85, 137). En effet, pour le philosophe, « on peut dire du nominalisme qu’il est devenu l’horizon métaphysique indépassable de notre temps » (p. 17) : cela signifie que seules les réalités individuelles et matérielles possèdent quelque consistance ontologique, tout concept générique n’étant finalement qu’une commodité ou une convention de dénomination à laquelle il ne faut sous aucun prétexte prêter corps. C’est la raison pour laquelle, comme le note encore Jean Grondin, le nominalisme s’oppose directement au platonisme qui marqua durablement de son empreinte la métaphysique.
Le philosophe se refuse toutefois à rendre les armes : il estime ainsi qu’aujourd’hui encore « il est possible de redécouvrir [l’expérience de la métaphysique] » (p. 51) ; mais, sous la plume de Jean Grondin, cette possibilité se transforme assez rapidement en nécessité, tant « la métaphysique, avec toute sa riche histoire, représente le bienfait le plus précieux de l’histoire de l’humanité » (p. 44). D’où la ligne générale de l’ouvrage qui mêle deux types d’arguments étroitement liés : d’une part, la mise en évidence des postulats généraux de la métaphysique ; d’autre part, leur commune origine dans le terreau grec, tant platonicien qu’aristotélicien.
La restauration des trois piliers de la métaphysique
Dès le premier chapitre, Jean Grondin s’attache à décrire ce qu’il nomme les « trois piliers de la métaphysique », ce que nous pourrions appeler ses « invariants », puisque nous les retrouvons d’un bout à l’autre de l’histoire de la philosophie, malgré les coups de butoir du nominalisme. Trois plans sont ainsi articulés : l’ontologique, le théologique et l’anthropologique : « La métaphysique est l’effort vigilant de la pensée humaine de comprendre l’ensemble de la réalité et ses raisons. Sa visée peut se focaliser tantôt sur le réel dans son ensemble, elle prend alors un tour ontologique, tantôt sur le principe ou sur les raisons du réel, elle devient alors plus théologique, tantôt sur celui qui s’efforce d’entendre le réel, ce qui lui procure une assise anthropologique. Toute métaphysique engage ainsi une ontologie, une certaine « théologie » et une anthropologie » (p. 21). Examinons tour à tour ces trois piliers.
Le premier, de facture ontologique, énonce que « le monde est habité de quelque sens » (p. 24). Nous autres postmodernes tendons à croire que le sens, si sens il y a, ne serait que le fruit d’une subjectivité ou d’une inter-subjectivité : bref une construction psycho-sociologique, une convention, qui, soumise à la loi de l’historicité, se trouve évidemment en constante évolution selon les modes et les rapports de domination. De telle sorte qu’il n’existerait rien de tel qu’un sens absolu et étranger aux représentations des acteurs sociaux et historiques. La métaphysique, quant à elle, prend l’exact contrepied de ces thèses : les choses qui constituent le monde regorgent de sens car « nous pouvons y observer une régularité, une cohérence, une permanence, une légalité, une finalité, en un mot, une rationalité » (p. 24). Contrairement à une idée reçue, Platon n’a pas réservé le sens, c’est-à-dire la Vérité, au lieu intelligible : c’est parce que le monde sensible nous donne à voir, dans son spectacle cosmique, la rationalité de l’être que nous pouvons déceler la permanence derrière la brièveté et la stabilité au-delà du mouvement apparent.
De surcroît, le sens du monde se donne à voir dans les formes et les contours des choses qui le peuplent : le mot grec eidos, qui se trouve à l’origine directe de notre moderne « idée », désigne précisément « l’aspect général des choses, leur type, qui nous permet de les distinguer les unes des autres » (p. 27). C’est la raison pour laquelle le sens de la vue (eidô, voir) revêt une si grande importance pour les Grecs : le monde est une scène, un théâtre, qui ne peut que s’appréhender par la vue, tout d’abord par les yeux du corps qui captent les apparences du lieu sensible, puis par les yeux de l’âme qui contemplent les vérités intelligibles. Et Jean Grondin de préciser qu’eidos signifie également « beauté » : comme si, pour les Grecs, forme et beauté ne pouvaient être dissociées, ainsi que le laisse entendre le mot cosmos qui renvoie à la fois à l’ordre et à son éclat.
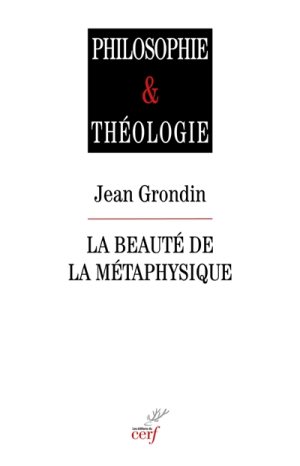
Le deuxième pilier que Jean Grondin prend le temps de présenter a trait à la structure théologique de la métaphysique, à savoir que « le sens du monde renvoie à un principe ultime » (p. 30). Qu’il s’agisse du Souverain Bien, du Premier Moteur, de l’Un, de Dieu et même du Hasard, les philosophes ne cessent, au fond, de chercher la clef de voûte du réel : il doit bien y avoir quelque chose ou quelqu’un que l’on peut tenir pour responsable du sens du monde, ne serait-ce qu’en vertu du résultat logique de la régression à l’infini qui nécessite que l’on mette un terme à la chaîne des « pourquoi ? » pour poser une Origine, un point de départ anhypothétique et par conséquent postulé, à partir duquel la construction d’un système philosophique devient possible.
En somme, la nécessité observée dans le cours du monde témoigne de la présence d’un principe organisateur et supérieur, vers lequel l’homme tend sans toutefois pouvoir appréhender et maîtriser une telle majesté : « Eu égard à la raison ultime, l’attitude la plus prudente consiste sans doute à dire que c’est un principe auquel nous comprenons peu de choses et qu’il dépasse nos capacités d’intellection » (p. 33). Néanmoins, cette conscience des limites et de la finitude n’empêche pas les philosophes de spéculer sur la nature et les propriétés de ce principe, à l’image d’Aristote, cité par Jean Grondin, qui conçoit le Premier Moteur comme une pensée de pensée.
Reste enfin à examiner le dernier pilier de la métaphysique, sa dimension proprement anthropologique, que le philosophe exprime de la manière suivante : « l’homme peut par sa raison comprendre quelque chose à l’ordre du monde et y introduire du sens » (p. 35). C’est certainement ici que l’influence de l’herméneutique se fait la plus claire : pour le formuler en termes heideggériens, le Dasein est au monde dans un rapport de précompréhension de l’être, si bien que la tâche du philosophe consiste à expliciter cette entente implicite et première, à déployer ce cercle herméneutique dans l’horizon du logos.
Cependant, Jean Grondin note que l’herméneutique moderne voire contemporaine, loin de se trouver en rupture avec la tradition métaphysique, en reprend le projet tout en le renouvelant : « la tradition a volontiers parlé d’esprit, de conscience ou de raison pour exprimer cette spécificité humaine, mais la philosophie plus récente, d’inspiration herméneutique, situe cette distinction dans la capacité langagière de l’homme qui l’habiliterait à dire le sens du monde, à le comprendre et à en infléchir le sens » (p. 37). En d’autres termes, l’homme capte le sens des choses par la raison théorique, tandis qu’il introduit le sens dans le monde en vertu de sa raison pratique.
L’esprit grec de la beauté
Il est désormais temps de venir au cœur du message de Jean Grondin : à cette beauté de la métaphysique, qui donne à l’ouvrage son titre. Si la métaphysique postule un sens des choses, l’existence d’un principe supérieur et une capacité humaine de compréhension, ainsi que nous venons de le voir, ces trois piliers ne peuvent s’élever qu’en vertu d’une commune « assise » : « Sur quoi reposent les piliers ontologique, théologique et anthropologique de la métaphysique ? Assurément sur quelque sol qui leur permet de se tenir. Ce sol, c’est l’ordre du cosmos et l’expérience que nous pouvons en faire » (p. 45). Que le cosmos désigne à la fois l’ordre et la beauté, et même la beauté ordonnée ou l’ordre beau, est une évidence si l’on se remémore que le terme servait aussi à désigner la parure voire la chevelure des femmes grecques, et qu’il nous en reste, au sein même de l’époque industrielle, une trace étymologique dans nos produits cosmétiques.
En premier lieu, il convient de rappeler que les Grecs, à la différence des Modernes, ne dissocient guère le Beau du Bien : ce qui est beau est bien, et ce qui est bon est beau. Comme l’écrit le philosophe, « la beauté est le rayonnement naturel du bien et son révélateur » (p. 47). Cette identité va de soi : s’il existe un principe supérieur d’organisation du monde, une raison ultime garante de l’ordre des choses, alors les apparences et les formes ne peuvent que reproduire, dans leur éclat, la beauté de cette intelligence. Comment expliquer l’activité contemplative autrement par le caractère désirable de ce qui est contemplé ? Question rhétorique, bien sûr, qui use de l’argument aristotélicien de la cause finale pour établir cette évidence que l’homme se lance dans l’aventure de la contemplation à la manière des phalènes qui tournoient autour de l’ampoule : attiré par la lumière de la beauté du monde.
Il est, en outre, une dimension essentielle de la beauté, héritée du pythagorisme nous semble-t-il : tout en elle est question de mesure, c’est-à-dire de proportion, ou encore, en termes plus mathématiques, d’égalité géométrique. C’est la raison pour laquelle Jean Grondin peut écrire que « l’idée de summetria évoque celle d’harmonie, de proportion, d’heureuse disposition et de commensurabilité, alors que la notion de metriotès laisse entendre que la mesure est ici celle d’un ordre ou d’une excellence (arètè) qui suscite l’admiration » (p. 53). En d’autres termes, la beauté n’est pas dans les choses, mais dans l’équilibre des choses : dans les rapports de rapports (a est à b ce que c est à d) qui fondent l’analogie et, par conséquent, autorisent le passage du sensible à l’intelligible (la contemplation est à l’âme ce que la vue est au corps). La forme pourra ainsi être déclarée belle en raison des relations harmonieuses que ses parties tissent entre elles et avec le tout, mais aussi en vertu de l’équilibre qu’elle entretient avec son milieu. C’est alors que la forme resplendit et qu’elle donne à penser : « Grâce à la beauté, enseigne le Phèdre, on se ressouvient du monde vrai et c’est la raison pour laquelle l’apprentissage de la beauté représente l’une des meilleures initiations à la philosophie » (p. 59).
Conclusion
En conclusion, nous dirons que l’essai de Jean Grondin s’inscrit en faux par rapport à une tradition devenue sinon dominante du moins prégnante en philosophie et, peut-être, plus encore en sciences humaines et sociales : à savoir la dissolution ou la dissémination de la métaphysique dans des jeux d’écriture ou des relations de pouvoir. Un symptôme en est donné par le refus de dresser la généalogie des phénomènes étudiés : soit que l’origine soit dissoute dans des séries discontinues, comme chez Michel Foucault, soit que la dimension de la profondeur – celle du temps ici – soit évacuée au profit de la prolifération plane, horizontale et anarchique, à l’image du rhizome chez Gilles Deleuze. Jean Grondin, contre les séries et les rhizomes, ne renonce guère à l’idée que la métaphysique est et demeure « la science des racines » (p. 77) qui doit servir de socle à l’ensemble du savoir rationnel ; et contre la différance de Jacques Derrida qui jamais n’arrête son mouvement de décentrement, le philosophe n’hésite pas à lier métaphysique et herméneutique pour établir l’étroit et indissociable lien qui unit le désir humain de comprendre et le sens du monde lui-même.








