C’est un véritable petit bijou que les éditions du Seuil viennent de livrer au public français sous la forme d’une Histoire de la philosophie dirigée par Jean-François Pradeau1, laquelle réunit les plus grands spécialistes européens – on notera la présence massive d’universitaires italiens – de l’histoire de la philosophie. Le souci pédagogique ne le cède en rien à la rigueur, et la brièveté des articles permet toutefois de proposer un aperçu des avancées majeures de chacun des auteurs retenus. En outre, le souci constant de rapporter la question philosophique aux avancées scientifiques de chaque époque (savoirs grecs, philosophie naturelle du XVIIIème, physique quantique et neurosciences) fait de cette nouvelle Histoire de la philosophie l’outil le plus performant en langue française, pour qui souhaiterait avoir un panorama de grande qualité et accessible de la pensée européenne.
A : Des explications précieuses pour les novices
La première chose qui marque lorsque l’on parcourt ce livre est l’extraordinaire clarté des explications des concepts majeurs de la philosophie qui y est proposée ; ainsi, cette si redoutable question du monde intelligible, dont il est si difficile de faire comprendre aux élèves de terminale ce qu’il désigne, tant il leur paraît abstrait, reçoit ici une description qui permet de lever les incompréhensions courantes qu’il peut légitimement susciter. « Platon a proposé l’hypothèse de l’existence des réalités intelligibles, à la fois distinctes des choses sensibles et en rapport avec elles. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un geste paradoxal destiné à faire croire qu’il était possible à un petit nombre de privilégiés de se retrancher dans un ailleurs idéal ; elle explique en quoi ce monde, où tout ne cesse de changer, offre néanmoins assez de permanence et de stabilité pour que l’homme puisse en parler et y agir. Convaincu que cette stabilité et cette permanence ne pouvaient se trouver dans le sensible, Platon posa qu’il devait exister une réalité d’une autre sorte qui réponde à ces exigences, et qui explique pourquoi, dans tout ce changement, quelque chose ne change pas. »2 Luc Brisson explique ainsi avec brio que les réalités intelligibles sont d’abord le résultat de quelque chose comme un double constat : d’une part, il y a de la permanence, et d’autre part, le monde sensible est incapable de contenir une telle permanence ; par conséquent, le monde sensible ne saurait contenir ces réalités intelligibles ce qui, en aucun cas, ne signifie l’inexistence de telles réalités, mais qui, bien au contraire, fait signe vers l’existence d’une réalité autre que celle que nous percevons par les sens, dans laquelle la corruption matérielle et temporelle cesserait de mener les êtres au néant.
Je pourrais multiplier à l’envi les exemples de grande clarification des problèmes opérée par ce livre, mais je vais me concentrer sur quelques-unes, afin de donner une idée des avantages que procure cette entreprise ; le cas de Kant est intéressant car il charrie un certain nombre de concepts dont la compréhension n’est guère aisée, et dont la mise en rapport devient souvent franchement incompréhensible ; ainsi en va-t-il pour celui de la représentation et de son rapport à l’objet, qu’Alain Renaut élucide avec talent : abordant la fameuse lettre à Markus Herz, A. Renaut propose d’appeler O1 la représentation de l’objet et O2 la chose en soi ; comment s’organise alors le rapport entre O1 et O2, c’est-à-dire entre la représentation que nous avons de la chose, et la chose elle-même ? « Ce problème de la conscience d’objet présente à son tour deux aspects : celui, d’abord, de la vérité : comment peut-il y avoir accord ou adéquation entre O1 er O2 ? Celui, ensuite de l’en-soi : comment, pour présenter cet accord, penser quelque chose de O1, alors que dès que nous pensons quelque chose de O1 il devient pour nous, et qu’il ne s’agit plus du rapport entre O1 et O2 ? Bref, la question de la vérité ne se pose que parce que, plus fondamentalement, se pose celle de l’en-soi (…). »3 Ce que Renaut montre fort bien, c’est que si l’on préserve l’idée d’une vérité comme adéquation entre la pensée que l’on a de la chose et la chose elle-même, on préserve nécessairement l’idée de la chose en soi, ce qui pose problème car si on pose l’en-soi, on le pose et par conséquent, il est déjà pour nous. Les deux solutions classiques, idéalisme et réalisme, offrent ici une solution insatisfaisante : en supprimant l’en-soi, l’idéalisme rend incompréhensible la passivité du sujet, c’est-à-dire la manière dont le sujet est affecté par les choses dans l’intuition et en vertu de la sensibilité. Le réalisme, quant à lui, rendrait impossible toute théorie de l’objectivité.
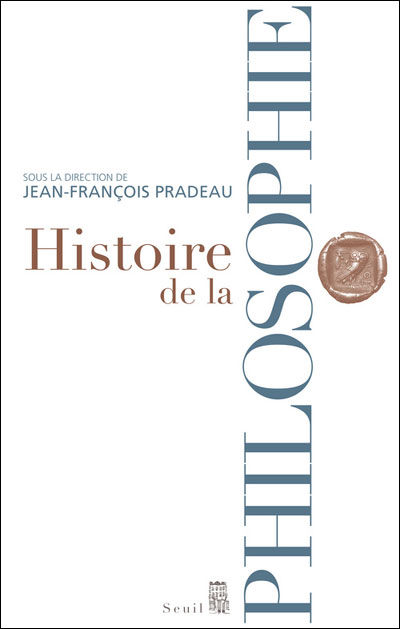
Alain Renaut explique alors, de la plus claire des manières qui soient, que la démarche kantienne consiste dès lors à renoncer à poser le problème comme étant celui du rapport entre O1 er O2. « Dit de façon plus positive, le geste kantien consistera à résoudre le problème de l’objectivité par un retour au sujet : il s’agira d’un mouvement de retour à l’intérieur de la représentation qui consiste à fonder l’objectivité non sur la comparaison de la représentation et de l’en-soi, mais sur la distinction à l’intérieur de la représentation – à l’intérieur de la subjectivité – des représentations subjectives (particulières) et des représentations objectives (universelles, c’est-à-dire intersubjectives). » 4 On voit ici ce que la démarche kantienne a de réellement novateur : l’objectivité n’est plus définie par une quelconque transcendance en soi mais bien plutôt par ce qui, au sein de tout sujet, est universellement valable. Cette inflexion kantienne du regard philosophique reçoit, grâce à Alain Renaut, un éclairage tout à fait remarquable.
B : Quelques mises au point salutaires
Si cette Histoire de la philosophie offre au novice un panorama très clair de la philosophie occidentale, elle permet également à ceux qui ont déjà été en contact avec les textes de briser certains malentendus, nés de lectures parfois dominantes d’un auteur, occultant les véritables paroles de ce dernier. Dans cette optique, l’article de Jean-François Kervégan consacré à Hegel s’avère fort précieux ; d’une part, il dissipe un malentendu – d’ailleurs présent chez bon nombre de professeurs de philosophie eux-mêmes, et pas seulement chez les élèves – consistant à croire que Hegel serait ce penseur figé d’une dialectique en trois temps, que sont la thèse, l’antithèse et la synthèse. Bien évidemment, ce n’est pas ainsi que les choses se passent chez Hegel et s’il est bon de l’apprendre aux novices en philosophie, il est aussi bon de le rappeler à ceux qui, pétris d’une lecture deleuzienne de Hegel à défaut d’avoir lu ce dernier dans le texte, croient pouvoir ricaner de la dialectique en pensant y voir ce mouvement mécanique – voire automatique – de la pensée, qui ne ferait que reproduire sans fin ce geste sans âme. Contre cette croyance fausse, donc, Kervégan rétablit la vérité du texte hégélien : « Ce schéma « thèse-antithèse-synthèse » induit en effet une vision erronée de la dialectique. Ce terme ne désigne chez Hegel qu’un moment, sans doute capital, du procès logique : le moment médian, qui est le « principal moteur du concept » et qui se dédouble lui-même (négation première ; négation de la négation). Ce moment négativement rationnel a vocation à être nié, ou plutôt à se nier en portant au jour le moment positivement rationnel, spéculatif en lequel il se dépasse. »5 Premier point, donc, où s’opère bien souvent la confusion : le mélange de la dialectique avec l’un de ses moments. Mais ce n’est pas tout ; le schéma abstrait de la thèse-antithèse-synthèse n’est en rien hégélien, mais bien kantien, comme nous le rappelle Kervégan : « C’est chez Kant que Hegel repère « le schéma – il est vrai dénué d’esprit – de la triplicité » ; c’est lui qui « a affirmé partout la thèse, l’antithèse et la synthèse ». Hegel juge pour sa part que ce n’est là que « le côté superficiel, extérieur, de la manière du connaître » (…). »6
De manière générale, Kervégan dissipe six erreurs couramment commises sur Hegel : d’une part la pseudo-justification conceptuelle qu’il apporterait à ce qui est selon la fameuse formule du « ce qui est rationnel est réel, ce qui est réel est rationnel », formule mal traduite, et surtout mésinterprétée à l’envi, afin de faire coller à Hegel soit l’étiquette infamante du réactionnaire, soit celle du penseur préfigurant le totalitarisme (Popper). Se trouve ensuite dissipée la mésinterprétation consacrée à la dialectique, puis celle que commet Kojève en faisant de la dialectique de la maîtrise et de la servitude la matrice de toute la pensée hégélienne : « La « dialectique du maître et de l’esclave » décrit sans doute l’origine proto-historique de la société ; elle n’indique ni le principe rationnel du rapport politique de subordination, ni le mode de constitution de l’humanité, en tout cas en son entier ; car celle-ci, pour Hegel, engage toute la sphère de l’esprit, y compris l’esprit absolu. »7 Kervégan pointe ensuite les assimilation excessives entre le système hégélien et l’Etat prussien, les critiques mal informées contre l’hyperrationalisme hégélien à partir de la ruse de la raison et la supposée « fin de l’histoire ».
De la même manière, l’article de Giuliano Campioni consacré à Nietzsche tord le cou aux approches approximatives de Nietzsche faisant de ce dernier un irrationaliste convaincu, brisant tout ce qui ressemblerait de près ou de loin à une argumentation rationnelle ou scientifique. Expliquant fort bien que ce contre quoi lutte Nietzsche est d’abord l’illusion de données naturelles et originelles, Campioni utilise à dessein un vocabulaire précis, lui faisant écrire que pour Nietzsche, « l’éternel retour est la plus scientifique8 des hypothèses. »[/efn_note] En outre, et citant Goethe, Campioni prend le soin de dissiper les illusions d’un Nietzsche chaotique, se complaisant dans les brumes d’un chaos qu’il s’agirait de recréer en permanence : tout au contraire, ce que Nietzsche promeut est « l’homme le plus développé possible, mais pas chaotique pour autant »9 Cette Histoire de la philosophie ne saurait donc être réduite au statut d’une simple initiation : elle joue également un rôle, en vertu de la grande compétence des auteurs retenus, de correction des lectures, afin de passer d’une histoire de la philosophie fantasmée à une histoire raisonnée de cette même philosophie.
C : Quelques regrets
Si la qualité des articles proposés est bien excellente, il n’en demeure pas moins que certains choix éditoriaux demeurent surprenants et frustrants : nous ne trouvons ainsi rien sur Maître Eckhart, pratiquement rien sur Nicolas de Cues ; plus proche de nous, Hermann Cohen et Cassirer sont passés sous silence, ainsi que Jankélévitch, tandis que Derrida fait l’objet d’une petite page bien pauvre, en conclusion d’un article consacré à Heidegger. Levinas, quant à lui, est juste cité. On notera également la très grande pauvreté des articles consacrés à la philosophie anglo-saxonne : pas un mot sur John Searle, pratiquement rien sur Quine, rien ou presque sur Denett ou Davidson…
En revanche, certains auteurs mineurs reçoivent un traitement qui paraît, au regard des absents, disproportionné : Deleuze a droit à onze pages – songeons que Thomas d’Aquin n’en a que cinq … –, Habermas en compte plus de dix, sans compter ses nombreuses occurrences tout au long de l’ouvrage. La philosophie politique, quant à elle, n’est pas vraiment à l’honneur : Aron n’a droit qu’à trois maigres occurrences, Hayek une seule, Marx lui-même ne fait pas l’objet d’un article qui lui serait consacré, tandis que Montesquieu obtient péniblement trois petites pages au sein d’un article qui ne lui est pas dédié. Cette pauvreté du politique au sein de cette Histoire de la philosophie est d’autant plus surprenante que la préface rédigée par Pradeau indiquait les deux voies de la philosophie en ces termes : « La philosophie n’a pas toujours dit la même chose, certes, mais elle parle toujours de la même chose : de la réalité et de la connaissance que nous pouvons en avoir ; du sens de notre existence et de la manière dont nous pouvons la conduire. »10 Or, et ce n’est pas un antiquisant qui me contredira, le politique et la cité constituent certainement une des voies royales pour bien conduire son existence ; la réflexion politique aurait donc fort logiquement dû recevoir un traitement conforme à cette préface programmatique, ce qui est hélas loin d’être le cas.
Nonobstant ce choix parfois stupéfiant – comment peut-on consacrer deux fois plus de place à un auteur aussi circonstanciel que Deleuze qu’à Thomas d’Aquin ! –, et ce déficit de philosophie politique, cette Histoire de la philosophie constitue un outil de découverte – et de travail – précieux, et gageons qu’elle deviendra rapidement le texte de référence pour qui voudra appréhender l’histoire de la philosophie avec pédagogie et rigueur.








