La note des éditrices, Pascale-Anne Brault et Peggy Kamuf, qui ouvre cette édition du Séminaire consacré à la vie la mort[1], apporte un certain nombre d’indications qui replacent le séminaire de Derrida dans son contexte et met en valeur certains intérêts de sa publication. Ce texte est contemporain de la naissance du GREPH (Groupe de recherche sur l’enseignement philosophique, dont Jacques Derrida fut le principal animateur et qui aboutit en 1979 à la tenue des Etats généraux de la philosophie. Cette indication est à mettre en rapport avec la visée explicite de faire de son séminaire un contre-modèle de ce que la GREPH se proposait d’attaquer[2]. Le texte du séminaire, conformément aux habitudes de Derrida, est entièrement rédigé, et est ensuite lu et commenté devant son auditoire. De plus, le texte de ce séminaire est à l’origine d’autres textes publiés par J. Derrida : c’est le cas de la deuxième séance reprise sans grand changement dans Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre (Paris, Galilée, 1984), de la huitième séance et d’une partie de la neuvième dans une conférence publiée en anglais et en allemand (« Guter Wille zur Macht II. Die Unterschriften interpretieren (nietzsche/Heidegger), dans Text und Interpretation, Philippe Forget (éd.), Munich, W. Fink, 1984 et « Interpreting Signatures (Nietzsche/ Heidegger : Two Questions) » dans Philosophy and Literature, vol. 10, n°2, octobre, 1986). C’est surtout le cas des quatre dernières séances du séminaire qu’on trouve dans La Carte postale. De Socrate à Freud et au-delà (Aubier-Flammarion, 1980). C’est donc par des considérations génétiques qu’apparait d’abord intéressante la publication de ce séminaire. Mais c’est également – et surtout – parce qu’il déconstruit le discours de grands biologistes, en particulier à propos de la génétique, que la publication de ce séminaire importe : J. Derrida montre ainsi comment ces discours déploient sans les interroger les notions de texte, de programme, de langage etc.
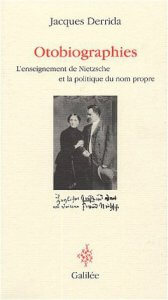
Position du problème
Dans la première séance, intitulée « programmes », Derrida commence par justifier du titre qu’il donne à son séminaire, démarqué du programme de l’agrégation de cette année (la vie et la mort), « la vie la mort ». En ôtant le « et » qu’il soit de juxtaposition ou d’opposition, Derrida dit vouloir montrer que la différence de ces notions que sont la vie et la mort n’est pas philosophiquement de l’ordre de « l’opposition », et que, sous cette condition, la vie et la mort étaient dès lors soustraites au processus dialectique par lequel l’opposition de deux opposés se transforme – exemplairement chez Hegel (que vise et cite Derrida) – « en identification relevant l’un dans l’autre »[3]. Autrement dit, dire « la vie la mort », c’est exclure ces notions du système de pensée dans lequel ces deux notions seraient à penser l’une en regard ou à partir de l’autre et de leur quasi réconciliation. La vie n’est pas d’abord, ou pas seulement l’autre de la mort et vice-versa.
Derrida prend également soin de démarquer ses propos de l’ontologi[sm]e de la tradition philosophique. Il évoque l’équivalence qui transparaît entre la vie et l’être. Il illustre cette position par un passage de Hegel : « Seule l’idée absolue est l’être (Sein), vie impérissable (unvergängliches Leben), la vérité qui se sait et est toute vérité »[4] qu’il commente en expliquant qu’alors « l’être est vie, la mort est impensable comme quelque chose qui soit (…) La vie est cette réappropriation de l’être, elle est l’être : seule l’idée absolue est l’être, seule elle est vie impérissable (non-mort) »[5]. J. Derrida relève également un fragment de Nietzsche cité par Heidegger associant vie et être : « « l’être » – nous ‘en avons d’autre représentation que « vivre » ». Comme le commente Derrida, « Si dans l’étymologie « métaphorique » du mot « être », il y a quelque chose qui veut dire vivre, si être égale vivre, être-mort est impensable »[6]. Il y aurait quelque chose d’irreprésentable dans la mort, si pour Nietzsche nous ne pouvons pas nous faire d’image de l’être que sous la forme de la vie[7]. Nietzsche et Hegel semblent s’opposer puisque le premier envisage la mort comme représentable, à la différence du second. Sortant de cette alternative qui semble la seule possible : soit penser la mort comme autre de la vie, soit, si l’être ne peut se donner que la vie comme représentation, ne pas pouvoir penser la mort. Dès lors, soit on ne peut pas penser la mort, puisque rien ne peut rien dire hors de la représentation et de la logique qui en est tributaire, soit on essaie de penser la mort au-delà de la représentation, « le mort devenant alors à son tour le nom générique pour tout ce qui excède, déborde, transgresse les limites du dicible, de l’énonçable »[8], comme si nous ne pouvions pas penser la mort parce que rigoureusement nous ne pouvions la dire.

Reprenant le terme de « programme », celui de sa leçon, J. Derrida marque qu’il est également un terme dont se sert la biologie contemporaine, et, en particulier, est le titre de l’introduction du livre de François Jacob La Logique du vivant[9]. Le programme est pensé par F. Jacob comme ce qui lève les antinomies jusqu’alors indépassables entre la volonté dans les sciences du vivant d’expliquer par des causes sans recourir au finalisme (c’est un critère de scientificité) et la nécessité de recourir au finalisme, sous un nom ou une forme qui ne s’avouait pas comme tel. J. Derrida caractérise la situation de double blind, d’injonctions contradictoires que la notion de programme permettrait de résoudre. Le programme ainsi conçu rendrait compte à la fois de « la finalité de chaque organisme et de la non-finalité des organismes, de l’histoire des organismes »[10]. L’hérédité, remarque Derrida, se décrit en termes d’information, de message, de code, termes qui semblent empruntés à la communication sémiotique et linguistique. Ce que remarque Derrida lisant F. Jacob, c’est l’analogie qu’il introduit entre deux logiques ou deux systèmes : de même que la mémoire dans l’esprit accumule et transmet une information, de même agit la mémoire génétique. Et J. Derrida commence par questionner cette analogie : « cette analogie une fois admise sans question sur ce qu’est un logos, un message et un code déterminés à partir de leur code sémiotique, on peut se demander s’il suffit d’en faire disparaître le sujet, ce que Jacob appelle ici « l’intention d’une Psyché », formule qui caricature toutes les providences théologiques traditionnelles, pour échapper à tout ce que les valeurs de message, de traduction, de dessein, de but importent du système du logos, du logocentrisme traditionnel »[11]. Autrement dit, quel impensé est charrié par les termes de code, message, etc., pris à la sémiotique, et transposé à la génétique ? Dans sens peut-on parler d’un code, par exemple, ou d’un message, sans tenir compte de la question d’un sujet à l’origine de ce message ? Comment parler d’un « programme finalisé mais dont les sujets sont des effets et non des auteurs, programme dont le dessein n’est pas structurellement délibéré, conscient et intentionnel »[12] ? Qu’est-ce qui resterait dans un tel programme du programme tel que le conçoit un sujet ? Dans un programme sans programmateur conscient, comme l’est le programme génétique tel que le conçoit F. Jacob[13] ?

Biographique et biologique
Derrida réfléchit sur le bio-graphique et le bio-logique, et repense la relation entre la biographie d’un philosophe et sa pensée, à partir de l’exemple de Nietzsche : « la biographie d’un philosophe ne peut plus être considérée aujourd’hui ni comme un accident empirique laissant son nom et sa signature dans le simple dehors du système offert à une simple lecture philosophique immanent, moyennant quoi on peut ensuite écrire des vies de philosophes dans le style ornemental et traditionnel », ni comme « des psycho-biographies rendant compte de la genèse du système selon des mécanismes empiriques (de type psychologiste (même si elle est teintée de psychanalyse), historiciste, sociologiste, etc.) »[14]. Aussi faut-il renouveler le questionnement autour de la signature et du nom propre[15]. En effet, la question de la vie d’un philosophe et de son rapport avec sa pensée est fondamentale : on ne peut pas faire totalement délier les idées du philosophe, son système de son existence, sauf à considérer qu’il n’engage à rien. On ne peut pas non plus faire de la vie du philosophe ou de sa pensée le résultat de causes, conscientes ou non, qui le détermineraient de l’extérieur. De là, J. Derrida corse encore le problème en remarquant qu’une des difficultés pour saisir la vie, le bio du biographique, tient au fait que tout sujet vivant est déjà engagé dans la vie, donc ne peut pas étudier de l’extérieur, objectivement, la vie, dont la sienne est une modalité.
Pour approfondir ses analyses J. Derrida dit devoir se référer à Nietzsche, seul philosophe avec Kierkegaard, à inscrire sa philosophie dans sa vie, ou à le revendiquer[16]. Aussi convient-il de lire Nietzsche à partir du geste par lequel il met son corps et son en avant et qu’on trouve dans la préface à Ecce Homo[17] dans laquelle il explique que sa propre identité n’est pas réductible avec ce que ses contemporains connaissent sous son nom, son état civil pourrait-on dire, mais qu’elle vient d’un contrat qu’il a passé avec lui-même et « par lequel il s’est endetté lui-même auprès de lui-même »[18]. En effet, pour savoir qui il est, Nietzsche ne se fie pas à « quelque assurance sur l’identité et à ce que nous croyons savoir d’un nom propre »[19] mais à un savoir qu’il tient des expériences qu’il a vécues relativement à la psychologie des grands noms de la philosophie. Autrement dit, on ne peut pas penser le nom de Nietzsche disjoint de la pensée de l’Eternel retour. Par ailleurs, Nietzsche écrit dans Ecce Homo : « Je suis en tant que mon père déjà mort, en tant que ma mère, je vis encore et deviens vieux, ou vieille »[20]. Par-là est donné à voir que la bio-graphie est « allo-biographique ou thanato-biographique », et non donc réductible à une donnée factuelle et civile.
Questionnant, à partir de Nietzsche, la métaphore, J. Derrida analyse le lieu où la métaphore n’est pas un moyen rhétorique de domination, mais lieu de transition et de passage. Il s’appuie à nouveau sur le Livre du philosophe qui contient toute une théorie de la métaphore et des rapports entre métaphore et concept, et fait saillir, plus spécifiquement le schème reproduction/sélection, schème qui fonctionne aussi bien dans les institutions (scolaire par exemple) que dans la biologie. Nietzsche écrit ainsi : « Dans la pensée en image aussi, le darwinisme a raison : l’image la plus forte détruit les images de peu d’importance »[21]. Ce que J. Derrida commente en disant :
« Il y aurait donc, à suivre ce propos, une sélection naturelle des métaphores, obéissant à la raison du plus fort. Il y aurait un système socio-biologique, politico-biologique, des images en état de guerre »[22].
C’est comme si, d’après J. Derrida, pour Nietzsche, la sélection naturelle était une métaphore, puisqu’elle pourrait s’appliquer hors du champ dans lequel elle a été élaborée. C’est comme si la sélection naturelle ne pouvait être qu’une métaphore, puisqu’elle semblera, aux yeux de Nietzsche se contredire, dans la mesure où Nietzsche, reprochera à Darwin d’avoir conçu la sélection naturelle de telle sorte qu’elle rende son renversement inexplicable. Comment Darwin et la sélection naturelle expliquent-ils la domination de fait des plus faibles ? Autrement dit, « comment le faible peut-il être plus fort que le plus fort ? »[23]
Ce travail sur la métaphore chez Nietzsche, corrélé à sa critique de Darwin, prépare à une réflexion sur les philosophes ou les épistémologues de la vie, qui, explicitement, ne renvoient jamais aux analyses de Nietzsche sur la métaphore alors qu’ils réfléchissent sur les enjeux et les difficultés liés à « l’intervention des métaphores dans le champ dans lequel ils travaillent (…) pour maintenir à tout prix la frontière rigoureuse et rassurante entre le conceptuel et le métaphorique »[24], alors que pour J. Derrida, maintenir tranchée la distinction, voire la séparation entre métaphore et concept, c’est s’interdire de comprendre convenablement l’histoire de la science. J. Derrida illustre alors sa critique en citant un texte de Canguilhem, « le concept et la vie », dans lequel ce dernier dresse une opposition radicale entre ce que Canguilhem appelle métaphore et ce qu’il appelle « concept adéquat » à propos des analyses de Bachelard. Pour Canguilhem, Bachelard fait des tentatives, faute du « concept adéquat » de définir le vivant à l’aide de métaphores comme « idée directrice », « dessein vital », « préordonnance vitale », « plan vital », etc.. Mais Canguilhem tend à prétendre que si Claude Bernard utilisait des métaphores, ce n’était pas parce qu’on ne peut jamais atteindre le « concept adéquat », mais c’est parce qu’il ne le possédait pas, alors que Canguilhem pense l’avoir. Pour Canguilhem, « ce qui garantit l’efficacité théorique ou la valeur cognitive d’un concept, c’est sa fonction d’opérateur »[25]. Autrement dit, pour Canguilhem, le « concept adéquat » n’est pas la représentation exactement proportionnée d’un objet ou d’un processus, mais simplement ce qui permet un travail efficace. J. Derrida désosse l’argumentation de Canguilhem en reprenant les étapes de son analyse. Pour Canguilhem, Claude Bernard aurait eu une idée force, que « l’être vivant organisé est la manifestation temporairement perpétuée d’une idée directrice de son évolution »[26]. En d’autres termes, la thèse fondamentale de Claude Bernard aurait été que le vivant était l’expression d’une idée directrice, ce qui, dès lors, expliquerait pourquoi les lois physico-chimiques seules sont incapables de rendre compte de la singularité de chaque être vivant. Canguilhem dit que Claude Bernard a bien pressenti que l’hérédité consistait dans la transmission de quelque chose qu’aujourd’hui on appelle une information codée mais que l’analogie entre transmission bernardienne et information codée ne recouvre pas une réelle parenté de concept, mais seulement une « affinité de fonction »[27]. Canguilhem reproche à Claude Bernard d’en être resté à une métaphore et de ne pas avoir accéder à l’ordre du concept. Mais comme la seule caractérisation qu’il donne du concept est son efficacité opératoire et que des métaphores peuvent avoir une efficacité opératoire, comme le dit J. Derrida, « la distinction qu’il [Canguilhem] veut à tout prix sauver entre concept et métaphore est, elle, pré-critique, qu’elle n’est jamais problématisée et qu’elle reste donc, en tant que telle, un obstacle anti-opératoire. Elle empêche de libérer la réélaboration nécessaire, la refonte de tout ce problème »[28]. Et même, comme le conclut J. Derrida à la fin de la séance, pour fustiger l’inanité de la critique de Canguilhem : « Ce qu’on dénonce aujourd’hui comme des métaphores a été opératoire, ce qui est opératoire aujourd’hui, si l’on suit ce schéma, ne tardera pas à paraître métaphorique demain »[29]. En effet, ce qui fonctionne et est efficace et adéquat dans une pratique scientifique dans un temps donné – les concepts selon la nomenclature de Canguilhem – devient, comme nous l’apprend l’histoire des sciences obsolètes. A suivre la thèse de Canguilhem, les concepts perdant leur opérativité perdraient du même coup leur conceptualité…
Epistémologie du vivant
Dès l’ouverture de sa quatrième séance, J. Derrida pointe la mutation capitale qui a eu lieu dans les sciences du vivant :
« l’émergence de la modernité scientifique dans le domaine génético-biologique consiste, semble-t-il, en cette mutation par laquelle la science, la connaissance n’est plus la production d’un production d’un texte au sujet d’un objet qui en lui-même ne serait plus, comme référent de cette connaissance, méta-textuel, mais lui-même textuel dans sa structure. Ce qui aurait pu paraître, plus ou moins naïvement, la condition limitée de la philologie, de la critique littéraire, de la science des documents et archives, etc., à savoir d’avoir pour référent ultime quelque chose qu’on appelait, qu’on croyait connaitre sous le nom de texte, cette condition est maintenant celle de la génétique ou de la science du vivant en général »[30].
Mais si le texte, ou le message textuel devient le modèle dominant en génétique – ce que montre J. Derrida en s’appuyant sur des citations tirées de la Logique du vivant de F. Jacob –, quelque chose dans l’ordre, la nature ou la structure du savoir n’est-il pas amené à changer ? Ne faut-il pas faire bouger les lignes de ce qu’on appelait, traditionnellement, connaissance biologique, du fait de leur changement relatif de nature, passant d’objet méta-textuel à objet textuel ? En effet, la division classique entre sujet connaissant et objet connu est remplacée par la commune nature du vivant (comme analogue de texte), du chercheur (comme vivant donc comme analogue de texte) et de la science elle-même (comme texte).
- Derrida relit La Logique du vivant et y note la définition implicite chez F. Jacob du vivant comme ce qui peut se reproduire (comme le caractérise également Hegel). Le propre du vivant est la reproduction. F. Jacob entend couper court à tout vitalisme métaphysique, mais, ce que remarque J. Derrida, c’est que « non seulement Jacob ne rompt pas purement et simplement avec le discours philosophique sur l’essence mais il retrouve, avec l’essence de la vie comme tendance et aptitude à la reproduction (…) non seulement l’essence, mais l’essentialité de l’essence, l’origine et la fin de l’essence comme dynamique et énergie d’être, ce qui donne la puissance et l’acte d’être, le maximum d’être »[31], s’accordant ainsi avec tout un pan de la tradition philosophique, du conatus chez Spinoza à l’appatitus chez Leibniz. Reproductive, la logique du vivant est celle de la sélection. Aussi, loin de rompre avec les déterminations philosophiques de la tradition, ce que revendiquent certains biologistes, la science du vivant, sans les interroger, ne fait que reprendre.
L’auto-reproductibilité est le propre du vivant, comme le conclut J. Derrida des analyses de F. Jacob. Est vivant qui se reproduit et qui se reproduit est vivant. Or, explique J. Derrida, il y a une espèce de clôture du vivant que l’extérieur ne semble pas affecter au sens où dans « le se-reproduire, ni le se nie le re ne viennent affecter du dehors, ne surviennent à un produire qui les précéderait, un produit qui leur préexisterait. Ce qui semble pré-exister, c’est déjà un re-produit comme un re-produit de soi, un se-reproduit »[32]. Autrement dit, il n’y a pas de soi suffisant avant, en amont de la reproduction, car le soi n’est que sa reproductibilité. Toutefois, si la biologie contemporaine utilise l’image et le champ sémantique de la reproduction, elle n’opère aucune problématisation ni aucun questionnement à son sujet[33]. F. Jacob n’explique pas ce que serait le produire originel, dont le reproduire ne serait qu’une modalité. Et J. Derrida de soutenir que « la notion de production vient partout combler les vides du discours moderne »[34] et en devient « le vicaire général de la détermination de l’être »[35]. Aujourd’hui, on ne conçoit, ne forme, ni ne provoque quelque chose, on le produit. Or cet unique terme qui sert à tout aujourd’hui provient du discours marxiste. Le marxisme est une théorie de la production, fonctionnant chez les humains et, sinon comme, chez les autres animaux. On est donc, dans la pensée de Marx, « ce qu’on produit et tel qu’on le produit, et le mode d’être est le mode de production comme manifestation de soi ou extériorisation »[36]. Mais Marx distingue de nombreux sens de la production (production de la vie animale et production de la vue humaine ; re-production biologique et re-production des conditions de production dans la technologie humaine) et la production est également pensée d’abord comme re-production. Mais chez Marx comme chez Jacob, le sens de la production, en tant que tel, n’est jamais interrogé. Conséquemment, J. Derrida questionne la scientificité du discours de F. Jacob dans lequel un « support opératoire non critiqué, non interrogé » tient une place très considérable, et le rapproche comme incidemment de l’idéologie.
Puis J. Derrida montre que F. Jacob associe sexualité et mort dans la mesure où un être, comme une bactérie, qui ne se reproduit pas sexuellement, mais, par simple scission avec lui-même, ne meurt littéralement pas. D’où le lien entre la mort et la sexualité, établi par F. Jacob que veut interroger J. Derrida : la mort ne viendrait pas du-dedans, mais consisterait dans la dilution de l’identité. La bactérie ne mourrait pas, au sens habituel du terme.
- Derrida relève au début de cette séance une contradiction entre le fait que d’une part, comme le souligne F. Jacob : « « le message génétique ne peut être traduit que par les produits mêmes de sa propre traduction »[37], et, d’autre part, les données du premier théorème d’incomplétude de Gödel, contradiction que reformule J. Derrida et qu’il appelle une « nécessité paradoxale : on ne peut comprendre un ensemble qu’à l’aide de l’un de ses éléments (produits ou parties), ce qui revient à l’impossibilité et de le comprendre ou de le traduire dans un ensemble plus grand et pour lui de se comprendre, du moins selon la logique courante de la compréhension qui prétend comprendre la partie dans le tout ou un ensemble dans un ensemble plus grand »[38]. En d’autres termes, on affirme à la fois qu’un message peut être traduit ou compris s’il l‘est dans ses parties, et que si un système est décrit à partir de ses parties, on ne peut pas légitimement dire qu’il est compris ou traduit. Et ce paradoxe de la traduction ou de la compréhension d’un texte vaut pour le vivant s’il est, à sa façon, un texte. Du coup le message émis par le texte du vivant se donne comme un message qui a la même structure que lui. Cela implique l’absence de toute autre chose dans le vivant que le vivant lui-même. On n’a pas d’un côté un vivant conçu comme un texte qui délivrerait une information ou une communication d’un ordre autre que textuel ; on n’a que du vivant conçu comme textuel produisant un message lui-même textuel[39].
« L’activité du savant, la science, le texte de la science génétique dans son ensemble se déterminent comme des produits de leur objet (…) des produits de la vie qu’ils étudient, des produits textuels du texte qu’ils traduisent ou déchiffrent ou dont ils produisent les procédures de déchiffrement »[40].
Vivant donc textuel, le scientifique étudie le vivant textuel, comme une partie un tout. Dès lors, cela apparaît comme une limite à l’objectivité de la science puisque que le sujet observant ne peut pas détacher formellement de l’objet observé, le vivant textualisé dans les deux cas ; mais, en même temps et paradoxalement, c’est aussi sa condition de possibilité (c’est parce que le scientifique est vivant qu’il peut observer le vivant).
Pour J. Derrida, si on réfère le vivant à la structure d’un texte, on fait un progrès dans la connaissance du vivant, qui a pour corollaire une transformation du statut de la connaissance réductible à du textuel. On pourrait presque appliquer à cette nouvelle forme de connaissance du vivant l’axiome programmatique de l’œuvre de Derrida dans de la Grammatologie : « il n’y a pas de hors texte » : tout texte doit être lu dans sa texture propre sans être référé à autre chose qu’à lui-même. Le vivant n’a pas à être référé à autre chose que lui-même. Un certain savoir a changé le statut de la connaissance sur le vivant et fait en quelque sorte du texte un modèle pour penser le vivant. Ce qui invite également à repenser dit J. Derrida le statut du modèle dans la connaissance. Pour approfondir l’analyse, J. Derrida explique qu’une fois qu’on a déterminé le texte comme modèle de connaissance du vivant, il s’agit de voir quel type de texte peut servir de modèle à une telle connaissance. Et il est évident que le vivant n’a rien à voir avec un texte auquel l’auteur aurait donné une intention précise au présent, texte du coup téléologique, puisqu’il faudrait alors, par analogie, se demander qui a écrit le texte du/qu’est le vivant et dans quel but. Au contraire, à référer le vivant à un modèle textuel non téléologique (un texte sans intention immédiatement décelable), on pourrait à nouveaux frais repenser la connaissance du vivant. D’où l’émergence d’un questionnement sur le modèle. Il s’agit aussi bien de savoir quel modèle textuel peut servir de texte au vivant et quel vivant peut servir de modèle ? En effet, si on pense la bactérie comme modèle du vivant, que faire du supplément que la mort et la sexualité représentent pour le modèle ? Réfléchissant sur ce que doit être ce modèle textuel pour connaître le vivant, J. Derrida écrit : « le modèle dont il [F. Jacob] parle est toujours un modèle descriptif, mettant en évidence une ressemblance, une affinité naturelle, et non pas un modèle mathématique »[41]. J. Derrida remarque que paradoxalement le modèle peut aussi bien être naturel que technique pour penser le vivant, et qu’en pensant en termes d’ « informations », la biologie moléculaire s’appuie sur un modèle technique (comme l’analyse J. Derrida, la pensée peut aussi décrire l’animal comme une machine.
Le biologisme prétendu de Nietzsche
- Derrida a pour l’instant interrogé ce qui pouvait servir de modèle au vivant et à quoi le vivant pouvait servir de modèle, d’où l’idée d’un échange de modèle entre le vivant et autre chose. Mais on peut se demander ce qui advient quand le discours biologique n’est plus seulement interrogé comme ce qui a affaire à des modèles, mais est considéré comme modèle, par exemple philosophique. En quoi cela consiste-t-il ? « Ça veut dire que, subrepticement ou explicitement, la vérité de la science biologique, son contenu et sa forme deviennent la référence ultime, le fondement ou la règle d’autres discours (je dis référence, fondement ou règle, mais il y a d’autres formes d’autorité du modèle, nous aurons à y revenir). Tout s’ordonne alors à la connaissance biologique, tout devient effet de cette connaissance, tous les discours y trouvent leur dernière instance. C’est ce qu’on a souvent désigné, depuis la fin du siècle dernier, sous le nom de biologisme »[42]. Certes, la possibilité que la biologie incarne la norme et le fondement du savoir est une possibilité existe à partir du moment où on pose, ne serait-ce qu’implicitement, l’équivalence entre vie et être, c’est-à-dire depuis presque toujours, mais les modalités du biologisme varient en fonction de l’importance qu’on reconnaît aux découvertes biologiques : si on fait de la biologie une science capitale en plein progrès, on sera plus facilement tenté d’ne faire le modèle de la connaissance en tant que telle. Une telle configuration surgit à la fin du XIXème siècle, et ce qui l’illustre c’est l’accusation portée contre Nietzche et Freud de biologisme, accusation dont pourrait s’enrichir la conception du texte comme modèle pour penser le vivant, dans la mesure où les philosophies de Nietzsche et de Freud se prêtent superbement à une activité de déchiffrement textuel, psychanalytique ou philologique.
La question du biologisme de Nietzsche suppose de voir d’abord si le vivant est une région de l’être et si on peut ordonner le savoir à cette région de l’être. Pour évaluer l’éventuel biologisme de Nietzsche, J. Derrida rappelle les acquis de son analyse et la pensée de Heidegger : il y aurait une unité de pensée de Nietzsche tenant à son unicité singulière liée à l’unité de la métaphysique occidentale. Il faut alors poser la question de la vérité de l’être qui permet de déterminer en quoi Nietzsche signe le nom de la fin de la métaphysique occidentale, condition nécessaire pour répondre à la question de savoir qui était Nietzsche. La perspective de Heidegger est de dégager Nietzsche de ce qu’il appelle la « philosophie de la vie » – et en particulier du nazisme et de l’utilisation qu’il a fait du nom de Nietzsche – en soustrayant Nietzsche à l’accusation de biologisme. C’est pour cela qu’il ancre Nietzsche définitivement du côté de la métaphysique (et non du biologisme) en en faisant « le penseur de l’achèvement de la métaphysique »[43]. Quand Heidegger fait de Nietzsche un métaphysicien, « c’est en définissant le métaphysique comme pensée de l’étant en totalité, pensée rivée dans une pensée de l’étant »[44], comme le dit J. Derrida. De plus, pour Heidegger, il ne revient pas plus à la physique de penser la physis qu’à la biologie de penser le bios. Ce n’est pas à une science de penser « l’essence de l’étant sur lequel elle travaille »[45]. La science opère sur des étants ou des objets mais ne s’intéresser pas à leur essence. Et c’est à partir de cette considération que Heidegger veut délivrer Nietzsche du soupçon de biologisme qu’on lui adresse : en « déterminant l’essence de l’étant-vivant, Nietzsche rompt avec le discours biologique, scientifique en général, il parle en philosophe »[46]. Heidegger remarque que le mot vie a deux sens dans la pensée nietzschéenne, il renvoie soit à la totalité de l’étant, soit à notre situation existentielle à l’intérieur de la totalité de l’étant. Pour soustraire Nietzsche au soupçon de biologisme, Heidegger analyse la notion très importante de force chez Nietzsche, en montrant qu’elle est irréductible avec la notion de force en physique (la force chez Nietzsche n’est ni susceptible d’équilibre, ses effets sont incalculables, elle n’existe que dans un monde pensé comme chaos, etc.).
Reprenant la critique du biologisme prétendu de Nietzsche par Heidegger, J. Derrida fait voir que Nietzsche « ne pense pas l’essence de la vie à partir de ce que lui en dit la biologie, par exemple le vitalisme de l’époque ou le darwinisme et la doctrine de la conservation de soi ou du « struggle for life ». La vie se pense depuis sa condition, à savoir ce qui porte, soutient, active et suscite la vie »[47] : la vie comme valeur et accroissement. Pour Nietzsche, selon Heidegger, l’essence de la vie, c’est-à-dire la totalité de l’étant, est Volonté de puissance. Et du coup, l’identification de la vie et de la volonté de puissance permet de mieux saisir ce qu’est la volonté de puissance en évitant les contresens qui en font une psychologie de la volonté ou une physique ; en effet, dans la mesure où la volonté de puissance est l’essence de tout l’étant, on doit pouvoir la trouver partout à l’œuvre. Du coup, le traitement que Heidegger fait subir à la pensée de Nietzsche soustrait Nietzsche à l’accusation de biologisme pour en faire un métaphysicien de premier ordre, voire pour faire du « biologisme » l’effet de la métaphysique. Comme le note J. Derrida : « Quand Nietzsche parle de la vie, quand il détermine, selon Heidegger la totalité de l’étant comme vie, il n’emprunte donc pas, par définition, ses concepts à une science régionale appelée biologie. Sa démarche ne relève ni du biologisme en tant que débordement ou transgression impérialiste d’une région ni en tant que naïveté scientifique qui ignore ses fondements métaphysiques et croit pouvoir s’assurer de son fondement en elle-même. Nietzsche pense métaphysiquement la vie et les conditions de la vie comme totalité de l’étant. En quoi il porte à son ultime épanouissement ce qui se réservait encore depuis la détermination de l’être comme physis[48] ».
La troisième boucle : Freud
Dans les quatre dernières séances, J. Derrida dit effectuer sa « troisième boucle » en réfléchissant sur Freud, et en particulier sur son livre Au-delà du principe de plaisir. Ce que fait voir sa lecture c’est le caractère non thétique, non positionnel de ce livre : Freud n’y soutiendrait aucune thèse – ce serait un texte sans conclusion définitive[49]. Lisant Au-delà du principe de plaisir, J. Derrida remarque que Freud présente l’état de la théorie psychanalytique à cette époque « comme une assomption qui peut être imprudente » et « comme une croyance »[50]. Il qualifie la pensée freudienne de « spéculation », qu’il distingue de l’hypothèse, de l’empirique comme de l’a priori, et de la philosophie[51]. J. Derrida relève l’importance de la mort et du principe de plaisir, ainsi que le caractère inéducable des « pulsions sexuelles ». Du deuxième chapitre du livre de Freud, J. Derrida remarque que l’argumentation semble ne pas avancer : ce chapitre n’est que la répétition du geste de Freud de rejeter tout ce qui paraît remettre en question de principe de plaisir[52]. Le principe de plaisir comme le refoulement en réalité ne se démontrent pas, ne sont pas susceptibles d’une démonstration. Or ce geste de répétition évoque pour J. Derrida celui d’un travail souterrain, comparable à celui qu’exerce la pulsion de mort, même si elle n’est pas thématisée comme telle[53], comme si même elle ne pouvait pas se donner à lire tout en agissant cependant. Dans ce même chapitre, Freud, remarque J. Derrida se peint analysant son petit-fils faire l’expérience du fort/da – et J. Derrida revient au thème de l’autobiographie. Il commente longuement le contenu et le statut de cette observation célèbre de Freud. Dans le troisième chapitre du livre, sur lequel J. Derrida passe très rapidement, se contentant de souligner l’intérêt de certains exemples freudiens, Freud analyse la compulsion de répétition. Puis J. Derrida analyse soigneusement la topologique de l’Inconscient présenté dans le quatrième chapitre du livre. J. Derrida y commente l’emploi de métaphores freudiennes et en arrive à souligner l’ambiguïté des pulsions de vie freudiennes qui peuvent être parfois des pulsions de mort[54] – ce qui est loin d’être sans intérêt dans la perspective d’un séminaire titré La vie la mort. Dans sa dernière séance, J. Derrida s’intéresse assez longuement au statut du plaisir par rapport au principe de plaisir dans le dernier chapitre du livre de Freud. Comme l’analyse J. Derrida : « le principe du plaisir est une sorte d’ennemi du plaisir, une sorte de contre-plaisir, de bande contre-bande qui vient limiter le plaisir pour le rendre possible, qui en limite et contrecarre la possibilité pour le rendre possible »[55]. Pour J. Derrida – et de façon, délibérément provocatrice – l’irrésolution de Freud qui ne pose aucune thèse dans ce livre important revient à dire : « allez-vous faire foutre, moi ça me plaît, l’au-delà du plaisir tel est mon bon plaisir, l’hypothèse de la pulsion de mort, moi j’aime ça, ça m’intéresse »[56]. Puis J. Derrida clôt son séminaire par une anthologie de citations de la Volonté de puissance de Nietzsche sur le thème du plaisir, qui laissent à son auditoire de quoi méditer et ébaucher des rapprochements entre la philosophie nietzschéenne et la pensée freudienne.
Conclusion
Finalement, ce texte de J. Derrida, riche, dense et qui suit un raisonnement parfois sinueux, mêle différents matériaux, de nature hétérogène (données et discours de la biologie, interprétation heideggérienne de Nietzsche, lecture déconstructrice d’un livre de Freud, etc.) qu’il soumet à des analyses pointilleuses et entrelace savamment, produisant une pulsation ou un rythme propre de la pensée. Ce qui laisse augurer, pour la suite de la publication des séminaires, un fourmillement d’informations, d’indications et de raisonnements charpentant l’œuvre publiée essentielle – mais souvent difficile – de J. Derrida.
[1] Jacques Derrida, La vie la mort. Séminaire 1975-1976, édition établie par Pascale-Anne Brault et Peggy Kamuf, Seuil, « bibliothèque Derrida », 2019
[2] J. Derrida dit vouloir « en analysant l’intitulé du programme d’agrégation, non pas [s]’ conformer, mais en faire l’objet – à déconstruire – de ce séminaire », Jacques Derrida, La vie la mort. Séminaire (1975-1976), édition établie par Pascale-Anne Brault et Peggy Kamuf, Seuil, « bibliothèque Derrida, 2019, p25.
[3] Jacques Derrida, La vie la mort. Séminaire (1975-1976), édition établie par Pascale-Anne Brault et Peggy Kamuf, Seuil, « bibliothèque Derrida, 2019, p19.
[4] Hegel, La Science de la logique, cité dans Jacques Derrida, Ibid., p22.
[5] Jacques Derrida, Ibid., p. 22-23.
[6] Ibid., p. 23.
[7] Nous pourrions ajouter à cela la remarque de Derrida : « Appeler les vivants des êtres, comme cela se fait dans un langage courant marqué par une culture à la fois philosophique et chrétienne qui fait être ce qui vit et parle, voilà qui rejoint notre propos de tout à l’heure sur l’équivalence entre être et vivre avec tout son foyer problématique », Jacques Derrida, Ibid., p. 29.
[8] Ibid., p. 24. C’est dans ce sens qu’on peut lire les guillemets autour de « être » et « vivre » dans la citation de Nietzsche que donne J. Derrida.
[9] F. Jacob, La Logique du vivant. Une histoire de l’hérédité, Paris, Gallimard, 1970.
[10] Jacques Derrida, Ibid., p. 27.
[11] Jacques Derrida, Ibid., p. 36.
[12] Jacques Derrida, Ibid., p. 37.
[13] F ; Jacob, en effet, définit le programme génétique ainsi : « Le programme génétique, en effet, est constitué par la combinatoire d’éléments essentiellement invariants. Par sa structure même, le message de l’hérédité ne permet pas la moindre intervention concertée du dehors. Chimiques ou mécaniques, tous les phénomènes qui contribuent à la variation des organismes et des populations se produisent en toute ignorance de leurs effets (…) Pour chaque individu le programme résulte d’une cascade d’évènements, tous contingents. La nature même du code génétique empêche tout changement délibéré du programme sous l’effet de son action ou du milieu. Elle interdit toute influence sur le message des produits de son expression. Le programme ne reçoit pas les leçons de l’expérience », cité Ibid., p. 39-40.
[14] Jacques Derrida, Ibid., p. 48.
[15] C’est par exemple ce que fait avec réussite Patrick Boucheron qui réfléchit à ce que signifie à Milan, au cours de l’histoire, se revendiquer de l’héritage d’Ambroise (Patrick Boucheron, La trace et l’aura. Vies posthumes d’Ambroise de Milan (IV-XVIe siècle), Seuil, 2019). P. Boucheron se réfère à la pensée de Derrida.
[16] « Le nom de Nietzsche est aujourd’hui pour nous, en Occident, le nom de celui qui fut le seul, peut-être d’une autre façon avec Kierkegaard, à traiter, je dirais de la philosophie et de la vie, de la science de la vie et de la philosophie de la vie, avec son nom, en son nom, en mettant en jeu son nom, ses noms, sa biographie, avec presque tous les risques que cela comporte, pour lui, sa vie, son nom et l’avenir de son nom », Jacques Derrida, Ibid., p. 50.
[17] F. Nietzsche, Ecce Homo, trad. Fr. A. Vialatte, Paris, Gallimard, 1942.
[18] Jacques Derrida, Ibid., p. 51.
[19] Jacques Derrida, Ibid., p. 53.
[20] Traduction de Derrida, dans Jacques Derrida, Ibid., p. 57-58.
[21] Nietzsche, Le livre du philosophe, cité par J. Derrida op. cit., p. 89.
[22] J. Derrida, op. cit., p. 89.
[23] J. Derrida, Ibid., p. 90. Sur l’idée d’un renversement de fait de la sélection naturelle, J. Derrida cite extraits de La Volonté de puissance de Nietzsche : « Ce qui me surprend le plus, quand j’embrasse du regard les grands destins de l’homme, c’est d’apercevoir toujours le contraire de ce que Darwin et son école voient ou veulent voir aujourd’hui : la sélection au profit des plus forts, des mieux partagés, le progrès de l’espèce. Le contraire est partout saisissable ».
[24] J. Derrida, Ibid., p. 98.
[25] G. Canguilhem, op. cit., cité par J. Derrida, Ibid., p100.
[26] G. Canguilhem, op. cit., cité par J. Derrida, Ibid., p101.
[27] G. Canguilhem, op. cit., cité par J. Derrida, Ibid., p104.
[28] J. Derrida, Ibid., p105.
[29] J. Derrida, Ibid., p106.
[30] J. Derrida, Ibid., p. 110.
[31] J. Derrida, Ibid., p. 121.
[32] J. Derrida, Ibid., p. 134.
[33] « A aucun moment Jacob ne se demande ce que ça veut dire, jamais il ne soumet ce concept ou ce mot de production/reproduction (de soi) à la moindre question critique », J. Derrida, Ibid., p. 135.
[34] J. Derrida, Ibid., p. 136.
[35] « Là où on ne peut plus dire créer (parce que Dieu est censé créer et que l’on en a fini avec le théologique), on dit produire, là où l’on ne peut plus dire engendrer, exprimer, penser, etc., là où un concept paraît par trop – et à juste titre – importer de métaphysique ou de théologie, ou d’idéologie suspecte, on en appelle au produire pour le remplacer ou le neutraliser », J. Derrida, Ibid.
[36] J. Derrida, Ibid., p. 141.
[37] F. Jacob, op. cit., cité dans J. Derrida, Ibid., p155.
[38] J. Derrida, Ibid., p155.
[39] « Naturellement, cette autoréférence textuelle, cette fermeture sur soi du texte qui ne renvoie qu’à du texte, n’a rien de tautologique ou d’autistique. Au contraire. C’est parce que l’altérité y est irréductible qu’il n’y a que du texte, c’est parce que aucun terme, aucun élément n’y a de suffisance ni même d’effet qu’il ne renvoie à l’autre et jamais à lui-même qu’il y a texte ; et c’est parce que l’ensemble texte ne peut pas se clore sur lui-même qu’il n’y a que du texte, et que le texte dit « général » (…) n’est ni un ensemble ni une totalité : il ne peut se comprendre ni être compris. Mais il peut s’écrire et se lire, ce qui est autre chose », J. Derrida, Ibid., p159. On pourrait, mais ce serait trop long, voir dans quelle mesure la conception du texte chez Derrida est à délier de la question de sa compréhension. Selon Derrida, un texte écrit est une sorte de machine qui produit un renvoi indéfini. Une fois le texte privé de l’intention subjective qui serait derrière lui, ses lecteurs n’ont plus le devoir, ou la possibilité, de rester fidèles à cette intention absente.
[40] J. Derrida, Ibid., p. 159.
[41] J. Derrida, Ibid., p. 161.
[42] J. Derrida, Ibid., p. 181-182.
[43] Heidegger, cité dans J. Derrida, Ibid., p. 212.
[44] J. Derrida, Ibid., p. 226.
[45] J. Derrida, Ibid., p. 238.
[46] J. Derrida, Ibid., p. 238.
[47] J. Derrida, Ibid., p. 252.
[48] J. Derrida, Ibid., p. 273.
[49] J. Derrida, Ibid., p. 275.
[50] J. Derrida, Ibid., p. 285.
[51] J. Derrida, Ibid., p. 286.
[52] J. Derrida, Ibid., p. 300.
[53] J. Derrida, Ibid., p. 301.
[54] « Freud définit les pulsions conservatrices de la vie, les gardiens de la vie comme des sentinelles de la mort ou des satellites de la mort », J. Derrida, Ibid., p. 335. On retrouve une conclusion similaire ibid., p340.
[55] J. Derrida, Ibid., p355-356.
[56] J. Derrida, Ibid., p344.








