La traduction française de l’Éthique sans l’ontologie de Putnam[L’éthique sans l’ontologie, Traduction Pierre Fasula (coord.), Paris, Cerf, 2013[/efn_note] aura pris neuf ans et mobilisé une équipe de haut niveau, coordonnée par Pierre Fasula. Cette traduction arrivant après celle de La philosophie juive comme guide de la vie1 qui en constitue pourtant un prolongement, les acquis principaux de l’ouvrage pourront sembler moins nouveaux à un public francophone déjà familiarisé avec les derniers développements putnamiens. Pour autant, ce bref ouvrage, écrit dans un style accessible et constitué de plusieurs conférences rassemblées, ne doit pas être sous-estimé. Il n’est en rien une introduction à la pensée de l’auteur, encore moins une tentative de la vulgariser, et marque au contraire l’ultime inflexion d’une œuvre réputée pour ses nombreux tournants. Il mobilise ainsi toute l’extension préalable de la pensée de Putnam, s’appuie tant sur les problématiques rencontrées, les positions adoptées puis abandonnées que sur les acquis et conclusions de cet itinéraire. Il s’agit bien là en résumé d’un travail de maturité, dont la densité frappe d’autant plus que l’argumentation en est efficace en dépit de sa brièveté et de sa simplicité.
Le titre de l’ouvrage est une référence explicite à Levinas. Avec Levinas, Putnam assume que l’éthique n’a pas besoin de fondement et s’enracine dans l’exigence immédiate que constitue la souffrance d’autrui. Cette exigence constitue en cela une sphère indépendante (Levinas dirait pour sa part préalable, puisque seule selon lui cette dimension originairement éthique, ouverte dans la rencontre d’autrui, seule cette injonction à répondre d’un sens que je n’ai pas fait et qu’on m’adresse permet de comprendre l’ontologie[cf. sur ce point l’ouvrage de R. Moati, Événements nocturnes. Essai sur Totalité et infini, Paris, Herman, 2012 et la [recension de Thibaut Gress consultable sur ce même site.[/efn_note]) ; elle implique une asymétrie fondamentale, même si Putnam ne semble pas vouloir suivre Levinas jusqu’au bout dans son mouvement de dramatisation et d’hyperbole de la question éthique.
Tout autant, l’influence du pragmatisme, et tout particulièrement celui de John Dewey est fortement revendiquée dès les premières pages de l’ouvrage (pragmatisme auquel Putnam lie classiquement le second Wittgenstein, et dans une plus faible mesure, Husserl et Heidegger en tant que penseurs du monde de la vie). Plus familière aux lecteurs des œuvres précédentes de Putnam, cette référence est structurante du réalisme défendu par l’auteur, qui ne peut être compris qu’en passant par une critique préalable des formes exacerbées de réalisme métaphysique : Putnam, comme on y reviendra, se méfie des oppositions trop tranchées entre faits et valeurs, Verstehen und Erklären (le Verstehen n’étant pas plus l’apanage des seules sciences historiques et humaines que l’Erklären celui des sciences naturelles), sciences empiriques et sciences a priori, et plus globalement Weltbegriff et Schulbegriff de la philosophie. Le pragmatisme signifie autant un refus de l’idée « qu’il y a un ensemble de vérités nécessaires existant par elles-mêmes que la philosophie pour tâche de découvrir » que de celle que tout ce que nous découvrons soit provisoire et révisable.
Dans cette perspective, Putnam pose avec Dewey que le rôle de l’éthique n’est pas de produire des systèmes mais de contribuer à la résolution de problèmes pratiques, étant entendu que ces problèmes pratiques sont tout aussi bien et même d’abord des problèmes théoriques, mais rencontrés et affrontés dans le cours de notre vie et réfractaires au « point de vue de nulle part » que la philosophie tend à vouloir adoper en la matière. Que veut dire dès lors appliquer notre intelligence à des problèmes éthiques ? Il s’agit de ne plus réduire l’éthique à un seul trait ou un seul principe : l’éthique n’attend pas de la raison un fondement, une explicitation de normes, de règles, mais une mise en œuvre de l’intérieur de la vie éthique.
Outre ces références, Putnam en appelle également à deux figures plus classiques de l’histoire de la philosophie, qui font notoirement partie de son panthéon. La première est la perspective kantienne, exigeant de l’éthique qu’elle soit universelle, que « dans la mesure où l’éthique se préoccupe du soulagement de la souffrance, elle se préoccupe du soulagement de la souffrance de toute personne ». La seconde est la perspective « eudamonienne » aristotélicienne, qui sous le terme d’éthique interroge ce qui rend une vie humaine admirable et en constitue l’accomplissement. Putnam ne considère pas ces approches opposées, encore moins contradictoires, mais bien complémentaires : il faut penser, écrit-il, une éthique à trois pieds (Aristote, Kant, Levinas), la perspective pragmatiste étant ce qui rend possible cette conciliation de la préoccupation de la rencontre singulière de l’autre, de la visée universelle et de l’aspiration à l’accomplissement et à l’épanouissement.
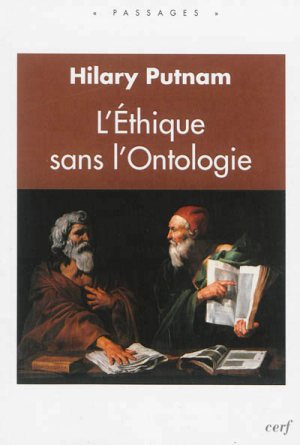
Fidèle à sa méthode, Putnam refuse le cloisonnement de la philosophie en sous secteurs et la distinction des interrogations éthiques, épistémologiques et ontologiques. La première partie de l’ouvrage fait ainsi la part belle aux questions de philosophie des mathématiques et de la logique ; ce faisant, Putnam revient sur une de ses thèses les plus fortes, dénonçant la volonté de chercher dans l’ontologie le fondement de l’objectivité, qu’il s’agisse d’objectivité des mathématiques, de l’éthique ou de l’objet en général. Il ne s’agit pas là de récuser toute métaphysique, mais plutôt, de manière très kantienne, de refuser l’assimilation de la métaphysique à une science et son ancrage dans l’ontologie. L’objectivité doit être explicitée pour elle-même et cette explicitation n’implique en rien la postulation d’objets censés la porter. Il faut bien comprendre ici bien sûr que l’ontologie est entendue dans son sens « aristotélicien » de science de l’être et non dans son sens heideggérien ; Putnam, notons-le, ne dit cependant rien de l’apparition historique du terme « ontologie » chez ou Goclenius puis Clauberg (qui lui préférait le terme d’ontosophia), et en mobilise une acception sans doute moins aristotélicienne que contemporaine, entrée dans la tradition analytique depuis la réapparition du terme au XXe siècle chez Meinong et Husserl. C’est avec cette tradition que débat l’ouvrage, lequel conteste aussi bien son volet inflationniste et « métaphysique » conduisant à multiplier les entités (le bien, le vrai, etc. ) que son volet relativiste et quinien, substituant à la question de l’ontologie celle des engagements ontologiques.
Contre l’ontologie, Putnam promeut un pluralisme pragmatique qui n’exige pas pour sa part que nous trouvions des entités derrière nos jeux de langage ; la vérité peut être dite dans les langage dont nous usons et n’a pas besoin d’explicitation philosophique. Première illustration de cette position, un chapitre consacré à une défense de la relativité conceptuelle (dont les traits sont précisés par rapport aux illustrations proposées dans Représentation et réalité et distinguée du pluralisme conceptuel)) traite de l’interprétation du concept d’existence, ou plus précisément, des usages possibles des quantificateurs existentiel universel. Le prétexte du développement est une discussion de la méréologie (développée par Lesniewski à partir des Recherches Logiques III et IV de Husserl comme calcul des parties et des touts).
Soit donc, pose l’auteur, un monde constitué de trois individus x1, x2, x3. L’application des sommes méréologiques à cet ensemble permet de concevoir un autre monde contenant les éléments x1, x2, x3, mais également les différentes façons d’agencer ces éléments (x1, x2+x3, x2, x1+x3, x3, x1+x2, x1+x2+x2). Cela implique-t-il de dire que les sommes méréologiques existent au même titre que les individus ? Selon Putnam, une telle question n’a pas de sens : en effet, « il n’y a rien dans la logique de la quantification existentielle et universelle qui nous permette de savoir si nous devons dire que les sommes méréologiques existent ou non ; et il n’y a pas non plus d’autre science qui réponde à cette question ». Le quantificateur existentiel n’a donc pas un usage unique et absolument certain mais une famille d’usages, impliquant chaque fois un certain nombre de lois.
L’argumentation de Putnam mérite d’être suivie de près car le cas des sommes méréologiques n’est pas choisi au hasard. En effet, à l’interprétation de Putnam, les critiques pourraient objecter que le cas des sommes méréologiques n’implique pas tant un usage différent du quantificateur universel qu’un univers de discours sur lequel on quantifie de manière élargie. Là contre, répond Putnam, la décision de quantifier ou non sur les sommes méréologiques implique bel et bien autre chose qu’un élargissement préalable de l’univers de discours. Les sommes méréologiques ne sont pas introduites a priori ; la décision de les intégrer ou non implique un certain nombre de conséquences théoriques, car il ne s’agit pas seulement dès lors d’ajouter des éléments à un univers de discours, mais de modifier les raisonnement et déduction possibles à partir de cet usage sont considérables. En filigrane, on retrouve ici la position putnamienne sur les mathématiques elles-mêmes. En effet, posait déjà Putnam dans une expérience de pensée célèbre, celles-ci peuvent à ce titre être considérées comme « empiriques2 » autant que comme a prioriques ; les conditions auxquelles on accepte ou refuse certains postulats ou même, les considère comme postulats plutôt que comme hypothèses (l’axiome du choix en est l’exemple type) varient en effet selon divers paramètres, aussi bien liés à la fécondité démonstrative de ces choix qu’à certaines exigences « culturelles » voire « éthiques » sur ce qui peut ou non être admis comme preuve.
En d’autres termes, la relativité conceptuelle souligne que la question de savoir quel est l’usage correct entre différents usages du mot exister est laissée ouverte par les significations des mots dans le langage naturel. Il ne s’agit pas pour autant d’une simple vérité par convention, car notre connaissance n’est tout simplement pas décomposable de façon qu’on puisse en distinguer les éléments essentiels des éléments conventionnels, certains éléments pouvant être conventionnels relativement à certains choix et factuels relativement à d’autres. La relativité conceptuelle distingue ainsi précisément des choix de modalités descriptives cognitivement équivalentes mais incompatibles (tandis que le pluralisme conceptuel distingue des descriptions non cognitivement équivalentes et non incompatibles).
Le concept de relativité conceptuelle permet alors à Putnam d’aborder la question de la traduction en se gardant des écueils de l’indécidabilité quinienne autant que la rigidité supposée de schèmes conceptuels partagés ou impartageables (réfutée par Davidson comme le « troisième dogme de l’empirisme) ». Il y a bien une dimension pragmatique au sein de la traduction, liée à la convergence d’intérêts vitaux partagés, mais celle-ci pas nécessairement aussi biologiquement normée que Quine semble le penser. Au contraire, la traduction mobilise également une dimension cognitive et créatrice. Elle met bien en jeu des schèmes conceptuels, mais qui ne sont ni partagés ni préalables et sont développés par le processus même de la traduction, qui ne laisse pas intacte la langue dans laquelle nous traduisons et l’enrichit sans cesse de nouveaux motifs.
Le chapitre suivant remet en cause le platonisme naïf de nombreuses théories de la vérité, posant qu’une affirmation est toujours rendue vraie par des objets ou états de choses auxquels elle correspond. Cette position, faisant des énoncés vrais des descriptions, doit être mise à bas. Elle méconnait tout d’abord les différences fondamentales entre les différentes sortes d’énoncés vrais et extrapole aux vérités logiques ou conceptuelles une structure qui ne leur convient pas. Les énoncés logiques en effet ne sont pas descriptifs ; ils sont vrais en tant qu’ils suivent des règles qui déterminent les critères d’inférences valides. Comment savons-nous dès lors que les énoncés de la logique sont corrects, s’ils ne se mesurent à aucune réalité ? Putnam s’attache plus spécifiquement à ce qu’il désigne comme vérités conceptuelles, telles qu’il est impossible de donner sens à l’assertion de leur négation. Celles-ci ne sont pas pour autant des vérités analytiques, puisqu’elles impliquent une interprétation : le fait qu’il soit aujourd’hui impossible de donner sens à l’assertion de leur négation n’implique pas que cela le soit toujours, ce dont les mathématiques ne cessent d’attester. Ainsi, un énoncé de type « un triangle dont la somme des angles est supérieure à 180 » n’avait pas de sens avant l’invention des géométries non euclidiennes, mais celle-ci ont construit un cadre conceptuel dans lequel il est tout à fait admissible. L’impossibilité, précise Putnam, n’est pas psychologique : les vérités conceptuelles servent de fondement à la connaissance au sens wittgensteinien du terme, en ce sens qu’elles sont inséparables de l’ensemble de l’édifice. Les mathématiques sont ainsi d’abord un faire : on apprend moins la vérité mathématique que les critères selon lesquels on fait des mathématiques et les applique. Or, cette application implique l’invention, laquelle peut conduire à élaborer des cadres conceptuels dans lesquels de nouveaux énoncés prennent sens. Le développement et l’acceptation de tels cadre, à nouveau, n’est pas affaire de vérité ou de fausseté mais de fécondité heuristique : la façon dont les théories sont mises en place est inséparable de critères à caractère esthétiques et éthiques évaluant leur finalité autant que leur pertinence. Ceux-ci n’en sont pour autant pas dénués d’objectivité.
La deuxième section de l’ouvrage revient plus nettement à la problématique éthique. Putnam appelle de nouvelles lumières (après les « lumières grecques » et celles des XVIIe et XVIIIe siècle) qualifiées de pragmatistes, car visant l’appropriation collective d’une raison elle-même comprise sur fond de ses ancrages sociaux et historiques. Pour autant, ce pragmatisme se démarque nettement de tout scepticisme et relativisme. L’œuvre de Foucault a certes le mérite de montrer la genèse de structures conceptuelles (décidant de ce qui vaut ou ne vaut pas comme problème), mais en tire des conclusions trop unilatérales : pourquoi cette genèse ne serait-elle due qu’à des luttes pouvoirs, pourquoi ne serait-elle pas aussi le résultat de processus d’apprentissage ? Il y a, affirme Putnam, un sens de la rationalité qui va au delà du respect des normes d’un « jeu de vérité » : les sujets, précisément, ne sont pas prisonniers de tels jeux. Il n’y a pas de sens à considérer une pensée totalement déterminée par un système social ou symbolique. Pour le dire avec les mots de Marc Richir, l’institution symbolique ne peut fonctionner de manière totalement aveugle : dans le rapport même aux normes et à leur application est impliquée une distance ouvrant à leur interprétation, donc potentiellement aussi, à leur contestation, et laissant la place, sinon au recul critique direct, du moins à la réflexivité investigatrice.
La critique portée contre Derrida est tout aussi ferme et tranchante. La posture déconstructionniste, selon Putnam, est bâtie sur un sophisme généralisant la dimension interprétative au sein de nos pratiques et théories : je n’ai pas besoin de tout interpréter pour savoir, tous les contextes n’exigent pas cette clarification, souligne Putnam là contre dans le fil de Searle et Austin. La perspective de Derrida extrapole une quête de fondement absolue, en fait un principe s’appliquant à tout jeu de sens ; elle confère qui plus est à cette régression un caractère sémantique (chercher un terme non interprétable). Or, un tel élargissement de la forme textuelle est indu : le type d’unilatéralité que Derrida déconstruit n’est en rien exigé par l’usage que nous faisons de notre rationalité dans notre recherche de la vérité.
Telle est bien la thèse centrale du pragmatisme de Putnam : rejeter l’absolutisme dogmatique et le relativisme comme deux faces d’une même erreur, les uns prétendant de l’extérieur de toute pratique déterminer unilatéralement les normes du vrai, les autres attaquant cette compréhension spécifique de la vérité pour contester toute pertinence à la question de la vérité en général. Il faut bien plutôt poser que l’intelligence s’exerce intersubjectivement à travers des formes collectives et historiques dont nous héritons et sur lesquelles nous nous appuyons. Nous ne sommes pas des intelligences vierges : nous pensons à partir de ce qu’on nous a donné et nous pensons ensemble. Il n’y a pas de sens à vouloir isoler un noyau algorithmique ou procédural de rationalité pure dont nous disposerions individuellement. Le pragmatisme, assumant la dimension d’emblée intersubjective et historique de notre existence, coupe à la racine les tentatives de conclure de cette historicité au relativisme.
Dans une telle perspective, ce n’est pas parce qu’on ne peut pas justifier et légitimer le progrès à l’aune d’une norme unique et transcendante qu’on doit nier qu’il y a sinon toujours du progrès, du moins des progrès réels. L’incommensurabilité entre monarchie absolue et démocratie, l’absence de référentiel commun opposée à ceux qui refusent de considérer la seconde comme un progrès par rapport à la première, est par exemple sophistique. Monarchie et démocratie rassemblent toutes deux des êtres rationnels, capables de distance par rapport à des systèmes dans lesquels ils évoluent et œuvrant de l’intérieur, avec plus ou moins de marges de manœuvre, d’outils, d’incitations externes à leur évolution. C’est à l’aune de cette rationalité située et pragmatique que le progrès doit être compris. C’est la difficulté à concilier les avancées de la physique avec le modèle admis par l’église qui conduit à ébranler son interprétation du monde. De même, les interrogations juridiques et institutionnelles nées au sein même de la monarchie absolue portent déjà en germe sa contestation en isolant l’élément du pouvoir, de la souveraineté et de l’état de l’instance qui les occupe ; la transition implique plutôt qu’une rupture brutale une lente élaboration de nouveaux concepts structurant à la fois l’état, son fonctionnement, les droits, rendent à leur tour possible notre conception de la démocratie. Il s’agit bien là en d’autres termes d’un processus d’apprentissage, d’une solution située mais rationnelle à des problèmes et conflits éthiques et politiques.
- Hilary Putnam, La philosophie juive comme guide de la vie, Paris, Cerf, 2011. On peut en consulter la recension [à cette adresse.
- What is mathematical truth ? in Putnam H. : Mathematics, Matter and Method. Philosophical papers. vol. 1. 1975. Cambridge University Press. pp. 60-78. Repris dans : Tymoczko T. (ed.) : New directions in the philosophy of mathematics. 1986. Birkhaüser. pp. 49-65.








