Hervé Clerc n’est pas seulement journaliste à l’Agence France-Presse : il est surtout l’auteur des Choses comme elles sont, un ouvrage qui aborde en termes simples les problèmes spirituels les plus profonds. L’homme d’esprit s’y livre avec franchise, sans artifice et parle de lui-même comme d’« un tiers, un étranger ». Il se défend d’être un sage ou un maître et déclare n’être pas bouddhiste, sinon de façon partielle et sélective1. Il se présente plutôt comme un inspiré, dans la mesure où il imite le modèle des sages. Hervé Clerc est en réalité un passeur : son ouvrage initie le lecteur au bouddhisme. Outre cette fonction propédeutique, il offre également une magistrale apologie du bouddhisme, à la fois intègre et nuancée.
Hervé Clerc ne s’attache pas à déterminer « l’essence du bouddhisme », mais plutôt à « engager un dialogue amical » avec lui, afin de le présenter aux esprits occidentaux (p. 31). C’est la raison pour laquelle l’ouvrage se présente sous la forme de « bribes » et de « fragments », d’« éléments de langage » qui, à la manière des pièces du jeu lego, s’agencent avec les représentations et les valeurs occidentales, pour composer un édifice inédit, « une nouvelle maison, plus flexible et plus résistante que la nôtre » (p. 25). Le livre s’adresse à un lecteur français caricatural qui, sous son béret, se tient habituellement « très éloigné du bouddhisme ». L’objectif est de montrer au tout-venant que le bouddhisme contient « quelques pistes pour éclairer la conduite souvent problématique de la vie », en présentant cet enseignement « sous la forme la plus simple et la plus dépouillée possible », qui est la seule que l’auteur prétende connaître. Le lexique placé en appendice retient les termes clés du bouddhisme, dont il formule des définitions à la fois précises et accessibles. En évitant l’analyse érudite, ces définitions parviennent à éclairer le sens profond de l’enseignement.
Qu’est-ce qui peut bien pousser un journaliste français à consacrer un ouvrage au bouddhisme ? Loin d’esquiver la question, l’auteur proclame qu’il « ne devrai[t] pas écrire sur le bouddhisme », faute de posséder la qualification universitaire requise. Néanmoins la justification de son projet ne tient pas à l’étendue de son érudition, mais bien à son expérience vécue, à sa profondeur et à sa singularité : « Je crois, sur l’expérience centrale du bouddhisme, disposer d’une information de première main ».
L’auteur ne présente pas un ouvrage neutre et purement théorique, dégagé de toute considération subjective. Les raisons qui l’ont conduit à écrire sont au contraire intimes et privées. Hervé Clerc livre les acquis d’une tentative personnelle : l’essai d’une réforme complète de l’existence, l’effort paradoxal de fixer une identité mouvante, de « recoller les morceaux d’un « moi » qui n’existe pas » (p. 46). Quelle a donc été la teneur de l’expérience vécue par l’auteur, pour qu’elle ait pu transformer si radicalement son existence, jusqu’à lui faire perdre l’évidence de son identité personnelle ?
L’expérience radicale et absolument singulière vécue par Hervé Clerc prend place dans un appartement parisien, 40 ans avant la rédaction de l’ouvrage, dans les années 70. Le retour sur ses conditions est important, parce qu’il s’agit d’une expérience paradoxale, à la fois désirée et impréparée. Désirée, elle l’était depuis l’adolescence, dès lors que l’auteur, affecté d’une inextinguible « soif d’absolu » (p. 204), s’est engagé dans une quête spirituelle ardente et passionnée. Quiconque sait, par son propre vécu, ce qu’une telle errance contient de tourments et de désillusions – comprendra que l’auteur en soit venu à désespérer sur le chemin spirituel et, partant, à consommer « une substance illicite, puissamment hallucinogène », utilisée à la façon d’un expédient, pour parvenir à « l’au-delà » désiré (p. 207). Néanmoins l’expérience qui s’ensuivît est apparue à l’auteur entièrement fortuite et inespérée ! L’expérience du nirvana surgit soudainement : elle est une survenue, un « scoop », un raptus extatis qui transporte la conscience bien au-delà de tout ce qu’elle pouvait espérer.
« Je n’avais pas voulu cela, et d’ailleurs je n’avais pas la moindre idée que cela existât ». 2
Alors qu’il cherchait Dieu, voici qu’il découvre…. « rien » !3. Le nirvana se caractérise en effet de façon négative, comme n’étant rien de ce que nous connaissons ordinairement : « soudain, rien occulta tout » (p. 210). L’auteur insiste à cet égard sur la duplicité du nirvana, c’est-à-dire sa double nature, dont le paradoxe ne peut s’exprimer qu’en termes de coïncidentia oppositorum, puisque le nirvana se présente à la conscience à la fois comme plénitude et comme vacuité ! Le nirvana est vide dans la mesure où il n’apparaît pas : il n’est pas un phénomène conditionné, mais l’inconditionné lui-même, l’absence d’expérience, « l’élément éteint ». Le nirvana n’est donc ni dans l’espace, ni dans le temps. Il ne s’agit pas d’un lieu, mais d’un état dépourvu de gradation, en sorte que l’« on est dedans ou dehors » (p. 44). S’il fait l’objet d’une « expérience-limite » (p. 40), reste qu’il ne contient en lui-même aucune limite, ce qui en fait une utopie au sens propre, aucun lieu n’étant dépourvu de limite. Il n’est pas au bout du monde, mais « ici même dans notre propre corps » (p. 50). Néanmoins il n’est pas dans le temps, puisqu’il incarne bien plutôt l’abolition de toutes les dimensions temporelles : « Et soudain plus rien. Je dis ce qui fut. Plus de sensations, de pensées, d’images. L’effet de la drogue avait cessé […]. Tout avait cessé. D’un coup : grande cessation, extinction, abolition. Et cependant ce n’était pas la mort » (p. 208).
Gardons-nous donc de confondre le nirvana avec un état ou une simple disposition subjective. S’il est précédé du sentiment de gravité et d’urgence rapporté par l’auteur, reste qu’en lui-même il constitue l’absence de toute sensation, de tout appui, de toute expérience. Le nirvana n’est donc pas la vision des choses telles qu’elles sont, puisqu’il survient lorsque tous les phénomènes se sont évanouis. Pour le dire autrement, le nirvana surgit lorsque la conscience perçoit la vacuité de tous les phénomènes : voir les choses comme elles ont suppose « un « non-voir » les choses », un acte de déconstruction qui entraîne la fusion unitive du sujet et de l’objet, lesquels s’abolissent dans la vacuité. L’auteur remarque à juste titre que, dans la mesure où ce néant annule l’homme, le « bouddhisme n’est pas un humanisme » (p. 212). S’il fallait exprimer cette expérience en termes religieux, il faudrait employer le lexique de la théologie négative. Néanmoins le nirvana se présente également comme plénitude et nouveauté radicale.
Confondre le nirvana avec le néant, c’est oublier qu’il est précédé d’un éveil de tous les sens, alors exacerbés ; qu’il s’accompagne d’un sentiment d’« évidence absolue » et d’une « intensification inouïe de la réalité » (p. 46 et 209) ; enfin qu’il est suivi d’un formidable soulagement, par quoi le rien apparaît « infiniment mieux – et plus réel que le reste ». Les impressions de « splendeur » et de « fulgurance » conduisent Hervé Clerc à nommer cette expérience « l’état inouï ».
Après cette expérience, l’auteur a vécu dans la douleur le retour à la vie ordinaire. Gagné par une « nostalgie dévorante » (p. 219), il entreprend alors d’explorer la littérature mystique orientale et occidentale. Il découvre de cette façon le bouddhisme et son fondateur atypique. Le Bouddha se présente comme un être singulier, unique en son genre et paradoxal, dans la mesure où il « réconcilie les contraires »4. A la fois « éveillé » et « éteint », grave et « toujours souriant » (mihita-pubbamgama), serein et simultanément pressé par un sentiment d’urgence, le Bouddha est également plein de compassion envers des êtres dont il reconnait pourtant la vacuité ! Cette gravité souriante conduit à poser à nouveaux frais le problème du mal, en se demandant comment il est possible de « sourire dans le malheur » (p. 118). L’essence du bouddhisme réside sans doute dans sa capacité foncière à admettre la contradiction et à dépasser tous les dualismes, en cultivant une « double ligne de conduit : retrait et rayonnement » (p. 106).
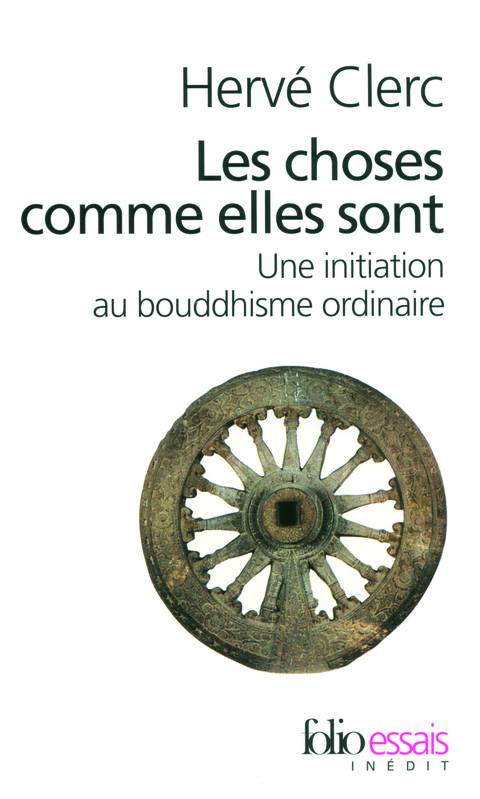
Le « bouddhisme ordinaire » présenté par l’auteur est un bouddhisme remodelé, simple et moderne, conforme à nos façons de penser et de sentir habituelles.5. Présenter une telle doctrine à des Occidentaux exige tout un « travail d’adaptation » : l’auteur remarque à juste titre que l’Occident n’a pas encore « renouvelé la physionomie du bouddhisme », au contraire de ce qui s’est passé en Chine, au Japon ou au Tibet. Pourtant le bouddhisme se prête aisément « au brassage, à la construction, à la déconstruction » (p. 25). C’est que, loin d’avoir appris à connaître le bouddhisme en profondeur, la culture occidentale s’est contenté de l’extraire de l’Orient pour le transplanter tel qu’el en Occident, ce qui produit « l’image d’un bouddhisme clérical, hiérarchisé, centralisé, emberlificoté ». En ce sens, le bouddhisme nous est encore inconnu 6. Il est pourtant au plus haut point capable d’enrichir et de renouveler notre identité, en éclairant des modes d’être qui nous demeurent obscurs et en nous apprenant « à voir d’un œil neuf, c’est-à-dire à revoir » (p. 30). Le bouddhisme n’a pas vocation à se substituer à notre culture, mais bien plutôt « à l’irriguer » (p. 70).
Apparemment contradictoire et aussi paradoxal que son fondateur, le bouddhisme semble « marche[r] sur la tête » (p. 36). De fait, quiconque l’étudie reconnaît rapidement qu’il pose un formidable « défi au sens commun » (p. 46). Loin d’être une religion rationnelle, il affirme que ce que nous tenons pour réel est irréel et il tient pour réel ce qui nous paraît irréel ! Ce renversement de toutes les valeurs, « de nature quasiment séismique » (p. 41), est le signe d’un « tout autre » qui demeure inaccessible aussi bien aux spirituels qu’aux matérialistes (p. 37). « Religion sans dogme », foncièrement adaptable et modulable selon les cultures et les époques 7, le bouddhisme évite néanmoins tout prosélytisme et demeure probe : « Le bouddhisme est la seule doctrine qui recommande à ses adeptes de ne s’attacher à aucune doctrine, pas même le bouddhisme » (p. 55).
Il apparaît, de ce point de vue, comme « la religion de la liberté que l’Occident cherche en tâtonnant, de crise en crise » (p. 55). Dire que le Bouddha « était le premier à tuer le Bouddha » signifie qu’il refusait toute position d’autorité. Il adoptait au contraire les coutumes, les manières d’être et jusqu’à l’intonation de ses hôtes, tout en prenant le soin de conserver toujours un langage « délibérément polysémique, flexible, ouvert à l’interprétation ». Le bouddhisme s’avère dans des « formulations infiniment diverses » : il adopte la diversité et « va au-devant d’elle, se plie à elle » (p. 58). Tout ce qui conduit à l’Eveil est, en ce sens, conforme à l’orthodoxie bouddhiste, à savoir « tout discours fécond, utile, favorable, habile (kuasala) » (p. 57).
Le bouddhisme est bien une religion, selon Hervé Clerc, puisqu’il est vécu comme telle par plusieurs centaines de millions de bouddhistes. La question est de savoir s’il peut ne pas être une religion. Le bouddhisme ne nie certes pas l’existence des dieux, mais il les considère néanmoins comme accessoires, dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires à la libération. Religion athée, le bouddhisme s’apparente à cet égard au taoïsme, tout en entretenant avec le christianisme des affinités que l’auteur prend le soin d’étudier – le comparatisme permettant ici de cerner, comme par contredistinction, le mystère du bouddhisme, « doctrine des cimes » (p. 95) qui demeure finalement incomparable et absolument singulière.
Comme toute grande vision du monde, le bouddhisme tient « en deux mots » : la douleur et la fin de la douleur ; ou pour le dire autrement : « les mortifications, le dépassement des mortifications, la lutte, le dépassement de la lutte » (p. 97). Lorsqu’il est envisagé comme religion, le bouddhisme apparaît comme « une religion de l’attention », la lucidité étant la voie qui conduit à l’Eveil spirituel. Exprimé en termes non religieux et plus proprement philosophiques, le bouddhisme présente une phénoménologie élaborée, dont la pratique consiste à « ouvrir les yeux sur la chose même, la voir dans sa nudité, posée, comme se donne à voir, sans écran, sans ego » (p. 193). La doctrine de l’Eveil s’identifie à l’action la plus triviale : nul besoin de rituel, de travail, puisqu’« il n’y a rien qui doive être cherché ni poursuivi » (p. 194). 8. Le terme qui qualifie le mieux cette démarche, lorsqu’il est entendu en son sens profond, est sans doute le terme « méditation ».
Une clarification lexicale est ici nécessaire : la méditation ne consiste pas à penser, mais à connaître, à « voir ce qui se donne à voir », autrement dit à pratiquer « un juste-voir » (p. 175) et comme à rassembler ses esprits pour « faire la part des choses ». Il s’agit d’une constante disposition à la vigilance, qui se confond avec la vie elle-même, ce qui en fait la « voie unique » (ekayano maggo) vers la libération. L’auteur prend le soin de distinguer, à cet égard, la pratique de la concentration, qui conduit à la tranquillité d’esprit (samatha) – de la pratique de l’attention (sati), qui conduit à la vision directe (vipassana) de la réalité. La description de la méditation sur la respiration, de la culture de l’amour bienveillant (metta) ou encore des nombreux plaisirs qui accompagnent le développement de l’esprit, permet d’éclairer le sens de ce que nous appelons « méditation ». Ni contemplation béate, ni sommeil quasi minéral des puissances de l’âme, la méditation est au contraire un acte de révolte courageuse : « L’arrêt pourrait bien être l’acte subversif par excellence ».
Le but de cette démarche est « de nous établir dans la continuité » (p. 189), ie. de maintenir une vigilance constante et de cultiver ce que l’auteur a le bon goût de nommer une « conscience de derrière ». Notons incidemment que la claire conscience revêt un rôle central également dans la philosophie occidentale, l’auteur remarquant à juste titre qu’elle est comparable à l’hêgemonikon des stoïciens (p. 113)9. Du reste, l’effet d’une telle pratique est essentiellement de développer, d’apaiser et de libérer l’esprit ; mais elle n’est pas sans produire des sensations d’un nouvel ordre, des impressions qui semblent provenir « d’un « au-delà » des sens » – sorte de « résonances » de l’âme et comme un avant-goût de l’Eveil.
Analysant le chemin qui conduit à l’Eveil, l’auteur note la difficulté qu’il y a à s’engager sur une voie dont on ne connaît pas encore la destination. Le paradoxe concerne ici de la notion de commencement en matière spirituelle, puisqu’« il faut cheminer un peu pour voir le chemin, il faut se mettre en position de voir » (p. 125). Autrement dit, l’intelligibilité des raisons du commencement n’apparaît qu’une fois le commencement dépassé ! Le commencement se précède lui-même, car ce qui l’appelle – ce qui motive l’engagement sur la voie – n’est ouvert que par le geste de commencer lui-même. Cette difficulté, célèbre en Occident 10, suppose dans le cas du bouddhisme de retrouver l’origine radicale, la source et les conditions d’apparition de la souffrance. La pratique méditative consiste précisément à retourner à la conscience du présent le plus immédiat, puisque « l’origine (samudaya) est intemporelle et s’actualise continuellement » (p. 127-8). La source de nos maux est bien le désir, cette « complaisance mystérieuse que nous éprouvons à goûter les choses comme elles ne sont pas ». Seulement le désir est, on le voit, contaminé d’ignorance, la source de la souffrance se trouvant dans la confusion mentale. L’erreur de l’esprit consiste à confondre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas et il n’y a pas d’autre errance (samsâra) que celle qui provient de cette inversion de toutes les valeurs (l’esprit confond le beau et le laid, le plaisir et la douleur, ce qui est substantiel et ce qui ne l’est pas, ce qui est stable et ce qui est éphémère). Sur ce sujet comme sur tous les autres point qu’il aborde, Hervé Clerc révèle les tensions propres à la démarche bouddhiste et il éclaire ces difficultés
La lecture des Choses comme elles sont n’est pas toujours aisée, du fait notamment de son style décousu, quasiment aphoristique. Cette difficulté est accusée par les allusions à certains concepts qui ne sont pas toujours analysés, tel que le « sans signe » évoqué par l’auteur11. Le plus étonnant est, bien plus, la franchise avec laquelle l’auteur déclare avoir connu l’Eveil. Difficile en effet de comprendre comment la drogue pourrait conduire à l’expérience du réel ultime ! Que signifie donc Hervé Clerc lorsqu’il affirme que la drogue a livré son « âme frêle, à l’essence de l’ondulation » ?
Hervé Clerc ne fait certes pas l’éloge des stupéfiants et reconnaît qu’ils peuvent avoir des effets opposés12. Néanmoins il semble déclarer des propos contradictoires à leur sujet, la drogue apparaissant à la fois liée à l’expérience de l’Eveil et sans rapport avec elle ! C’est bien dans un but spirituel que l’auteur a eu recours à une substance hallucinogène et c’est après l’avoir consommée qu’il aurait rencontré l’absolu. Afin de mieux expliquer la capacité de la drogue à nous rapprocher du sacré, Hervé Clerc s’appuie sur les recherches d’Henri Michaux, qui considère que « la drogue modifie nos appuis » sur nos sens, sur le monde et sur l’existence 13. L’auteur soutient pourtant que l’expérience de l’Eveil était pour lui inattendue (« Je n’avais pas voulu cela ») et qu’elle a surgi une fois que « l’effet de la drogue avait cessé […]. Tout avait cessé ». On voit mal comment l’esprit pourrait absorber « une substance puissamment hallucinogène » et cependant ne pas s’en trouver affecté dans sa vigilance et sa capacité d’attention, si essentielles à la connaissance de l’Eveil ! Que l’auteur ait, par la suite, perdu le contact avec l’absolu et qu’il l’ait recherché ardemment sans le retrouver : voilà qui peut facilement conduire un esprit méfiant à l’incrédulité. Hervé Clerc dissipe néanmoins habilement tous ces soupçons.
Si l’auteur a perdu le contact avec le nirvana, c’est sans doute qu’il a expérimenté « le nirvâna dont on revient », et non pas le nirvâna ultime et définitif, ou nirvana « sans retour » (p. 218). Surtout, cette expérience était impréparée et pour ainsi dire accidentelle, de sorte qu’elle n’a pas délivré son esprit de toutes les souillures14. De là l’incapacité à retrouver l’expérience du nirvana et l’épreuve d’une nostalgie de l’absolu dévorante, qui a néanmoins pour vertu d’avoir conduit l’auteur à écrire un ouvrage unique, lucide et d’une rare profondeur. A supposer que l’expérience vécue par l’auteur ait été trompeuse et illusoire, cette illusion a néanmoins transformé entièrement sa vie. Pour Hervé Clerc, il ne peut s’agir d’une illusion, puisqu’il en ressent encore aujourd’hui – quatre décennies après l’avoir vécue – les effets et les contrecoups, qui lui procurent « le sentiment de la contingence du monde et la conscience aigüe de l’ignorance dans laquelle nous nous trouvons » (p. 215).
Quelle qu’ait pu être la teneur de l’expérience vécue par l’auteur, elle l’a conduit à une recherche attentive et passionnée, dont Les Choses comme elles sont livrent le fruit savoureux. Conforme aux écritures les plus anciennes, dont il éclaire le sens profond, l’ouvrage s’inspire de ce matériau pour lui donner une forme inédite et produire une nouvelle manière de penser l’existence et le monde. Dans la mesure où la pensée bouddhiste parvient à dépasser toutes les oppositions métaphysiques (transcendant/immanent, intelligible/sensible, matériel/spirituel), elle est capable d’enrichir substantiellement la réflexion occidentale. Seulement cette contribution serait impossible sans un long travail d’éclaircissement, d’adaptation et de reformulation, dont l’ouvrage d’Hervé Clerc offre un modèle particulièrement abouti. De là un bouddhisme simple, décomplexé et accessible à tous – un bouddhisme nouveau qui est aussi le bouddhisme de l’avenir.
- Hervé. CLERC, Les Choses comme elles sont, Une initiation au bouddhisme ordinaire, Ed. Gallimard, Coll. « Folio essais », 2011 : « Moi, qui ne suis pas bouddhiste » (p. 103) ; « je ne suis pas pour autant devenu bouddhiste. J’en prends un peu et j’en laisse beaucoup. Je suis devenu […] un bouddhiste « partiel » » (p. 219) ; « Mon approche est dictée par l’expérience, c’est dire combien elle est parcellaire et insuffisante » (p. 171)
- « Je n’ai rien fait, rien mérité […]. Ce fut un coup heureux » (p. 44) ; « Je n’avais rien médité, rien prémédité » (p. 47).
- « J’ai nommé cet état rien. D’autres l’appelleront Dieu » (p. 211 ; cf. p. 209)
- « Solennel et bonhomme, grave et souriant, carré et subtil, droit et flexible, proche et distant » (p. 94). « Il constitue à lui seul une catégorie à part, hors série […] un être sui generis » (p. 102)
- Il s’agit d’un bouddhisme « inculte », dans la mesure où il n’est « pris dans aucune culture » (p. 15). Hervé Clerc évoque un « bouddhisme de poche, morcelé, pliable, aimable, assimilable, ordinaire, pour voyageur qui ne veut pas s’encombrer […] étonnement moderne, en conformité avec notre raison et notre sensibilité » (p. 26)
- « Le bouddhisme est encore pour nous l’étranger » (p. 31) : il s’agit d’« une idée (relativement) neuve en Europe » (p. 27), avec laquelle « nous faisons encore connaissance » (p. 28)
- « Mongol avec le Mongols, chinois avec le Chinois, tibétain avec le Tibétains » (p. 55)
- « Chier et pisser, voilà le bouddhisme (voilà la phénoménologie). Il n’y a pas de travail à faire dans le bouddhisme […]. Il n’y a rien qui doive être cherché ni poursuivi » (p. 194)
- La gravité du sage stoïcien s’exprime dans la vigilance ou circonspection (eulabeia, cautio ; par opposition à la crainte) qu’il montre à être respectueux d’autrui, et dans la pureté de ses actions, qui révèlent l’harmonie profonde du cosmos. S’il est inaccessible au chagrin, c’est précisément que sa vigilance n’est jamais prise en défaut. La vigilance fait partie des bonnes passions (eupathies) : elle est une des espèces raisonnables (eulogaz) de « l’impulsion vers un bien » (orexîs) et de « l’aversion contre un mal » (ekklîsîs, declînatîo ; cf. Epictète, Entretiens, in fine ; et Diogène Laërce, Vies, doctrines et Sentences des Philosophes illustres, VII, 116). Le stoïcisme romain invite à la retraite en soi-même et vers soi-même (anachorésis), une façon pour l’individu de se couper du monde extérieur pour se retirer en lui-même (Marc-Aurèle évoque la purification des représentations, la vérification des phantasiai, la distinction entre représentations pures et impures, etc.). Auparavant, l’Antiquité grecque conférait déjà à l’attention une importance capitale. Dès le VIème siècle av. JC, les milieux des sectes conçoivent la vertu aristocratique (aretè) comme le produit d’une ascèse et d’une discipline, qui impliquent selon Vernant un « contrôle vigilant sur soi, une attention sans relâche » (épimeleia) afin d’échapper aux « tentations du plaisir » (hedonè), à la mollesse et la sensualité (malachia et la truphè), en consacrant sa vie à l’« effort pénible » (ponos ; cf. Vernant, Les Origines de la Pensée grecque, ch. 6). La concentration de l’âme est également au cœur de la conception platonicienne de la purification (katharsis), qui consiste à habituer l’âme à se concentrer en elle-même et à résider en elle-même, autant que possible (Platon, Phédon, 67 c et 83 c ; cf. également Plotin, Ennéades et Hadot, Plotin ou la simplicité du regard, Folio essais, p. 139 et p. 162). Cette pratique de l’isolement, de l’anachorésie, de la retraite en soi-même se manifeste essentiellement par l’immobilité, à commencer par celle de Socrate, lequel restait, pendant la guerre, seul, immobile, droit, les pieds dans la neige, insensible (cf. Platon, Banquet) – l’immobilité du corps étant le signe de la tranquillité d’un esprit qu’aucune agitation ne vient troubler. Reconnaissant les vertus salvatrices de l’attention, la tradition chrétienne lui confère une fonction sotériologique, manifeste dans la pratique de la prière du cœur, décrite dans la Philocalie, un manuel de prière orthodoxe (cf. La philocalie, Les écrits fondamentaux des pères du désert aux pères de l’Eglise, trad. TOURAILLE J., Desclée de Brouwer/J.-Cl. Lattès, Paris, 1995, p. 626. Cf. l’art. de DEPRAZ N., « Pratiquer la réduction : la prière du cœur » in : Laval théologique et philosophique, Vol. 59, n°3, octobre 2003, p.503-519, et, sous forme remaniée, in Alter n°11, Paris, 2003). A la modernité, l’attention revêt un rôle épistémologique central, notamment dans les philosophies de la conscience qui apparaissent à l’âge classique. Elle définit selon Descartes la clarté d’une représentation (Descartes, Principes de la philosophie, I, art. 45) et permet d’expliquer certaines passions de l’âme, telles que l’admiration (cf. Passions de l’âme, art. 70). Leibniz quant à lui en fait la condition de la réflexion de la conscience (ou « aperception », cf. Leibniz, Nouveaux Essais sur l’Entendement humain) et de la connaissance en générale, l’erreur trouvant sa source première dans un problème d’attention (la distraction ; cf. Remarques sur les principes de Descartes). L’importance de l’attention est manifeste également dans la sphère pratique, Leibniz lui reconnaissant une fonction apotropaïque, puisqu’elle permet de préserver l’esprit des intentions qui peuvent conduire à commettre des actions délictueuses ou destructrices, pour soi-même comme pour autrui. La culture de l’attention apparaît bien plus comme une condition du bonheur : Pascal enjoint le lecteur à prendre conscience du présent et de la misère actuelle, afin de convertir l’âme vers le divin (Pascal, Pensées, Ed. Lafuma, fragment 56 ; cf. les objections de Voltaire dans sa Vingt-cinquième Lettre philosophique). A l’époque contemporaine, enfin, l’attention fait l’objet de nombreux travaux, d’abord dans le domaine de la psychologie (cf. notamment William James, Principes de Psychologie et Précis de Psychologie) ; mais c’est surtout la phénoménologie qui fera d’elle son outil princeps, en la plaçant au cœur de la méthode réductive (cf. Husserl, Ideen I, § 92 et Phénoménologie de l’Attention, VRIN, 2009)
- Comparant, dans un rapprochement avec Platon, l’attitude naturelle de la phénoménologie au « royaume des ombres » que décrit le mythe de la caverne de la République, et la voie réductive à l’ascension du prisonnier vers le monde extérieur, Fink observe que « le caractère illusoire des ombres n’apparaît qu’une fois l’ascension effectuée : la motivation de l’ascension présuppose l’accomplissement de l’ascension ; le commencement se précède lui-même » (E. FINK, De la phénoménologie). Platon considère en effet que le commencement est « ce qu’il y a de plus important » (République, II, 377b) et va jusqu’à le comparer à « un dieu qui […] sauve toute chose » (Lois, VI, 775e). Averti que « le commencement est la moitié du tout » – selon le mot de Pythagore –, Platon insiste sur l’exigence de « commencer par le commencement naturel ». Aristote considère quant à lui qu’en philosophie, tout commence par l’étonnement (cf. Aristote, Métaphysique, A 3). Néanmoins pour le Stagirite il ne faut pas toujours « commencer par le commencement et par la notion première de l’objet, mais par ce qui peut le mieux en faciliter l’étude » (Métaphysique, D 1). A la Modernité, la philosophie commence par le doute, comme c’est le cas chez Bacon et Descartes (« qui saura se contenter de commencer par des doutes finira par des certitudes », Bacon, Du Progrès et de la Promotion des Savoirs, I). Ce scepticisme conduira Pascal à reconnaître l’impossibilité d’une méthode idéale en géométrie, l’esprit humain étant incapable d’aller au-delà de certains mots primitifs indéfinissables et de principes indémontrables (Pascal, De l’esprit géométrique). De façon générale, la philosophie moderne fonde la réflexion dans un principe ou une puissance première ; néanmoins il en va autrement chez Hegel, pour qui l’absolu n’est pas un principe mais un processus. Conscient de la difficulté qu’il y a à introduire le lecteur à une façon de penser radicalement nouvelle, Hegel donne une formule explicite du problème du commencement dans la Préface de la Phénoménologie de l’Esprit. Comme l’apprentissage d’une science suppose toujours une préparation de l’esprit, il n’y a pas en science de « commencement absolu » ou abstrait, c’est-à-dire « un commencement qui ne serait que commencement » (Hegel, Introduction à l’esthétique, ch. 1). Au XXème siècle, la difficulté resurgit, notamment chez Wittgenstein, qui remarque combien « il est difficile de trouver le commencement. Ou mieux : il est difficile de commencer au commencement. Et de ne pas chercher à aller plus loin en arrière » (Wittgenstein, De la Certitude, § 471). Surtout, la phénoménologie témoigne d’une conscience aigüe de ce problème : conformément au « principe des principes » (le recours à l’intuition originaire comme source de la connaissance), la phénoménologie se situe au « commencement du commencement » (Husserl, Idées directrices pour une philosophie et une phénoménologie transcendantale I, trad. P. Ricoeur, Gallimard, Coll. « Tel », Paris, 1950, introduction, p. XXXVIII). Le « sérieux du commencement » revendiqué par Husserl (ibid., p. XXXVIII) exprime donc une exigence de radicalité : le donné intuitif est le seul « point de départ » légitime, parce qu’il est « antérieur à tout point de vue […] antérieur même à toute pensée qui élabore théoriquement ce donné » (ibid., § 20, p. 69). A cet égard, le courage est, comme le note Jankélévitch, « la vertu inaugurale du commencement » (Jankélévitch, Traité des vertus)
- Cf. p. 12, où il faut sans doute lire animitta au lieu de « animatta ».
- « La même clef ouvre et ferme. Le même escalier monte et descend » (p. 208).
- La drogue « modifie nos appuis : l’appui que nous prenons sur nos sens, que nos sens prennent sur le monde et celui que nous prenons sur « notre impression générale d’être » » (p. 209), cf. Michaux, Connaissance par les gouffres
- « Ce fut un accident. Je n’avais pas fait mes classes. Il n’y eut pas de longues années de yoga et de méditation avant et après, qui m’auraient donné un vernis de sagesse »








