Très récemment a paru une série d’opuscules hégéliens, regroupés autour d’un thème commun : les œuvres de jeunesse. Il ne s’agit pas là des classiques Foi et savoir ou L’esprit du christianisme mais bien d’œuvres datant de l’époque lycéenne de Hegel, où ce dernier s’essaye à quelques textes tournant essentiellement autour de la religion. C’est pourquoi, le point d’orgue du recueil est constitué par La vie de Jésus, sorte de tentative hégélienne de relire les évangiles dans une perspective philosophique, encore teintée d’un certain kantisme et d’une philosophie de la subjectivité.
Le plus ancien texte présenté dans le recueil1 date de 1785 c’est-à-dire que, lors de sa rédaction, Hegel n’avait que quinze ans ; selon les éditeurs, il s’agit du plus ancien texte connu de la main de Hegel, lequel met en scène Octave, Antoine et Lépide ; il est difficile de tirer une substance philosophique de ce petit dialogue, qui relève davantage de l’exercice de style littéraire que d’un véritable essai philosophique. De même, en 1787, l’essai sur la notion de grandeur ne contient-il rien de vraiment puissant ni de novateur, sinon l’insistance sur la relativité du temps et de l’espace.
Plus intéressant me semble être le court essai consacré à la religion des Grecs et des Romains, où, à l’âge de 17 ans, Hegel établit une naturalitéde la religion à l’humanité, si bien que l’on ne saurait concevoir celle-ci sans celle-là : « Pour ce qui est de la religion, les Grecs et les Romains suivirent la voie de toutes les nations. L’idée d’une divinité est si naturelle à l’être humain qu’elle s’est développée chez tous les peuples. Dans leur enfance, dans l’état originel de la nature, ils pensaient Dieu comme un être tout-puissant les régissant, eux-mêmes ainsi que tout ce qui est, simplement selon son bon-vouloir. »2 Mieux que cela : outre la consubstantialité de la religion à la nature humaine, Hegel en note l’absence relative de progrès, d’une époque à l’autre ; à l’encontre des textes de maturité où le christianisme apparaîtra comme un accomplissement et un progrès effectifs, cet opuscule de jeunesse témoigne d’une admiration telle pour la religion antique que Hegel n’envisage pas la possibilité d’un progrès effectif. « C’est ainsi qu’ils concevaient leur divinité, et les représentations de la plus grande part des hommes de notre époque soi-disant éclairée ne sont pas différentes. »3
A : Le vulgaire et l’élite
Un thème majeur apparaît dès les années 1787, à savoir une dissociation fort explicite entre ce qui est bon pour le peuple (Hegel dit « la plèbe) et ce qui est valable pour les élites ; l’ensemble des textes de jeunesse repose ainsi sur une dichotomie essentielle entre ce qui est accessible au peuple, inculte et essentiellement limité, et la vérité même de la religion, accessible à l’élite – on n’ose dire à quelques initiés. Mais derrière ce qui pourrait passer pour une attitude somme toute méprisante, se profile déjà l’exigence hégélienne de penser la nécessité de cela même qui innerve l’être, selon ses contradictions ; ainsi, cette représentation basse de la religion dont le peuple a besoin, n’est pas sans gains, et si le concept de nécessité rationnelle n’apparaît pas encore, on pressent malgré tout quelque chose comme une tentative de rationaliser la nécessité d’une telle dichotomie : « La plèbe de tous les peuples attribue à la divinité des caractéristiques sensibles et humaines, et croit en des récompenses et punitions arbitraires. Au demeurant, ces opinions sont pour leurs passions le frein le plus puissant. »4 Ce que Hegel suggère en ces termes, c’est que, derrière les représentations médiocres que la « plèbe » se fait de la divinité, réside sinon une rationalité, à tout le moins une utilité régulatrice, une instance éthique, permettant à ceux pour lesquels le savoir est insuffisant de moduler leur vie en fonction de principes appréhendés comme transcendants.
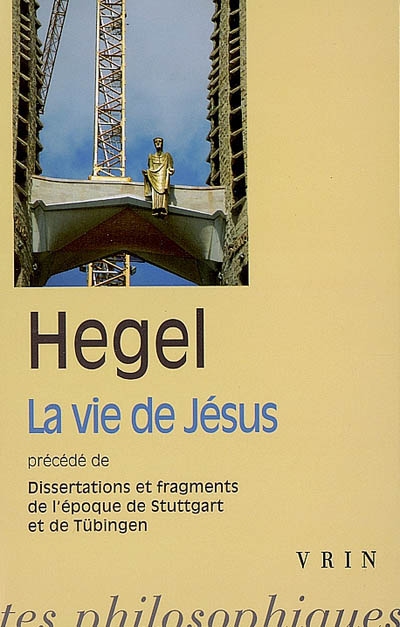
Le texte de 1788 consacré aux poètes anciens file la dichotomie et reconduit l’idée d’une forme de religion – et même d’art – spécifique au bas peuple. Mais plus on avance dans le temps, et plus Hegel voit cet art destiné au peuple comme le signe d’une absence de vérité ; ainsi les contes populaires sont-ils « des récits d’aventure qui n’ont de rapport ni avec notre système religieux ni avec l’histoire véritable. »5 Toutefois, de ces « fêtes grossières »6 données en l’honneur de Bacchus sortira malgré tout la tragédie, la grande tragédie grecque, ce qui invite à ne pas outrer l’hétérogénéité de la culture populaire et de la culture de l’élite : bien que Hegel se refuse à attribuer quelque caractère de vérité à l’art destiné à la plèbe, il n’en demeure pas moins que tout se passe comme si ce dernier constituait le terreau favorable à l’éclosion d’une forme d’art – ou de religion – supérieure, comme si, en somme, dès 1788 les oppositions étaient moins tranchées qu’on ne le croit et déjà en voie d’une résorption certaine dans un mouvement ascendant.
Notons enfin que l’essai de 1792-1793, intitulé « la religion est l’affaire la plus importante de notre vie », repose tout entier sur un questionnement qui confirme ce que nous venons de dire : tout le problème auquel se confronte Hegel est celui de la vérité qu’il est possible d’inscrire dans une religion faite pour le peuple ; comment une religion populaire doit-elle être conçue pour guider vers la raison ? Autrement formulée, cette question revient à se demander quel est le degré de vérité qu’il convient d’introduire dans la religion destinée au vulgaire, afin de guider ce dernier vers le vrai. D’une part, cela signifie bien que ce qui est destiné au peuple ne saurait contenir la vérité – comme totalité – mais d’autre part, il est patent que la religion populaire y conduit : de ce fait, la dichotomie existe bel et bien, mais elle n’est pas définitive en tant que cela même qui est contenu dans la religion populaire peut constituer un guide idoine pour le peuple vers la vérité rationnelle.
B : L’épreuve de la vérité
S’il est un problème dont Hegel semble être très précocement conscient, c’est de celui de la vérité : ô combien celle-ci lui apparaît comme une quête difficile, à l’issue incertaine ! L’opuscule de 1787 consacré à la religion des Grecs et des Romains nous convainc de cela : « L’effort répété de ces hommes à rechercher la vérité nous convainc de la difficulté d’atteindre à la vérité pure et non entachée d’erreurs et montre combien souvent l’homme reste en panne au milieu du chemin qui mène à elle, osant certes souvent aller plus loin, souvent déviant du bon chemin, souvent ébloui par une apparence trompeuse, prenant une ombre pour la réalité. »7 Cela pourrait sembler banal si l’on n’y voyait que la marque d’une difficulté : mais en réalité, cela engage une philosophie entière : dès lors que la vérité s’annonce comme une tâche presque impossible, en tout cas ardue, cela ouvre et ferme en même temps plusieurs voies : la voie intuitive se trouve d’emblée bannie en tant qu’elle assurerait une immédiateté par trop aisée de l’accès au vrai. En revanche, le chemin sinueux et parfois déconcertant de la quête se trouve sollicité, et prépare déjà le difficile cheminement dialectique, décrivant « la patience du concept » dont Gérard Lebrun a si bien parlé, et que les Grecs, déjà, avaient éprouvée.
Il ne me semble donc pas outré d’affirmer que dès ses 17 ans, Hegel ferme la voie à toute saisie immédiate, intuitive de la vérité, et ce en raison même de la nature de celle-ci : comme la nature, elle aime à se cacher et seul un cheminement long et méticuleux parviendra à la découvrir. Du reste, dans l’essai de 1788 sur la comparaison des poètes anciens et modernes, Hegel remarque que la difficulté même de trouver la vérité se traduit historiquement : « Les nombreuses contradictions des philosophies de l’Antiquité, en particulier dans leurs spéculations sur la partie pratique de la sagesse du monde, ont au moins allégé la difficulté à trouver le juste milieu où se trouve la vérité. »8 Probablement serait-il prématuré d’y voir une correspondance du déploiement du concept et de l’effectivité historique, mais il n’en demeure pas moins que Hegel s’efforce déjà de constater dans l’histoire les effets du concept : ainsi, la difficulté même de découvrir la vérité se traduit-elle dans l’histoire par les contradictions grecques qui, loin d’être le signe d’une défaillance grecque, témoignent ben au contraire de la réalisation historique du concept de la vérité.
C : La religion sensible au coeur
Le premier vrai essai de ce recueil est celui de 1792-1793 consacré à la religion comme affaire principale de notre vie. D’inspiration kantienne, il insiste nettement sur la dimension subjective de la religion au point de faire de celle-ci un attribut du cœur et de la moralité ; ainsi, loin d’être une science historique ou une science des propriétés de Dieu, la religion est d’abord cela même qui nous invite à la moralité sublime. « La religion donne donc à la moralité et à ses mobiles un nouvel élan plus sublime, elle renforce la digue destinée à retenir la puissance des impulsions sensibles. »9 C’est donc à un éloge de la religion subjective que se prête Hegel car « La religion subjective est vivante, agissante à l’intérieur de l’être, activité tournée vers l’extérieur. »10 Une telle appréhension de la religion conduit inévitablement à dévaloriser la religion objective, laquelle se trouve réduite rapidement à l’inessentialité. « Tout dépend de la religion subjective, c’est elle qui a une valeur intrinsèque – les théologiens peuvent se disputer sur les dogmes, sur ce qui appartient à la religion objective, sur les définitions précises de ses propositions ; de toute manière toutes les religions n’ont à leur base que peu de principes fondamentaux qui ne sont en chacune d’elles que plus ou moins modifiés, déformés, présentés plus ou moins purement, qui constituent le fondement de toutes les croyances et de tous les espoirs que nous offre la religion. »11 Pis que cela, la religion objective se trouve ramenée, quant à son être même, à la religion subjective qui, en fin de compte, mérite seule le nom de « religion » véritable : « Je ne parle de religion objective que dans la mesure où elle est partie constituante de la religion subjective. »12
Il serait bien difficile de trouver, dans ce texte de jeunesse, une quelconque trace de la supériorité du christianisme, que Hegel n’a pourtant cessé de décrire dans ses œuvres de maturité : tout se passe au contraire comme si, pétri d’un esprit des Lumières tardif, Hegel réduisait la religion à la sincérité et à la moralité, comme si en somme tout homme sincère et moral parvenait ipso factoau divin. De là cette remarque œcuménique avant l’heure, rappelant nettement Nathan der Weisede Lessing : « Celui qui appelle son Jéhovah Jupiter ou Brahma et est un véritable adorateur de dieu, témoigne de sa reconnaissance et accomplit son sacrifice comme le véritable chrétien, d’une manière tout aussi innocente. »13
Ce à quoi procède Hegel en réalité dans ce texte, c’est à une naturalisation de la religion : puisque cette dernière est essentielle à tout homme, le problème n’est plus tant de penser la révélation que d’accorder chaque révélation particulière avec la religiosité de chaque homme, et donc de déterminer qui de la révélation et de la nature humaine aura la priorité. Pour des raisons évidentes, Hegel privilégie la nature humaine ainsi qu’en témoigne ce passage : « Même si leur autorité repose sur une révélation divine, les doctrines doivent être nécessairement constituées de telle manière qu’elles soient autorisées, en réalité, par la raison universelle des hommes, que leur caractère obligatoire soit compris et ressenti par chaque homme dès lors qu’il y prête attention ; car des doctrines qui soit nous indiquent un moyen particulier d’obtenir la bienveillance de Dieu, soit promettent de nous apporter quelques connaissances particulières supérieures, (…) n’atteindront certainement jamais, parce que leur rapport avec les véritables besoins et les exigences de la raison n’est jamais naturel et parce qu’elles se prêtent facilement à des abus, même si cette liaison est cependant fermement établie par l’habitude, n’atteindront jamais, dans le sentiment, l’importance d’un moment pur, véritable et pratique portant immédiatement sur la moralité. »14 L’accord rationnel universel enraciné en l’homme désigne, comme chez Kant, la rationalité pratique : c’est en elle, et en elle seule, que réside l’enracinement du religieux. Il n’y a donc rien de vraiment surprenant à lire une Vie de Jésusqui consiste essentiellement en traductions de passages des évangiles, insistant sur l’intériorité de la foi, et sur le Dieu immanent au cœur dont Jésus est venu annoncer la (bonne) nouvelle.
Il est toujours difficile de déterminer l’intérêt réel de textes de jeunesse de philosophes qui, par la suite, sont devenus des géants de la pensée ; assurément, si l’on en restait là, Hegel ne serait rien d’autre qu’un disciple à peu près fidèle du kantisme dominant de la fin du XVIIIè siècle. Mais l’intérêt naît lorsque l’on cherche quelques « traces » d’une pensée ultérieure contenue en germe dans les tentatives encore balbutiantes d’exprimer une pensée naissante. Toutefois le danger s’avère alors être celui de vouloir trouver à tout prix dans ces textes de jeunesse des concepts qui n’y sont pas, des intuitions qui n’y résident pas réellement : lire les textes du lycée à partir de la Phénoménologie de l’Espritpermet certes de donner du sens et de l’intérêt à des textes peut-être banals sans cela, mais charrie aussi le risque de conférer à ceux-ci plus qu’ils ne contiennent effectivement : ce qui demeure certain, c’est que la position que défend Hegel sur la religion dans ces années-là est appelée à être infiniment dépassée par la suite, à tel point que l’on se prend à penser que la position que Hegel critique dans les Lumières n’est pas sans évoquer la sienne propre des années 1792-1793…








