Entretien avec Pierre Caye : autour de Durer. Eléments pour la transformation du système productif (partie I)
DEUXIÈME PARTIE : DES RESSOURCES DU NEOPLATONISME À L’ARCHITECTURE
AP : Dans une telle situation, celle du déferlement sans limite des forces du marché et de la technique, vous jugez que nous nous trouvons face à une alternative. Vous l’avez en quelque sorte déjà évoquée ci-dessus dans votre commentaire de l’œuvre de Joseph Schumpeter : « Il existe deux façons de répondre à cette question, deux voies pour réguler l’instabilité menaçante des systèmes complexes : soit par la vitesse, soit par la tenue […] » (Morale et Chaos, page 18).

On imagine bien, en suivant vos analyses précédentes, que la première option ne conduise finalement qu’à entretenir le régime de la pleine puissance de l’ontologie. Alors : en quoi l’hénologie, c’est-à-dire la pensée de l’Un de la tradition platonicienne et néoplatonicienne, ouvre-t-elle le chemin de la tenue ? En quoi consiste exactement ce changement de perspective sur l’histoire de la métaphysique ?
PC : Le néoplatonisme, et en particulier le néoplatonisme originaire, celui de Plotin, Proclus et Damascius, est une philosophie pour notre temps, peut-être même la philosophie de notre temps, et cela pour deux raisons. D’abord, parce que c’est une philosophie qui pense l’Etre comme production, procession et déploiement. Il est vrai qu’avant elle la physique stoïcienne, avec son feu artiste et son jeu incessant de transformation des éléments, nous le donnait aussi à penser. Mais le néoplatonisme y ajoute une perspective absente du stoïcisme : pour le néoplatonisme cette procession est entropique, en tant que le moteur de la procession est moins le principe qu’au contraire l’attraction de l’être par le non-être, « la fuite vers le néant » dit Plotin qui se traduit par un processus de dispersion et de dissémination : ce que Plotin et toute la suite du néoplatonisme après lui appellent la skédasis. Le terme de skédasis provient lui-même du verbe qu’emploie Hésiode dans les Travaux et les Jours pour décrire la propagation des maux hors de la boîte de Pandore. C’est la raison pour laquelle le néoplatonisme refuse de s’en tenir à la seule ontologie trop affectée de négativité, et pose un premier principe epekeina tês ousias, pour reprendre les termes mêmes de Platon au livre VI de la République, un principe « au-delà de l’être » ou « au-delà de la substance ». Ce principe est l’Un, une force ou une instance néguentropique qui, dit Plotin, sauve les étants, c’est-à-dire stabilise la procession, règle ses intervalles, et garantit la cohérence et l’unification de chacune des entités de sorte qu’elles participent, par leur unification même, à l’un et qu’elles puissent ainsi résister à l’attraction du néant. Or, ne sommes-nous pas aujourd’hui dans une phase de production entropique, d’intense renouvellement des étants, de transitions incessantes, conduisant à une usure accélérée du monde ? Cette situation m’a conduit à définir, à partir du néoplatonisme, ce que j’appelle la différence hénologique qu’il faut bien distinguer de la différence ontologique. La différence ontologique postule que le principe de production qui rend raison de l’existence des étants est étouffé et épuisé par l’existence même des étants au point qu’il vient à en perdre sa capacité à régner, à transformer le réel, à faire histoire. Telle est la malédiction que le règne de la technique fait planer sur le monde. Dans ces conditions instaurer la différence ontologique consiste à libérer l’être de ses étants pour qu’il retrouve sa capacité à susciter l’émerveillement, elle-même cause pour Aristote du questionnement philosophique, et que l’homme retrouve ainsi, au-delà de sa relation aliénante aux objets, le lien direct avec l’Être dont dépend son humanité même. Il s’agit ici de sauver l’être des étants, alors que la tâche du néoplatonisme est exactement l’inverse : sauver les étants de l’être, de sa skédasis, de sa négativité, de sa marche vers le néant. Et c’est pourquoi le néoplatonisme distingue radicalement du principe d’existence qu’est l’être un principe de cohérence qui est l’un. L’être en tant que principe de l’existence répond à la question ; « Pourquoi y a-t-il de l’être plutôt que rien ? L’un, en tant que principe de cohérence : « Pourquoi y-t-il de l’ordre plutôt que du chaos ? » L’un est cette part de la réalité qui ne procède pas, qui reste totalement immuable dans son ermitage, tandis que l’être est la part qui procède et fait monde. Dans la tradition philosophique usuelle, un être est un être. L’être assume de soi-même sa cohérence et son unité, du fait même d’exister. Les deux questions, celle de l’existence et celle de la cohérence se rejoignent sous le couvert de ce qu’on appelle la convertibilité des transcendantaux. Dans ces conditions, il n’existe aucune différence entre produire et conserver. C’est cette convertibilité que le néoplatonisme remet en cause. La différence hénologique signifie donc clairement que l’existence ne signifie pas nécessairement la cohérence, qu’il faut que quelque chose retienne et maintienne la procession, sans y participer. Ou pour le dire en terme plus trivial, plus économique : il faut garder pour donner, ou, plus exactement, il faut donner pour mieux garder : giving for keeping. C’est ainsi que Maurice Godelier interprète l’énigme du don à l’origine des sociétés. On comprend mieux alors la nécessité de sauver les étants, du moins un certain nombre d’entre eux, du mouvement de l’être. La différence hénologique permet ainsi de donner un fondement métaphysique à la nécessaire dialectique que réclame le développement durable entre production et conservation.
Heidegger considérait que le règne de la technique et l’exposition universelle des étants conduisaient à l’oubli de l’être, c’est-à-dire à l’oubli de la différence ontologique, au fait que l’être se trouve entièrement assimilé et réduit à ses produits, et que cet oubli de la différence ontologique devait irrémédiablement conduire à l’oubli de la différence anthropologique entre l’homme, l’animal et la machine. Mais ici la question de l’entropie en jeu dans tout déploiement et mouvement de l’être n’est pas posée, ou plus exactement elle est posée au niveau des étants, mais non pas au niveau de l’être. Le règne des étants est blocage et pétrification ; mais que le mouvement de l’être lui-même puisse être une cause d’usure et d’épuisement n’est pas envisagé par Heidegger. Si le monde s’use et devient obsolète, c’est ici parce que le mouvement de l’Être est entravé par la persistance des étants. De fait, il y a dans le mouvement de l’être affranchi de la pesanteur de ses étants quelque chose qui ressemble à la destruction créatrice comme en témoigne tout particulièrement la conférence d’Heidegger de 1946 sur La parole d’Anaximandre.
Il me semble au contraire que nous souffrons aujourd’hui de l’oubli de l’un. La marchandisation généralisée des sociétés et l’accélération du système productif ont fait sauter tous les verrous de conservation et de protection des étants, que la dialectique de la production et de la conservation, de ce qui s’échange et de qui se garde, de l’in commercio et de l’extra commercium, n’avait cessé de poser dans notre droit et dans notre culture, déverrouillage que traduit la désinstitutionnalisation de nos sociétés, et qui apparaît comme la condition de la mobilisation intensifiée des biens et des hommes.
L’oubli de l’un dans l’histoire de la métaphysique est le résultat d’une double opération :
1) La métaphysique n’a cessé dans son histoire de procéder à la convertibilité de l’être et de l’un, et ce faisant d’assimiler l’un à l’unité du tout, à l’unitotalité que les ontologies sauvages que j’ai évoquée, souveraineté absolue ou virtualité infinie, ne remettent pas nécessairement en cause. Il est vrai que la tentation de l’unitotalité est déjà perceptible dans un certain nombre de passages du néoplatonisme, en particulier chez Damascius. La différence hénologique est une pensée difficile, exigeante, toujours à la limite de son impossibilité.
2) Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la philosophie s’efforce de défaire les unitotalités et de dissocier être et un, engageant ainsi d’une certaine façon un retour à l’inconvertibilité des transcendantaux. On connaît la formule méthodologique d’Aristote : « Le chemin d’Athènes à Thèbes n’est pas le même que celui de Thèbes à Athènes » ; autrement dit, dissocier l’être et l’un ouvre deux voies différentes, voire contraires : soit on dissocie l’être de l’un, soit on dissocie l’un de l’être. Dissocier ou affranchir l’être de l’un conduit à la suppression définitive de l’un et, par voie de conséquence, à la multiplicité pure, à l’infiniment infini, apeiria apeirakis, comme le dénonce le néoplatonisme. Ici, l’oubli de l’un est radical : ce n’est plus simplement la différence hénologique qui est supprimée comme dans l’unitotalité, mais toute modalité d’unification quelle qu’elle soit. Il reste que, parmi les nombreuses philosophies de la multiplicité qui émaillent notre époque, aucune n’est en mesure de répondre à l’aporie que Platon leur oppose dans le Parménide et que le néoplatonisme ne cesse de rappeler, à savoir que la multiplicité pure, dénuée de tout mode d’un, est nécessairement inconsistante et inconnaissable, et relève d’une impossibilité métaphysique, ou d’un jeu de l’esprit, puisque toute connaissance et toute consistance réclament nécessairement des points d’unification et de synthèse, aussi nombreux et partiels soient-ils. Et c’est pourquoi ces philosophies de la multiplicité finissent par véhiculer en contrebande, en raison même de leur dénégation de l’un, des retours brutaux et sauvages d’unitotalité comme le manifeste le fonctionnement mondialisé du marché. L’autre voie – affranchir l’un de l’être – préserve à la fois l’unité et la multiplicité et permet de les concilier sans en passer par l’unitotalité ; par là même elle permet aussi de concilier la dialectique de la conservation et de la production dont, je le rappelle, dépend un développement vraiment durable. C’est le sens même de la différence hénologique.
AP : Cette reconstruction de l’histoire de la métaphysique que vous opérez à partir du stoïcisme, mais surtout du néoplatonisme, n’a pas vocation à rester dans le giron de l’histoire des idées ; elle est en effet grosse d’analyses et de pistes d’action pour notre époque. Si dans l’ordre de la métaphysique l’Un assure la tenue de l’Être qui sans son action deviendrait multiplicité pure, quels sont alors les vecteurs d’adunation des communautés humaines qui les préservent de tomber dans l’ « anomie » pour reprendre ici le concept de Durkheim ? Deux dimensions me semblent constituer un véritable de leitmotiv de votre pensée : l’architecture et le droit. J’aimerais y ajouter celle du travail qui apparaît dans votre dernier ouvrage, Durer (2020).
Abordons-les, si vous voulez bien, tour à tour, en commençant par l’architecture à laquelle vous avez consacré vos deux premiers livres, Le savoir de Palladio[1] en 1995 et Empire et décor[2] en 1999. Dans ce dernier ouvrage, vous écrivez (page 111) que « l’architecture est à l’Un ce que la mobilisation totale est à l’Être ». Pourquoi l’architecture est-elle si proche voire intime de la pensée hénologique ? En quoi forme-t-elle le décor dans lequel prend place l’agir de l’homme ? Et, enfin, à quelles analyses de l’urbanisme contemporain, et plus particulièrement des projets de « villes intelligentes » (smart cities), les réponses aux questions précédentes vous mènent-elles ?
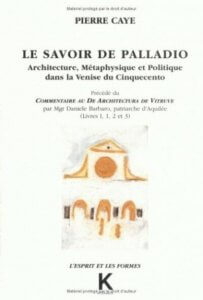
PC : Le De architectura de Vitruve a une conception très large de l’architecture qui ne se limite pas aux seuls édifices, mais concerne nombre d’objets et de machines très divers : des machines de guerres aux machines de chantier en passant par l’orgue hydraulique ou les cadrans solaires. En réalité l’architecture pour les Anciens est une science : la science des assemblages techniques. À cet égard la Renaissance a fortement renforcé cette dimension scientifique en soulignant deux points fondamentaux : la dimension méthodologique de l’architecture et sa nature mathématique. Les théoriciens de la Renaissance (Alberti, Filarète) ont posé les principes du projet, à savoir que l’architecte conçoit par avance dans l’atelier de son esprit l’œuvre qu’il rumine et médite jusqu’a ce qu’elle tombe comme un fruit mûr de son esprit. L’architecture, comme la peinture chez Léonard de Vinci, et finalement comme tous les autres arts de la Renaissance, est une cosa mentale. Deuxième point : l’assemblage architectural tire sa cohérence, sa solidité et son efficacité des rapports de proportion qui relient mutuellement chacun de ses éléments. L’Architecture à l’antique est aussi appelée architecture à proportion : elle est une architecture mathématique. Davantage encore, les mathématiques servent ici non seulement à organiser harmonieusement la forme de l’assemblage, mais elles servent aussi d’outils de conception, qui structurent la morphogenèse du projet en assurant au passage d’une phase à une autre de la conception sa continuité et son univocité : elles revêtent une dimension non seulement formelle mais aussi efficiente. Bref, en tant que méthode et science, que projet et morphogénèse, qu’efficience et mathématiques, l’architecture est à l’origine de la technique moderne. Le vitruvianisme a affirmé la modernité de la technique un siècle et demi avant que Galilée ne pose la modernité de la science physique.
Et pourtant, aussi rationnelle et mathématisée apparaît l’architecture humaniste puis classique, elle n’annonce en rien la provocation de la technique, la mobilisation totale, la computation universelle, la démiurgie et le Gestell qui caractérisent aux yeux d’Heidegger la technique moderne. C’est que, selon mon interprétation, la violence de la technique n’est pas le fait de sa rationalisation et de sa mathématisation, mais provient de ce que l’une et l’autre sont mises au service de la transformation et de la mobilisation de l’être, de l’exploitation de la Terre et non de sa surédification et de sa pacification comme se le propose l’aménagement ornemental du monde par l’architecture. L’architecture palladienne, qui constitue sans doute l’expression la plus haute de l’architecture de la Renaissance, s’inscrit dans un débat épistémologique majeur sur la nature du nombre mathématique. Face à la thèse néo-aristotélicienne qui fait du nombre le résultat de l’abstraction de la matière à partir de laquelle celle-ci se donne le plus facilement à connaître et à maîtriser, les vitruviens vénitiens du temps de Palladio soutiennent une autre thèse inspirée du Commentaire de Proclus au premier livre des Eléments d’Euclide qui fait du nombre une projection mentale de la dianoia, ou entendement, en vue de construire un diakosmos, un monde moyen, un mediomondo, entre d’une part le monde des archétypes inconnaissables et immaîtrisables pour notre intelligence, et d’autre part le chaos de la nature jugée alors inconnaissable et immaîtrisable en tant que tel par son inconsistance. Le monde moyen noue un lien entre le ciel et la terre et contribue ainsi à la cohérence de l’ensemble du cosmos qui caractérise la tâche de l’un. L’architecture s’affirme comme l’instrument privilégié de la cohérence du réel, ce qui relie le monde des idées au monde naturel sans pour autant jamais les confondre. Quatremère de Quincy bien plus tard dira que l’architecture a la tête au ciel et les pieds profondément ancrés dans la terre. Cependant cette relation, de nature clairement scientifique et technique que met en place l’architecture, ne consiste assurément pas à transformer la nature physique, mais au contraire à la stabiliser et à la protéger de son inconsistance et de son entropie. Il importe de noter que le terme grec de diakosmos est alors traduit en latin de façon singulière par le terme ornamentum. L’une des expressions les plus accomplies du diakosmos est sans doute la ville classique dont l’urbanisme se résume à ce que Voltaire appelle les embellissements. La philosophie méprise habituellement l’ornement qui apparaît comme la manifestation la plus pauvre de l’être ; mais ce qui est, du point de vue ontologique, insignifiant devient, du point de vue hénologique, l’expression la plus haute du monde qui tient. La technique ici à l’œuvre est une technique élégiaque et frôleuse qui met la nature à distance bien plutôt qu’en mouvement. Si l’architecture forme un paradigme technique singulier, c’est parce qu’elle est une technique hénologique et non pas ontologique, qui vise à « sauver les étants » selon l’expression plotinienne et non à manifester le règne de l’être, aussi appauvri soit-il par sa technicité même.

Or, les deux tendances principales de l’urbanisme contemporain, la numérisation et la végétalisation, aussi opposées soient-elles dans leur idéologie comme dans leur façon de faire, tendent toutes deux à détruire le monde moyen et plus spécialement la fonction médiatrice de son architecture. Sous le terme de smart city s’impose un nouvel urbanisme qui tend à ignorer l’espace sensible et construit, en le réduisant à un simple réseau de flux invisibles qui soumettent la ville à la mobilisation totale. De l’autre côté la végétalisation à outrance dissimule le plus souvent, sous une exaltation factice de la nature sauvage affranchie de toute artificialisation, des opérations de greenwashing immobilier. Dans l’un et l’autre cas se trouve déniée la capacité de l’architecture à créer de la distance, de l’espacement, du débrayage dans les champs d’immanence de la mobilisation totale pour mieux faire arche.
TROISIÈME PARTIE : DROIT, TRAVAIL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
AP : J’en viens à présent à la centralité du droit dans votre réflexion. Le dernier chapitre de la Critique de la destruction créatrice était déjà consacré à la conversion du capital en patrimoine, thématique que vous reprenez également dans le troisième chapitre de Durer. Quel est le rôle du droit dans cette conversion ? Quel statut accordez-vous au droit et à l’idée d’« institution » de façon plus générale ? Vous écrivez notamment dans Durer (page 92) : « Bref, le droit institue, tandis que l’économie désinstitue ». Quelle est la nature des rapports entre droit et économie, particulièrement à l’heure de la mobilisation totale ? S’agit-il d’une tension, d’un conflit, d’un mouvement de balancier, d’un jeu dialectique ?
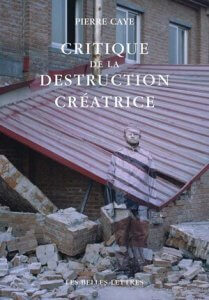
PC : Le droit a en commun avec l’architecture d’être un savoir de l’espacement, de la mise à distance. Prenons le cas de la prohibition de l’inceste qui fait l’actualité. Il n’y rien de moral dans cet interdit et la dimension sexuelle est secondaire. Ce qui compte c’est que l’État-civil ne vire pas au chaos, autrement dit que les distances généalogiques soient respectées : que la sœur ne soit pas aussi la mère, le fils le frère, la sœur la nièce, etc. Ce que les Grecs appellent l’ordre, la taxis, est d’abord un ordre de succession que structurent des intervalles. Prenons un second exemple : les successions. Les successions jacentes, c’est-à-dire les successions en recherche d’héritiers forment dans le droit romain le premier exemple de personnalité morale. L’ haereditas est à elle-même son sujet de droit, sa propriétaire, et cela pour assurer sa transmission à travers le temps, pour faire pont entre le mort, l’ancien propriétaire qui n’est plus, et des héritiers qui restent encore à déterminer. L’haereditas est à l’origine de ce que le droit allemand appelle les patrimoines à but (Zweckvermögen), c’est-à-dire des patrimoines qui n’appartiennent qu’à eux-mêmes en fonction du but ou de la mission qui leur est assignée. Il me semble que cette façon objective d’organiser les biens se révèlent bien plus protectrice en réalité que de faire des arbres, des eaux, des pierres des sujets de droit, ce qui me semble une impasse dangereuse pour le droit de l’environnement.
Le droit et l’économie sont les deux techniques fondamentales de l’organisation des sociétés. L’économie s’appuie nécessairement sur le droit pour éviter que le marché ne se trouve soumis à la loi de la jungle et que la concurrence ne devienne la nouvelle expression de la guerre de tous contre tous. Mais en réalité la finalité de l’économie est l’exact opposé de celle du droit, car elle vise d’abord à réduire les distances pour favoriser les interactions sociales dont dépend sa croissance. Nous assistons entre ces deux techniques contraires, condamnées pourtant à collaborer, à une évolution en ciseau : le droit qui est d’origine aristocratique comme l’exprime sa passion de la distance (le droit romain a été originairement conçu pour créer des relations sociales entre patriciens et plébéiens sans remettre en cause leur différence fondamentale de rang et de statut) est devenu un formidable vecteur de démocratisation dans l’histoire ; tandis que la théorie économique qui fait partie originairement des grandes forces de démocratisation et de lutte contre les féodalités dans la société au XVIIIe siècle (et il faut lire La richesse des Nations d’Adam Smith dans cette perspective) est devenue très vite au contraire un formidable facteur d’inégalité.
Aujourd’hui l’économie essaie de plus en plus d’instrumentaliser le droit au risque d’affaiblir sa fonction symbolique. Cette instrumentalisation a pour nom l’Analyse économique du droit (AED) qui malheureusement est de plus en plus reçue par la jurisprudence en Europe comme aux États-Unis. L’AED est née à l’Université de Chicago sous l’impulsion du juge Richard Posner ; elle est en quelque sorte le pendant et le complément des théories économiques néo-libérales de Friedrich Hayek et de Milton Friedman développées un peu plus tôt dans la faculté d’économie de cette même université. L’exemple le plus éloquent de ce type d’approche du droit est certainement ce qu’on appelle « la rupture efficiente du contrat » ou dans le texte original l’efficient breach. Que les contrats dussent être respectés, pacta sunt servanda, était jusqu’alors un principe fondamental du droit. Avec l’efficient breach, il n’en va plus de même : si l’une des parties contractantes considère que le contrat, pour telle ou telle raison, ne lui est plus aussi avantageux, il a tout loisir de le rompre en se contentant de payer à l’autre partie une compensation que calcule le juge selon des critères purement économiques, sans dédommagement ni pénalité pour la faute que ne constitue plus au demeurant la rupture unilatérale de droit. L’intérêt de l’individu prime sur la sécurité juridique de la société. Le droit sert non plus à protéger l’économie de son entropie ni la société de la violence sociale qu’engendre son abstraction, mais au contraire à intensifier les échanges, et à étendre le règne du marché, puisque tout se monétarise, même les entorses à la loi.
A mes yeux, on ne saurait réduire le droit à une simple boîte à outils comme le présuppose l’AED, à une simple technique au service du développement des affaires, Doing business selon les termes de la Banque mondiale, et de la marchandisation générale de la société. Le droit est un savoir immémorial dont il importe de préserver la fonction symbolique d’espacement et de ménagement des intervalles. Il y a une origine du droit comme il y a, pour Husserl, une origine de la géométrie, une origine non pas confuse et indistincte, mais qui s’instaure dans des corpus savants structurés : les Eléments d’Euclide pour la géométrie, le Corpus juris civilis pour le droit, qu’il soit au demeurant public aussi bien que privé. Et comme la géométrie euclidienne, le droit romain possède aussi cette puissance conceptuelle qui lui permet de s’arracher de son contexte historique et pratique pour structurer de nouveaux champs. De même qu’Euclide, selon Husserl, annonce la révolution galiléenne, l’accès de la science à l’infinité du réel, de même le droit romain est à l’origine de nos démocraties.
Entre le droit et l’économie il existe un différentiel de temps frappant. Le droit plonge ses racines dans les sociétés antiques, tandis que l’économie politique date du XVIIIe siècle. Ce seul effet temporel nous fait comprendre en quoi leur fonction symbolique diffère. Or, le développement durable dépend, pour sa « durabilité », de sa capacité à s’inscrire dans la profondeur de notre hominisation et de notre socialisation et à jouer des différentes strates temporelles dont nous provenons, sans chercher à réduire les strates le plus anciennes aux plus récentes.
AP : Cette différence de temporalité entre économie (politique puis scientifique) et droit rejaillit sur la manière sont ces deux savoirs appréhendent les biens et leur propriété : la première les envisagera comme du « capital » qui se caractérise par la production, la circulation et l’échange, tandis que le second maniera plus volontiers la catégorie de « patrimoine » qui a à voir, quant à lui, avec une inscription immobile (lire : qui ne participe pas à la mobilisation totale) dans le temps. Quelles relations entretiennent le capital et le patrimoine ? Demeurent-ils étrangers l’un à l’autre, chacun se déployant de façon autonome dans sa propre sphère, ou existe-t-il entre eux des passerelles, des partages, des intersections voire des conversions ?
PC : Le capital est la grande affaire de notre temps comme il le fut à l’époque de Marx. Cependant, je ne partage absolument pas la position de l’économiste Thomas Piketty qui juge que, pour restaurer l’égalité nécessaire à la multiplication des interactions sociales, elle-même condition de la croissance, il faut dissoudre le capital dans les flux des revenus à travers une augmentation des prélèvements fiscaux en vue de leur redistribution sociale. Ce type de politique favorise sans doute l’égalité sociale et la justice intragénérationnelle, mais je ne vois pas en quoi cette façon d’assurer l’égalité sociale suffira à rendre durable le développement économique et à établir la justice entre les générations (selon ce qu’on appelle la justice intergénérationnelle). La période 1945-1973 a sans aucun doute réduit les inégalités sociales dans l’OCDE (thèse de Piketty), mais n’a guère eu souci de la durée de son modèle de développement (ce que tait Piketty). Il me semble, tout au contraire, que, pour construire la durée nécessaire au développement, il faut extraire une part du capital social des flux économiques et financiers, et non l’y dissoudre.
Ce capital extrait des flux, accumulé sous le couvert du temps au service de la construction de la durée, est ce qu’on appelle depuis longtemps le patrimoine. On m’objectera : Capital et Patrimoine, c’est la même chose. Et il est vrai que pour le banquier votre patrimoine, c’est du capital. Simplement l’un (le capital) est un terme d’économie, l’autre (le patrimoine) de droit. Il s’agit donc d’une distinction quasi épistémologique, réglée en fonction du savoir qui traite la question. Il est vrai que la distinction entre capital et patrimoine est certainement l’une des manifestations les plus patentes de l’écart symbolique entre l’économie et le droit que je viens d’évoquer à la question précédente. De fait, cette seule distinction de forme est cependant susceptible d’avoir les plus grandes conséquences. Le capital est lié au court terme, le patrimoine implique un peu plus une idée de long terme ; le capital n’a pour fin que lui-même, son propre accroissement, tandis que le patrimoine est d’abord du capital affecté au service d’une mission, selon les termes des juristes. Cette mission peut revêtir diverses formes. Elle peut viser simplement l’entretien et la conservation de la vie de son détenteur et de sa famille : nous avons affaire au patrimoine privé, identique au capital, que reconnaît et organise le droit civil. Cette mission peut aussi se consacrer à la réalisation du service public ; relève alors du patrimoine le domaine public que reconnaît et organise le droit public. La notion de patrimoine sert enfin à favoriser un usage raisonnable, par l’ensemble de la communauté internationale, d’un certain nombre d’environnements naturels (les fonds marins, l’espace, l’antarctique, etc.) selon un partage équitable entre toutes les nations : ce qui définit le patrimoine commun de l’Humanité que formule le droit international.
Cette notion juridique de patrimoine est aussi intéressante parce qu’elle organise la convergence autour du régime des biens du droit civil, du droit public, du droit environnemental et du droit international. Mieux encore elle permet aussi d’infléchir le droit de l’environnement du droit pénal vers le droit civil, le droit des biens, ce qui lui donne en réalité beaucoup plus de moyens, et d’impact dans les activités économiques et sociales. Qu’il se présente sous la forme du patrimoine privé, du domaine public ou du patrimoine commun de l’Humanité, le patrimoine peut à chaque fois se définir comme du capital institutionnalisé.
Mais que veut dire l’expression « Capital institutionnalisé ». L’institutionnalisation du Capital signifie 3 choses :
1) Le Capital institutionnalisé, je l’ai dit, est d’abord du capital affecté à une mission, mieux encore à une œuvre, à un projet : nous assistons aujourd’hui à une mise en valeur de plus en plus nette de l’affectation du capital comme en témoigne la montée de la Finance durable que favorise au demeurant la nouvelle réglementation européenne (Green Act ou Pacte vert de déc. 2019) qui vise à orienter les investissement en les réservant ou les affectant à des « Investissement socialement responsable », des investissements qui répondent à des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (dits critères ESG) en vue de la transformation productive ; le plan de relance prévu pour parer les conséquences économiques de l’épidémie, même s’il reste de l’ordre du saupoudrage, s’efforce néanmoins d’affecter un certain nombre de financements, 30% des 100 milliards initialement prévus, aux missions de DD : rénovation thermique, transition énergétique, décarbonation de l’industrie, logique d’affectation qui s’accompagne du grand retour de la Planification avec la nomination d’un haut-commissaire au plan de modernisation et d’équipement. Quant à l’effectivité de tout cela, c’est une autre affaire. En attendant, et c’est l’une des conséquences de la crise présente, nous assistons au retour du capital institutionnalisé, que le néo-libéralisme des années 80 avait voués aux gémonies. Souvenons de Milton Friedman qui déclarait, au début des années 70, que « l’entreprise n’avait d’autre responsabilité sociale que d’accroître son profit ».
Or, c’est précisément en organisant les moyens de ce projet, en fixant sa mission, en répartissant les compétences, en élaborant des procédures ad hoc pour son bon accomplissement que l’on construit des institutions. On quitte petit à petit l’idée que le capital serait exclusivement un objet d’échange, de profit et de spéculation, même si, sous le régime de l’affectation, il reste tout à fait intégré à la vie économique contemporaine comme en témoignent les « Investissements socialement responsables ».
2) Affecté, le patrimoine devient aussi de facto du capital protégé, ce sont des biens qu’il s’agit plus de conserver et de protéger que d’échanger, je pense en particulier au domaine public immobilier ou mieux encore mobilier, c’est-à-dire au patrimoine artistique que le droit définit au demeurant comme Trésor national, et qu’il protège par un régime juridique censé assuré sa stabilité et sa permanence, à l’exemple du domaine public immobilier imprescriptible, insaisissable et inaliénable. En tant que protégé, le patrimoine est un peu plus éloigné du monde de l’échange et du profit, puisque comme en témoigne le domaine public, aussi bien mobilier qu’immobilier, les obstacles à sa cession se multiplient.
3) Enfin, si l’on conserve le capital, c’est que celui-ci, en tant que patrimoine, est destiné à la transmission bien plus qu’à l’échange : On ne gère pas un patrimoine de la même façon que l’on gère un capital. On gère un capital pour l’accroître, on gère un patrimoine pour le transmettre. Il n’est pas jusqu’à Marx qui ne finisse par reconnaître que le patrimoine et sa transmission constituent la finalité ultime de ce que doit être l’économie. Je ne résiste pas au plaisir de citer ce texte de Marx : « Aucune société, aucun peuple, ni même toutes les sociétés d’une époque prises ensemble ne sont les propriétaires de la terre. Ils n’en sont que les possesseurs, les usufruitiers, et ils devront la léguer aux générations futures après l’avoir améliorée en boni patres familias. » (Karl Marx, Le Capital, III, sixième section, chap.23). Ce texte et bien d’autres du tome III du Capital, oubliés par le marxisme du XXe siècle aussi bien dans sa version social-démocrate que léniniste, sont aujourd’hui redécouverts et mis en exergue par les mouvements éco-socialistes (James O’Connor, John Bellamy Forster).
Instituer le capital, c’est donc peu à peu retirer de l’échange, du commerce, un certain nombre de biens que l’on juge essentiels pour la conservation et la reproduction de la société ; ou encore c’est lutter, pour parler comme Marx, contre «les formes primitives d’accumulations du capital», violente, sauvage, sans autre but que son propre accroissement, sans mission sociale, sans volonté de faire œuvre durable, au service du seul accroissement des profits : l’argent noir (12% de la richesse mondiale), davantage encore l’argent gris (30%) qui sont l’exact opposé de ce capital affecté .
Il me semble enfin que la notion de patrimoine est plus englobante que celle de communs, pour garantir la démocratisation du capital dans le respect de l’environnement au service du développement durable.
A la fin des années 60, l’écologue Garret Hardin évoquait la tragédie des biens communs, c’est-à-dire le fait que la rationalité économique doit a priori pousser des individus qui se partagent un bien en commun à le surexploiter, sans souci de préservation et de conservation, en une sorte d’égoïsme sacré où l’on se réserve les bénéfices pour faire porter les charges sur les autres. (v. par exemple la pêche illégale qui représente environ un cinquième du tonnage mondial des pêcheries). Pour la plupart des économistes, la solution à cette « tragédie » passe soit par la création de droits individuels de propriété, qui font que le coût est payé par celui qui tire profit du bien (solution libérale), soit par la gestion des biens communs par la puissance publique, c’est-à-dire par un tiers souverain qui règle à la fois l’usage et la conservation du bien (solution étatiste). Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie 2009, s’est au contraire efforcée de montrer (à travers ses travaux sur la gestion des nappes aquifères en Californie ou de l’irrigation dans des villages du district de Dang au Népal) que, depuis longtemps et presque partout dans le monde, des collectivités ont pu et peuvent encore gérer, de manière économiquement optimale des biens communs, à travers la création d’« arrangements institutionnels » (institutionnal settings), évitant ainsi à la fois tant leur privatisation que leur gestion par la puissance publique. Il s’agit donc d’un troisième cadre institutionnel, efficace, dans lequel des communautés gèrent collectivement des biens communs (Common-pool resources). Elinor Ostrom a ainsi montré que ces arrangements institutionnels, fondés notamment sur les relations de confiance entre utilisateurs, avaient permis la gestion collective de nombreux écosystèmes sans conduire à leur effondrement. Je me contenterai simplement de dire que peu importe le cadre institutionnel : propriété privée, propriété publique, ou auto-organisation collective de l’usage à partir du moment où se trouve attribuée, comme c’est le cas dans les exemples d’Elinor Ostrom, une mission d’intérêt général à cette gestion et où se trouve mis en place un cadre organisationnel pour remplir cette mission : ce que la doctrine du Droit public français appelle depuis plus d’un siècle une institution, de cette institution qui, nous l’avons vu, transforme le capital en patrimoine.
[1] Pierre Caye, Le savoir de Palladio. Architecture, Métaphysique et Politique dans la Venise du Cinqueccento, Paris, Klincksieck, 1995.
[2] Pierre Caye, Empire et décor. L’architecture et la question de la technique à l’âge humaniste et classique, Paris, Vrin, 2000.








