Introduction radicale à la philosophie se présente d’emblée comme un hapax dans la production philosophique contemporaine par sa qualité esthétique : écrit sans aucune note de bas de page, ce livre est un prodige d’écriture en ce sens qu’il ne parle qu’« avec le minimum de concepts simples et radicaux » (p.9). Ce livre est en effet la réécriture d’une thèse de philosophie, soutenue en 2010, qui est sa simplification, sa réduction à l’essentiel. Rares sont les œuvres avec une telle ambition – ambition de modestie –, à l’heure où la sagesse décroît à mesure que l’érudition croît. N’est-il pas extraordinaire d’écrire aujourd’hui de la philosophie en une langue ordinaire, sans jargon ni terme allemand ? Même le philosophe de métier admirera cette sobriété de la prose philosophique, qui ne cède rien à la profondeur de la pensée, nous le verrons. Il s’amusera aussi à reconnaître les références philosophiques, surtout phénoménologiques et herméneutiques, entre les lignes, en sous-texte, plus particulièrement dans les titres de chapitres (« La crise des sciences », « La prose du monde », etc.). La trame de l’ouvrage est nouée de citations, in extenso, ou réécrites. Enfin, le lecteur goûtera assurément divers moments de prose poétique, qui parsèment l’ouvrage et attestent une fois de plus le souci esthétique de son auteur. La vérité, qui est aimable, mérite qu’on manifeste son éclat.
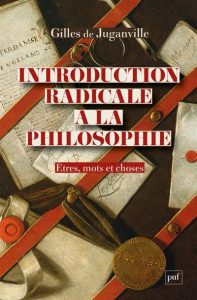 Que fait Gilles de Juganville ? Il essaye une ontologie. « L’ontologie est le discours sur l’être, c’est-à-dire la description de ce qui est fondamentalement. » (p.18). Cette ontologie sera conduite en déployant la variété des sens d’être qui peuplent le monde. En effet, « être signifie en plusieurs manières » (p.11), nous le savons, et il va s’agir d’identifier et de décrire les catégories fondamentales de l’étant, les grands types ou sens d’être « Un sens d’être est une manière fondamentale d’être, un « comment » de l’être » (p.27). Cette diversité de sens d’être est originaire, affirme Juganville, elle est donnée d’emblée ; nous n’avons pas affaire à de l’étant en général, qui ensuite se distinguerait en genres, puis en espèces. Les sens d’être sont originaires. N’importe quel étant est toujours déjà d’une certaine manière, selon un certain sens d’être.
Que fait Gilles de Juganville ? Il essaye une ontologie. « L’ontologie est le discours sur l’être, c’est-à-dire la description de ce qui est fondamentalement. » (p.18). Cette ontologie sera conduite en déployant la variété des sens d’être qui peuplent le monde. En effet, « être signifie en plusieurs manières » (p.11), nous le savons, et il va s’agir d’identifier et de décrire les catégories fondamentales de l’étant, les grands types ou sens d’être « Un sens d’être est une manière fondamentale d’être, un « comment » de l’être » (p.27). Cette diversité de sens d’être est originaire, affirme Juganville, elle est donnée d’emblée ; nous n’avons pas affaire à de l’étant en général, qui ensuite se distinguerait en genres, puis en espèces. Les sens d’être sont originaires. N’importe quel étant est toujours déjà d’une certaine manière, selon un certain sens d’être.
Comment identifier ces sens d’être et catégoriser les étants ? Quel point de vue adopter pour découvrir cette structure élémentaire du monde ? Le choix de Gilles de Juganville est celui de Heidegger : l’ontologie doit se parcourir au fil conducteur de l’ordinaire. En effet, seul l’ordinaire est originaire, radicalement premier, universel, précédant toute théorie particulière et de toute catégorisation propre à une époque ou une culture. « Avant toute théorie, le monde est donné, les sens d’être sont toujours déjà précompris dans l’existence ordinaire parce qu’ils sont eux-mêmes ordinaires » (p.58). Puisque notre comportement ordinaire précomprend les sens d’être, le rôle de la philosophie n’est que de les expliciter et de les prendre en vue conceptuellement. Il faut donc repartir du concret, et constituer une simple « science des évidences », de ce qui se donne d’emblée. « Tâche difficile parce que simple » (p.32), parce diverses abstractions ont recouvert comme un vêtement d’idées l’ordinaire.
Cela suppose en particulier de régresser en-deçà de l’abstraction qu’accomplit la science moderne. Reprenant la magistrale critique husserlienne, Juganville montre le caractère dérivé de la science et son abstraction qui en est l’essence. « Toutes les sciences ont en commun une abstraction de notre expérience ordinaire. (…) L’abstraction est un appauvrissement, une démondanéisation : nous quittons le sol de l’expérience ordinaire, celui du monde ordinaire. » (p.44). Méthodiquement, la science s’arrache à l’expérience commune du monde et reconstruit un univers épuré et mathématisé. « Une science ne veut rien savoir d’autre que ce que sa méthode lui prescrit comme objet. » (p.53). Au contraire, l’ontologie n’a de sens qu’à hauteur d’homme, en revenant à l’ordinaire qui est plus originaire. « Nous sommes hommes avant que d’être savants » (p.52), et l’ontologie est affaire d’hommes, ordinaires, en chair et en os sur la terre bien solide et bien ronde. La science n’est pas fausse, mais partielle, parce que méthodique et abstraite. La pensée philosophique doit littéralement atterrir : « Pour remettre la pensée sur terre, il faut que la pensée de science, pensée de survol, pensée de l’objet en général, se replace dans un « il y a » préalable, sur le sol du monde. » (p.55).
Revenons donc sur le sol du monde, « à ras de terre, à hauteur d’homme » (p.66), afin d’aller aux choses mêmes. Comment découvrir les sens d’être fondamentaux ? Juganville, s’inspirant de la variation eidéitique husserlienne, propose une méthode des contrastes : « Les sens d’être apparaissent par contraste les uns par rapport aux autres. Le contraste fait apparaître. Le contraste est le principe de l’apparaître. Les choses mêmes apparaissent d’elles-mêmes par contraste entre elles » (p.67). Il s’agit donc de laisser les étants être et se manifester d’eux-mêmes – selon la définition heideggerienne du phénomène dans Être et Temps – et de recueillir cette manière d’apparaître, qui livre leur manière d’être. Or, certaines manières d’apparaître sont fondamentalement contrastées, et sautent aux yeux : « L’oiseau se détache de l’entrecroisement des branches ; la silhouette des palmiers annonce l’oasis au milieu du désert ; l’odeur d’un feu signale une présence humaine ; le saut du cerf le découvre tout à coup ; l’avion ressort dans bleu du ciel » (p.68). Autant de manifestations contrastées de sens d’être eux-mêmes contrastés, et qu’on ne peut ordinairement confondre.
Plus encore, Juganville invite à examiner les situations « archi-ordinaires », qui radicalisent les contrastes et les manifestent d’autant mieux. Par exemple, « la faim exaspère la recherche de tout ce qui peut ressembler à un aliment au détriment du reste des choses, un risque de noyade manifeste notre rapport à l’air, le béton gris et pollué d’une mégapole rend somptueux un îlot de verdure » (p.70). Alors il n’y a plus de doute sur les contrastes ontologiques, et « l’archi-ordinaire rend manifestes les structures du monde ordinaire » (p.70).
Voici pour la méthode de l’ontologie. Quel en est le résultat ? Juganville identifie six sens d’être fondamentaux et irréductibles : les hommes, les animaux, les végétaux, les éléments, les choses (artefacts) et les aliments. Envers tous ces types d’étant, nous avons une manière bien spécifique et irréductible de nous rapporter.
 Avant d’étudier séparément chacun de ces sens d’être, Juganville analyse l’existence humaine, selon une perspective fort heideggerienne. L’homme a un monde, il n’est jamais sans monde, il est au monde. Plus précisément, nous existons toujours en situation, en un certain lieu et un certain temps. « Nous sommes toujours déjà nés et pas encore morts » (p.93). Nous existons toujours quoique parfois – le plus souvent – de manière impersonnelle, mais l’existence impersonnelle ou inauthentique ne nous ravale pas au rang de l’animal ou d’une chose, c’est encore une manière d’exister, c’est-à-dire d’être homme. « L’existence nous déborde ; notre sens d’être est plus large que notre soi » (p.97). « Nous existons quels que soient les rapports que nous entretenons à notre être, à nous-mêmes. (…) Nous n’avons pas à être, nous existons malgré nous. » (p.98). En outre, suivant cette fois les leçons de l’herméneutique, notre comportement est toujours compréhensif, et cette compréhension est toujours triple : perceptive, affective et langagière. Aucune de ces trois modalités ne prime sur les autres, mais elles sont toutes trois indissociables et co-originaires.
Avant d’étudier séparément chacun de ces sens d’être, Juganville analyse l’existence humaine, selon une perspective fort heideggerienne. L’homme a un monde, il n’est jamais sans monde, il est au monde. Plus précisément, nous existons toujours en situation, en un certain lieu et un certain temps. « Nous sommes toujours déjà nés et pas encore morts » (p.93). Nous existons toujours quoique parfois – le plus souvent – de manière impersonnelle, mais l’existence impersonnelle ou inauthentique ne nous ravale pas au rang de l’animal ou d’une chose, c’est encore une manière d’exister, c’est-à-dire d’être homme. « L’existence nous déborde ; notre sens d’être est plus large que notre soi » (p.97). « Nous existons quels que soient les rapports que nous entretenons à notre être, à nous-mêmes. (…) Nous n’avons pas à être, nous existons malgré nous. » (p.98). En outre, suivant cette fois les leçons de l’herméneutique, notre comportement est toujours compréhensif, et cette compréhension est toujours triple : perceptive, affective et langagière. Aucune de ces trois modalités ne prime sur les autres, mais elles sont toutes trois indissociables et co-originaires.
Juganville en vient ensuite à la description du monde en ses six sens d’être principaux et originaires. Peut-être peut-on regretter que le passage de l’existence humaine au monde ne soit pas vraiment développé. En quoi l’homme est-il par nature ontologue, c’est-à-dire celui pour qui il y a ces six modalités d’être et qui les comprend et les connaît ? Dans quelle mesure la question de l’être dépend-t-elle de l’existence humaine ?
Le fait est qu’il y a six sens d’être pour l’homme. Chacun de ces sens d’être apparaît d’une certaine manière et caractérise une manière d’être bien particulière. Pour résumer les développements, disons que « les hommes existent, les choses sont disponibles, les végétaux croissent, les animaux vivent, les aliments sont comestibles et les éléments persistent » (p.229). Voici comment ils apparaissent à l’homme et comment celui-ci les identifie.
Telle est la structure du monde, sa composition fondamentale, sa grammaire essentielle ou ses couleurs primaires. Juganville affirme nettement l’irréductible pluralité de ce monde : « Le monde est ontologiquement pluriel. (…) Non seulement l’être n’est pas simple mais les sens d’être se tiennent irréductiblement et originairement en leur pluralité. Autrement que l’être sont les sens d’être. Il n’y a pas pluralité dans l’unité d’un sens, mais pluralité des sens sans unité. » (p.229). C’est une thèse forte du livre. Quoiqu’il n’use pas de ces termes, on peut dire que Juganville rejette l’univocité de l’être, c’est-à-dire la réduction des sens d’être à un concept simple et uniforme, qui assurerait « l’unité d’un sens », au profit d’une équivocité – « pluralité des sens sans unité ». Nous critiquerons à la fin de notre recension ce parti pris ontologique, qui omet selon nous indûment toute analogie de l’être. Ce refus de toute métaphysique de l’être laisse inachevé l’essai d’ontologie que constitue cette Introduction radicale à la philosophie.
Une fois la structure du monde établie, il reste à penser la situation que notre époque lui fait. Cette ontologie ordinaire, universelle et trans-historique, vaut-elle encore pour aujourd’hui ? Le livre de Juganville aborde dans une troisième partie la mutation ontologique qui caractérise notre époque. Le changement, c’est maintenant. « Le monde a changé, ontologiquement changé » (p.243), constate l’auteur. Cette mutation ontologique, ce changement de monde, cette fin du monde, résulte d’une mutation de la production.
Auparavant, l’auteur avait analysé avec minutie la structure ordinaire de la production. Au contraire des végétaux, des animaux et des éléments, les choses et les aliments viennent à l’être selon un certain mode : la production. Celle-ci, comme Aristote l’avait dit, est un système de quatre causes : matérielle, formelle, motrice et finale. Nous ne reprenons pas l’analyse, qui est classique.
Or, la production a changé, depuis la révolution industrielle. On peut approcher cette mutation de la production de trois manières : la production est devenue totalisante, totalitaire et totale.
1/ La production totalisante est le fait du techno-capitalisme. Elle est totalisante parce qu’elle s’attaque aux sens d’être : « la production envahit le donné. Les sens d’être sont intégrés au système de la production avant leur mutation comme s’ils étaient déjà puissance de produits. » (p.248). Tous les étants sont réduits au rang de matériau, de « matière première », à exploiter pour la production. Par exemple, « l’écorce terrestre se dévoile désormais comme bassin houiller, le sol comme entrepôt de minerai » (p.249). Les éléments ne se dévoilent plus par eux-mêmes, mais ils n’apparaissent plus que dans le processus de production, qui leur assigne comme seul sens d’être matériau. De même, « le champ de blé n’est plus un champ de végétaux mais déjà de la farine en puissance » (p.251). Le génie de Juganville est d’analyser la production capitaliste du point de vue strictement ontologique. Que constate-t-on alors ? Que désormais « tout étant est compris à partir des catégories de la production » (p.251). Ce qui ne valait que pour les artefacts et les aliments vaut désormais pour tous les étants, enrôlés dans le processus de production.
La cause motrice change : ce n’est plus l’homme qui manie des outils, mais « d’abord des machines et ensuite des travailleurs qui les font tourner, ou plutôt qui tournent auprès des machines qui produisent » (p.253). Le statut ontologique du travailleur change : « il ne produit rien mais participe à la production », il n’est plus acteur libre et responsable de son travail, « il n’est plus alors qu’un rouage » (p.254). Qui est le sujet de la production totalisante ? A vrai dire, personne, sinon « la machinerie », c’est-à-dire le système des machines. « Avec l’engrenage des machines, le monde devient une immense machine automatique » (p.256). Et le système s’étend, implacablement, irrésistiblement : « depuis qu’il y a des machines, il y a toujours plus de machines » (p.255). Nous ne pouvons citer toutes les analyses de Juganville, mais on ne saurait trop les recommander tant elles manifestent bien la si évidente transformation de la production qu’on ne la perçoit même pas.
Pourquoi produire ainsi ? Quelle est est la cause finale ? On produit pour l’argent – ce qui définit le capitalisme. Or, celui-ci a une portée ontologique : par lui, tout étant est réduit au rang de marchandise. « Parce qu’à tout étant doit correspondre une quantité d’argent, la marchandisation s’étend à tout étant quel qu’il soit » (p.263). Une sentence de Juganville laisse le philosophe profondément songeur : « La mondialisation du marché est la marchandisation du monde » (p.263). Le capitalisme atteint l’essence même du monde. Il n’est pas qu’une activité humaine, aux contours légèrement différents de ceux d’il y a quelques siècles ; mais il est un fait social total, et même un fait ontologique total. « Quand la production est devenue production d’argent, en lieu et place des choses et des aliments, le monde a changé. Le monde est devenu le système. Lorsque la production se transforme totalement, le monde se transforme totalement. » (p.263). Le monde ne se donne plus que dans l’exploitation, par et pour la production. « Le système dévoile le monde par l’exploitation. Ou plutôt, puisque les sens d’être sont voilés par le système : l’exploitation est le voile du système sur le monde. » (p.268).
Mais l’exploitation des sens d’être en vue de la production est aussi leur destruction. « La production vise la destruction et la destruction la reproduction. Le système produit du détruit » (p.270). « La destruction du système advient parce qu’il est un système de destruction » (p.273). Telle est la catastrophe ontologique en cours. Le capitalisme est un nihilisme.
2/ Originale est la thèse selon laquelle le totalitarisme peut aussi et d’abord s’analyser en termes de production. « Le totalitarisme est une production nouvelle » (p.278). Laquelle ? Sa finalité est la production d’un homme nouveau, dont le moyen est la « destruction d’une communauté (cause matérielle) par des camps (cause motrice) au nom d’une idéologie (cause formelle). » (p.279). « La production d’un homme nouveau implique corrélativement l’uniformisation du matériau et la destruction d’une partie du matériau qui n’est plus que déchets » (p.287).
3/ Enfin, le troisième type de production est appelé « production totale » ou « mutation » – d’autres diront « Anthropocène ». Désormais, la mainmise de la production humaine s’étend jusqu’à « produire les sens d’être eux-mêmes » (p.294). Ainsi, les végétaux sont de plus en plus produits, dès lors que « la production intervient le plus tôt possible sur sa matière première, s’efforçant dès le premier stade de la production de la produire. » (p.295). Les éléments eux-mêmes sont produits, étant donné que, par exemple, « l’énergie nucléaire ou les bombes atomiques sont la production de soleils » (p.295). Les animaux sont également produits industriellement : « Désormais, on élève de la viande, on produit de la viande en vie. » (p.296). Notons au passage le puissant effet que cause cette description extrêmement sobre, presque laconique, par l’auteur de cette effrayante catastrophe ontologique. Car, pour finir, l’homme lui-même n’est pas indemne ni intact, puisque il est conçu comme une matière à améliorer et augmenter – donc à produire. « La production totale se manifeste dans la production en éprouvettes, les procédés eugéniques de sélection des embryons, la modification du patrimoine génétique, la production d’implants, de prothèses, d’organes artificiels, d’interfaces électroniques, etc. » (p.296). Juganville prophétise à peine, en ne faisant que suivre la courbe actuelle : « L’homme cherche à se produire totalement lui-même. On verra des fabriques pour la production artificielle de cette matière première : des usines de production de l’homme » (p.297). Le post-humain n’est plus une simple fiction.
Cette production totale, qui investit ce qui échappait aux catégories de la production ordinaire, constitue l’unique révolution ontologique de tous les temps. « S’il y a mutation dans la manière dont les étants viennent à l’être, alors il y a révolution ontologique » (p.292). Il n’est plus de monde que produit. « Le monde de la production devient la production du monde » (p.310).
 Il reste à évaluer l’avènement de cette triple production, totalisante, totalitaire et totale. En quoi est-ce mal ? L’originalité de Juganville est de décrire là encore le mal contemporain de manière seulement ontologique, et non éthique. Ou plutôt, il déduit de l’ontologie une sorte d’éthique minimale, qui peut sembler pour cela d’autant plus sérieuse et certaine. « L’ontologie est une éthique originelle négative qui affirme seulement, mais malgré tout, qu’il n’y a pas de bien sans différences ontologiques » (p.311). Autrement dit, l’être ne prescrit qu’un unique devoir-être : laisser être. C’est pourquoi « oublier les sens d’être, indifférencier les sens d’être, se borner à avoir affaire à l’étant, réduire les différences à néant, est le nihilisme. Les productions totalisante, totalitaire et totale mettent en œuvre, chacune à leur manière, une indifférenciation ontologique. Il y a mal ontologique quand les contrastes ordinaires sont abolis. » (p.302). Notre époque est donc celle d’un mal inédit et terrible : le mal ontologique, qui atteint les sens d’être eux-mêmes. Non seulement il détruit, mais il indifférencie : tout n’est plus que de l’étant en général, c’est-à-dire du produit ; tout est le même. Gilles de Juganville l’explique avec une poésie crépusculaire : « La production totale recouvre de son voile noir les sens d’être qui apparaissaient au grand jour. Elle est l’assombrissement du monde pour tout produire. L’abolition des différences entre sens d’être est donc la fin du monde. À l’entrelacs des sens d’être se substitue un univers d’indifférenciations mutantes disséminées. » (p.311). Alors que la variété du monde, sa polychromie avait été décrite et même célébrée, il est manifeste que nous allons vers une « décoloration, une grisaille généralisée » (p.19). De manière mélancoliquement poétique, Juganville développe une sorte d’argument éthico-esthétique qu’il tire de son ontologie de la pluralité : « Dans certaines forêts – les déserts verts –, les oiseaux sont partis et plus aucun animal ne peut séjourner. Dans ces alignements parfaits de troncs, toute vie a disparu et un silence mortel frappe le visiteur. Plus loin, la terre retournée se montre comme un bloc massif et impénétrable où plus aucun ver ne respire. Là-bas, le plongeur ne croise plus que des méduses au sein d’un désert bleu. Et ici, dans nos déserts de béton gris, seuls demeurent chiens et chats qui, leur vie durant, n’iront pas plus loin que le bout de l’avenue. (…) Le désert croît et le divers décroît. » (p.187).
Il reste à évaluer l’avènement de cette triple production, totalisante, totalitaire et totale. En quoi est-ce mal ? L’originalité de Juganville est de décrire là encore le mal contemporain de manière seulement ontologique, et non éthique. Ou plutôt, il déduit de l’ontologie une sorte d’éthique minimale, qui peut sembler pour cela d’autant plus sérieuse et certaine. « L’ontologie est une éthique originelle négative qui affirme seulement, mais malgré tout, qu’il n’y a pas de bien sans différences ontologiques » (p.311). Autrement dit, l’être ne prescrit qu’un unique devoir-être : laisser être. C’est pourquoi « oublier les sens d’être, indifférencier les sens d’être, se borner à avoir affaire à l’étant, réduire les différences à néant, est le nihilisme. Les productions totalisante, totalitaire et totale mettent en œuvre, chacune à leur manière, une indifférenciation ontologique. Il y a mal ontologique quand les contrastes ordinaires sont abolis. » (p.302). Notre époque est donc celle d’un mal inédit et terrible : le mal ontologique, qui atteint les sens d’être eux-mêmes. Non seulement il détruit, mais il indifférencie : tout n’est plus que de l’étant en général, c’est-à-dire du produit ; tout est le même. Gilles de Juganville l’explique avec une poésie crépusculaire : « La production totale recouvre de son voile noir les sens d’être qui apparaissaient au grand jour. Elle est l’assombrissement du monde pour tout produire. L’abolition des différences entre sens d’être est donc la fin du monde. À l’entrelacs des sens d’être se substitue un univers d’indifférenciations mutantes disséminées. » (p.311). Alors que la variété du monde, sa polychromie avait été décrite et même célébrée, il est manifeste que nous allons vers une « décoloration, une grisaille généralisée » (p.19). De manière mélancoliquement poétique, Juganville développe une sorte d’argument éthico-esthétique qu’il tire de son ontologie de la pluralité : « Dans certaines forêts – les déserts verts –, les oiseaux sont partis et plus aucun animal ne peut séjourner. Dans ces alignements parfaits de troncs, toute vie a disparu et un silence mortel frappe le visiteur. Plus loin, la terre retournée se montre comme un bloc massif et impénétrable où plus aucun ver ne respire. Là-bas, le plongeur ne croise plus que des méduses au sein d’un désert bleu. Et ici, dans nos déserts de béton gris, seuls demeurent chiens et chats qui, leur vie durant, n’iront pas plus loin que le bout de l’avenue. (…) Le désert croît et le divers décroît. » (p.187).
Telle est la gravité de la crise ontologique – et non seulement écologique – si impensable qu’il faut oser le néologisme d’« ontocide » (p.315). La production totale détruit le monde et sa diversité de sens d’être.
La démonstration de Gilles de Juganville est admirable, et nombre de ses développements visent juste et entraînent la conviction. Nous voudrions seulement ouvrir la discussion à propos de deux éléments moins convaincants : la question de l’être et celle de la cause et de la finalité des étants, autrement dit deux questions essentielles de la métaphysique.
Concernant l’être, tout d’abord, il est clair que l’auteur pose la diversité des sens d’être au principe. Il refuse de poser un concept général et commun d’étant, lequel se subdiviserait ensuite en divers catégories ou espèces d’étant. Répétons-le : « Autrement que l’être sont les sens d’être. Il n’y a pas pluralité dans l’unité d’un sens, mais pluralité des sens sans unité. » (p.229). Quid de l’être en tant qu’être ? L’ontologie ne doit-elle pas, comme son nom l’indique, s’interroger au moins autant sur l’être en tant qu’être, et non l’être selon tel ou tel sens d’être ? Sauf erreur de notre part, Gilles de Juganville distingue à ce propos le concept d’être et le phénomène d’être.
« L’étant « en général », écrit-il, suppose un nivellement des genres d’étant, une réduction au seul « fait d’être » de tous les étants quels que soient leurs genres » (p.27-28). Cela est parfaitement vrai, mais il ne va pas de soi qu’une telle réduction des étants à ce qui leur est commun, à savoir leur étantité, leur caractère commun d’être, purement et simplement, soit vaine et inutile. Certes, « l’expérience ordinaire ne rencontre l’être que comme une abstraction : le concept le plus universel et le plus vide. » (p.230). Nous rencontrons toujours tel ou tel étant, et nous pouvons en abstraire la détermination la plus minimale et fondamentale, qui est son fait d’être. Mais il est indispensable de s’interroger sur le sens de cette détermination logiquement première qu’est le fait d’être, préalable à l’être-tel, selon un certain sens d’être. Ne pas envisager le sens de l’être en tant qu’être, autrement dit se refuser à la métaphysique, c’est laisser l’ontologie inachevée.
Pourtant, Juganville s’interroge sur l’être, en tant que distinct de l’étant. « Un étant n’est pas l’être. Qu’en est-il de l’être ? L’être n’est pas un étant mais se déploie dans tout étant. Jamais un étant n’est sans l’être. Ordinairement jamais l’être ne se déploie sans étant » (p.229). De telles affirmations doivent sans doute se comprendre en un sens heideggerien, eu égard à la manière dont Juganville pense « le phénomène d’être », la manière que l’être a de se donner dans une expérience affective, en sa distinction d’avec l’étant. C’est dans sa typologie de l’affectivité qu’il aborde les « affects profonds », extraordinaires, qui livrent divers phénomènes de la plus haute importance, que les phénoménologues ont tâché de décrire (à moins qu’ils ne les aient inventés) : « l’horreur de l’il y a » (on reconnaît là Lévinas), « l’angoisse du néant » (Heidegger), « la nausée du trop-plein d’être » (Sartre), « l’ennui de l’étant dans son ensemble » (Heidegger, complété par Jean-Luc Marion), « la terreur du sacré », « la joie de l’étant en plénitude » (p.127). Ce qui importe principalement dans l’économie de l’oeuvre, c’est que ce sont des phénomènes extraordinaires, qui abolissent les sens d’être. « Le phénomène par excellence est toujours la pluralité ordinaire des sens d’être et non pas son abolition dans les phénomènes extraordinaires de l’être ou du néant. » (p.132). De tels affects profonds sont donc dérivés, extraordinaires ; par eux, nous quittons, dit magnifiquement l’auteur, « la polychromie ordinaire du monde bariolé », et nous plongeons « dans la monochromie du gris ennui de la totalité de l’étant, de la blanche angoisse du néant, de la nausée noire de l’être ou même dans la plénitude rosée d’une exaltation fondamentale » (p.132). Où il apparaît néanmoins que le peu de métaphysique dont la phénoménologie est capable est essentiellement littéraire.
 Revenons au « phénomène d’être ». « Qu’en est-il de l’être ? Si l’être il y a, il faut qu’il puisse être tout d’abord donné. Il faut que nous puissions le rencontrer. » (p.130). Je ne suis pas certain qu’il faille ainsi poser le problème de l’être. Du moins apparaît ici un présupposé phénoménologique, qui est que ce qui est doit se donner, ou que seul le donné a droit d’être. Or, il se pourrait que l’être ne fût jamais rencontré en tant que tel, mais fût seulement connu, par abstraction, à partir de et dans l’étant. Juganville tâche d’établir une affection de l’être, « une expérience fondamentale de l’être », « dans l’expérience de l’il y a : expérience d’un être neutre impersonnel, sans soi : un être sans néant, ni étant : le simple fait d’être sans qu’il n’y ait d’étants. L’être, c’est le fait qu’on est, qu’il y a. » (p.130). Il y a beaucoup à dire sur ce peu de lignes. Déjà, on reconnaît la méditation lévinassienne de l’il y a, « neutre impersonnel, sans soi » – qui bizarrement suscite dégoût ou horreur, comme si l’être était mauvais, ce qui reste à prouver… Mais il est surtout étonnant que l’être soit « sans étant ». Qu’est-ce que l’être, sinon l’être de l’étant (au sens d’un génitif objectif), l’être qui fait être un étant, le principe d’existence et d’actualité de l’étant ? L’être ne flotte pas dans le vide, il est le principe immanent de l’étant, qu’on peut distinguer par analyse, mais qui n’a pas de sens en tant que séparé. Penser un « être sans étant », c’est finalement chosifier ou substantialiser l’être, comme s’il était lui-même un existant concret, c’est-à-dire un étant, une substance, ce qui est. En somme, faire de l’être quelque chose qui peut être donné comme tel, indépendamment de l’étant, ou dans sa différence avec lui, n’a pas vraiment de sens. Nous préférerons une perspective thomiste – telle qu’Etienne Gilson la lit chez Thomas d’Aquin –, où l’être (esse) est l’acte d’être de l’étant, son principe d’existence, ce qui l’actue et le pose dans l’existence, ce qui le constitue existant concret. L’être n’est pas une chose, mais un principe, un acte : l’exister. L’être, immanent à l’étant, comme ce qui le fait exister, ce par quoi il est, ne peut être donné indépendamment de l’étant, dont il est le principe. Ni concept universel et pauvre, vide et vain, ni phénomène indépendant, l’être est l’acte que l’analyse métaphysique découvre au plus intime de l’étant et qu’elle ne peut que péniblement et indirectement désigner, sans pouvoir le circonscrire, car il n’est pas une chose possédant une essence et donc conceptualisable. En outre, l’être n’a rien à voir avec quelque « nausée noire » ou « horreur de l’il y a ». La métaphysique fait fausse route si elle commence par l’affectivité. L’être n’est pas objet de sentiment. Tel est le ratage inaugural de la phénoménologie concernant l’être.
Revenons au « phénomène d’être ». « Qu’en est-il de l’être ? Si l’être il y a, il faut qu’il puisse être tout d’abord donné. Il faut que nous puissions le rencontrer. » (p.130). Je ne suis pas certain qu’il faille ainsi poser le problème de l’être. Du moins apparaît ici un présupposé phénoménologique, qui est que ce qui est doit se donner, ou que seul le donné a droit d’être. Or, il se pourrait que l’être ne fût jamais rencontré en tant que tel, mais fût seulement connu, par abstraction, à partir de et dans l’étant. Juganville tâche d’établir une affection de l’être, « une expérience fondamentale de l’être », « dans l’expérience de l’il y a : expérience d’un être neutre impersonnel, sans soi : un être sans néant, ni étant : le simple fait d’être sans qu’il n’y ait d’étants. L’être, c’est le fait qu’on est, qu’il y a. » (p.130). Il y a beaucoup à dire sur ce peu de lignes. Déjà, on reconnaît la méditation lévinassienne de l’il y a, « neutre impersonnel, sans soi » – qui bizarrement suscite dégoût ou horreur, comme si l’être était mauvais, ce qui reste à prouver… Mais il est surtout étonnant que l’être soit « sans étant ». Qu’est-ce que l’être, sinon l’être de l’étant (au sens d’un génitif objectif), l’être qui fait être un étant, le principe d’existence et d’actualité de l’étant ? L’être ne flotte pas dans le vide, il est le principe immanent de l’étant, qu’on peut distinguer par analyse, mais qui n’a pas de sens en tant que séparé. Penser un « être sans étant », c’est finalement chosifier ou substantialiser l’être, comme s’il était lui-même un existant concret, c’est-à-dire un étant, une substance, ce qui est. En somme, faire de l’être quelque chose qui peut être donné comme tel, indépendamment de l’étant, ou dans sa différence avec lui, n’a pas vraiment de sens. Nous préférerons une perspective thomiste – telle qu’Etienne Gilson la lit chez Thomas d’Aquin –, où l’être (esse) est l’acte d’être de l’étant, son principe d’existence, ce qui l’actue et le pose dans l’existence, ce qui le constitue existant concret. L’être n’est pas une chose, mais un principe, un acte : l’exister. L’être, immanent à l’étant, comme ce qui le fait exister, ce par quoi il est, ne peut être donné indépendamment de l’étant, dont il est le principe. Ni concept universel et pauvre, vide et vain, ni phénomène indépendant, l’être est l’acte que l’analyse métaphysique découvre au plus intime de l’étant et qu’elle ne peut que péniblement et indirectement désigner, sans pouvoir le circonscrire, car il n’est pas une chose possédant une essence et donc conceptualisable. En outre, l’être n’a rien à voir avec quelque « nausée noire » ou « horreur de l’il y a ». La métaphysique fait fausse route si elle commence par l’affectivité. L’être n’est pas objet de sentiment. Tel est le ratage inaugural de la phénoménologie concernant l’être.
Ce manque de métaphysique de l’auteur se manifeste également dans une grossière réduction de la métaphysique à la pensée de l’étant comme produit, dont nous avons vu le sens précédemment. Juganville écrit qu’« à partir de la production, naît la possibilité de comprendre l’étant en général sans plus de différences ontologiques : l’étant en général comme stock. Et si tout étant est compris au sein de la production, alors il devient même possible de penser l’étant en général comme lui-même produit en totalité. » (p.209). Il est vrai que la production contemporaine a tendance à faire de tout étant un produit et une marchandise. Mais il est faux d’en tirer que l’essai de la métaphysique pour penser « l’étant en général » résulte de cette pratique productive. Pour Juganville, et à la suite de la doxa heideggerienne, « les concepts fondamentaux (de la métaphysique) proviennent d’une expérience originelle d’où ils furent tirés : la production. Plus encore : la métaphysique est une ontologie de marchand. » (p.210). La sentence est tentante, mais elle ne correspond évidemment pas à la réalité. Approfondissons la difficulté.
Il nous semble que l’ontologie proposée par Gilles de Juganville manque de métaphysique, non seulement dans sa conception de l’être, comme nous avons essayé de le montrer, mais aussi dans son analyse de la causalité et donc aussi de la finalité. Pour Juganville, la causalité revient à la production. Seuls les produits ont des causes – matérielle, formelle, motrice et finale. Toute extension du système de la causalité à d’autres sens d’être que les choses et les aliments serait indue. Mais alors d’où viennent éléments, végétaux, animaux et hommes ? Juganville se contente de parler de leur « venue à l’être », mais celle-ci ne serait pas une causalité – sauf aujourd’hui où tout devient produit. Or, dans son étude de la causalité, l’auteur définit la cause « ce à quoi tient qu’une chose soit, et qu’elle soit telle et non une autre » (p.203), « ce par quoi quelque chose vient à être » (p.204). On ne voit pas ce qui interdit d’appliquer cette définition à l’homme et à l’animal. Refusant cette évidente application de la notion de causalité à ce qui n’est pas strictement produit, Juganville se condamne à parler du « jaillissement sans cause du monde » (p.311), qui est menacé par l’extension tous azimuts de la production. C’est poétique, mais est-ce rigoureux ? En fait, Juganville est comme prisonnier du présupposé phénoménologique, selon lequel on ne peut connaître que ce qui est phénoménalement donné. À la différence des produits, les autres sens d’être sont simplement donnés, ce sont des donnés, des étants donnés, comme dirait Marion, et nullement causés ni produits. Sauf qu’il est évident qu’on peut assigner des causes du devenir et de l’être aux animaux, aux hommes, aux végétaux et aux éléments. La science ne s’en prive pas, ni non plus l’expérience ordinaire. Le confinement de la causalité dans la seule production n’est pas ordinaire.
Or, se contenter d’un « jaillissement sans cause du monde » et refuser d’assigner quelque cause aux choses entraînent pour conséquence de ne jamais poser une question métaphysique fondamentale : pourquoi y a-t-il de l’être ? Quelle est la cause de tout, la cause radicale et totale de tout étant ? D’où vient qu’il y a de l’étant ? Et bien sûr : quelque principe divin ne serait-il pas à l’origine du monde ? On peut considérer qu’y répondre est délicat et difficile, mais elle n’est sûrement pas insensée. Ne pas la poser de fait, voire par principe, est une restriction indue de l’enquête ontologique. D’ailleurs, même d’un strict point de vue phénoménologique, il n’est pas impossible de poser un sens d’être supplémentaire – la divinité –, qui se donne en un certain type de phénomène – la révélation –, certes extraordinaire, ainsi qu’un Jean-Luc Marion ou un Jean-Yves Lacoste l’ont affirmé. En somme, comme Cause première ou comme Amour qui se donne et se révèle, pourquoi Dieu n’aurait-il pas droit de cité ontologique, certes selon un sens d’être bien particulier ?
L’origine des autres sens d’être n’est pas posée, ni non plus leur finalité. Là encore, Juganville considère que la cause finale ne vaut que pour les produits. « La finalité est un concept de la production. La catégorie fin-moyen appartient à la production. (…) Les autre sens qui ne sont pas produits sont sans pourquoi. Seuls les produits ont un pourquoi : leur cause finale. » (p.221). Outre qu’on voit mal comment on pourra dès lors rendre compte de l’action humaine, il est une autre conséquence majeure qui intéresse plus directement la réflexion présentée dans ce livre. Si le monde ni l’homme n’ont de finalité, s’ils ne sont « faits pour » rien, s’ils sont « sans pourquoi », s’ils n’ont nulle orientation, au nom de quoi s’opposer au mal ontologique que sont la dévastation du monde par la production totale et l’indifférenciation des sens d’être, si bien présenté par ce livre ? Pourquoi s’inquiéter de l’époque de mutants ? Pourquoi ce mal ontologique est-il mauvais ?
 Au fond, un tel argument vaut aussi pour les magistrales œuvres de Jean Vioulac, dont les analyses consonent avec celles de Gilles de Juganville. De plus en plus fataliste, Vioulac montre l’ampleur de la catastrophe contemporaine et termine sur un aveu d’échec de l’Histoire : « Il est alors possible qu’il faille faire un constat d’échec sur l’Histoire comme telle […] peut-être que l’insurrection ontologique de l’homme au sein de la nature, lutte millénaire pour s’en différencier, quête alchimique d’une transsubstantiation de la négativité en liberté, peut-être que cette guerre, de droit ou de force, de logique bien imprévue, doit à la fin consentir à sa défaite – constat des plus désolants, mais la philosophie n’a pas vocation à consoler, son honneur est la lucidité » (Anarchéologie, Paris, PUF, 2022, p.351). Il est frappant de mesurer combien l’historicisme de telles pensées nous laisse profondément désarmés face à la catastrophe. Si nous ne sommes pas auteurs ni maîtres de l’histoire, notre passivité est indépassable, et la lucidité conquise risque de se muer au mieux en mélancolie, au pire en cynisme.
Au fond, un tel argument vaut aussi pour les magistrales œuvres de Jean Vioulac, dont les analyses consonent avec celles de Gilles de Juganville. De plus en plus fataliste, Vioulac montre l’ampleur de la catastrophe contemporaine et termine sur un aveu d’échec de l’Histoire : « Il est alors possible qu’il faille faire un constat d’échec sur l’Histoire comme telle […] peut-être que l’insurrection ontologique de l’homme au sein de la nature, lutte millénaire pour s’en différencier, quête alchimique d’une transsubstantiation de la négativité en liberté, peut-être que cette guerre, de droit ou de force, de logique bien imprévue, doit à la fin consentir à sa défaite – constat des plus désolants, mais la philosophie n’a pas vocation à consoler, son honneur est la lucidité » (Anarchéologie, Paris, PUF, 2022, p.351). Il est frappant de mesurer combien l’historicisme de telles pensées nous laisse profondément désarmés face à la catastrophe. Si nous ne sommes pas auteurs ni maîtres de l’histoire, notre passivité est indépassable, et la lucidité conquise risque de se muer au mieux en mélancolie, au pire en cynisme.
Or, il n’est de mal que par rapport à une finalité, qu’on manque et qu’on n’atteint pas, à ce qui devrait être et hélas n’est pas. La cécité n’est un mal que pour celui qui est fait pour voir. Si nous existons simplement, sans origine ni fin, ce n’est pas faillir que de s’anéantir. Si le monde jaillit sans cause, s’il est simplement, par hasard si l’on veut, s’il ne porte nul sens en son sein, s’il n’indique nulle origine ni finalité, si l’être est neutre, pourquoi serait-ce un mal qu’il ne soit plus tel qu’il est, ou qu’il ne soit plus tout court ? Si nous ne sommes faits pour rien, quel mal y a-t-il à se précipiter vers (le) rien ? N’est-ce pas finalement ce pour quoi nous sommes faits ? À mon sens, il manque ainsi à cette méditation ontologique une ouverture à la question religieuse, de laquelle dépend le sens des choses, je veux dire à la fois leur signification et leur direction. « Tu nous as faits pour Toi… » On verrait alors que la catastrophe appelle un salut, qui vient d’en-haut, d’ailleurs.
Voici quelques interrogations qui peuvent rester au lecteur, mais qui n’entacheront sans doute pas son admiration devant la profondeur et même la gravité de la pensée à l’oeuvre. Ce livre, mûrement médité, patiemment écrit, minutieusement pesé, est un vrai livre de philosophe. Quoiqu’elle manque de métaphysique, ou que la métaphysique lui manque, cette ontologie phénoménologique et herméneutique donne à penser. Saisissons cette opportunité et remercions-en son auteur.








