Les éditions Fayard, sous l’excellente impulsion de Francis Wolff et Paul Clavier[Lesquels Francis Wolff et Paul Clavier avaient déjà édité un posthume de Lebrun, L’envers de la dialectique, Seuil, 2004, chroniqué ici même [https://actu-philosophia.com/spip.php?article106 [/efn_note], viennent de publier sous le titre Kant sans kantisme un recueil d’articles de Gérard Lebrun consacrés à Kant1. On ne dira jamais assez combien Gérard Lebrun fut un esprit libre, loin de l’esprit de clan ou de système ; ses articles portent trace de cette liberté, de ce savoir si imposant qu’il parvient à s’affranchir du superflu – de l’érudition pédante des notes de bas de page –, tant la maîtrise des textes et des commentaires impose d’aller directement à l’essentiel. Cela, les éditeurs en rendent parfaitement compte par une belle remarque introductive : « Le lecteur ne peut manquer d’être saisi par l’extraordinaire richesse et précision de l’information, et en même temps par l’économie qui en est faite : pas d’esbroufe, pas de déballage, pas d’intimidation érudite. »2 En lisant Lebrun, on se prend à rêver de commentateurs libres, ne se croyant plus liés par l’obligation de n’aborder le texte de l’auteur étudié qu’après avoir exposé les 150 interprétations précédentes, bref on se prend à rêver d’un commentaire moins commentariste, moins scolastique, plus éthéré, plus libre, plus philosophique.
Le recueil est divisé en quatre parties principales : les textes pré-critiques (expression que Lebrun remet évidemment en cause), la période de la raison pure, la Critique de la faculté de juger comme médiateur unifiant des deux précédentes Critiques, et enfin la « morale de l’Histoire », ce qui permet de donner au lecteur un aperçu vaste et global de la pensée kantienne, et l’on ne saurait que louer les éditeurs d’avoir proposé pareil découpage.
A : Kant et la métaphysique
Fidèle à ce qu’il avait magistralement exposé dans sa thèse, Kant et la fin de la métaphysique3, Lebrun rappelle que le souci principal de Kant est d’ordre métaphysique, et non, comme le pensait Cohen, d’ordre cognitif : son problème n’est pas d’abord celui d’établir une théorie des sciences, mais bien de penser une métaphysique possible après la charge humienne. On se rappelle ce que, en 1970, Lebrun écrivait contre la célèbre interprétation de Cohen : restreindre la critique « à la Déduction et au Système des Principes, c’est faire de la science des limites un instrument au service du principe de la possibilité de l’expérience ; c’est donc confondre, dans la Critique, le positif avec l’essentiel, comme si l’assignation de la frontière du non-savoir n’était qu’un corollaire de la fondation des sciences. »4 Cette défense de la recherche d’une métaphysique possible comme souci primordial de la pensée kantienne se trouve maintenue dans les articles présentés ici ; la défense de la raison, selon Lebrun, ne vise pas à assurer une fondation de la science possible, mais bien à repenser en termes neufs ce qui, du suprasensible, demeure accessible. « Kant ne défend la science en tant que pratique rationnelle que pour en faire ressortir les droits de la raison en général, et notamment le droit de penser – sinon de connaître – le suprasensible. »5
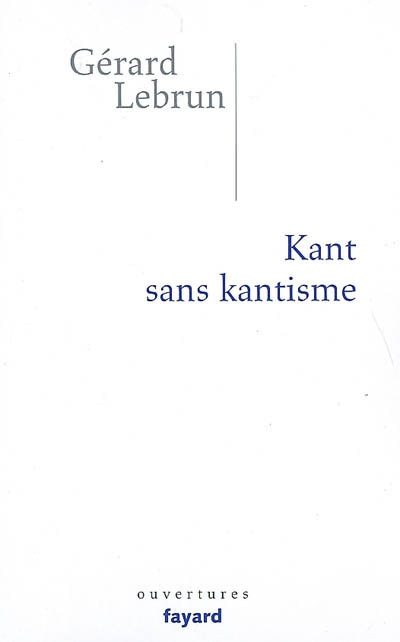
Ce qu’il y a de fascinant chez Lebrun, c’est qu’il pense une troisième voie, entre la réduction du kantisme des néokantiens à une théorie cognitive, et l’interprétation de Heidegger qui oblitère cette théorie de la connaissance au profit d’une ontologie exclusive. Il ne s’agit pas pour Lebrun de décrire la manière avec laquelle Kant construirait une métaphysique, ni même de savoir si ce dernier a voulu détruire la métaphysique, mais bien plutôt de comprendre comment Kant a cherché à penser la possibilité d’une métaphysique après les coups sceptiques de Hume. Dès 1970, Lebrun annonçait la couleur : « Kant a-t-il oui ou non aboli la métaphysique ? Nous voudrions montrer que cette seule question semblerait à Kant signe d’incompréhension. »6 Le problème kantien n’est en effet pas de savoir s’il convient ou non d’abolir la métaphysique après Hume, mais bien de savoir comment penser cette dernière en tant que possible après Hume. C’est pourquoi, le premier article du recueil s’avère fondateur : pour contrer Hume, Kant va « ruser » contre Hume ; en simulant une concession sur le scepticisme, il va déjouer la méfiance et rétablir une pensée critique de la métaphysique. « Kant feint de céder sur tout parce que ce sera le seul moyen de ne céder sur rien. »7
Ce que Lebrun cherche donc à établir, c’est que le centre de tout problème philosophique au sein de la pensée kantienne n’est autre que celui de la métaphysique : si Kant simule d’être vaincu par Hume, c’est pour mieux le contourner et le contrer ; si Kant élabore une théorie de la connaissance, c’est d’abord et avant tout pour répondre à un problème métaphysique, et pour déterminer ce qui reste possible en elle, si bien que l’élaboration d’une théorie de la connaissance n’est alors plus que la conséquence d’une pensée tout entière consacrée à l’investigation de ce qui reste possible dans la métaphysique.
Cette question métaphysique va ainsi recevoir un traitement dirimant tout au long des articles réunis dans notre ouvrage ; dans une remarquable étude consacrée à l’espace, Lebrun va montrer combien le problème de l’espace dont hérite Kant est lié tout autant à des questions physiques qu’à des problèmes métaphysiques. Ainsi, le problème de la totalité infinie se voit-il interprété dans une perspective métaphysique en tant que ce qui est contradictoire pour nous – une totalité infinie – ne signifie pas forcément qu’elle le soit dans l’absolu ; contre les leibniziens, Kant refuse de passer de ce qui est impossible pour nous à ce qui est impossible en droit. Ce principe kantien signifie une chose claire : le savoir se limite au fini, si bien que le tout infini ne saurait faire l’objet d’un savoir, ou, dans des termes plus kantiens, il ne saurait faire l’objet d’une saisie intuitive, condition première du savoir. L’enjeu de la phénoménalité de l’espace est alors manifeste : « des affirmations qui seraient absurdes au niveau des substances cessent justement de l’être au niveau des non-substances. »8
Mais un autre des points majeurs de l’analyse que propose Lebrun autour de la métaphysique consiste à en cerner l’évolution entre 1770 et 1781. En 1770, l’égarement de la métaphysique dénoncé par Kant, provenait de l’universalisation irréfléchie des conditions de leur connaissance sensible ; comme les métaphysiciens, à leur insu, confondent conditions de celle-ci avec celles de l’objet en général, ils parlent d’un intelligible qui est en réalité un phénomène intellectualisé. En 1770, ce sont donc les conditions des sensibilia qui donnent lieu à une extrapolation illégitime ; en 1781, en revanche, ce sera l’extrapolation des intelligibilia qui désignera la critique de la mauvaise métaphysique dont Kant semble donc n’avoir cessé d’affiner les contours.
B : Hegel chez Kant
L’ouvrage le plus célèbre de Lebrun portant sur une analyse du discours hégélien, nous ne saurions être surpris de trouver parmi les articles ici réunis de très nombreuses références à l’auteur de l’Encyclopédie. L’un d’entre eux se propose de clarifier le débat sur la chose même entre Kant et Hegel, selon une lecture à la fois claire et audacieuse ; Hegel, on le sait, a toujours reproché à Kant d’avoir perdu de vue que la pensée était capable de pénétrer l’en-soi des choses et, par conséquent, que le sujet était capable de pénétrer le cœur même de la substance sans se contenter des miettes phénoménales. Certes Hegel reconnaît à Kant le mérite d’avoir pensé la nécessité de la contradiction inhérente au penser, mais il lui reproche de n’avoir pas vu que cette contradiction résidait dans les concepts eux-mêmes. Or, remarque Lebrun, le point de désaccord est probablement plus profond que ne l’est la louange opérée par Hegel à l’adresse de Kant, Lebrun prenant ainsi le contrepied de l’analyse classique de Guéroult : « Enquête sur la simple nature des catégories ou enquête sur la valeur de l’application à laquelle elles peuvent donner lieu : il y avait là un choix décisif à partir duquel des point de contact entre Kant et Hegel ne sauraient plus être, pour celui-ci, que de furtifs points de rencontre. »9 La démonstration que propose Lebrun est magistrale et absolument convaincante car il explique avec force clarté la manière dont chacun des debaters des antinomies est contraint de procéder à une pétition de principe, ce qui est une manière originale et probablement très pédagogique de présenter le problème.
Un des autres débats que soulève Lebrun relève de la philosophie de l’histoire : partant d’une interrogation fort simple – peut-on dire que Kant est le fondateur de la philosophie de l’histoire ? Lebrun en profite pour interroger aussi bien les écrits sur l’histoire kantiens que la philosophie hégélienne de l’histoire, le tout sur fond d’une interrogation nettement politique. Prenant appui sur l’autonomie morale, Lebrun rappelle qu’élaborer des maximes morales, c’est agir comme devrait le faire tout être raisonnable, et nous avons là d’emblée un « modèle politique »10 dont il s’agit de penser les implications ; en d’autres termes, le fonctionnement même de la moralité kantienne dessine les contours d’une assemblée politique de sujets rationnels, guidés par le règne des fins. Pour autant, cette vocation politique de l’homme ne saurait être naturelle, dans la mesure où la véritable moralité kantienne réside dans son arrachement à la naturalité de l’homme ; de ce fait, si l’homme est bien un être politique, il ne saurait l’être par nature, pour autant que sa vocation politique relève du même règne que celui de la morale : « Que le règne des fins soit l’horizon de l’autonomie signifie donc que l’homme est un être politique par surnature, et que la civitas dei est même le seul type possible pour l’expression mundus intelligibilis. »11
Mais il est possible d’aller plus loin : Kant, on le sait, justifie l’observance de la loi morale par le progrès indéfini de la moralité dans le monde, si bien que je décide d’obéir à la loi morale parce que je présuppose que mon action contribuera – certes marginalement – à accroître la quantité de bien dans le monde ; de la sorte, la moralité kantienne s’appuie sur le présupposé d’une Histoire qui, au fur et à mesure, se rapprocherait du Bien, c’est-à-dire de la norme morale. Progressivement, ce qui arrive se rapproche de ce qui doit arriver. Il y a là, nous dit Lebrun, une parenté certaine avec Hegel, ce dernier ayant repris l’idée d’un rapprochement historique entre ce qui est et ce qui doit être. Pour autant, Hegel ne reprend pas la liaison entre la moralité et l’histoire, mais il semble bien, malgré tout, que Hegel se soit appuyé sur les concepts kantiens d’un cours de l’histoire donnant son sens, non pas au devoir, mais bien plutôt à l’action individuelle.
C : Kant relu en lui-même
Le dernier point que je souhaite mettre en évidence dans cette série d’articles remarquables, c’est le procédé de lecture retenu par Lebrun : non pas une succession de références infinies à la littérature secondaire, ni même une tentative de reconstruire la totalité du kantisme à partir d’un point jugé décisif, mais bien plutôt une patiente discussion de quelques passages, jugés essentiels quant à la compréhension de Kant – et non du kantisme.
Cette volonté de déprise à l’égard de la systématisation excessive qui encombre plus qu’elle n’éclaire la pensée ne signifie pourtant pas que Lebrun renonce à penser l’unité d’une œuvre ou d’une idée ; cela est particulièrement manifeste lorsque se trouve examinée la Troisième Critique, que Lebrun relit selon une perspective pour le moins originale : à ses yeux, la faculté de juger « aide la raison pratique à construire l’idée de Dieu qui est indispensable à l’exercice de celle-ci. »12 Mieux que cela, affirme Lebrun, la faculté de juger est là pour rétablir la providence : non pas, bien sûr, pour assurer la connaissance théorique que j’ai pu acquérir, mais bien plutôt pour guider mon action, pour éclairer ma pratique. Toujours soucieux de penser Kant à partir de Hume, Lebrun relie ainsi la Troisième Critique à une œuvre de celui-ci : « la Critique de la Faculté de Juger est la riposte de Kant aux Dialogues sur la religion naturelle. »13 Cela ne veut pas dire que Kant réintroduit les fins objectives que Hume avait ruinées, mais cela signifie que la nature se règle sur notre pouvoir de connaître, et cet accord presque miraculeux rend l’existence de Dieu moins improbable. Lebrun retrouve là une des interrogations majeures de Kant et la fin de la métaphysique où la fin du chapitre VI se demandait comment était acquise la garantie de la rationalité du monde dès lors que la providence n’en garantissait plus la connaissance théorique…
On ne sera alors guère surpris de découvrir le titre du chapitre III. 2, « La Troisième Critique ou la théologie retrouvée », où Lebrun propose de subsumer la Critique de la faculté de Juger sous le problème des fins : qu’est-ce qui peut être dit obéir à une fin ? La limitation du savoir ouvre un abîme, en tant que le savoir humain se trouve incapable de décider théoriquement de cette question ; en revanche, le sujet rationnel est en mesure de trancher du point de vue pratique : être soumis à la Loi – donc être libre – dessine la carte des fins ultimes, et donc d’un dépassement possible des limites théoriques. En d’autres termes se trouve résolue une question majeure : pourquoi obéir à la Loi ? Mais aussitôt que se trouve résolue cette question, s’en trouve créée une seconde, plus redoutable : pourquoi dois-je croire en Dieu ? C’est à cette question que la Troisième Critique, selon Lebrun, se trouve essentiellement consacrée.
On ne saurait trop conseiller la lecture de cet ouvrage, dont la précision, la profondeur de vue, et la liberté de ton apportent une gigantesque bouffée d’oxygène dans les études kantiennes : loin de l’esprit sclérosé, Lebrun restitue toute la fraîcheur d’une pensée géniale, celle de Kant, et nous rappelle que philosopher c’est avoir de l’audace et faire usage de sa liberté dans les limites du savoir théorique. Il faut insister, en conclusion, sur cette liberté dont Lebrun fait usage, liberté qui n’est en réalité possible que parce qu’elle repose sur une connaissance parfaite de l’œuvre kantienne et – paradoxalement –, sur celle des commentateurs, pourtant timidement présents dans les notes. On se prend enfin à rêver que les commentaires philosophiques sachent adopter cette modestie audacieuse, qui est peut-être la marque d’une philosophie authentique.
- Gérard Lebrun, Kant sans kantisme, Fayard, 2009
- Ibid. p. 13
- cf. Gérard Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique, LGF références, 2003
- Ibid. p. 30
- Kant sans kantisme, p. 35
- Kant et la fin de la métaphysique, p. 45
- Kant sans kantisme, p. 32
- Ibid. p. 65
- Ibid. p. 133
- Ibid. p. 301
- Ibid. p. 302
- Ibid. p. 191
- Ibid. p. 194








