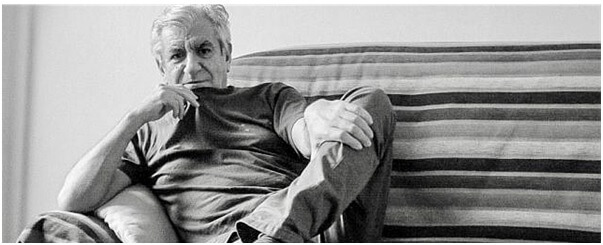Actu-Philosophia : Gérard Bensussan, bonjour, vous êtes philosophe, professeur émérite à l’université de Strasbourg, et vos travaux sont incontournables dès que l’on aborde des sujets qui peuvent paraître très différents les uns des autres, comme la philosophie juive (en particulier la pensée de Rosenzweig[1] ou de Levinas[2]), le marxisme ou la pensée de Schelling[3]. Vous avez de plus consacré nombre d’ouvrages à d’autres sujets de réflexion, Marcel Proust[4], la question du bonheur[5] ou celle de la morale[6], pour ne citer qu’eux.
Le premier champ d’investigation sur lequel vous vous êtes penché est le Dictionnaire critique du marxisme[7], que vous avez dirigé avec Georges Labica et qui a été, depuis, plusieurs fois réédité. Pourriez-vous nous d’où vous est venu votre intérêt pour le marxisme, et en quoi cet ouvrage de référence s’est voulu « critique » ?
Gérard Bensussan : J’ai du mal à reconnaître la trajectoire philosophique qui a été la mienne dans ce portrait d’un touche-à-tout de la pensée que vous dressez. En même temps, je comprends bien qu’un regard extérieur puisse saisir ou ressaisir ses « moments » de cette façon. Vu de loin et du dehors, quoi de commun, en apparence, entre Proust et le marxisme, la justice et Schelling, la pensée juive et le bonheur ? Ce commun, précisément, n’est pas nommé, et je dirais aujourd’hui que c’est Hegel ou plutôt l’ensemble des questions qu’il adresse à la pensée. Je m’explique. Quand j’ai commencé à lire de la philosophie, vers l’âge de quinze ans, je me suis immédiatement et simultanément trouvé emporté par un courant et un contre-courant, une fascination pour des textes très obscurs, par exemple, et notamment, L’éthique ou La Phénoménologie de l’esprit, et un désir profond de résister à cette fascination, ce qui, croyais-je à l’époque, commanderait ma façon propre de faire de la philosophie en la destituant de ses titres, de philosopher tout autrement que tous ceux qui m’avaient précédé. Il n’y avait là bien sûr aucune originalité, une présomption naïve plutôt, et aussi l’effet d’un climat d’époque, une affaire de génération. Marx, le jeune Marx, lisant Hegel et dénonçant dans ses élucubrations spéculatives une farce métaphysique, m’apparut alors, à moi et à tant d’autres, je le répète, comme un modèle associant à la parfaite maîtrise de la conceptualité hégélienne la férocité décapante d’un militantisme anti-philosophique, celle-là emportant la critique élaborée par celui-ci. Ceci impliquait par ailleurs, ou plutôt du même mouvement, un investissement radicalement politique de la philosophie. Le mot d’ordre, l’injonction étaient désormais évidents : il me fallait en même temps faire de la philosophie et militer de façon concrète aux côtés du mouvement ouvrier communiste, « lire le Capital », décrypter ses attendus hégéliens ou contre-hégéliens, et entrer dans la contestation pratique, militante, de l’ordre des choses réellement existant. Cette décision de prime jeunesse a marqué ma vie pendant de très longues, trop longues, années. Je n’y reviens pas pour le moment, il faudrait évoquer Mai 68, mes années passées dans la feue République démocratique allemande, etc.
Le Dictionnaire critique du marxisme fut pour Labica et moi, une grande entreprise collective, l’étendard des « althussériens » comme on a dit à l’époque. Il signifia pour moi le point d’orgue de mon rapport au marxisme. Et « critique », pour répondre à votre question, signifiait non pas un refus ou un rejet, pas du tout, mais la nécessité historique où nous nous trouvions ou croyions nous trouver de penser la pensée de Marx et les marxismes dans une situation de crise. Au fond, je suis devenu marxiste à l’époque de la crise profonde du marxisme, et c’est la raison pour laquelle mon marxisme fut forcément althussérien. Je suis devenu communiste à l’époque de la scission russo- chinoise du mouvement communiste, et militant politique à l’époque de la mise en crise de la forme-Parti. Et on pourrait décliner le refrain à propos de la politique, face à la crise de la représentation, comme on dit ; ou encore à propos de la philosophie, confrontée à la déconstruction de la métaphysique de la subjectivité.
Sur le plan philosophique, l’enjeu était clairement posé en tout cas et, à bien y regarder, il s’est maintenu continûment. Penser avec Hegel et contre Hegel, depuis le rapport à Marx, dans l’adolescence, jusqu’au rapport à la pensée et à sa forme philosophique ensuite et sans interruption. La façon, les modes, les voies permettant de « sortir de Hegel », expression de Schelling, vous voyez, n’ont jamais cessé de me retenir, parfois sans que cette attention ne soit même explicitée…
Mais la tâche était infinie et le chemin impraticable à la façon en tout cas dont je pouvais me le figurer dans ma jeunesse. D’abord parce que, Foucault ou Blanchot l’ont très bien dit, on ne sort pas de Hegel, sauf si on n’y est jamais aventuré. Ensuite parce que Hegel représente l’assomption récapitulative et la sommation dialectique de l’histoire de la philosophie dans son entièreté. La question « sortir de Hegel » ne signifie rien de moins que la question même de la philosophie et de la possibilité d’en sortir, très vieille question au demeurant, tout le monde se souvient de « pour ne plus philosopher, il faut philosopher encore », Aristote, Pascal, etc. Ce qui n’a jamais cesser de me saisir, ce fut donc l’examen spectrographique d’un certain nombre de figures de cette « sortie » et de tout ce que la philosophie contemporaine, mais déjà aussi moderne, portait de cet effort au fond immémorial. Heidegger a un mot très expressif pour le dire, « sich aus der Philosophie herausphilosophieren », il faut s’extirper par la philosophie hors de la philosophie, affirme-t-il. De ce fait, mais je vais très vite, chacun des éléments ou des noms propres que vous avez mentionnés présentent, selon des modes d’exposition et d’expression totalement hétérogènes, des issues, des façons, des condensations de cette auto–extirpation dont parle Heidegger, et dont je dirais quant à moi qu’elle est plutôt hétéro- affection. A la philosophie pérenne, « il faut » une extériorité – la poésie pour Heidegger, c’est cela d’ailleurs. C’est à cette place déplacée que se tient la pensée juive, comme mode de questionnement étranger à l’essence, à la substance, ou encore la littérature en tant qu’elle montre, souvent, comment se dramatisent des sujets sans souveraineté ni libre-arbitre, des ek-sistences, des intrigues. Autant de figures de cette extériorité dont je parle et que les sorties tentent de retrouver, Marx « le sortant », c’est le titre d’un de mes livres[8], avec les conditions matérielles d’existence du prolétariat, Schelling face à la révélation ou la mythologie, Proust avec le thème de « l’involontaire ».

AP : Ainsi, c’est par le biais de l’opposition à Hegel, en cherchant comment « sortir de Hegel » que vous suivez une sorte de double parcours. Il s’agit, d’une part, de relire et approfondir les critiques de Hegel émanant de philosophes de sa génération ou de celle qui suit immédiatement, comme dans votre livre sur Hess ou votre travail sur Schelling (d’où la grande présence de la philosophie allemande dans vos recherches) et, d’autre part, de lire des auteurs en étant porté à le faire par le mouvement d’ « anti-hégélianisme » qu’ils partageraient, pourrait-on dire (Rosenzweig, ou Levinas, et avec eux, toute la philosophie juive). Est-ce bien cela ? Et alors, qu’avez- vous trouvé chez Moses Hess[9] qui vous permette d’entrevoir ce que pourrait être une sortie de Hegel ? Est-ce en lui le philosophe juif ou le compagnon de route de Marx et Engels que vous avez étudié ?
GB. Je vais vous répondre sur Hess. Mais je voudrais d’abord revenir, puisque vous m’y invitez, sur Hegel – et sur de possibles malentendus que j’entrevois, parce que c’est une question capitale et délicate. On ne « s’oppose » pas à Hegel, ça n’a pas vraiment de sens, je vais essayer de l’expliquer, on n’est pas « contre » Hegel, tout ceci, toutes ces positions sont comme pré-enregistrées dans le système si j’ose dire, les contre, les négations, les oppositions, les rejets et les refus sont sa nourriture la plus consistante. Et cela parce que Hegel fournit la logique conceptuelle adéquate à tous les raisonnements du type « x n’est pas x », « x est autre que x », en en rendant compte dans leurs mécanismes les plus subtils (l’essence n’est que dans sa manifestation) ou les plus bêtes (ce discours dit tout autre chose que ce qu’il dit). Et d’ailleurs dans n’importe quel post publié sur un réseau social aujourd’hui, en particulier les conspirationnistes, les complotistes, tous ceux qui savent mieux que tous ceux qui savent, il y a un petit ressort hégélien, il y a du Hegel, un Hegel du pauvre inutile de préciser ! Hegel nous livre la clé philosophique qui ouvre à leur « vérité » les pensées les plus triviales qui nous environnent comme il le fait avec tous les philosophies qui l’ont précédé. Je ne le force nullement en disant cela. Lui-même n’a cessé de rappeler que le Spéculatif consiste avant tout à donner aux riches contenus de l’expérience naïve la forme rationnelle qui leur est adéquate. Hegel fait souvent office d’instrument d’élucidation continue du commun restitué à sa source, de la doxa renvoyée à l’abstraction, de l’abstraction revisitée dans sa concrétude. On a là, je crois, une des raisons du succès de l’hégélianisme, jusque dans les refus qu’il suscite. Je publierai bientôt un diptyque sur Hegel[10], après avoir passé ma vie philosophique à refuser ses invitations à entrer dans sa forteresse, sans y parvenir toujours ; à cheminer aux côtés de tant d’adversaires, Heidegger, Rosenzweig, Levinas, Schelling. Comme s’il me fallait comprendre, tenter de comprendre, ce que veut dire et ce que porte, contre moi-même peut-être, le Contre-Hegel qui traverse ma vie philosophique. Je crois que chacun, dès lors qu’il commence à philosopher, doit se mettre au clair sur le rapport qu’entretiennent avec Hegel et lui-même, en son ipséité de lecteur, et les philosophes en général. Il est hors de question de tenir Hegel pour le charlatan mystificateur qu’y ont vu ou feint d’y voir tous ceux qui ont dû philosopher immédiatement après lui. Je dirais que, à condition d’en sortir (et comment ? tout est là !), Hegel fournit ou indique par la négative (on est déjà là dans le problème de Hegel) l’inventaire quasi-exhaustif des questions que nous pouvons nous poser et que lui-même n’articule jamais comme telles, comme questions. La systématicité de l’œuvre fait de chaque « moment » lu une instance en attente de son avenir dans le texte même, c’est-à-dire de sa vérité, tout à la fois immanente à l’ensemble du texte lu et toujours différée dans l’exercice pratique de sa lecture. Plus qu’aucun autre penseur, Hegel ne peut pas se lire (en) une seule fois. Il faut le lire au moins deux fois, s’avancer en terra incognita pour reconnaître le terrain, puis revenir sur ses pas et recommencer, avec en tête une cartographie mentale du système désormais « reconnu ». C’est seulement après avoir frayé des voies, reconnu le système et reparcouru les triades en accord rythmique avec leurs scansions, en respirant philosophiquement avec elles – qu’on pourra enfin, peut-être, s’aventurer dans l’exercice d’une libre lecture de Hegel où l’audace, impérieuse, s’est d’avance garantie de toute extravagance, inutile. Que veut dire « libre » ? L’association de la patience exigée dans les premiers accompagnements du Concept et d’une saine impatience manifestée ensuite envers Hegel lui-même. Lire Hegel « librement » pourra consister à le lire en toute connaissance de cause, c’est-à-dire du système, mais selon un détachement calculé, soit en détachant les pensées rencontrées chez lui de la totalité vraie où elles prennent place.
Hegel ainsi traité (ou maltraité ?), Hegel sorti, Hegel renversé, offre du coup, m’a offert en tout cas de quoi asseoir le seul principe qui me soutient comme philosophe : exiger du monde un peu de réalité. C’est peut-être l’unique tâche du philosophe, ne pas céder, ne pas trop céder, sur ce point. Sans doute ai-je toujours fait de la philosophie avec cette exigence au fond de la tête, et surtout en lisant Hegel, dans l’irritation parfois car il est celui qui semble répondre à cette contrainte et celui qui l’exhausse trop loin d’elle-même.
Un mot à propos de Moses Hess, pour autant qu’il m’en souvienne car c’est une très ancienne histoire pour moi puisque c’est à lui que j’ai consacré ma thèse. On le range souvent parmi les Jeunes-Hégéliens. À tort à mon avis, car ce n’est pas d’abord par lui que Marx et Engels se sont appropriés la « méthode » de Hegel, la dialectique, contre son « système ». Et il a été le troisième homme, aux côtés de Marx et d’Engels, après que les autres accompagnants ont été abandonnés à leur sort ! C’est parce qu’il est pour l’essentiel celui qui les a introduits dans le communisme de son époque, de façon concrète, dans les associations ouvrières, leurs débats, par le militantisme, par ce qu’on appelait jadis l’engagement. Hess est une figure très singulière, par son « communisme », par son élaboration d’une « philosophie de l’action » bien peu hégélienne, plutôt pratico-fichtéenne, si j’ose dire ainsi. Sans parler de sa prime invention, avant Herzl, du sionisme politique, là aussi avec des implications stratégiques et pratiques. C’est un penseur de l’utopie concrète, du genre Bloch, qu’il s’agisse d’un socialisme anti-autoritaire ou d’un sionisme collectiviste.
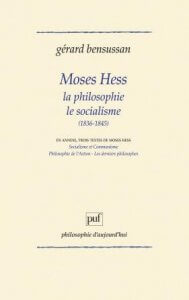
Et puis quand j’ai travaillé sur la pensée schellingienne de l’histoire, très importante – Habermas expliquait que Schelling avait un sens de l’historicité beaucoup plus aiguisé que Hegel ! – j’ai constaté une profonde affinité avec Hess. Schelling propose de lire l’histoire de façon stratifiée. L’histoire « ordinaire », phénoménale, externe, serait en fait travaillée en son cœur par une histoire « propre », ou encore supérieure, « suprême », interne, par une « histoire supra-historique » selon la formule de la Philosophie de la Révélation. L’histoire, pour ne pas virer en maladie mortelle, comme dira Nietzsche un peu plus tard, ni se laisser aller à la simple Historie linéaire, selon Heidegger, doit être plus et moins que l’histoire comme processus. Il lui faudrait un « principe » extérieur à la totalité qui s’autototalise en elle, pour être vraiment intelligible. Dans un texte de 1837, Die heilige Geschichte der Menschheit, Moses Hess propose, selon une intuition voisine de la suggestion schellingienne, de lire les événements historiques selon une double grille « interne »/« externe » qu’il détermine, lui, comme un rapport du latent, les déterminations vécues du réel social, au patent, leurs réalisations par défaut. Comme si, et contre Hegel évidemment, l’histoire, à chaque fois, n’était pas toute dans l’histoire…
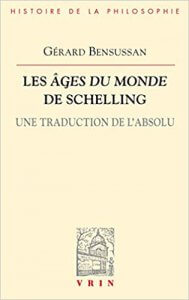
AP : Pourrait-on dire que vous analysez comment pourrait s’opérer quelque chose comme une sortie de Hegel au moyen d’une sortie de la conception de l’histoire pour Hegel, histoire récapitulative et qui laisse sans dehors à son système ? Cela expliquerait-il alors votre intérêt pour le temps messianique, que vous décrivez comme épreuve « d’une verticalité interruptive de l’horizontalité de la « longueur de temps » et de la logique linéaire des finalités » et auquel vous avez consacré un livre[11] ? Est-ce également cela qui a initié ou renouvelé votre intérêt pour Rosenzweig, très fin connaisseur de Hegel mais qui s’y oppose finalement dans L’Etoile de la rédemption, pour qui le peuple juif se définirait par le refus d’une existence historique ?
GB. Bien sûr, c’est comme cela que s’est effectué mon cheminement, d’un marxisme non-hégélien, plus ou moins rêvé par les althussériens, à un messianisme, appréhendé d’abord comme une intuition, une possibilité de salut, ou de sortie loin de Hegel. Les prestiges de Hegel, même pour un jeune marxiste feignant de s’en moquer, étaient en profondeur attachés à la question de l’Histoire, et du temps, et de la place du judaïsme dans ces vectorialisations des grandes « époques », des Esprits des peuples. Le texte même des Leçons sur la philosophie de l’histoire trahit une perplexité, il laisse affleurer une sorte de tremblement sur le judaïsme, lequel semble résister par inertie à l’automouvement de l’Esprit en marche vers le Savoir de ce qui est en vérité, comme dit Hegel. Par sa perexistence, même à titre de fossile vivant, le judaïsme brouille les scansions successives du temps comme la venue à l’existence, via les Esprit des peuples, du Concept ; et il ne se résigne pas à la Nécessité d’une aliénation par où les volontés particulières seraient guidées par une Ruse centripète, et où la circonférence est ramenée nolens volens à son centre de rationalité intégrale. Le judaïsme pose à Hegel le même problème qu’au jeune Marx ou qu’à l’historiographie en général, surtout lorsqu’elle est, comme en Allemagne jadis, marquée par l’hégélianisme. Pas moyen d’en rendre « raison », sauf à en faire une exception à l’histoire qui ne ferait que confirmer sa règle. Le recours au messianisme m’a semblé, à un certain moment, proposer un type de temporalité très étranger à Hegel, sans que, tout d’abord, je sache bien pourquoi. Mais la condition impérative était de revenir à sa source juive. Parce que le paradoxe, c’est que le terme de messianisme, tel qu’il est habituellement utilisé, du simple journaliste à l’historien éminent, désigne une téléologie, c’est-à-dire une structure historiale orientée par une universalité abstraite selon un sens déjà prédisposé au mouvement d’ensemble qu’il traverse. Et ce serait alors ce sens que les mouvements et les discours « messianiques » voudraient effectuer et faire advenir tout de suite, ici et maintenant. L’avenir se présenterait du coup comme l’autoréalisation de ce sens à la fin, dans l’unification ultime et précipitée des fins. Cette téléologie objective paraît alors conforter la téléologie subjective hégélienne, laquelle pense l’effectuation de cette même structure sensée comme recherche de la liberté par l’Esprit. En tant que « messianisme », elle s’est incorporée, à un certain moment, dans des formes idéologiques et politiques historiquement datées, le progressisme, voire le communisme, les Lumières, ou encore les « grands récits » dont parlait Lyotard. C’est ce qu’on appelle, globalement, la sécularisation.
Sécularisation de quoi ? Pour l’essentiel du messianisme juif, c’est la difficulté. Or, une fois transfiguré par cette sécularisation, celui-ci est défiguré. Si l’on se rapporte en effet à ses sources, talmudiques en particulier, on voit que les choses sont disposées tout autrement que dans cette téléologie objective comme sécularisation d’un pseudo-messianisme.
D’un point de vue messianique, l’histoire, c’est ce qui arrive, et le Messie a à arriver dans cette histoire qui arrive. Mais que veut dire « arriver », « venir » dans une histoire qui est histoire du salut, du peuple, de l’individu, des collectivités – de Dieu ? Ca veut dire interrompre ce qui arrive par une hyper-arrivée et donc interrompre, du dedans et du dehors à la fois, ce qu’on appelle l’histoire, puisque la venue messianique ne se laisse pas prédéterminer rationnellement. Les docteurs sont très opposés entre eux sur ces points, je n’entre pas dans ces débats, pourtant très importants et très stimulants. Disons que la venue du Messie est une effectivité immédiatement arrivante, un soudain réel – lequel ne peut être précédé par aucune potentialité. Elle est en quelque sorte l’événement des événements, un réel sans nulle possibilité qui le pré-viendrait. Le Messie viendra, lit-on dans le Talmud, de façon aussi inattendue qu’un objet perdu qu’on retrouve inopinément ou qu’un scorpion qu’on découvre dans sa chaussure (Sanhédrin 97 a).

D’où un certain type de rapport à l’instant : le Messie peut venir à tout instant, il peut passer par la petite porte de chaque instant. Et ceci bouleverse la compossibilité des temps, des trois dimensions exclusives du temps. Même le respect de la Loi, au fond, se tient dans cette instantanéité originaire. Respecter la Loi, en vérité, c’est entretenir avec elle un rapport à son instantanéité vivante (c’est bien la difficulté de toute observance religieuse). A chaque instant, il faut faire comme si la Torah venait d’être donnée, à l’instant même. Chaque instant, donc, s’instantanéise comme s’il pouvait contenir le tout du temps à l’état d’enveloppement en quelque sorte.
Ce comme-si (il faut agir à chaque instant, écrira Rosenzweig, « comme si le destin de l’humanité en dépendait ») est déterminant pour l’action humaine –laquelle sera envisagée d’un point de vue éthico-pratique et temporel plutôt qu’historique ou politico-historique, messianique plutôt qu’« hégélo-marxiste ». Car ce qui se passe et survient, ce qui s’engendre et se perpétue au fil des générations, l’histoire, donc, ne peut jamais épuiser ses possibilités. Elle ne peut à elle seule correspondre à ses actualisations et être adéquate à son concept, par où l’on retrouverait Schelling. Il y a dans l’histoire quelque chose d’agissant, une sorte de principe actif invisible, mais qui est plus que l’histoire. Nietzsche expliquait que l’histoire sert toujours une « puissance non-historique », soit pour lui « la vie » –mais l’art ou la religion font aussi bien partie de ces « forces » supra-historiques que la généalogie convoque et mobilise.
Le penseur qui a le mieux repris tous ces thèmes messianiques, sans jamais se contenter de les reproduire, mais au contraire en les fécondant de façon très particulière, c’est Rosenzweig, comme vous le relevez. Il faudrait longuement revenir notamment sur le paragraphe « messianique » de la troisième partie de l’Etoile de la Rédemption[12], et, au-delà, sur un ensemble de textes rosenzweigiens. On y trouve une lecture très originale de la sécularisation comme mimétique, une analyse de la mondialisation « johannique », une éthique singulière de la justice et de l’instant – je peux y revenir si vous le voulez, mais ça nous prendrait sans doute trop de temps, sans compter qu’il faudrait aussi parler de Derrida qui n’est pas étranger à ma façon propre de me réapproprier cette source juive du messianisme. Mais je préfère vous laisser la parole.
AP : Si je comprends bien, le messianisme, comme interruption in-anticipable de l’imprévisible, est inintégrable au système hégélien. Il serait comme ce qui nécessairement ne peut y être dissout ou prévu. Il est l’autre absolument et donc irréductible à toute téléologie, et à ce titre, radicalement étranger et inconcevable pour la pensée hégélienne. Dès lors, n’y aurait-il pas une tentation d’attendre ce Messie infigurable en renonçant l’exigence de la vie commune, de la politique qui se vit dans l’histoire ? À quoi bon, pourrait-on se dire, tenter d’anticiper le futur en se demandant comment réguler les désirs et les passions des hommes, trouver des moyens de les faire coexister ensemble, puisque que cela ne serait que secondaire, qu’accessoire ? N’y a-t-il pas un risque de fuite dans la mystique (que condamne, je crois, Rosenzweig), et, à l’inverse, comme pour en prendre le contrepied, un nécessaire souci de ne pas laisser aller la politique à elle-même ? Autrement dit, comment tenir ensemble le souci du politique qui vous a, semble-t-il, toujours guidé et cette conception du messianisme, pour laquelle le politique semble devoir être relégué au second plan ?
GB : Question décisive. Vous savez qu’elle est l’enjeu d’une controverse très vive entre docteurs du Talmud, la venue étant entre les mains de Dieu, si je puis dire, pour les uns, entre nos mains à nous selon d’autres Sages, puisqu’elle serait dépendante de notre observance des six cent treize commandements. Je ne reviens pas sur ce qu’en hébreu on appelle mahloqet, désaccord ouvert à la discussion argumentée mais sans fin, c’est-à-dire sans figure résolutoire finale, « toutes paroles étant paroles de Dieu ». Je ne m’arrêterai qu’à ce que vous cernez très bien à propos de la politique. Si tout est imprévisible, à quoi bon gouverner ou avoir l’ambition de gouverner, si gouverner, c’est prévoir, comme dit le vieil adage.
D’abord il faut être très prudent à chaque qu’on dit ou écrit « tout » ou « tous », il ne faut le faire qu’en tremblant, et en gardant en mémoire l’urgence de « briser » le tout au moment même où on y recourt, en même temps. La politique, c’est avant tout, avant tous les « touts » qu’on voudra, une responsabilité transactionnelle (ce qualificatif indique qu’il ne s’agit pas de la responsabilité éthique précédant toute question politique), la pratique de compromis instables passés avec le réel, avec ses exigences irrémissibles et cruelles. La topologie lévinassienne de l’éthique et de la justice, du visage et des tiers, est une matrice extrêmement féconde pour en dire quelque chose. Parce qu’elle engage deux questionnements inconciliables simultanément. Il y a toujours du deux, au moins, dans la décision politique, on le voit bien aujourd’hui – c’est le thème central de mon livre Les deux morales. Dire qu’il y a Deux, c’est dire que la politique ne peut être que tragique, elle doit parfois trancher là où il faudrait moralement ne pas trancher, ou trancher tout autrement. Il n’y a pas que Levinas pour nous instruire de ce Deux. On peut recourir à Max Weber. La responsabilité transactionnelle entre en conflit avec l’éthique de conviction. Deux « éthiques » au sens de Weber, pas de Levinas, se téléscopent, et la politique a affaire à cette collision et à son traitement. il lui faut tenter de se faire « nuance », sans cesse, comme disait Nietzsche -qui pouvait être aussi « marteau ». Et ce n’est pas dans sa nature, si je puis dire ainsi.

Je ne peux m’empêcher de me rapporter à la situation planétaire créée depuis près d’un an par la pandémie de coronavirus-19. Ceux qu’un comédien qualifiait récemment de « cons glorieux » affirment des convictions, elles-mêmes variables par ailleurs, sans jamais se poser la question de leur confrontation avec l’opacité et la résistance du monde. Ils se tiennent hors pratique, hors finitude, hors responsabilité. En fait ils présupposent, ou feignent de présupposer (mais la différence est politiquement sans importance), une transitivité immédiate entre des « valeurs », je suis encore dans Weber, qu’ils ont bien le droit d’avancer et de défendre, et leur traduction politique ou leur « faisabilité » historique (Koselleck). La politique est toujours une affaire de traduction entre Deux, visage/justice, valeurs-convictions/responsabilité-transaction. On pourrait décliner longuement ces figures du conflit duel qui déterminent les pratiques politiques, l’exercice et la décision politiques. Mais il faut tout de suite ajouter que ladite traduction est impossible, et qu’« il faut la faire malgré tout » comme disait Rosenzweig. Impossible en deux sens précis : d’abord la traduction sera nécessairement une trahison parce qu’elle n’est pas de l’ordre d’un transport du même dans le même, mais d’une réfraction, comme la paille qui nous paraît brisée, plongée qu’elle est dans un verre d’eau, d’une déformation. Traduction-trahison, traduction-réfraction, la politique est livrée à ces torsions, il n’y a pas lieu de le déplorer, au fond, mais il faudrait tâcher au moins de se défaire des schémas naïfs de l’intransitivité, de l’immédiateté sans reste d’une « application » mécanique d’un programme. D’où le second sens de l’impossibilité de la politique qu’il faut faire malgré tout, c’est-à-dire qu’il ne faut pas la « laisser à elle-même ». L’événement, les événements, qui en advenant préviennent toute prévision, tout programme, tout projet rationnel et concerté, arrivent hors toute possibilité qui les préviendrait, ils ne sont pas actualisation d’un possible, d’abord possibles ensuite réels, ils sont impossibles, c’est-à-dire réels. On ne devrait même pas avoir besoin de le dire en cette année d’épidémie généralisée, fauchant des millions de vies. Si l’on veut dire quoi que ce soit de l’événement impossible, c’est-à-dire, je le répète, précédé d’aucune potentialité, possibilité ou pensabilité, alors il faut se rapporter à ce qu’a été ce bloc d’impossibilité qui est tombé sur le monde il y a près d’un an. Personne, évidemment, n’a vu venir l’événement, même s’il se trouvera toujours un « glorieux » pour prétendre le contraire. Et c’est pourtant aujourd’hui le problème numéro un de toute politique, de toute proposition politique, issu d’un événement lui-même radicalement extra-politique.
Je reviens par là à votre question, à ce qu’elle a de principiel. Ce que vous appelez le « souci politique » est doublement déterminé : toujours « après » (Levinas), toujours « à faire ». Si la politique devait venir avant, avant-tout puisqu’elle-même Tout, on se trouverait devant le cas de figure de la « tyrannie », du totalitarisme. Et je me dis, à entendre certains discours tenus aujourd’hui, dans cette conjoncture si particulière, et si instructive, de la pandémie, que toute pensée d’un rapport transitif à la politique comme débouché suprême des valeurs, de la morale, de la conviction, des ontologies et des historiographies, est porteuse d’une catastrophe. Mais ce point de vue, au sens nietzschéen ou rosenzweigien, ne s’égale jamais pour moi à un apolitisme. Il peut bien emporter un dégrisement, le sentiment d’une perte irrémédiable, ce que j’appelais tout à l’heure tragique. Mais ce sentiment tragique de la politique, si je puis dire, ne peut, en tant que tel, laisser la politique à elle-même. Car il implique une action, un agir, moins « glorieux » peut-être et moins « radieux » que les optimismes historiques et gnoséologiques des « lendemains qui chantent » de jadis ou des grands récits de naguère. Mais en tant que sentiment tragique, justement, il ne peut pas s’y dérober. Le fameux « Politique après ! »[13] de Levinas contient bien l’injonction « Politique ! ». Après quoi alors ? Après ce que Levinas appelle éthique. Je rappelle souvent, pour expliquer ce que ça veut dire, l’exemple que prend Rousseau d’un homme qu’on égorge sous les fenêtres du philosophe[14]. Le cas est très intéressant parce qu’il décrit une situation inscrite dans un « avant » la politique : devant pareille violence, je suis renvoyé à un faire immédiat, ou à un ne-pas-faire, je sais bien que si je fais appel à la police , aux pompiers, à SOS-machin, ce sera trop tard. La temporalité qui me saisit lorsque je suis confronté à une violence meurtrière faite à l’autre est une sorte d’archi-temporalité plus vieille que toute prise de conscience, toute présence d’esprit. L’instant où, sans aucun préalable, sans savoir, sans pouvoir, sans vouloir, un homme se laisse bouleverser par une irruption inattendue exige impérativement et impérieusement une réponse de responsabilité, face à un événement qui le traverse, pour le contraindre à agir ou au contraire pour l’inhiber sans retour. Ce cas de figure, ce que j’ai appelé parfois l’instant éthique appelant immédiatement un faire éthico-pratique, n’invalide pas du tout la politique. Il est bon, il est juste, il est nécessaire, impératif, qu’il y ait une police, des pompiers, des SOS-machins, des institutions qui viennent en aide et au secours. Et le « philosophe » de Rousseau y fera sûrement appel, lui qui se bouche les oreilles et s’argumente un peu, comme dit le texte -s’argumenter, c’est en quelque sorte un dit sans dire, tout comme le faire éthico-pratique sans médiation est, dans les termes de Levinas, un dire sans dit. Il s’argumente, le philosophe de Rousseau, pour justifier à ses propres yeux, aux yeux de sa conscience qui vient le questionner après la bataille, qu’il n’a pas répondu, qu’il s’est déchargé de sa réponse sur des appareils et des instances qui sont là pour ça, justement, et qui forment ensemble l’État, les institutions, le politique comme incorporation de la politique dans des structures d’amortissement de la responsabilité éthique par une responsabilité civile. Cet exemple dit beaucoup sur la politique, laquelle devrait se savoir toujours prévenue par ce qui n’est pas elle. Ceci ne la destitue pas. La politique a pour office d’interrompre ce qui imémmorialement l’interrompt elle-même, bien avant son argumentation raisonnée, bien avant ses lois, ses dispositifs, sa juste intervention.
Par où je peux essayer de mieux répondre à votre question, en essayant d’en reprendre les termes : le messianisme n’empêche pas la politique ; l’imprévisibilité de l’événement n’annihile pas le prévoir inhérent à tout gouverner ; l’imprédictibilité absolue de l’histoire, liée à sa non-processualité radicale (voir Nietzsche encore sur ce point), ne débouche pas sur un quiétisme « mystique », confit et confiné dans sa tour d’ivoire et son éloge de l’apolitisme. On a plutôt affaire à des modes d’investissement de la politique par ce qui n’est pas elle, par ce qui, avant elle, la laisse advenir comme question et après elle, en relance encore la signification. Il est probable qu’alors la façon dont chacun se rapporte à la politique, celle des gouvernants, celle des gouvernés, sera tout autre que le harcèlement par la conviction mille fois assénée hors responsabilité, tout autre que le ressentiment généralisé, ce que Camus appelait une « méchanceté ».
AP : Vous avez évoqué à plusieurs reprises Althusser, qu’a-t-il apporté – disons du moins, que vous a-t-il apporté – sur le plan philosophique ? Est-ce une nouvelle façon de relire Marx en le débarrassant de l’héritage hégélien dont il n’était lui-même pas conscient ? Est-ce une façon d’approcher quelque chose comme le messianisme avec le « matérialisme aléatoire », c’est-à-dire comme une façon de penser le matérialisme historique comme évitant aussi bien une conception « eschatologique » qu’une compréhension « téléologique », pour reprendre la distinction de F. Bruschi ? Autrement dit, une façon de penser le développement du temps à la fois en refusant « de réduire le passage d’un mode de production à l’autre à une évolution progressive à partir d’une origine et vers une fin, tout autant qu’un surgissement miraculeux »[15] ?
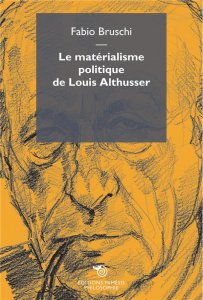
GB. Vous savez, Althusser, pour moi aujourd’hui c’est très loin, très loin en arrière. Il fut mon maître comme on dit pompeusement, avec la fausse humilité et l’onction d’une pseudo-reconnaissance. Par lui, je suis entré en marxisme, en comprenant qu’il fallait impérieusement le délester du poids très lourd de Hegel – dont l’ombre se tient, vous voyez, perpétuellement à l’horizon, du début à la fin de ma vie philosophique. J’ai rectifié et amendé en le lisant, en l’écoutant, tout ce que je croyais avoir compris, à 16 ou 17 ans, de Marx, du communisme, du mouvement ouvrier international. Bien sûr le matérialisme aléatoire, la théorie des AIE (appareils idéologiques d’État), l’anti-humanisme théorique, l’association de Freud, de Lacan, d’autres encore, à un marxisme entièrement repensé, sans parler de la question du pouvoir soviétique, de la révolution culturelle chinoise, de l’appareil du PCF, enfin toutes sortes de choses et de questions et de points, brûlants à ce moment-là, tout ceci fut pour beaucoup d’entre nous comme un coup de tonnerre, un bouleversement intellectuel et politique comparable à celui produit par Feuerbach sur Marx, Engels, d’autres Jeunes-Hégéliens, tel qu’ils en relatèrent eux-mêmes la force disruptive. Mais que reste-t-il de tout cela dès lors que le marxisme lui-même n’a plus du tout, pour moi, la place qu’il occupait alors, un repère toujours là, un rapport continu, une source et une ressource ? Pas grand-chose, je le crains, et même les points que j’indiquais cursivement ne sont peut-être que des illusions rétrospectives, rétroactives, voire des anachronismes. En dire davantage m’obligerait à revenir à Marx lui-même bien sûr, donc à me répéter. Je dois ajouter que Marx et Althusser, chacun à sa place, continuent de représenter, à la lumière rasante de Hegel, des pensées fortes, imposantes, auxquelles on peut certainement continuer à se rapporter avec un bénéfice de pensée incontestable, mais qui n’est plus du tout du même ordre que ce qu’il fut pour moi dans les années 60 et 70.
AP : Merci pour tous ces éclairages. J’entends ce que vous dites sur Althusser et sur ce qu’on pourrait appeler la fécondité potentielle de ses analyses pour la philosophie contemporaine. A vous écouter c’est comme si ces analyses gardaient toujours une grande force conceptuelle, mais ne possédaient plus le caractère d’évidence urgente qu’elles pouvaient avoir autour de mai 68. Est-ce à dire que si la philosophie de Marx est toujours une boussole, ne serait-ce que dans sa mise à nu du processus d’exploitation qui constitue le capitalisme, elle l’est autrement ? Quelle actualité conserverait la pensée de Marx aujourd’hui ? Serait-ce sous la forme d’un spectre comme le disait Derrida ? D’un marxisme hérétique ou hétérodoxe ? Et si oui, en regard de quelle orthodoxie ?
Vous dites également qu’il faut penser la politique autrement que ne le fait la tradition philosophique, comme s’il fallait qu’elle soit toujours décentralisée, décentrée ou acentrée. C’est comme s’il fallait s’efforcer de penser la politique en la désolidarisant de ce à quoi elle est ordinairement articulée, en bousculant les fondements à partir desquels on la pense habituellement, ou puisque vous avez évoqué son importance cruciale dans votre travail, comme Hegel – dont on pourrait dire que « la voix off continu[e] à résonner »[16], pour reprendre une image de Derrida dans un de ses séminaires – la place au sein de son système. Vous proposez ainsi de penser ce que vous appelez l’« inspiration » de la politique par l’éthique chez Levinas, en interrogeant ce qui chez lui – que l’on réduit encore trop souvent à ce moraliste qui aurait le mystérieux, indéfinissable et culpabilisateur visage pour objet d’étude – peut donner à penser à la politique. Que ressort-il de ces questionnements ?
GB. Sur Marx, sur le marxisme, sur le marxisme althussérien, je crois m’être expliqué. Pour être clair, tout ceci n’est plus du tout pour moi une boussole ou quoi que ce soit de ce genre. Je précise, je l’ai écrit et expliqué, que Marx ne nous sert à rien pour penser, même minimalement, la politique, ou même quelque chose de la politique. C’est une pensée du ou des modes de productions, ou mieux des formations économiques et sociales ; c’est sur un autre versant une pensée de la révolution comme « poésie de l’avenir », langue inouïe. Mais entre les deux, entre « la science » et « la révolution », un paysage lunaire que la social-démocratie d’abord, puis le léninisme, le stalinisme, le maoïsme, ont voulu coloniser. On pourrait dire d’ailleurs qu’avec Levinas, c’est pareil : entre la proximité ou le face à face, d’une part, et la justice, la démocratie, les droits de l’homme, les tiers, d’autre part – aucune articulation, aucune médiation, aucun passage. La différence, c’est que, héritant de Levinas, nous héritons aussi explicitement de cette énorme difficulté et devons tenter de la penser comme telle, d’une façon ou d’une autre. Avec Marx, en en héritant ou en se reconnaissant dans sa pensée, on s’imagine ou on s’est longtemps imaginé avoir affaire à une pensée politique ou du politique, voire de la politique révolutionnaire, on erre donc bien davantage, on cherche ce qui ne s’y trouve pas et on croit l’avoir trouvé. Je me souviens d’une blague qu’on racontait en R.D.A. Elle consistait en trois définitions : qu’est-ce que la Science ? c’est : chercher un objet qui se trouve dans une pièce complètement obscure ; qu’est-ce que la Philosophie ? c’est chercher dans une pièce obscure un objet qui ne s’y trouve pas ; qu’est-ce que le Marxisme-léninisme ? c’est chercher dans une pièce obscure un objet qui ne s’y trouve pas et s’exclamer à la fin : « je l’ai ! ».
Je voudrais revenir à la dernière partie de votre observation -celle qui concerne la politique, une absence pour Marx, une aporie pour Levinas. Le régime habituel de la philosophie politique, depuis les Grecs, organisé autour de l’autonomie du champ, de la souveraineté des sujets politiques, du meilleur gouvernement et d’autres requisits encore, le contrat par exemple, me paraît excédé par de tout autres façons de penser la politique. J’ai déjà expliqué que la politique relevait de ce que j’ai appelé une responsabilité transactionnelle. Il y a du Deux, il y a deux exigences inconciliables, souvent également légitimes, et la politique démocratique doit inventer des formations de compromis entre ces Deux. J’ai évoqué Weber, conviction et responsabilitté, Levinas, éthique et justice. On pourrait songer également au Deux derridien de la justice indéconstructible, butée inconditionnelle de la politique comme démocratie « à venir », et du droit à déconstruire toujours et encore dans ses formes. Le rapport entre la condition et l’inconditionnalité, tel que le détermine Derrida à propos de l’hospitalité, se retrouve, je crois, avec ses grandes difficultés, dans les pratiques politiques effectives. Cet exemple de l’hospitalité me permet de préciser ma position, peut-être. L’hospitalité s’accorde, ou pas, au plus intime (mes enfants, mes parents, mes proches) et au plus lointain des lointains (le migrant, l’inconnu, le premier venu). Comment se présente cet arc ? L’accueil domestique « naturel » ou encore la fraternelle solidarité encouragée par les différentes cultures, par les religions, peuvent-elles asseoir une politique, ou bien au contraire retrouve-t-on entre les deux figures (accueil intime / accueil social), une intransitivité très problématique ? On retrouve l’inconciliabilité entre tout ce qui est déterminé par la loi, juridique, éventuellement symbolique, l’institution, l’organisation, la distribution de l’aide, l’assistance, etc., bref ce qui relève de la conditionnalité de l’accueil, d’une délibération collective, d’un assentiment politique ; et le principe de l’inconditionnalité de cet accueil, lequel seul ouvre la possibilité et la pensabilité de l’hospitalité. Sans la convocation impérieuse de ce principe d’inconditionnalité, il n’y aurait rien à penser, rien à déterminer, rien à faire. Sans l’invention de conditions, même minimales, le fait pour un étranger accostant en Europe de décliner son identité par exemple, l’accueil virerait en chaos, ce que la politique a pour office de prévenir. Cette façon de prendre en charge des incompatibilités, la condition et l’incondition, l’hospitalité nécessaire et la règle démocratique, le principe et ce qui le met immédiatement en cause, aujourd’hui le sanitaire et le social-économique, à certains égards, on peut dire que c’est la politique même. La transaction est son essence, la transaction continuée entre deux modalités différentes, et même opposées, d’effectuation des valeurs, des principes, des « morales », ce qui est souvent très compliqué et expose la politique, toute politique, à la déception. Elle ne peut engager la réalisation de ses projets et programmes que partiellement – et la part manquante, c’est souvent celle de la finitude qui détermine nos pratiques et nos vies.
Beaucoup d’obstacles, à chaque fois, doivent être évités. S’agissant de l’hospitalité, une position qui consisterait à faire l’éloge unilatéral de la sacralité du devoir d’hospitalité, par exemple, en dévalorisant tout ce qui paraît y contrevenir, la règle juridique ou le protocole de la prestation, s’exposerait au risque d’angélisme – dont les ravages sont patents dans bien des analyses politiques contemporaines des mouvements migratoires et des politiques d’accueil. La position qui consisterait à refuser systématiquement l’hospitalité en raison des risques qu’elle porte avec soi, et que tout accueil engage, depuis l’inconditionnalité, serait intenable dans un cadre démocratique. La voie est étroite, mais elle seule relève à proprement parler de la politique, entre angélisme et cynisme brutal, l’un et l’autre extra-politiques en quelque sorte, relevant d’exigences autres que démocratiques. Le premier n’a pas de mains, le second en a trop.
Toute politique démocratique est soumise à ce double régime de l’inconditionnel et de la condition, requis face à ce qui, du réel, nous assaille, je cite Derrida de mémoire. Il faut donc trouver un mode d’inscription pratique, concret, de ce double bind, toujours variable, toujours aléatoire, indéterminable une fois pour toutes. Ce « il faut » n’est ni normatif ni de l’ordre d’une nécessité objective ou encore d’une injonction stricte. Il est l’indice d’une question lancinante : sous quelles figures effectives, politiques, s’articulent tant bien que mal, le catégorique et l’hypothétique, pour parler comme Kant, l’éthique, à laquelle les « valeurs » doivent tout et qui ne leur doit rien, et la morale des valeurs qui en est la réfraction, les codes de conduite et de comportement sociaux? J’ai essayé d’explorer cette topologie post-lévinassienne du deux, elle est certainement une clé pour penser quelque chose de la politique, mais aussi de tout ce qui est charrié par elle, la question de la violence, du terrorisme, de l’Etat et de l’Europe, de la souveraineté et du mondial.
Cette situation est commandée par un état singulier de notre monde mondialisé. Sur cette scène, nous nous retrouvons face à une sorte de vide de tout programme national-étatique et de tout projet d’émancipation, un vide de toute politique au fond. Nous nous retrouvons devant une double impossibilité : impossible de renoncer aux principes d’égalité, de liberté, d’hospitalité, d’amitié, de fraternité, et à leur inconditionnalité, à tout ce dont nous héritons, malgré tout ; impossible toutefois de ne pas regarder en face les terribles questionnements, voire les apories et les impasses où ils nous conduisent parfois. Une transmission s’est enrayée. Non seulement ce dont nous héritons n’est précédé d’aucun testament, selon le mot de René Char, ce qui est encore un moindre mal, mais surtout nous sommes hors de situation de transmettre à notre tour. Notre héritage sans testament n’a même plus d’héritiers, une transmission s’interrompt. Ce qui nous a été été transmis par les narrateurs des grands récits d’émancipation et des promesses qu’ils racontaient n’est plus transmissible. Nous pouvons bien en réaffirmer le principe, nous pouvons même tenter de l’actualiser. Mais faute de passation, même hors testament, faute de légataires, le legs demeure indécidable dans ses contenus. Il faut donc faire traduction d’un intraductible, pour reprendre un mot de Schelling à propos de la philosophie – et c’est la tâche d’aujourd’hui, s’agissant de la politique.
Entretien avec Gérard Bensussan : Autour de L’écriture de l’involontaire. Philosophie de Proust (partie 2)
[1] Voir par exemple, Franz Rosenzweig. Existence et Philosophie, Paris, PUF, 2000 et Dans la forme du monde : Sur Franz Rosenzweig, Paris, Hermann, 2009.
[2] Outre de nombreux articles et de nombreuses interventions, on peut lire Fernanda Bernardo et Gérard Bensussan, Os Equivocos da Etica/ Les équivoques de l’Ethique. A proposito dos/ A propos des Carnets de captivité de Levinas, Fundaçao Eng. Antonio de Almeida, Porto, 2013, Gérard Bensussan, Ethique et expérience : Levinas politique, Strasbourg, Éditions la Phocide, 2008 ainsi que le numéro qu’il a dirigé : Levinas et la politique, Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, N°14, automne 2002.
[3] G. Bensussan, Les Âges du monde de Schelling : Une traduction de l’absolu, Paris, Vrin, 2015. G. Bensussan a également dirigé avec Luc Fraisse, Proust-Schelling. Une affinité élective?, Presses Universitaires de Strasbourg – Cahiers philosophiques de Strasbourg, 43 (2018/1).
[4] G. Bensussan, L’Écriture de l’involontaire. Philosophie de Marcel Proust, Paris, Classiques Garnier, 2020.
[5] G. Bensussan, Être heureux. Ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas, Paris, Mimésis, 2019.
[6] G. Bensussan, Les deux morales, Paris, Vrin, 2019.
[7] Dictionnaire critique du marxisme, sous la direction de G. Bensussan et G. Labica, Paris, PUF, 1982 pour la première édition.
[8] G. Bensussan, Marx le sortant, Paris, Hermann, 2007.
[9] G. Bensussan, Moses Hess, la philosophie, le socialisme, Paris, PUF, 1985.
[10] G. Bensussan devrait faire paraître en janvier 2022 aux éditions de Cerf : Miroirs dans la nuit. Lumière de Hegel.
[11] G. Bensussan, Le temps messianique. Temps historique et temps vécu, Paris, Vrin, 2001. La citation se trouve op. cit., p. 8.
[12] F. Rosenzweig, l’Etoile de la rédemption, traduction d’A. Derczanski et J.-L. Schlegel, Paris, Seuil, 2003
[13] Titre d’une étude publiée par Emmanuel Levinas dans Au-delà du verset, Paris, Minuit, 2002 (1982 pour la première édition), p. 221-228.
[14] Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, dans J.-J. Rousseau, Œuvres complètes III, sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 156
[15] Fabio Bruschi, Le Matérialisme politique de Louis Althusser, Paris, Mimésis, 2020, p. 31.
[16] J. Derrida, Le Parjure et le pardon, volume II, Séminaire (1998-1999), Paris, Seuil, 2020, p. 103.