INTRODUCTION : LE RETOUR DES TITANS
Il est des frères cadets, des petits frères, des frérots, dont le défaut d’aînesse ne fait assurément pas d’eux des auteurs mineurs. Et si Elisabeth Foerster n’arrive pas à la cheville de son génie de frère, eh bien Friedrich Georg Jünger, quant à lui, tient incontestablement la dragée haute à son aîné, l’auteur des Orages d’acier et d’Héliopolis. On en avait déjà un aperçu avec l’excellent Les Titans et les dieux paru aux Éditions Krisis en 2013, mais on en possède désormais la preuve avec la traduction de La perfection de la Technique1. Que les Éditons Allia soient ici remerciées pour cette belle initiative qui vient combler une lacune dans l’histoire de la philosophie de la technique. Et notons ici que l’essai Machine et propriété, initialement paru en 1949, fait également partie de la traduction car Jünger décida de réunir les deux ouvrages en un seul dès 1953.
Dans sa présentation de l’ouvrage, le traducteur Nicolas Briand met justement l’accent sur la portée de l’œuvre de Friedrich Georg Jünger. Une influence décisive pourtant largement méconnue. La perfection de la technique, ouvrage détruit à deux reprises par les bombardements en 1942 puis en 1944, et finalement publié par Vittorio Klostermann en 1946, s’avère être tout d’abord un dialogue avec Le travailleur, l’essai d’Ernst Jünger paru en 1932. Si les deux frères s’accordent pour considérer la technique, et donc la mobilisation totale de l’étant et des hommes, comme les traits définitoires de la société industrielle, l’aîné aspire à un salut utopique dans l’avènement de la Figure du « Travailleur » qui s’approprie de façon active la loi de son époque, tandis que le cadet se montre beaucoup plus fidèle à la tradition marxienne en voyant dans l’extension du règne de la machine l’entreprise systématique de liquidation de la personnalité et des savoir-faire des ouvriers : « Plus la technique gagne du terrain, plus elle se spécialise, et plus la part du travail fonctionnel s’accroît. Ce faisant, le travail se détache presque complètement du travailleur, il s’en libère et s’en autonomise. Le travailleur n’est plus lié à son travail par sa personne comme celui qui possède un métier ; il n’entretient plus avec lui qu’une relation fonctionnelle » (p. 88-89). L’opération de réduction à la fonction qui découle du règne de la machine interdit tout optimisme quant à la société industrielle, et plus encore l’idéalisation de la Figure du Travailleur qui, d’un point de vue phénoménologique, s’ap-proprie moins son travail qu’il n’en est ex-proprié.
Mais l’œuvre de Friedrich Georg ne fut pas appelée à demeurer captive de l’enceinte du foyer familial ; son destin fut bien plus grand, bien plus décisif, ainsi que le met en évidence Nicolas Briand dans un paragraphe ramassé qui retentit comme un appel du pied à de futures études. En effet, Heidegger, dont La question de la technique, rappelons-le, émane d’une conférence donnée à Brème en 1949, lut le manuscrit de La perfection de la technique dès 1942, et on se rend compte, en comparant les deux textes et leur commune conception de la technique comme mise à disposition du réel, combien le cadet des Jünger a pu donner à réfléchir et à penser à Heidegger. Mais l’histoire ne s’arrête pas en si bon chemin, puisque Jacques Ellul fut également en possession du manuscrit, peu de temps avant de faire paraître son premier grand livre, La Technique ou l’enjeu du siècle, en 1954 : dans les deux cas se dessine une même analyse en termes d’autonomisation du système technique, comme si la créature avait échappé à son concepteur. Et enfin, Nicolas Briand signale que La perfection de la technique fut traduit en anglais dès 1949, et aussitôt lu par des écrivains tels que Lewis Mumford et Jeremy Rifkin. En voici donc une belle trajectoire et un vif succès pour un ouvrage auquel nous autres francophones n’accédons qu’en 2018. Il était temps !
Plutôt que de séparer la présentation et la discussion des deux essais, La perfection de la technique et Machine et propriété, nous choisissons de les traiter d’un seul tenant, en tirant trois fils qui nous semblent traverser l’ensemble du volume. Nous terminerons par une conclusion plus personnelle.
« LA DÉPRÉDATION DE LA TERRE »
Débutons par l’implacable constat que formule Friedrich Georg Jünger : « C’est une déprédation comme la Terre n’en a encore jamais connue. La déprédation aveugle, sans cesse amplifiée, caractérise notre technique. Et seule cette déprédation la rend possible et lui permet de se déployer » (p.46). Se trouvent ici mis en exergue, d’emblée, les traits saillants qui caractérisent la technique. En premier lieu, Jünger prend soin de préciser qu’il s’agit de notre technique : en aucun cas celle de nos Anciens, ni encore celle d’autres civilisations, mais la technique contemporaine liée à la foudroyante révolution industrielle. Cette remarque anodine permet alors de comprendre les deux points suivants : d’une part, si la technique peut bien être qualifiée d’invariant des cultures humaines, elle ne peut pas plus qu’elle ne doit être l’objet d’une saisie essentialiste indifférente à la nature des moyens déployés ni à ses contextes d’application ; d’autre part, si force est de constater que le règne de la technique est planétaire, il est tout autant remarquable que l’Occident se trouve bien à l’origine de ce processus à travers les mouvements de la colonisation et de la mondialisation : « Que celui qui a des doutes se remémore que nos méthodes de travail ne sont pas limitées à un peuple ou à un continent, qu’elles s’efforcent d’asservir tous les peuples de la Terre et que nous nous déchargeons de la plus grande partie des travaux pénibles et vils en les transférant sur les épaules de ceux qui n’ont pas inventé l’organisation technique » (p. 35). De même que les critiques contemporains de l’« anthropocène », notion qui désigne l’entrée de l’humanité parmi les forces géologiques, pointent l’universalisme abstrait de ce concept, de même Jünger souligne-t-il que la technique moderne, notre technique, est bien située dans le temps et dans l’espace.
Mais passons au point suivant : comment notre auteur qualifie-t-il l’action de la technique sur la Terre ? Quel rapport au monde instaure-t-elle ? Le terme choisi est radical : le mot « déprédation » désigne le pillage qui s’accompagne de lourds dégâts ; non seulement y a-t-il vol, mais en outre dégradation voire dévastation : « Là où la déprédation s’amorce, la dévastation commence, et notre technique nous en offre des images dès ses balbutiements, au temps de la machine à vapeur » (p.47). Le régime industriel de la technique exploite l’ensemble des ressources que la Terre offre : pour produire, il faut consommer, consommer sans cesse, sans se soucier du renouvellement desdites ressources ni des équilibres écologiques concernés. C’est la raison pour quelle cette déprédation est qualifiée d’« aveugle » : quand seule compte l’efficacité, alors la responsabilité, ne fût-ce qu’à travers l’élémentaire prise en compte des conséquences de nos actes, ne fait plus partie des critères de décision. La Terre se transforme alors en un amoncellement de gisements : de minerais tout d’abord, d’hydrocarbures ensuite, d’informations (de data) aujourd’hui. On en arrive alors à une situation paradoxale : alors que la technique semble être le moyen privilégié de créer des richesses, elle contribue au contraire à appauvrir le monde de ses ressources ; loin de participer à l’enrichissement, elle conduit à l’appauvrissement : « La technique ne crée aucune richesse, elle détruit celle disponible par la déprédation, c’est-à-dire en dehors de toute rationalité, mais avec des méthodes de travail rationnelles » (p. 50).
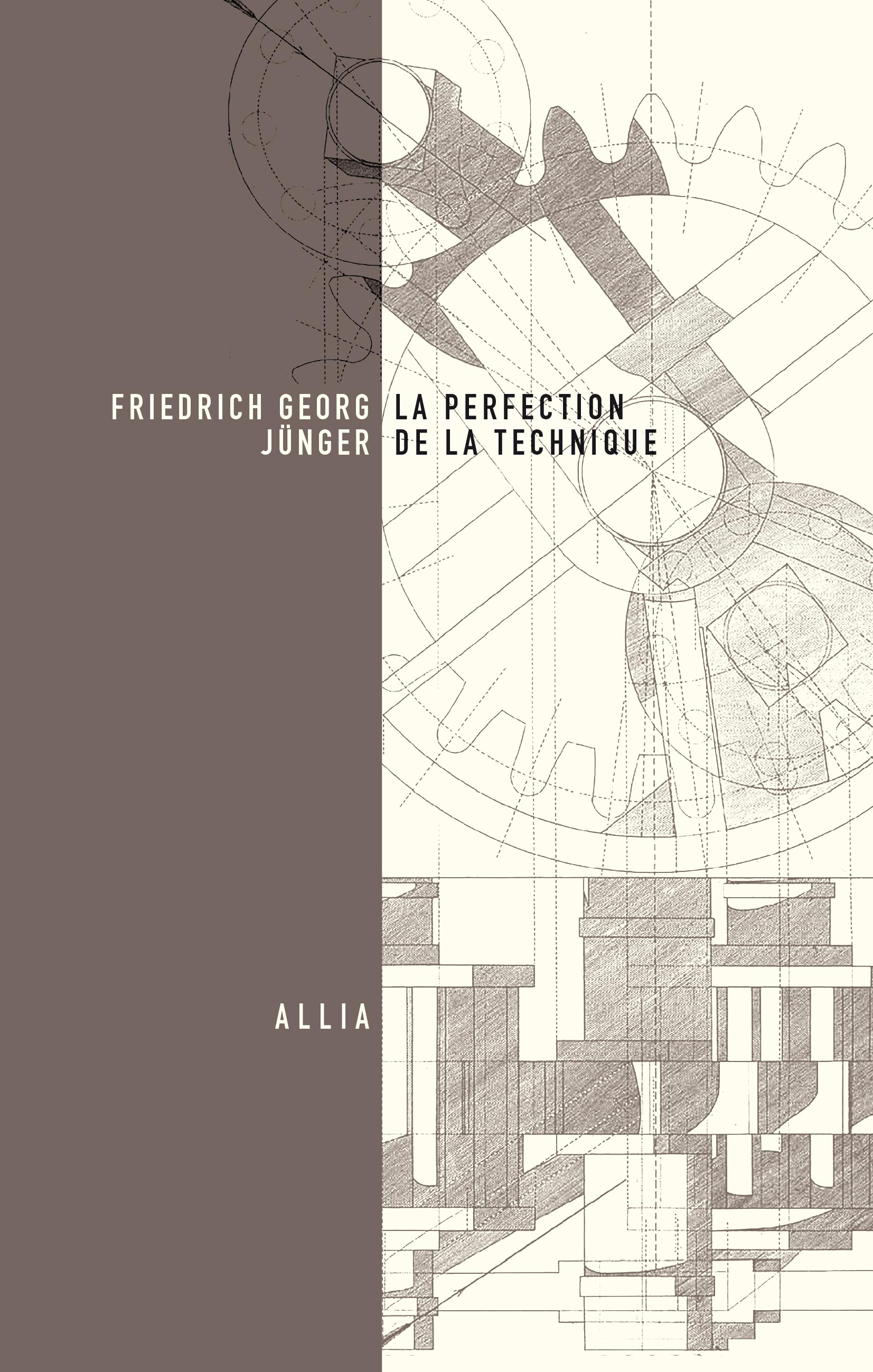
Le mouvement de déprédation ne saurait-il cesser ? Ne peut-on sinon lui mettre un terme du moins le freiner ou le ralentir ? Il semble bien que non : comme le dit Jünger dans la citation qui ouvre cette partie, la déprédation aveugle est « sans cesse amplifiée ». Tel est bien le troisième élément caractérisant notre technique : la recherche d’efficacité et la quête de nouvelles ressources ne connaissent pas de limites, emportées qu’elles sont par la démesure de leurs aspirations. Quand la cause finale est abolie et que les moyens deviennent à eux-mêmes leur propre fin, alors il n’existe plus de bornes ni de règles qui puissent rythmer l’éternel mouvement des processus. Pour reprendre ici les catégories d’Hannah Arendt, la vie active se fond entière dans le travail, c’est-à-dire dans le va-et-vient sans fin de la consommation et de la production. Mais non seulement ce cycle poursuit-il son cours jusqu’à la mort de l’organisme, mais en outre, dans le cadre de la technique industrielle, cherche-t-il son constant perfectionnement. Ce que l’on nomme aujourd’hui, dans le cadre du management de la qualité totale issu du toyotisme, « l’amélioration continue », était déjà décrit par Jünger comme « l’effort continu pour améliorer les installations techniques » ou encore comme « l’aspiration à la perfection du processus de travail » (p. 51).
Il nous faut toutefois introduire ici, en guise de transition vers notre deuxième partie, une nouvelle catégorie que nous avons jusqu’à présent tue : en effet, si la technique industrielle est si puissante qu’elle procède à la déprédation de la Terre, si ses processus sont aveugles et se reproduisent sans cesse, c’est bien parce que cette technique est faite non plus d’outils et de tournemains, mais de machines et d’automatismes.
MACHINE ET SCIENCE MODERNE
En effet, « le mouvement qui détruit, avale, dévore sans répit et sans repos, révèle la faim insatiable de la machine » (p. 45). L’outil traditionnel, qui prolonge la main, demeure encore sous la dépendance du corps humain, de sa finitude, de sa fatigue, de son usure. Quand le corps cesse de se mouvoir, le marteau ne peut pas, à lui tout seul, planter de clou. Il n’en va plus de même avec la machine qui, une fois allumée, une fois lancée, poursuit seule sa finalité. « Le gigantesque appareil technique » (p. 47), cet amoncellement de dispositifs réticulés et connectés, agit alors en donnant l’impression d’une quasi-autonomie et relègue l’ouvrier à un rôle de contrôleur : « L’usine elle-même devient un automate quand tout le processus de travail menant au produit technique est accompli par un mécanisme autonome et répété avec une régularité mécanique » (p. 56).
Mais Jünger ne s’arrête pas en si bon chemin et, de cette phénoménologie de la technique industrielle, glisse vers une enquête généalogique en remarquant « que ce n’est pas un hasard si l’horloge fut le premier automate à rencontrer un franc succès » (p. 58). Ce qu’il confirme quelques pages plus loin :
« Sans horloges, il n’y a ni automates ni science, car que serait celle-ci sans les procédés de mesure du temps sur lesquels elle repose entièrement. Ses méthodes de travail sont inconcevables sans un contrôle permanent par des procédés de mesure du temps. Ce n’est qu’une fois ceux-ci fiables et précis que le machinisme, l’industrialisme et notre technique s’amorcent » (p. 71)
En effet, si les automates reproduisent cycliquement et invariablement les mêmes opérations, c’est qu’ils sont sous-tendus par une conception du temps liée à la révolution philosophique et scientifique moderne. Tout comme Alfred Crosby établit, dans La mesure de la réalité, que la modernité et ses développements reposent sur le passage, symbolisé par l’horloge, d’une conception qualitative à une conception quantitative du temps, Jünger montre la mécanique galiléo-newtonienne accouche d’un temps abstrait et absolu coupé du monde et des choses. Peu importe que la fleur grandisse, s’épanouisse puis se flétrisse : désormais séparé de l’espace, le temps s’est autonomisé des étants et de leur rythme propre, et leur applique indifféremment sa propre mesure faite d’unités arbitraires et conventionnelles. C’est la raison pour laquelle Jünger le qualifie de « temps mort » (p. 71).
Mais le philosophe s’interroge : les avancées de la mécanique quantique ne remettent-elles pas en question ce déterminisme de la physique classique ? Un changement de paradigme s’est en effet produit qui rompt avec les anciennes représentations galiléo-newtoniennes et substitue la probabilité et la statistique à la cause : « la causalité rigoureuse du cours de la nature se dissout désormais dans des probabilités arithmétiques » (p. 79). Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, l’avènement de la mécanique quantique, si elle modifie les catégories du réel, ne change guère le rapport au monde : la loi des grands nombres permet d’étendre l’empire de la technique à des échelles microscopique. De ce point de vue, Jünger précède le Dominique Janicaud de La puissance du rationnel (1985) qui voyait dans la physique quantique, au rebours des prophètes de la Nouvelle Science, une révolution épistémologique mais en aucun cas un chamboulement ontologique.
Notons enfin ceci : plusieurs passages de l’ouvrage laissent penser que Jünger avait pris connaissance de la cybernétique ou avait l’intuition de ses catégories centrales. C’est plus particulièrement le cas lorsqu’il évoque les idées générales de téléologie et de finalité, mais aussi celles plus précises de « conduite » ou encore de « guidage » (p. 111). Le philosophe peut alors reformuler son appréciation de la technique industrielle à travers l’excellente expression de « fonctionnalisme téléologique » : « C’est précisément l’effort d’assujettir entièrement l’homme à une ratio technique, à un fonctionnalisme téléologique auquel rien n’échappe, qui neutralise la résistance manifestée par l’activité de l’esprit et sa volonté depuis un ordre plus profond » (p. 164). Réduit aux processus d’adaptation, c’est-à-dire à la réponse mécanique à un stimulus mécanique, le travailleur se fond dans le décor de l’ordre technique et ne devient qu’un rouage parmi d’autres, échangeable et remplaçable sur le marché du travail, tout comme les pièces d’une machine sont échangeables et remplaçable sur le marché des biens.
DES RAPPORTS ENTRE TECHNIQUE ET ÉCONOMIE
Que faut-il alors conclure de cette présentation de la technique industrielle par Jünger ? Où nous mène cette présentation de la « perfection de la technique ». À un point absolument décisif : dans un tel cadre, celui d’un système autonome et aveugle, l’économie n’est plus que l’ancillaire de la technique, elle lui est soumise, elle se plie à son rythme et à ses exigences. Se trouvent ici dans le viseur du philosophe Marx et la tradition marxiste : « Même la plus influente de toutes [il s’agit des théories économiques], celle de Marx, est économique de part en part. Raison pour laquelle son œuvre principale s’intitule Le Capital, Critique de l’économie politique et non La Machine. Les suites, publiées par Engels après la mort de Marx, portent aussi des titres de ce genre. Les idées de Marx tournent autour du capital et de ses mouvements. Or tout mouvement de capitaux est un chapitre de la mécanique et non l’inverse » (p. 229). Si l’on garde en tête que la physique moderne naquit comme une cinétique, alors il devient évident que le capitalisme procède de cette nouvelle cosmologie : c’est ainsi que l’argent, plutôt que de demeurer l’instrument solide de mesure et donc d’échange qu’il était chez Aristote, (Éthique à Nicomaque, livre IX), est devenu une matière liquide dont la circulation ne cesse de s’accroître au fur et à mesure du perfectionnement des machines. Plus encore, la disparition de la monnaie, qui constitue comme l’incarnation de l’argent, au profit des jeux d’écriture, déconnecte les capitaux de la réalité, de telle façon qu’ils en viennent à former un monde autonome qu’aucune mesure extérieure ne peut plus venir borner : « La chose suivante importe encore davantage : plus l’argent devient une simple monnaie de compte et plus il passe d’un rôle économique à un rôle technique. Les représentations économiques, les concepts associés à la fonction économique de l’argent sont refoulés. Non seulement l’argent se détache de son support matériel dans la monnaie symbolique, mais aussi, dans la monnaie de compte, de son fondement économique, auquel la circulation de l’argent liquide était encore liée. L’argent technique se couple toujours plus à un développement de la machinerie, il accompagne et se met au service de l’appareillage et de l’organisation » (p. 242).
Poursuivons plus avant : aux nombreux philosophes qui critiquent le monde moderne ou contemporain à partir du prisme du capitalisme ou du néo-libéralisme, Jünger oppose encore la dissolution de l’individualisme et de la propriété dans le « collectif technique », si bien que nous vivrions dans une époque bien plus proche du socialisme que du libéralisme. Il devient alors expédient d’abandonner cette ancienne dichotomie (capitalisme/communisme) pour appréhender l’opposition essentielle : « L’opposition ne se situe pas entre propriété privée et publique, mais entre chose et machine, monde de choses et organisation machinique, propriétaire et gestionnaire, propriété et collectif technique » (p. 289). Alors que beaucoup d’auteurs considèrent que la logique d’appropriation de la plus-value par les propriétaires des capitaux – les actionnaires – peut rendre raison de l’actualité, Jünger montre que la révolution industrielle a liquidé la propriété, que celle-ci est devenue obsolète et dépassée à l’heure de la machine : « La propriété repose sur des représentations de l’espace tandis que nos machines sont temporelles » (p. 271). Un paradigme s’est substitué à un autre : la propriété est façonnée par la main et se caractérise par des limites ; la machine fonctionne comme une horloge et ne connaît aucun terme. Jünger va d’ailleurs jusqu’à étendre son raisonnement à l’échelle de l’entreprise et du système économique : « L’entreprise n’est plus une propriété ; le mot le dit déjà. Dans le réseau du collectif technique, les usines autonomes se maintiennent difficilement ; les entreprises y apparaissent tels des points de jonction des fils d’une toile d’araignée » (p. 287). Voici décrits, avec quelques décennies d’avance, les organisations réticulaires, les systèmes d’information inter-organisationnels, les prises de participation croisées, etc.
CONCLUSION
Nous terminerons cette présentation par une remarque plus personnelle : nous avons en effet été frappé de retrouver chez Jünger un certain nombre d’intuitions qui anticipent les thèses que nous avons soutenues et développées dans les deux premiers volumes de la Théologie de l’Organisation.
Nous affirmions, dans Au fondement du Management (2014), que le régime organisationnel alimenté par les processus managériaux contribuait à transformer les institutions en organisations. Voici ce nous lisons sous la plume de Jünger :
« L’ère de la technique excelle certes à susciter des organisations mais s’avère incapable de fonder des institutions. Elle s’entend toutefois à transformer les institutions existantes en organisations, c’est-à-dire à les mettre en relation avec l’appareillage technique » (p. 96)
Et le philosophe d’en relever les corollaires : la loi, pour le technicien, ou, dirions-nous aujourd’hui, le manager, n’est plus l’expression juridique d’une souveraineté politique, mais un dispositif technique qu’il adapte à ses propres fins (traduction contemporaine : il s’agit de faire de la loi un « outil de gestion » performant). Plus loin (p. 127-129), Jünger met en évidence le chamboulement que produit l’introduction de l’esprit technicien dans l’institution scolaire et universitaire : cette dernière, plutôt que de transmettre un patrimoine d’œuvres et d’éduquer à l’esprit critique, construit désormais ses programmes de façon à former des élèves utiles aux connaissances pratiques : « compétence » et « employabilité » deviennent alors les maîtres mots.
Dans De l’exception permanente (2018), nous proposions une analyse des temps modernes centrée sur la catégorie de l’« exception », propos qui se fondait également sur l’importance du « principe d’exception » pour l’ingénieur américain Taylor. Nous faisions nôtre l’expression de Walter Benjamin selon laquelle « l’exception est devenue la règle » : et quelle ne fut notre surprise de la retrouver, au mot près, dans La perfection de la technique ? En effet, selon Jünger, « l’exception devient la règle et atteste ainsi le véritable enjeu » (p. 285). Dans la société industrielle qui « s’attaque à tout ce qui est fixe, possède durée et stabilité » (p. 121), ne subsistent plus que l’écoulement généralisé et le devenir aléatoire : les comportements adaptatifs tendent alors à absorber l’ensemble de la personnalité au détriment de la formation du jugement.
Si Jünger a selon nous vu si juste, c’est parce qu’il place au centre de son analyse la catégorie de l’« organisation » ; ce que nous nommions « mouvement panorganisationnel » apparaît sous sa plume dans de nombreux passages. Par exemple : « Partout où l’homme pénètre dans le champ des progrès techniques, il subit l’emprise de l’organisation » (p. 111) ou encore : « Nous ne vivons pas non plus sur des îles ni dans la jungle ; nous nous trouvons là où l’appareillage technique et l’organisation peuvent à tout moment nous atteindre » (p. 162). La société industrielle ne se résume pas à des innovations techniques, quand bien même ces dernières opérèrent la substitution de la machine à l’outil : elle est bien un système sociotechnique qui tient par le couplage de l’appareillage et du management, de la technique et de l’organisation rationnelle de la vie humaine : « Toute organisation de type technique amplifie le mécanisme ; toute mécanisation amplifie l’organisation rationnelle. Tant que l’organisation technique s’accroît, l’appareillage le doit également, et inversement » (p. 109). En fin de compte, ce à quoi invite La perfection de la technique, c’est à une genèse de la société industrielle pensée non plus à partir du marché ou du capital, mais de l’organisation.








