C’est à un véritable exploit que s’est livré Frédéric Worms dans son dernier ouvrage, La philosophie en France au XXème siècle1, ouvrage dans lequel il se propose de retracer l’ensemble de la pensée philosophique française du XXème siècle selon trois moments principaux, que sont l’esprit, l’existence et la structure. Aborder en moins de 600 pages (sans compter les notes) des pensées aussi diverses et aussi riches que celles de Bergson, Sartre, Merleau-Ponty, Alain, Brunschvicg, Camus, Poincaré, Meyerson, Levinas, Derrida, Deleuze, Lyotard, Blondel, Janet, et tant d’autres, voilà qui tient de la gageure, mais Worms la relève haut la main. C’est donc un grand livre, qui fera certainement date, qui nous est ici proposé, et que Worms appréhende sous un triple aspect : « Ce livre est tout à la fois un manuel, un recueil et un essai. »2 L’ouvrage est en effet un manuel, en tant qu’il présente le panorama le plus large possible de la pensée philosophique du XXè siècle en France, mais pour autant il est loin d’être exhaustif : la philosophique politique est quasiment absente, certains auteurs importants sont traités très rapidement (Deleuze et Foucault notamment), pour ne pas dire absolument absents (Michel Henry, Henri Maldiney, Desanti, Dominique Janicaud, etc.) Le terme de « manuel » paraît de ce fait quelque peu excessif, « dictionnaire amoureux de la philosophie française contemporaine » paraissant plus approprié en raison des absences évoquées. Plus convaincante est sa dimension de « recueil » en vertu des nombreux textes qui émaillent l’ouvrage, et des citations parfois substantielles sur lesquelles s’appuie Worms pour étayer telle ou telle démonstration. Enfin, et c’est peut-être là la dimension qui est la plus marquante, il s’agit d’un « essai » au sens où se trouve promue une méthodologie critique d’histoire de la philosophie, fondée sur une lecture relationnelle des œuvres ou, pour le dire avec l’auteur, « c’est bien une histoire relationnelle de la philosophie que nous proposons ici. »3
La notion de « moments » est, quant à elle, à envisager en un sens radicalement non-hégélien : « Il ne s’agit pas, en effet, en parlant de tels « moments » de réintégrer cette histoire dans une philosophie de l’histoire, c’est-à-dire de les considérer comme des moments d’un Sens supposé absolu, se déroulant dans le temps, et conduisant (comme toujours dans ces cas-là) jusqu’à celui qui parle. (…) Il n’y a pas ici d’unité d’ensemble. Le siècle n’a pas été écrit à l’avance. Il ne s’agit pas de le juger comme un tout. »4 Rien n’est donc plus éloigné de la pensée de Worms qu’un sens nécessaire de l’histoire qui en dicterait les déploiements selon un ordre rationnel préétabli ; les moments ne sont pas des déploiements particuliers du Concept, qu’une totalité viserait à réintégrer. Mais ce n’est pas non plus une démarche à la Michel Winock qui, dans Le siècle des Intellectuels5 avait défini trois grands moments de l’histoire intellectuelle du vingtième siècle français, organisés autour de Barrès, Gide et Sartre ; Worms étudie en effet moins une polarisation autour des personnes qu’il n’envisage l’émergence de problèmes communs donnant lieu à des réponses divergentes.
A : Force et limite d’une lecture relationnelle
Ce qui est certainement le plus novateur dans cet ouvrage, outre le fait qu’il vient combler un vide évident dans le monde éditorial français quant à sa réflexion sur ce que la France a philosophiquement produit au cours du siècle passé, c’est la méthode retenue : Worms propose une « histoire relationnelle » de la philosophie, c’est-à-dire une mise en relation des auteurs selon des problèmes qui leur seraient communs, sans pour autant apporter de réponses communes. Loin donc de se contenter d’une lecture chronologique des œuvres, même si, dans les faits, les problèmes communs sont eux-mêmes historiques et imposent une certaine chronologie, Worms suggère des rapprochements parfois étonnants, souvent convaincants. Bergson, figure tutélaire de l’ouvrage, au point parfois de devenir obsédant, se trouve ainsi relié à Brunschvicg, Blondel, mais aussi Freud, James, Husserl et Russell à partir d’un problème commun que serait celui de l’esprit. « Il s’agira en effet de montrer comment une pensée singulière, telle celle de Bergson, peut poser un problème philosophique si général, qu’il exprime celui d’un « moment » philosophique tout entier. »6 Mais quel est ce problème que Bergson inaugurerait et que tous les auteurs cités, chacun à leur manière, essaieraient de traiter selon leur singularité ? Worms l’expose en ces termes : « ce que nous prenons pour une expérience simple du monde, des hommes, ou de nous-mêmes, est en réalité une expérience double, déformée par notre esprit, par un autre acte de notre esprit, lui-même double, et que c’est sur cette dualité que doit s’orienter l’ensemble, non seulement de notre pensée, mais de notre vie. »7 Ainsi, le premier problème commun qui signe le « moment 1900 », c’est peut-être moins l’interrogation sur la nature de l’esprit en lui-même que le problème de la scission entre l’esprit et ce qui n’est pas lui, qui dédouble l’être.
Sur cette scission de l’être se jouerait ainsi le premier moment philosophique du XXème siècle, où chacun des auteurs se demanderait comment la pensée peut rejoindre ce qui n’est pas elle. Ce problème, très général, invite à penser des liens entre des philosophes que tout semblait opposer : toutefois, les rapprochements opérés sont bien souvent des rapprochements de type négatif, des refus communs. Bergson et Brunschvicg refusent ainsi l’idée d’une expérience simple et uniforme, les rapprochements positifs étant plus marginaux (la distinction immanente de deux religions et de deux morales). Parfois, les rapprochements positifs apparaissent plus fondamentaux, mais en même temps moins spécifiques : Bergson et Freud se rejoindraient par exemple par le besoin de penser la dissociation de la vie immanente de l’esprit, mais n’est-ce pas là un rapprochement extrêmement formel dans la mesure où les solutions apportées, et le sens conféré au problème, divergent de l’aveu même de l’auteur ?
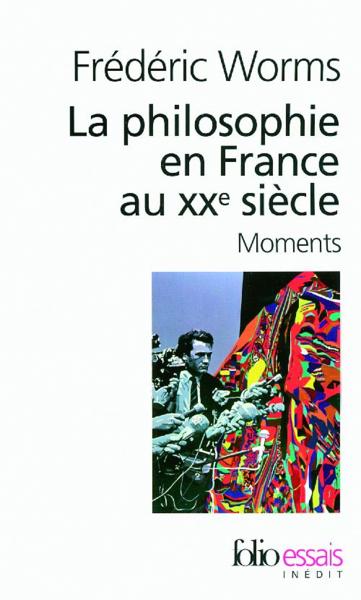
Plus généralement, il y a là à la fois la force et la limite de ce grand livre : les rapprochements sont opérés en vertu de « problèmes » communs qui signeraient des moments d’une trentaine d’années chacun. De ce fait, il semblerait que la méthodologie générale de l’essai s’oriente vers un constat de contenus communs pour en interroger ensuite les solutions divergentes ; mais dans les faits, il n’est pas certain que cette exigence inaugurale soit tenue et tenable : on s’aperçoit rapidement que les problèmes dont traite Worms sont moins des problèmes communs que des thèmes communs, en l’occurrence pour le premier moment, celui de l’esprit ; plus précisément, ce qui est commun à Freud, Husserl, Bergson, Meyerson, Poincaré, Alain, Brunschvicg, c’est peut-être moins l’esprit comme problème à résoudre que comme thème à interroger : en témoigne la diversité des questions qui sont adressées à ce dernier, et qui ne semblent pas dessiner les contours d’un problème commun en dépit d’une communauté thématique assurée par l’esprit. Pour exemplifier le propos, il suffit de comparer le « problème » de Brunschvicg et celui de Freud : il est clair, à lire Worms, que Brunschvicg pose une question centrale : comment l’esprit peut-il construire une connaissance de ce qui n’est pas lui, c’est-à-dire atteindre le monde ? Freud, quant à lui, ne se demande pas quel est le rapport de l’esprit à ce qui n’est pas lui dans le cadre d’une quête cognitive, il se demande au contraire quel est le rapport de l’esprit à lui-même, dans le cadre de ce qui ne lui est pas transparent ; si dans les deux cas il s’agit bien de l’esprit et si en effet il s’agit bien aussi dans les deux cas d’acquérir pour l’esprit un accès à ce qui ne lui est pas immédiatement visible, on ne peut pas pour autant en déduire qu’il s’agit du même problème : il s’agit uniquement de la même forme, c’est-à-dire du problème d’une relation de l’esprit à quelque chose, qui dans un cas est la transcendance du monde, dans l’autre sa propre immanence. En d’autres termes, que dans tous les cas il s’agisse de penser la relation de l’esprit à quelque chose, voilà qui est certain, mais ce geste désigne une question formelle, peut-être pas un problème commun.
B : Formalisme et deleuzianisme
La question soulevée ci-dessus se redouble lorsqu’il est question de l’existence, problème que Worms étend des années 30 aux années 60, et qu’il résume en ces termes : il s’agit du « fait de l’existence du monde, mais aussi de la conscience, ou de l’homme, quand on renonce à chercher à l’une ou à l’autre (de ces existences) un fondement, au-delà d’elles-mêmes. »8 Si l’on admet sans peine que cela caractérise la pensée de Sartre, Camus, Merleau-Ponty ou Jean Wahl, il devient plus délicat de comprendre en quel sens cela est valable pour des auteurs pourtant ramenés à ce problème, comme Simone Weil ou Gaston Bachelard. En effet, ainsi que Worms le rappelle fort bien, Simone Weil pense les effets de la nécessité sur l’âme humaine, afin de penser la relation de la nécessité et de l’âme. Ainsi, « son effort principal consisterait avant tout dans la recherche ou plutôt la vision du point de contact, c’est-à-dire aussi de relation et de rupture entre ces deux ordres, sans sacrifier aucun des deux, ni bien entendu la nécessité, ni en effet l’accès qu’elle ouvre au surnaturel. »9 Le point de contact que recherche Weil fait signe vers cela même qui dépasse l’existence, et donc qui dépasse la conscience et l’homme dans le cadre du « surnaturel » ou du divin. Qu’il y ait un tragique de l’existence humaine chez Simone Weil ne signifie peut-être pas pour autant que la manière dont elle appréhende l’existence destitue cette dernière de tout fondement, ou de toute transcendance ; l’existence est moins le terme ultime de la vie, que le moyen de retrouver le « point de contact » par où la relation au divin sera reconstruite et retrouvée et, par cette redécouverte sera expliqué le sens de l’existence qui, au bout du compte, ne saurait être réduit à la seule contingence.
Il est ainsi possible de dégager deux limites principales de la démarche de Worms en dépit du fait, redisons-le, qu’il s’agisse d’une très belle entreprise et d’un exploit de synthèse : il y a d’abord un formalisme franco-français qui entrave peut-être le libre déploiement des auteurs abordés ; Worms respecte en effet à la lettre la canonique des normes rédactionnelles françaises, au risque de proposer une immense dissertation : il y a les sacro-saintes trois parties (esprit, existence, structure), elles-mêmes systématiquement subdivisées en trois sous-parties (problèmes, positions, prolongements), qui limitent considérablement le nombre de problèmes possibles à aborder. En outre, le terme même de « problèmes » n’est pas sans évoquer l’inévitable « problématique » imposée aux étudiants, le tout donnant finalement l’impression de construire une sorte de gigantesque exercice scolastique contemporain où, à trois problématiques rigoureuses, répondraient trois parties subdivisées en trois sous-parties ; ainsi, il n’est pas certain que la diversité effective des pensées du XXème siècle se laisse ramener à ce carcan trinitaire et dissertatoire, d’où surgit l’écrasement de problèmes parfois différents sous un problème supposé commun mais réduit au formalisme d’une relation problématique. Le caractère un peu factice de cette démarche apparaît, par exemple, dans les rapports de Sartre et Aron ramenés l’un à l’autre par la seule dédicace de L’être et le néant de Sartre à Aron où celui-là présente à celui-ci son ouvrage comme une introduction à l’Introduction à la philosophie de l’histoire, ce qui signifie au mieux que Sartre s’imagine construire un lien en amont avec la pensée d’Aron, mais ce qui ne signifie ni que ce lien est réel, ni et encore moins que le lien proposé s’inscrive dans un problème commun. La forme très scolaire que revêt donc l’ouvrage10 pourrait constituer la première limite de ce panorama de la pensée française du XXè siècle.
En outre, bien que la démarche soit en apparence novatrice, il n’est pas certain qu’elle soit vraiment inédite quant à ses présupposés : tout se passe en effet comme si Worms tirait parti de quelque chose comme le rhizome deleuzien, rebaptisé « relation » pour l’occasion, afin de penser le « réseau » de la pensée philosophique française contemporaine ; Worms mettrait ainsi en pratique le principe même d’une pensée en rhizome, principe déjà ancien, mais encore non appliqué à ce cas précis d’histoire de la philosophie ; de ce fait, fort de son ancrage dans l’ère du temps du « tout-réseau », l’ouvrage ne prend en réalité que fort peu de risques, en répondant à une mode philosophique certaine tout en prenant l’apparence d’une radicale nouveauté. Il n’est dès lors pas étonnant que le livre ait reçu un accueil aussi favorable et élogieux, dans l’exacte mesure où il répondait véritablement à la pensée dominante, aussi bien dans l’ordre formel (problématiques obsédantes, structure tripartite) que dans la sanctification de la structure en réseau qu’il promeut11.
C : Une admirable analyse des œuvres étudiées
En dépit des limites esquissées dans la partie précédente, il ne faut pas perdre de vue l’extraordinaire « exploit » que constitue cet ouvrage ; synthétiser en moins de six cents pages l’histoire de la pensée d’un siècle, dans sa diversité et ses ambiguïtés, voilà qui force l’admiration et qui est l’occasion de superbes fulgurances. Si les passages consacrés à Brunschvicg sont excellents, tout comme l’abord de certains problèmes bergsoniens ramenés à James, on reste sans voix devant la beauté des analyses consacrées en particulier à Sartre et Derrida, qui revêtent véritablement le statut de manuel, recueil et essai comme annoncé en introduction. Au caractère didactique de l’introduction, se superposent de remarquables analyses qui percent admirablement la pensée sartrienne en profondeur. Le manuel présentera donc Sartre en ces termes : « Parler de la liberté sartrienne, c’est parler d’une pratique, autant que d’une philosophie. Autrement dit, il ne s’agit pas avec Sartre d’une philosophie de la liberté « pure », mais d’une liberté toujours en situation, face à une contingence et à une histoire concrètes, qui ne peut donc se réaliser ou même « exister » que dans cette relation, seulement, donc, dans une pratique. Telle sera la philosophie de l’existence, comme relation entre deux termes, entre deux faits : une liberté, une situation. »12 Mais l’essai ira bien au-delà en analysant la signification de l’être en soi lequel est « à la fois être absolument, être sans fondement, sans pouvoir être justifié, sans rien d’autre sur quoi s’appuyer : « en soi », et pourtant « contingent ». Les phénomènes ne sont pas seulement « relatifs » à une conscience ou en elle, ils « sont », ils s’imposent à elle, c’est certes une garantie ontologique, mais, en un sens, c’est bien pire : ils sont là, dehors, sans fondement, sans raison, sans signification. Telle est la position de Sartre : refuser de ramener l’être, sous prétexte qu’il est « phénomène » à une représentation, « dans » une conscience, mais refuser aussi de chercher l’être « au-delà » des phénomènes, dans une différence (…). »13
De la même manière, les pages consacrées à Derrida apparaissent tout à la fois comme une véritable élucidation et un éclaircissement de son œuvre, cherchant sans cesse à enraciner les interrogations sur la vie et la justice dès les œuvres de 1967, dans la mesure où dès le début, la différence porte le deuil et l’absence ; ainsi Derrida « est celui qui dès les années 60 a pensé la différence, ou plutôt la différance, comme deuil et le refus de la différance, comme violence (…). »14 De très belles analyses de La voix et le phénomène et de Violence et métaphysique permettent d’étayer cette continuité de problèmes spécifiques à Derrida, si bien que « tout se passe comme si la différance était d’abord, en effet, contre la présence, une absence : deuil, avenir, temps. »15
Mais si les auteurs traités font l’objet de développements remarquables, il n’en demeure pas moins que la limitation des problèmes au nombre de trois exclut de fait toute interrogation politique : l’esprit, l’existence et la structure qui semblent présentés comme épuisant les problèmes philosophiques français du XXème siècle ne ménagent aucun « lieu » pour le questionnement philosophico-politique, pourtant réels au XXè siècle : dès lors disparaissent tous les penseurs politiques français, ainsi que le remarquait d’ailleurs Nicolas Weil dans Le Monde16, comme Pierre Clastres, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, mais aussi Jacques Ellul, Julien Freund, Eric Weil, Louis Althusser, et même dans une certaine mesure Raymond Aron, qui est intégralement subsumé sous la dédicace de Sartre. En revanche, il serait injuste de reprocher à Worms de ne pas aborder la pensée des années 80, car il est vrai que les problèmes d’une époque apparaissent toujours rétrospectivement ; dès lors, si sont absents Alain Badiou et François Laruelle en métaphysique, Jean-Luc Marion, Dominique Janicaud, Claude Romano ou Jean-Louis Chrétien en phénoménologie, Pierre Manent, Philippe Nemo, Alain Renaut, Etienne Balibar ou Jacques Rancière en philosophie politique, cela est parfaitement justifié par la difficulté de s’élever hors de sa propre époque ; mais en même temps on pressent aisément que tous ces philosophes du temps présent ne s’organisent probablement pas autour du même problème, et ce soupçon jeté sur la difficulté de ramener ces penseurs à un même « moment » en vertu d’un même problème témoigne, me semble-t-il, de la difficulté d’opérer ce geste pour les philosophes du passé.
Il s’agit donc d’un ouvrage fondamental, qui fera certainement date, mais qui possède les défauts de ses qualités : si l’effort de synthèse est en tout point admirable, il n’en écrase pas moins certains auteurs sous des questions qui ne sont probablement pas prioritairement les leurs, et qui, de surcroît exclut de facto bien des philosophes, particulièrement dans le domaine politique, qui se trouvent comme étrangers à leur siècle alors même qu’ils en pensent avec acuité les questions les plus pressantes : les totalitarismes et la guerre en particulier. Mais encore une fois il convient de rendre hommage à cette grande œuvre dont la grandeur même invite à la discussion.
- Frédéric Worms, La philosophie en France au XXème siècle. Moments. Gallimard, coll. Folio-essais, 2009
- Ibid. p. 9
- Ibid. p. 14
- Ibid. p. 12
- cf. Michel Winock, Le siècle des intellectuels, Points Seuil, 1999
- Ibid. p. 31
- Ibid. p. 37
- Ibid. p. 203
- Ibid. p. 389
- Paul Valéry (absent de l’ouvrage de Worms) avait, déjà en son temps, déploré à sa manière la liaison parfois obsédante de l’enseignement scolaire de la philosophie et du sacro-saint problème : « l’enseignement de la philosophie, quand il n’est pas accompagné d’un enseignement de la liberté de chaque esprit non seulement à l’égard des doctrines, mais encore à l’égard des problèmes eux-mêmes, est à mes yeux anti-philosophique. » in Introdution à la méthode de Léonard de Vinci, Oeuvres, tome I, Gallimard, coll. Pléiade, 1957, p. 1249. On ne saurait ici prendre davantage le contrepied des thèses de Worms tant cette idée d’un problème auquel serait assujetti le philosophe apparaît à Valéry comme le signe même de l’anti-philosophie.
- On consultera avec profit l’excellente émission consacrée à l’ouvrage de Frédéric Worms passée sur France culture, où l’ « exploit » de ce dernier est grandement salué par l’animateur et deux professeurs de philosophie : http://ondemand.tv-radio.com/france_culture/SCIENCES_CONSCIENCE/SCIENCES_CONSCIENCE20090507.ram
- Ibid., p. 230
- Ibid., p. 237
- Ibid., p. 494
- Ibid. p. 509
- cf. Le Monde, 19 juin 2009








