Charles Bobant : Cher Frédéric Jacquet, je suis tout à fait heureux de pouvoir m’entretenir avec vous à l’occasion de la parution de votre huitième ouvrage, Vie et monde, publié chez Hermann en 2023 dans la collection « De visu ». Ainsi que l’indique le sous-titre, vous y développez « une philosophie de la naissance ». J’aimerais d’emblée m’arrêter sur ce point et vous poser une série de questions. En 2011, vous avez soutenu votre thèse de doctorat, dirigée par Renaud Barbaras, et intitulée « Vie et existence : recherche phénoménologique. Maldiney, Merleau-Ponty, Patočka ». En 2014, vous publiez votre premier ouvrage, Naître au monde. Essai sur la philosophie de Mikel Dufrenne (Mimésis, coll. « L’œil et l’esprit »), puis, en 2016, Patočka. Une phénoménologie de la naissance (CNRS Éditions). Ce qui me frappe d’abord, c’est pour ainsi dire votre conversion thématique. Alors que vous vous interrogiez sur le partage entre vie et existence lors de vos années doctorales, soit sur la différence zoo-anthropologique, votre intérêt s’est ensuite porté — et la chose n’a cessé de se vérifier par la suite — sur la problématique de la naissance. De là ma première question : d’où vient votre intérêt pour la problématique de la naissance ? Était-elle déjà présente dans votre thèse, ou s’est-elle imposée à vous ultérieurement ? Pour formuler les choses autrement : êtes-vous arrivé à la problématique de la naissance par voie spéculative, dans le cours de vos questionnements, ou bien était-elle toujours déjà là, avant même que vous ne commenciez à faire de la philosophie ? Ou peut-être mieux : la problématique de la naissance vous a-t-elle voué à la philosophie ?
Ce premier point conduit à ma seconde question : qu’entendez-vous par « naissance » ? Vous n’hésitez pas, vous n’hésitez plus à parler de « natalogie ». Pouvez-vous élucider le sens de ces termes, absolument décisifs dans votre élaboration philosophique ?
Ma troisième question revient sur votre itinéraire philosophique. En 2018, vous publiez Métaphysique de la naissance chez Peeters. Jusqu’alors, vous aviez publié des monographies sur des auteurs (Dufrenne, Patočka, Maldiney). Débute véritablement avec le livre de 2018 une série d’ouvrages dans lesquels vous avancez une ambitieuse réflexion en votre nom propre, dont la naissance constitue le cœur battant, et dont vous dites qu’elle n’est rien d’autre que « la question de la philosophie[1] ». En 2020 paraît Naissances chez Zeta Books, livre dont j’avais alors commis le compte rendu pour Actu Philosophia. Vous publiez cette année Vie et monde. Une philosophie de la naissance. Je souhaiterais savoir de quelle façon envisager ces trois ouvrages. S’agit-il de trois « essais » autonomes visant chacun à sa façon à faire droit à une philosophie de la naissance, ou bien d’une suite, sinon d’une saga, chaque nouveau livre s’adossant sur le précédent et effectuant une nouvelle « percée » ?
 Frédéric Jacquet : Merci pour ces questions, qui vont droit au cœur des choses. Effectivement, mon doctorat était intitulé Vie et existence et portait sur les auteurs que vous mentionnez. Il ne s’agissait toutefois pas d’abord d’une interrogation zoo-anthropologique, mais d’une anthropologie phénoménologique articulée à une cosmologie. Par conséquent, il s’imposait notamment de rompre avec Heidegger qui sépare vie et existence (Dasein), comme cela est manifeste en 1927 dans Être et temps : c’est en tant qu’il existe, en tant que Dasein, que l’homme est ouvert au monde et que la question de l’être se pose. Heidegger évacue les données anthropologiques et biologiques de l’analytique existentiale, si bien qu’il s’interdit toute compréhension de notre relation primordiale avec le monde ; première remarque qui entre bien sûr en résonance avec les percées de Patočka. Paradoxalement, le Dasein, qui est au monde, est aussi sans enracinement cosmique ni vital, ce qui appelle un renversement théorique : il faut penser que c’est en tant qu’il est en vie que l’homme existe ou s’inscrit dans le monde. Ce renversement est d’abord inauguré par Erwin Straus qui a une place décisive dans mon doctorat, non seulement parce que Maldiney en fut un lecteur constant (j’y insiste longuement par ailleurs dans La Transpassibilité et l’événement. Essai sur la philosophie de Maldiney, Paris, Classiques Garnier, 2017), mais aussi parce que Merleau-Ponty et Patočka s’y réfèrent. Ils lui doivent même beaucoup, et bien davantage que ce qu’il n’y paraît : son œuvre est l’une des matrices de la phénoménologie, du moins de l’un de ses pans, celui qui m’intéresse le plus et qui place le corps, la vie et le monde au centre de la réflexion. C’est dans ce cadre que j’abordais la différence zoo-anthropologique et la question cosmologique, appelée pour la compréhension de l’enracinement de l’homme dans le monde, l’idée étant que sa puissance phénoménalisante dépend de son vivre, lui-même puisant dans le mouvement du monde. Les auteurs figurant dans l’intitulé de ma thèse — Maldiney, Merleau-Ponty et Patočka — étaient considérés depuis cette interrogation qui, simultanément, résultait de leur lecture croisée tout à fait inédite, et j’en pointais les percées et certaines limites. Je rencontrais déjà la question de la naissance en tant qu’elle marque l’événement d’une vie, bien qu’aucun des philosophes étudiés ne s’attache de façon topique à penser la naissance, ni de surcroît ne la hisse au rang des principes. Si l’homme existe en tant que vivant, sa manière de vivre dépend de la modalité de sa naissance, c’est ainsi depuis une exigence théorique que la naissance s’est imposée à moi comme une tâche pour la réflexion et, simultanément, comme son fil conducteur le plus fécond.
Frédéric Jacquet : Merci pour ces questions, qui vont droit au cœur des choses. Effectivement, mon doctorat était intitulé Vie et existence et portait sur les auteurs que vous mentionnez. Il ne s’agissait toutefois pas d’abord d’une interrogation zoo-anthropologique, mais d’une anthropologie phénoménologique articulée à une cosmologie. Par conséquent, il s’imposait notamment de rompre avec Heidegger qui sépare vie et existence (Dasein), comme cela est manifeste en 1927 dans Être et temps : c’est en tant qu’il existe, en tant que Dasein, que l’homme est ouvert au monde et que la question de l’être se pose. Heidegger évacue les données anthropologiques et biologiques de l’analytique existentiale, si bien qu’il s’interdit toute compréhension de notre relation primordiale avec le monde ; première remarque qui entre bien sûr en résonance avec les percées de Patočka. Paradoxalement, le Dasein, qui est au monde, est aussi sans enracinement cosmique ni vital, ce qui appelle un renversement théorique : il faut penser que c’est en tant qu’il est en vie que l’homme existe ou s’inscrit dans le monde. Ce renversement est d’abord inauguré par Erwin Straus qui a une place décisive dans mon doctorat, non seulement parce que Maldiney en fut un lecteur constant (j’y insiste longuement par ailleurs dans La Transpassibilité et l’événement. Essai sur la philosophie de Maldiney, Paris, Classiques Garnier, 2017), mais aussi parce que Merleau-Ponty et Patočka s’y réfèrent. Ils lui doivent même beaucoup, et bien davantage que ce qu’il n’y paraît : son œuvre est l’une des matrices de la phénoménologie, du moins de l’un de ses pans, celui qui m’intéresse le plus et qui place le corps, la vie et le monde au centre de la réflexion. C’est dans ce cadre que j’abordais la différence zoo-anthropologique et la question cosmologique, appelée pour la compréhension de l’enracinement de l’homme dans le monde, l’idée étant que sa puissance phénoménalisante dépend de son vivre, lui-même puisant dans le mouvement du monde. Les auteurs figurant dans l’intitulé de ma thèse — Maldiney, Merleau-Ponty et Patočka — étaient considérés depuis cette interrogation qui, simultanément, résultait de leur lecture croisée tout à fait inédite, et j’en pointais les percées et certaines limites. Je rencontrais déjà la question de la naissance en tant qu’elle marque l’événement d’une vie, bien qu’aucun des philosophes étudiés ne s’attache de façon topique à penser la naissance, ni de surcroît ne la hisse au rang des principes. Si l’homme existe en tant que vivant, sa manière de vivre dépend de la modalité de sa naissance, c’est ainsi depuis une exigence théorique que la naissance s’est imposée à moi comme une tâche pour la réflexion et, simultanément, comme son fil conducteur le plus fécond.
Néanmoins, je suis entrée en philosophie par la voie de l’étonnement — ce qui est assez commun — et par celle de l’admiration, c’est-à-dire avec la certitude diffuse que la clef de l’existence et du monde s’y dévoilait : c’est du moins ainsi que j’ai ressenti mes premières lectures et mon initiation à la philosophie en terminale, où j’eus la chance de suivre les cours de Jean Colrat, qui a depuis écrit l’un des plus grands livres sur Cézanne (Cézanne. Joindre les mains errantes de la nature, Paris, Sorbonne Université Presses, 2013), et me fit entre autres découvrir Nietzsche, Merleau-Ponty et Jaccottet. Aussi loin que je me souvienne, le fait d’exister m’apparut avec étonnement, comme une grâce et une merveille, bien que très vite la mélancolie de ces premières lueurs s’est imposée, sans toutefois effacer l’étonnement joyeux d’être. Or, s’étonner d’exister, c’est au fond s’étonner d’être né, ce que la langue saisit par cette formule d’un « miracle de la naissance » : elle marque l’advenue d’une vie qui, à l’évidence, n’était pas, sans pourtant qu’elle ne survienne dans une absolue étrangeté, mettant ainsi l’ontologie en crise. C’est donc la naissance qu’il s’agit de penser, et le fait qu’il y ait de la naissance dans l’être : elle est la source vive de notre existence, en dessine la figure, et loin d’un monde d’essences, il y va d’un monde de naissances, au point que le monde même est de l’ordre d’une natalité qui jamais ne se dissipe. Cependant, une trajectoire philosophique est faite de contingences irréductibles, elle est aussi impérieuse que fragile, comme toute éclosion : ce qui peut apparaître limpide s’arrache de haute lutte et dans l’hésitation, toute percée est conquise selon un mouvement qui se cherche en avançant. C’est donc rétrospectivement que cet étonnement des commencements a pu s’attester dans sa puissance heuristique, il n’avait pas d’abord l’évidence du sens que l’avenir lui donna.
Étrangement en tout cas, même les philosophes de l’étonnement ne prennent pas conscience que la naissance possède un statut principiel, déjouant ainsi le sens métaphysique du fondement. Au contraire, la tâche est bel et bien de penser en naissance, comme Bergson se proposait de penser en durée ; mais qu’entendre exactement par naissance ? C’est là toute la question — je vous remercie de la poser aussi simplement —, mais finalement plusieurs livres ne suffisent pas encore à en fixer le sens, sans doute parce qu’elle est la loi de l’être (elle est ce à quoi tout renvoie et qui ne peut être expliqué par quoi que ce soit d’autre). Toutefois, elle possède un sens premier — phénoménologiquement —, celui de l’humaine naissance, qui est un phénomène paradoxal ne pouvant être adéquatement saisi par des catégories venues d’ailleurs. Il s’impose donc de philosopher selon la naissance, qui se place d’elle-même à son foyer, et la réflexion se démet du même coup d’alternatives ruineuses (dualistes et essentialistes, comme la différence entre degré et nature). La naissance est l’éclosion d’un événement qui marque l’événement d’une éclosion, et ouvre ainsi le potentiel d’une naissance continuée, encourant aussi le risque de l’aliénation et de l’effondrement. Voilà pourquoi il m’arrive de parler de natalogie — effectivement —, afin de dire que la philosophie se déploie selon la logique de la naissance, et qu’il y va d’une tout autre manière de philosopher. C’est pourquoi aussi il est question d’une épochè natale : le sens du sens s’ouvre depuis la naissance et en dépend de part en part, sauf à réintroduire dans l’existence une instance supra-vitale, ce qui serait céder au dualisme. Ce phénomène implique ainsi la suspension des schèmes communs de la pensée qui s’ouvre de façon inédite selon cette dynamique éclosive et conduit au principe suivant : « Autant de manière de naître, autant de manière d’exister et d’apparaître. » La conséquence en est une description renouvelée de l’essence de la manifestation — comprise comme éclosion —, et l’homme est lui-même ressaisi en accordant un sens transcendantal à ce fait empirique de la naissance, mais on voit immédiatement que la distinction entre le transcendantal et l’empirique s’avère elle aussi caduque. La naissance possède une irréductible facticité, une mondanité, qui est aussi et inséparablement le foyer d’un mouvement phénoménalisant.
Voilà ce que mes différents ouvrages tentent de penser. Les monographies consacrées à Maldiney, Patočka et Dufrenne (comprenant de nombreuses analyses portant sur Merleau-Ponty et Straus, parfois aussi sur Sartre, Ricoeur, Henry et Marion, ou encore Bergson et Simondon…) sont chaque fois des façons d’aller aussi loin que possible avec un philosophe pour en comprendre les avancées, considérables, et les limites, permettant de jouer une autre partition, celle d’une phénoménologie de la naissance. Cet événement n’est pas un phénomène régional, il engage le tout de la phénoménologie ; telle est du moins l’hypothèse de travail. Métaphysique de la naissance inaugure cette voie — préparée par les analyses de mon doctorat et par les monographies évoquées — que poursuit Naissances, en mettant les questions du corps, de l’accouchement, du portage et de l’enfance au premier plan, tout en insistant sur des phénomènes subséquents comme le jeu, la consolation, l’enfantement et la nudité. Esquisses phénoménologiques est un recueil d’essais déjà parus sur Merleau-Ponty, Maldiney, Patočka et Dufrenne, qui initie aussi de nouvelles percées relatives à l’idée de natalogie, au statut cosmologique du végétal et à la question politique, ou plutôt civilisationnelle (elle aussi étrangement absente de la phénoménologie contemporaine). Enfin, Vie et monde est l’essai le plus abouti en lequel tout est finalement rejoué : j’y précise, mieux que dans les autres essais, l’enracinement cosmologique de la vie humaine comprise selon la naissance et la réflexion anthropologique prend sa pleine mesure avec une phénoménologie de la tendresse, s’y déploie également une esthétique et une éthique de la fragilité articulée à une phénoménologie de la liberté cosmophanique.
Ch. B. : Je ne suis pas surpris de la place que vous accordez à la pensée d’Erwin Straus dans votre parcours philosophique. À la page 24 de Vie et monde, il y a cette importante formule — que Straus, en particulier celui des années 1950 et 1960, n’aurait pas refusée — d’après laquelle « les hommes vivent selon l’ambivalence d’une aspiration à la communion avec le monde et d’une tendance à la séparation existentielle par laquelle une vie singulière advient pour elle-même dans le tissu de ses relations ». À la page 132, plus laconiquement, vous écrivez que « les différentes activités humaines sont traversées par cette polarité de l’aventureux et de l’intime ». Ne pouvons-nous pas considérer ces deux affirmations comme la porte d’entrée, la voie royale de votre anthropologie philosophique ?
Fr. J. : Le foyer de l’anthropologie élaborée n’est autre que le foyer de notre existence, à savoir la naissance ; aussi, pour caractériser la dynamique de notre vie, je dirai que l’acte de notre existence n’est autre qu’un acte de naissance continuée. Chacun a le sentiment d’exister quand, à tout âge, il vient au monde, en fait l’épreuve et s’étoffe de sa puissance : littéralement, naître, c’est surgir dans le monde ; exister, c’est prolonger cette surrection. Tout homme en effet naît comme encore à naître — ce que le concept de naissance aperturale permet de comprendre —, et s’ouvre ainsi à une histoire qui ne s’achève qu’avec la mort. Ce n’est là nullement s’inscrire dans la continuité d’un premier jet — faisant routine —, mais bien renaître, naître encore, sous l’effet d’un renouvellement de notre expérience du monde. Il n’y a pas d’identité personnelle au sens commun de l’identité, elle consiste plutôt en une continuité de naissances — éclosion d’un événement qui marque l’événement d’une éclosion. Voilà pourquoi pointer une identité substantielle ou mettre l’accent sur une multiplicité interne, c’est chaque fois manquer la vérité : l’identité en question advient dans l’éclosion d’un événement, et donc signe une rupture, alors même qu’elle se fomente depuis un mouvement préalable. Ni identité simple ni multiplicité pure, mais une vie in statu nascendi dont l’identité se constitue à la mesure de la différence qui advient et selon le monde qu’elle enveloppe : toute ipséisation implique une naissance trans-individuelle, ou cosmo-génétique. Tomber amoureux, rencontrer une œuvre ou explorer un paysage, à condition de s’y ouvrir, c’est renaître, c’est-à-dire étoffer sa vie de dimensions de monde qui se transmuent en puissances existentielles.
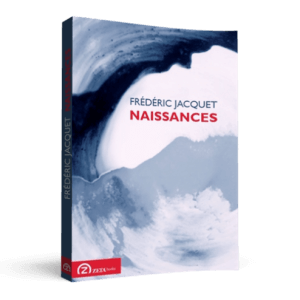 Ces nouvelles naissances engagent une topologie et un rythme, une certaine façon d’habiter le monde, c’est en quoi l’intimité à soi est conquise depuis l’aventure d’une exploration (un autre, un livre, un tableau, un paysage…). Et, inversement, la sphère de l’intimité, lorsqu’elle n’est pas le simple abandon à une routine, est une épreuve d’altérité, par exemple celle de l’enfant avec sa mère qui est également pour lui un pays étranger, une altérité tendre où pointe le monde. Aussi, loin que la polarité de l’intime et de la séparation aventureuse soit la voie royale de l’anthropologie édifiée[2], c’est la dynamique natale qui en constitue le cœur, ces tendances en procèdent de part en part, et les considérer seulement en elles-mêmes serait oublier qu’elles s’élèvent depuis l’événement de notre venue au monde et que notre naissance est en jeu dans leur inflexion propre, donc que vivre pleinement — intime ou aventureux —, c’est naître encore. Revenons en outre à l’idée évoquée de routine afin d’éviter un contre-sens, refusant de penser le quotidien comme la somme des insignifiances[3]. S’il est vrai que la routine est un enlisement, le quotidien est chargé de sens que certains peintres (Vermeer, Chardin, Morandi, Hollan…), poètes et écrivains révèlent (Baudelaire, Jaccottet, Kundera…) : les choses possèdent une aura cosmique qui exalte le sentiment d’exister et les relations avec d’autres peuvent émerveiller au quotidien tout en éveillant l’interrogation. Creuser l’intime est une aventure, et jamais la standardisation technique et politique de nos vies n’étouffe tout à fait la merveille d’exister ni les puissances du monde qui scintillent pour qui simplement ouvre les yeux et tend l’oreille, mais cela ne signifie à l’évidence pas qu’il faille se dispenser de lutter contre le devenir mortifère de la civilisation.
Ces nouvelles naissances engagent une topologie et un rythme, une certaine façon d’habiter le monde, c’est en quoi l’intimité à soi est conquise depuis l’aventure d’une exploration (un autre, un livre, un tableau, un paysage…). Et, inversement, la sphère de l’intimité, lorsqu’elle n’est pas le simple abandon à une routine, est une épreuve d’altérité, par exemple celle de l’enfant avec sa mère qui est également pour lui un pays étranger, une altérité tendre où pointe le monde. Aussi, loin que la polarité de l’intime et de la séparation aventureuse soit la voie royale de l’anthropologie édifiée[2], c’est la dynamique natale qui en constitue le cœur, ces tendances en procèdent de part en part, et les considérer seulement en elles-mêmes serait oublier qu’elles s’élèvent depuis l’événement de notre venue au monde et que notre naissance est en jeu dans leur inflexion propre, donc que vivre pleinement — intime ou aventureux —, c’est naître encore. Revenons en outre à l’idée évoquée de routine afin d’éviter un contre-sens, refusant de penser le quotidien comme la somme des insignifiances[3]. S’il est vrai que la routine est un enlisement, le quotidien est chargé de sens que certains peintres (Vermeer, Chardin, Morandi, Hollan…), poètes et écrivains révèlent (Baudelaire, Jaccottet, Kundera…) : les choses possèdent une aura cosmique qui exalte le sentiment d’exister et les relations avec d’autres peuvent émerveiller au quotidien tout en éveillant l’interrogation. Creuser l’intime est une aventure, et jamais la standardisation technique et politique de nos vies n’étouffe tout à fait la merveille d’exister ni les puissances du monde qui scintillent pour qui simplement ouvre les yeux et tend l’oreille, mais cela ne signifie à l’évidence pas qu’il faille se dispenser de lutter contre le devenir mortifère de la civilisation.
Notre expérience primordiale de l’être — disons plutôt du monde —, de l’il y a, n’est donc pas celle de l’effroi pascalien, de l’angoisse décrite par Heidegger, ni de l’horreur révélée exemplairement dans l’insomnie qu’envisage Levinas. Au sein de cette dernière expérience, l’insomniaque n’est plus à soi ni au monde, il est enfermé au dehors comme dans une prison sans limite ni barreau ; mieux, il est condamné à une « vigilance anonyme[4] ». Cependant, au contraire des conclusions qu’en tire Levinas, cette situation révèle négativement la dynamique cosmonatale de notre vie comme ce qui n’a plus lieu. Une phénoménologie de la naissance nous apprend alors que l’humaine expérience — hors cas extrêmes — est celle d’une intimité conquise dans l’étrangeté et d’une étrangeté saisie au plus profond de l’intime, elle est donc inséparablement ravissement et étonnement, pouvant aller jusqu’à la stupeur. L’effroi procède quant à lui d’un regard extérieur, où ce n’est plus depuis le mouvement de notre venue au monde que le monde est senti et pensé, mais bien depuis un point de vue de nulle part étranger à la chaleur d’un point de vie, le monde étant compris comme un infini froid, glaçant l’existence, et l’angoisse est une glaciation anti-natale. Tout trauma, il est vrai, plonge dans un exil mortifère, et le désespoir s’abat sur celui qui est brisé par cette épreuve. Ni l’angoisse ni l’effroi ou l’horreur ne qualifient toutefois l’expérience primordiale que nous avons du monde, notre existence étant tissée du sens qui jaillit de sa rythmique spacieuse, elle-même travaillée par un mouvement de co-naissance avec d’autres[5]. Afin d’écarter une interprétation erronée relative désormais à cette dynamique dans laquelle autrui est engagé, précisons que la solitude n’est pas un désert aride impliquant une désolation existentielle ; au contraire, elle est lourde de monde et participe de la scansion rythmique de notre vie. Autrement dit, la solitude est comme une chambre noire où le négatif photographique peut être développé, elle fertilise un espace et un temps où le monde se réfléchit dans une certaine suspension, à condition qu’elle soit désirée et ne relève pas d’une claustration extorquée. Et, plus fondamentalement, naître, c’est advenir à la solitude d’une expérience en première personne — nul ne peut sentir la vie à ma place —, qui suppose toutefois de participer du monde et de s’inscrire dans un partage originaire, chacun étant en outre, par la suite, ouvert à une vie de relation : la solitude ipséique est donc toujours sertie de monde et mêlée aux autres pour se conquérir comme telle[6]. On le comprend désormais pleinement, portés vers l’altérité, qui n’est jamais totale, et par un mouvement d’intimisation, où l’étrangeté n’est pas absente, nous sommes pris dans une dynamique oscillatoire selon laquelle le monde est habité, et cette double polarité répond elle-même à l’impulsion natale dont les figures dépendent de notre manière de naître.
Ch. B. : Avant d’en arriver à l’anthropologie comme telle, vous développez une phénoménologie des autres formes de vie, une phénoménologie des plantes et une phénoménologie des animaux, démarche qui vient témoigner de la singulière ambition de votre projet philosophique. À la page 88, vous écrivez : « La vie végétale doit être distinguée de l’animal qui est seul capable de ressentir et percevoir en vertu d’une motricité spécifique au point que c’est le mouvement vivant qui devient percevant » (je souligne). Qu’entendez-vous exactement par « ressentir » et « percevoir » ? En effet, n’y a-t-il pas un sens à admettre que les végétaux, à leur façon, ressentent et perçoivent leur environnement ? Ou bien, à l’instar de Florence Burgat dans Qu’est-ce qu’une plante ? Essai sur la vie végétale (Seuil, coll. « La couleur des idées », 2020), refusez-vous aux plantes tout sentir et se-sentir ?
Fr. J. : Effectivement, le phénomène de la naissance appelle une considération de son aval anthropologique et de son amont cosmologique. L’épochè natale découvre l’essence de la manifestation, qui consiste fondamentalement en une logique éclosive et engage une topologie, ou plutôt une toponatalogie : l’éclosion de tout phénomène suppose que le monde soit comme tel une matrice éclosive en quoi consiste la spatialité primordiale, et il n’y a finalement qu’éclosions dans le monde — minérale, végétale, animale, ou encore, avec l’homme, éclosion d’un sentiment ou d’une idée… Autrement dit, les plantes sont bel et bien de l’ordre de l’éclosion, et possèdent une puissance de faire monde en se déployant ; ainsi, les arbres déploient leur ramure, le moindre brin d’herbe possède une manière de naître au monde et d’avoir lieu en croissant et en verdoyant. Il est requis d’instruire ces analyses par celles des botanistes, mais la phénoménologie doit surtout être attentive à l’apparaître comme tel, penser selon lui, aussi dans Vie et monde, comme dans Esquisses phénoménologiques, je me réfère longuement à des descriptions poétiques — comme celle de Ponge et Jaccottet —, ainsi qu’à d’autres artistes comme Alexandre Hollan qui dessine et peint des arbres, habite pour ainsi dire le monde végétal et en donne à sentir la puissance éclosive singulière selon la vibration de ses couleurs et de ses traits. Les plantes sont toponatales, elles ouvrent un espace lui-même ouvert et s’enchâssant dans d’autres espaces tracés par d’autres plantes. Plus encore, elles font paysages avec l’espace qu’elles parcourent, et avec les roches et les animaux alentours. Autrement dit, loin de céder à de vaines discontinuités, cette philosophie met en évidence l’universel éclosif dont participent aussi les plantes ; cependant, il serait tout aussi naïf de rabattre leurs vies sur celles des animaux et des hommes, et la différence tient à ce qu’elles ne perçoivent pas selon une phénoménalisation atmosphérique et horizontale à la manière des vivants. En ce sens, nous croisons en effet le bel ouvrage de Florence Burgat — d’ailleurs explicitement cité dans Esquisses phénoménologiques[7] —, et je profite aussi de cette mention pour souligner plus généralement l’importance de son travail sur la vie animale et sur la nourriture carnée ; il est décisif aussi, dans la foulée, de penser la logique mortifère propre à l’élevage industriel. C’est toutefois depuis une tout autre perspective que la plante (et l’animal) est abordée dans Vie et monde, ce qui précède dans cet entretien le montre suffisamment je crois : l’archéologie de la finitude conduit à une cosmonatalogie au sein de laquelle la vie végétale prend place — dans tous les sens du terme. D’autre part et corrélativement, il ne s’agit pas d’effectuer une hiérarchie des formes de vie, et nous montrons — c’est une seconde différence à l’égard des analyses de Florence Burgat — que l’éclosion végétale est bel et bien une manière de faire monde, de nouer une relation avec lui, c’est-à-dire avec la terre, le ciel, les autres plantes, les animaux et les hommes eux-mêmes.
 Par ailleurs, de même qu’il faut penser la différence de l’animal et du végétal — sans se donner une compréhension restrictive de la plante —, il faut penser la différence des animaux et de l’homme, sans tomber dans une zoologie réductrice. Un double égarement affecte l’époque : théoriquement, nier la différence anthropologique — comme c’est largement le cas aujourd’hui en la réduisant à une question de degré —, c’est une façon de manquer l’humain. Les hommes habitent pourtant le monde d’une façon unique, un seuil est franchi qui excède toute échelle graduée, et notre époque prisonnière du quantitatif est impuissante à concevoir cette différence. Être attentif au phénomène de la naissance, c’est au contraire sortir résolument de l’empire du quantitatif, et notons par exemple que nul animal ne pense l’homme ni ne se pense à la manière de l’homme, pas davantage il ne considère les autres formes de vie (notre ouvrage montrant que cette différence est enracinée dans notre naissance aperturale)[8]. Politiquement, l’élevage industriel évoqué persiste dans nos sociétés qui s’accommodent tout à fait de cette barbarie qu’est la souffrance infligée de façon systématique aux animaux. L’essentiel est pourtant ici que la différence anthropologique consiste en une différence natale, notre manière d’exister procédant de notre manière de naître. Il faut dès lors dépasser la distinction entre différence de degré et différence de nature, l’humaine naissance fait événement au sein du mouvement de la vie ; bref, elle modifie qualitativement la dynamique éclosive en laquelle elle s’ancre pourtant. Les hommes et les animaux ont la vie en partage, la différence entre eux n’est pas d’essence et ne se décline pas non plus en termes de degrés. Ce dépassement suppose de penser au prisme de l’épochè natale qui décèle une logique conjurant des préjugés théoriques communs et enracinés dans la tradition ; Vie et monde le montre en détail. En tout cas, décrire la puissance éclosive singulière du végétal s’impose sans toutefois confondre les manières d’exister : le tissu du monde est tramé de vies irréductibles et pourtant toutes sont assignées à une dynamique natale spécifique.
Par ailleurs, de même qu’il faut penser la différence de l’animal et du végétal — sans se donner une compréhension restrictive de la plante —, il faut penser la différence des animaux et de l’homme, sans tomber dans une zoologie réductrice. Un double égarement affecte l’époque : théoriquement, nier la différence anthropologique — comme c’est largement le cas aujourd’hui en la réduisant à une question de degré —, c’est une façon de manquer l’humain. Les hommes habitent pourtant le monde d’une façon unique, un seuil est franchi qui excède toute échelle graduée, et notre époque prisonnière du quantitatif est impuissante à concevoir cette différence. Être attentif au phénomène de la naissance, c’est au contraire sortir résolument de l’empire du quantitatif, et notons par exemple que nul animal ne pense l’homme ni ne se pense à la manière de l’homme, pas davantage il ne considère les autres formes de vie (notre ouvrage montrant que cette différence est enracinée dans notre naissance aperturale)[8]. Politiquement, l’élevage industriel évoqué persiste dans nos sociétés qui s’accommodent tout à fait de cette barbarie qu’est la souffrance infligée de façon systématique aux animaux. L’essentiel est pourtant ici que la différence anthropologique consiste en une différence natale, notre manière d’exister procédant de notre manière de naître. Il faut dès lors dépasser la distinction entre différence de degré et différence de nature, l’humaine naissance fait événement au sein du mouvement de la vie ; bref, elle modifie qualitativement la dynamique éclosive en laquelle elle s’ancre pourtant. Les hommes et les animaux ont la vie en partage, la différence entre eux n’est pas d’essence et ne se décline pas non plus en termes de degrés. Ce dépassement suppose de penser au prisme de l’épochè natale qui décèle une logique conjurant des préjugés théoriques communs et enracinés dans la tradition ; Vie et monde le montre en détail. En tout cas, décrire la puissance éclosive singulière du végétal s’impose sans toutefois confondre les manières d’exister : le tissu du monde est tramé de vies irréductibles et pourtant toutes sont assignées à une dynamique natale spécifique.
Ch. B. : Un lecteur de l’œuvre de Renaud Barbaras ne pourra être que stupéfait par les nombreuses thèses de votre livre qui entrent en consonance avec Dynamique de la manifestation, et plus encore par le geste d’ensemble : celui d’un dépassement du cadre strictement phénoménologique au profit d’une perspective résolument métaphysique. Vous parlez d’« une percée hors de la phénoménologie depuis la phénoménologie[9] ». Pourtant le nom de Barbaras n’apparaît qu’une fois, à la note 2 de la page 37. De quelle façon la philosophie barbarassienne innerve-t-elle votre propre travail ?
Fr. J. : Il s’agit pour moi d’une stupéfiante stupéfaction, je vous remercie donc de me donner l’occasion d’une clarification : la philosophie de la naissance déployée est tout à fait étrangère à la voie par ailleurs décisive tracée par Renaud Barbaras (je l’indique dès Métaphysique de la naissance, Louvain-la-Neuve, Peeters, 2018, p. 10-11, note 5). Il fut mon directeur de thèse, j’ai suivi admiratif ses cours dans les années quatre-vingt-dix — sur Maine de Biran, Bergson et Merleau-Ponty notamment, Freud aussi —, et il faisait alors la différence à l’égard de bien d’autres par la profondeur de ses analyses et par l’énergie philosophique qu’il communiquait (je suivais aussi avec joie des cours de Monique Dixsaut, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien et Patrick Wotling, apprenant beaucoup d’eux). J’ai lu De l’être du phénomène et, ensuite, Le Désir et la distance avec passion, et il est certain que Renaud Barbaras contribua avec Jean-Luc Marion à me faire prendre conscience de la puissance inhérente à la phénoménologie. Son œuvre encore inchoative à l’époque, attachée à faire place à la vie en phénoménologie (et c’est d’abord l’immense mérite de Straus et de Patočka dont Renaud Barbaras hérite très largement), faisait pour moi écho à ce que je tentais déjà de penser. Et en effet, mes débuts en philosophie, lisant dès la classe de terminale Nietzsche et Merleau-Ponty, se plaçaient sous le signe du corps et de la vie, et mes premières recherches portèrent sur la finitude dans les œuvres de Kant et Husserl, puis sur Bergson et Merleau-Ponty, avant d’entreprendre un doctorat consacré à Maldiney, Merleau-Ponty et Patočka (soutenu en 2011), saisissant davantage le sens concret de notre finitude. Dans la conclusion, je montrais que la philosophie de Renaud Barbaras — alors recueillie dans Introduction à une philosophie de la vie (Paris, Vrin, 2008) et élaborant une anthropologie privative — cédait à une forme d’idéalisme, c’est-à-dire d’acosmisme. Le désir, qui définit l’être du sujet selon Renaud Barbaras, y était décrit comme procédant d’un refoulement à l’égard de l’Ouvert (en référence à Rilke), sans qu’il n’inscrive la vie dans un sens cosmologique du monde, il s’en tenait en effet à une acception strictement phénoménologique. Au contraire, il s’imposait à moi d’inscrire le vivant percevant dans le monde sans par ailleurs reconduire une perspective téléologique ; ce que Patočka entreprend lui-même. D’où le concept d’événement métaphysique élaboré dans Vie et existence et l’orientation vers une cosmologie (développés aussi dans un article intitulé : « Vie et existence : vers une cosmologie phénoménologique », Les Études philosophiques, n°3, 2011). Bien sûr, je ne pouvais pas savoir que Renaud Barbaras allait ensuite, après 2008, développer une cosmologie et une pensée de l’événement au foyer de la vie phénoménalisante, et il soulignait lui-même — dans le « Rapport sur la thèse de doctorat » relatif à Vie et existence — l’acuité et la nouveauté de mes percées[10]. Le dispositif théorique déployé permettait en effet de tracer une voie tout autre que la phénoménologie de la vie développée par lui en 2008[11], et la question de la naissance apparaissait dès cet essai doctoral, de sorte que la vie se trouvait définie de façon renouvelée, et différente de la sienne, une fois comprise selon sa natalité éclosive.
De surcroît, quand Renaud Barbaras en vient lui-même à une cosmologie, tout en saisissant le sujet depuis l’événement de son émergence, un écart capital demeure à l’égard de la perspective que j’avais élaborée et d’ailleurs, dans sa Préface à mon ouvrage sur Patočka[12], il critiquait — en cohérence avec ses analyses — le concept de naissance métaphysique que j’édifiais pour penser la surrection du sujet corrélationnel. Selon Renaud Barbaras, ce concept ne permet pas de concevoir l’événement de la séparation marquant l’apparition du sujet en tant que toute naissance figure une appartenance (je montrais en effet que ce concept enveloppe à la fois une appartenance au monde et la différence d’une surrection). Autrement dit, il s’agissait pour lui de concevoir une différence sans appartenance, un événement au foyer de la corrélation qui est sans raison dans le monde. Alors que je pense la surrection corrélationnelle comme naissance (sens de l’événement lui-même), conciliant appartenance et différence, Renaud Barbaras, lui, concevait la séparation comme événement de façon hypertrophiée, rompant les amarres avec le monde, et une métaphysique nouvelle voyait le jour par différence avec la cosmologie. Or, cette option théorique s’avère aporétique : Renaud Barbaras cède en 2011 et 2013 à une mystique de l’événement en tant qu’il témoigne d’une in-appartenance constitutive, et nous entendons ici par « mystique » une affirmation sans pertinence phénoménologique tenant lieu d’une aberration cosmologique (figure spécifique de l’irrationalité mystique). Il a fallu un certain temps pour que mes analyses se hissent pleinement à la hauteur de la naissance, subissant de façon d’abord outrancière l’empire des analyses sartriennes et patočkiennes de l’événement, mais la perspective développée a toujours échappé au risque d’acosmisme dans lequel tombe Renaud Barbaras (de façon différente en 2008 d’une part et en 2011 et 2013 d’autre part). Désormais, en vertu d’un nouveau revirement, il s’éloigne il est vrai — dans L’Appartenance (Louvain-la-Neuve, Peeters, 2019) — d’une métaphysique de l’événement, et il n’écrirait sans doute plus que mon concept de naissance métaphysique pèche par excès d’appartenance, échouant à penser la différence du vivant vis-à-vis du monde des mouvements, ou plutôt du monde comme mouvement. Mais il passe alors d’une mystique de l’événement à un monisme de l’indifférenciation ; autrement dit, sur fond de l’appartenance telle qu’il la comprend en 2019, on ne saurait saisir la différence du vivant à l’égard des choses ni celle de l’homme à l’égard des animaux — différence qui n’est pas de degré, contrairement à ce qu’affirme Renaud Barbaras, ni bien sûr de nature ou d’essence. Une philosophie de la naissance y parvient en revanche du fait de la dynamique qu’elle théorise, une éclosion cosmique générant une différence qualitative. Disons-le à nouveau, la naissance est l’éclosion d’un événement qui marque l’événement d’une éclosion, de sorte que ce type de différences s’inaugure depuis l’immanence, elle en est la vie même. Réduisant toute différence au degré d’appartenance, Renaud Barbaras en manque le sens, au point qu’elle s’évente purement et simplement, et il cède du même coup à une statique cosmologique incapable de penser le mouvement qu’il éternise : il y va d’un devenir qui ne devient rien du tout. Dans notre perspective, creusant en deçà de la partition espace-temps, le monde est défini comme une immanence éclosive, il consiste plus précisément en une Natalité inépuisable dont l’identité se confond avec sa dynamique d’enfantement qui, dès lors, se déploie au rythme d’aventures imprévisibles sous l’effet de rencontres contingentes. Ce n’est pas un hasard si Renaud Barbaras n’aborde jamais la question de la relation entre les choses, il ne peut dès lors saisir la puissance féconde de l’il y a et reste prisonnier d’une verticalité métaphysique — venue de Plotin —, symptôme d’une théologie masquée (que trahit d’ailleurs le vocabulaire de la « sur-éminence[13] »). Au contraire, nous montrons que le monde coïncide avec la fécondité de l’il y a, et l’idée d’aventures de l’Absolu est ici cruciale, la surrection du vivant et celle de l’homme participant de cette intrigue cosmologique. Exister, c’est donc toujours déployer une spatialité-de-fécondité, qui est une façon de faire-monde selon le tissu éclosif de l’il y a, et cette spatialisation implique une phénoménalisation, c’est-à-dire une naissance. Inversement, toute naissance est ouverture à, mouvement spacieux faisant paraître le monde depuis la séparation natale, et le monde est en jeu dans cette manifestation en tant que la séparation évoquée n’outrepasse jamais l’immanence matricielle, qui participe de ce qui s’en différencie et n’en participe qu’en vertu de cette différenciation — telle est la logique de la naissance.
 On le comprend donc, affirmer que notre philosophie est innervée par l’œuvre de Renaud Barbaras est aussi factuellement erronée (je ne pouvais pas savoir en écrivant ma thèse qu’il allait lui-même abandonner son anthropologie privative pour une cosmologie et une métaphysique de l’événement) que philosophiquement inadéquat (nos concepts de monde et d’événement n’ont pas le même sens et forment une alternative). L’impulsion et le fil conducteur de cette philosophie, ainsi que ses résultats, sont tout autre : la voie tracée repose sur l’épochè natale introuvable dans l’œuvre de Renaud Barbaras — votre interrogation nourrit d’autant plus ma surprise —, et elle conduit en outre à une anthroponatalogie qui place aux premières loges des phénomènes qu’il ne considère nullement (certaines réponses à vos questions évoquent ici même quelques-uns de ces phénomènes). Renaud Barbaras cède là aussi à une abstraction intenable, c’est-à-dire à un formalisme phénoménologique étranger à notre phénoménologie de la naissance ; plus précisément, il s’enquiert de la « couche solipsiste » du sujet sans pouvoir rejoindre le concret de l’existence abandonné à la sphère empirique tout en manquant du même coup l’essence de la dynamique subjective, à savoir notre élan natif. Penser natalement implique d’étoffer le « transcendantal » de déterminations qui adviennent durant l’enfance et qui ne peuvent être passées sous silence : la facticité existentielle participe de notre natalité essentielle, ce qui engage un dépassement des catégories de l’empirique et du transcendantal. Autrement dit, le monde ne se donne qu’à un sujet in statu nascendi et selon sa dynamique éclosive ; ce qui marque un différend majeur avec l’œuvre de Renaud Barbaras, puisque ce dernier s’en tient à un sujet pur imbriqué dans la couche d’une phénoménalité pure, et en manque le sens d’être : cette prétendue pureté est le masque d’un transcendantalisme désincarné (le corps relevant en vérité d’un mouvement d’advenue interminable) et la marque d’un refoulement anthropologique (conséquence du refoulement de la naissance et de l’enfance). Dans son optique, la réduction permet de conquérir un désir originaire, où l’autre notamment est absent, mais cette absence trahit une abstraction dont libère l’épochè natale en décelant notre mouvement natif selon la plénitude de son sens. Il s’agit bien sûr d’une abstraction de méthode pour Renaud Barbaras, visant à découvrir le sujet pour lequel il y a le monde ; cependant, notre vie d’expérience dépend de notre naissance et appelle une phénoménologie de l’enfance, puisqu’en elle seulement notre corps se pare de ses puissances propres à la faveur d’une relation de portage spacieux : cette phénoménologie découvre alors l’élan constitutif de notre vie, sa rythmique oscillatoire (intime/aventureux) et la fécondité de ses mouvements.
On le comprend donc, affirmer que notre philosophie est innervée par l’œuvre de Renaud Barbaras est aussi factuellement erronée (je ne pouvais pas savoir en écrivant ma thèse qu’il allait lui-même abandonner son anthropologie privative pour une cosmologie et une métaphysique de l’événement) que philosophiquement inadéquat (nos concepts de monde et d’événement n’ont pas le même sens et forment une alternative). L’impulsion et le fil conducteur de cette philosophie, ainsi que ses résultats, sont tout autre : la voie tracée repose sur l’épochè natale introuvable dans l’œuvre de Renaud Barbaras — votre interrogation nourrit d’autant plus ma surprise —, et elle conduit en outre à une anthroponatalogie qui place aux premières loges des phénomènes qu’il ne considère nullement (certaines réponses à vos questions évoquent ici même quelques-uns de ces phénomènes). Renaud Barbaras cède là aussi à une abstraction intenable, c’est-à-dire à un formalisme phénoménologique étranger à notre phénoménologie de la naissance ; plus précisément, il s’enquiert de la « couche solipsiste » du sujet sans pouvoir rejoindre le concret de l’existence abandonné à la sphère empirique tout en manquant du même coup l’essence de la dynamique subjective, à savoir notre élan natif. Penser natalement implique d’étoffer le « transcendantal » de déterminations qui adviennent durant l’enfance et qui ne peuvent être passées sous silence : la facticité existentielle participe de notre natalité essentielle, ce qui engage un dépassement des catégories de l’empirique et du transcendantal. Autrement dit, le monde ne se donne qu’à un sujet in statu nascendi et selon sa dynamique éclosive ; ce qui marque un différend majeur avec l’œuvre de Renaud Barbaras, puisque ce dernier s’en tient à un sujet pur imbriqué dans la couche d’une phénoménalité pure, et en manque le sens d’être : cette prétendue pureté est le masque d’un transcendantalisme désincarné (le corps relevant en vérité d’un mouvement d’advenue interminable) et la marque d’un refoulement anthropologique (conséquence du refoulement de la naissance et de l’enfance). Dans son optique, la réduction permet de conquérir un désir originaire, où l’autre notamment est absent, mais cette absence trahit une abstraction dont libère l’épochè natale en décelant notre mouvement natif selon la plénitude de son sens. Il s’agit bien sûr d’une abstraction de méthode pour Renaud Barbaras, visant à découvrir le sujet pour lequel il y a le monde ; cependant, notre vie d’expérience dépend de notre naissance et appelle une phénoménologie de l’enfance, puisqu’en elle seulement notre corps se pare de ses puissances propres à la faveur d’une relation de portage spacieux : cette phénoménologie découvre alors l’élan constitutif de notre vie, sa rythmique oscillatoire (intime/aventureux) et la fécondité de ses mouvements.
Ch. B. : Dans Naissances, en 2020, vous introduisiez dans votre questionnement le concept central de « rythme ». Dans Vie et monde, vous écrivez que « le rythme est natal et cosmophanique, enveloppant et aventureux[14] ». De quelle façon interpréter cette formule particulièrement dense ?
Fr. J. : Le rythme est effectivement décisif à une existence, il est la ponctuation de toute vie spacieuse et, de lui, dépend d’abord la manière dont l’enfant se dispose dans le monde : exister, c’est naître au monde selon une dynamique consistant en une éclosion cosmophanique. Une priorité doit donc être accordée à l’espace ; vivre, c’est spatialiser. Telle est la leçon d’une philosophie de la naissance qui focalise l’attention sur notre venue au monde entendue comme une éclosion continuée. Toute éclosion est une expansion qui a lieu selon la disposition d’un espace et par le nouage de relations avec d’autres, elles aussi spacieuses. Vie et monde décrit l’éveil de l’enfant, montrant qu’il suppose une différenciation à l’égard de la mère et à l’égard du monde s’effectuant selon la polarité de l’intime et de l’aventureux. Plus précisément, la spatialisation originaire coïncide avec une incarnation — habiter notre corps, c’est habiter l’espace qui, depuis l’espace de la pesanteur, enveloppe l’espace oral, l’espace du buste, du torse et celui des gestes. Le corps s’unifie à la mesure de ces différentes coordinations posturales où un soi émerge en émergeant au monde[15]. Or, cet éveil possède une rythmique propre ; ainsi, par exemple l’enfant, dans le jeu, naît à soi en éprouvant une altérité qui se donne rythmiquement. Tel est le jeu des chatouilles : la mère installe une régularité temporelle dans ses gestes et, tout à coup, surprend l’enfant par une légère accélération. De cette rupture procède une différenciation et un éveil, une altérité pointe vis-à-vis de laquelle une vie s’éprouve en éprouvant cette altérité qui surgit. Le rythme est donc natal, il est l’anti-routine : il est spacieux, ouvrant, il dispose un espace selon lequel un soi se profile. En cela, plus largement, il y a une école du rythme, ou une éducation par le rythme s’il est vrai qu’elle conduit hors de soi (e-ducere) selon des chemins où notre humanité est en jeu[16]. Cette rythmique est présente dès la vie fœtale au sein de cet espace du dedans qu’est l’utérus, lui-même déjà ouvert sur le grand dehors du monde sous l’espèce des voix qui en proviennent. On le comprend, une existence où le rythme s’absente désespère inévitablement en s’éteignant dans une immobilisation routinière ou se brise dans l’expérience d’un trauma qui plonge dans une vie mortifère.
 Il m’a fallu un certain temps pour comprendre pleinement la place du rythme dans une existence, en dépit de mon attachement à la philosophie de Maldiney où le rythme est décisif. Néanmoins, la façon dont Maldiney conçoit le corps dans l’abstraction m’a empêché de suffisamment saisir sa puissance existentielle (alors même que j’y consacre bien des pages dans La Transpassibilité et l’événement), faute d’en déceler pour ainsi dire le lieu. Il m’a donc fallu pour le comprendre déployer une phénoménologie de la naissance où le rythme se donne comme la scansion de l’éclosion charnelle, qui se poursuit ensuite dans les palpitations d’une vie spacieuse, marquant ses mouvements cosmophaniques. Voilà pourquoi le concept d’éclosion natale est décisif dans Vie et monde, conduisant à envisager l’« Espace et le rythme de naissance », et c’est aussi depuis cette phénoménologie de l’éveil et de l’éclosion que prend place le chapitre intitulé « La temporalité, la mémoire et le désir ». Dans ce cadre, le concept de topochronie, qui est aussi une topomnésie, manifeste l’insertion de la temporalité dans l’éclosion spatialisante, et toute expérience du ravissement consiste en un espacement rythmique ; c’est dire son importance.
Il m’a fallu un certain temps pour comprendre pleinement la place du rythme dans une existence, en dépit de mon attachement à la philosophie de Maldiney où le rythme est décisif. Néanmoins, la façon dont Maldiney conçoit le corps dans l’abstraction m’a empêché de suffisamment saisir sa puissance existentielle (alors même que j’y consacre bien des pages dans La Transpassibilité et l’événement), faute d’en déceler pour ainsi dire le lieu. Il m’a donc fallu pour le comprendre déployer une phénoménologie de la naissance où le rythme se donne comme la scansion de l’éclosion charnelle, qui se poursuit ensuite dans les palpitations d’une vie spacieuse, marquant ses mouvements cosmophaniques. Voilà pourquoi le concept d’éclosion natale est décisif dans Vie et monde, conduisant à envisager l’« Espace et le rythme de naissance », et c’est aussi depuis cette phénoménologie de l’éveil et de l’éclosion que prend place le chapitre intitulé « La temporalité, la mémoire et le désir ». Dans ce cadre, le concept de topochronie, qui est aussi une topomnésie, manifeste l’insertion de la temporalité dans l’éclosion spatialisante, et toute expérience du ravissement consiste en un espacement rythmique ; c’est dire son importance.
Ch. B. : Dans la troisième partie de l’ouvrage, intitulée « La vie partagée », vous développez une esthétique, laquelle s’adosse, on l’aura compris, à votre phénoménologie de la naissance. À la page 262, vous affirmez qu’« une archéologie de l’artiste est […] requise ». Il semble que, par ce syntagme d’« archéologie de l’artiste », il faille entendre un questionnement sur l’existence des artistes : pourquoi y a-t-il des artistes ? Ou, en d’autres termes, pourquoi certains sujets humains deviennent-ils des artistes ? Et pourquoi d’autres ne le deviennent-ils pas, demeurent, tout au plus, des peintres du dimanche ? Or ce ne sont pas les questions que vous (vous) posez. Votre interrogation est : « Pourquoi l’artiste crée-t-il ?[17] » Autrement dit : que signifie créer ? Vous avancez cette réponse, une nouvelle fois hautement dense philosophiquement : « Créer, c’est naître encore, s’ipséiser pour l’artiste et dénaître par conjuration — néanmoins jamais pleine — de la finitude natale.[18] » Pouvez-vous revenir sur ces différents points ?
Fr. J. : Merci à nouveau pour cette importante et fort belle question. Vie et monde déploie en effet une esthétique qui aurait pu donner lieu à un ouvrage autonome, et que je compte bien développer ailleurs. La troisième partie s’ouvre sur la question de l’enfantin et se poursuit par une esthétique, une érotique, une éthique et une politique, impliquant une réflexion sur la civilisation au prisme de la naissance. Le geste premier est d’enraciner la réflexion sur l’artiste et l’expérience esthétique — qui n’est pas nécessairement artistique — dans une phénoménologie de la naissance ; ce qui à l’évidence n’est pas un geste commun, et appelle une justification. Tout d’abord, la naissance possède une charge esthétique et l’esthétique une puissance natale, mais ce n’est pas directement l’objet de votre question ; focalisons-nous dès lors sur l’artiste. Effectivement, une archéologie de l’artiste est mise en œuvre, et vous avez raison, ma question n’est pas pourquoi y-a-t-il des artistes, mais plutôt pourquoi les hommes désirent-ils créer ? Et donc parfois ils deviennent des artistes, la question portant sur ce devenir sort toutefois du champ de ce qu’il y a à penser dans le cadre d’une phénoménologie de la naissance. Pourquoi certains hommes deviennent-ils des artistes et d’autres des philosophes, puisque dans les deux cas le désir natal est engagé, et pourquoi d’autres encore transforment-ils le monde en technicien ou en politique, et pourquoi certains hommes sont-ils dévoués, luttant contre les injustices et les souffrances diverses ? Vie et monde montre que, chaque fois, il y va d’une figuration du désir natal, mais ce qui préside au devenir existentiel est largement énigmatique. Il y a des facteurs sociologiques et idiosyncrasiques qui interviennent, cette chimie existentielle demeurant néanmoins largement opaque, et il n’y a pas à désirer la transparence intégrale en la matière : c’est de toute façon impossible et ce serait paradoxalement désirer dissoudre l’homme en une formule.
Une archéologie de l’artiste suppose alors de comprendre pourquoi certains hommes désirent créer et y passer leur vie entière : elle se limite donc à une exploration de la logique propre à la création afin d’en effectuer la genèse. Dans ce cadre, on découvre que l’acte de créer est appelé par l’événement de la naissance : l’artiste — l’homme qui le devient — aspire à créer des apparences sensibles qui préservent l’intimité cosmique et charnelle, et livrent un milieu en lequel se fondre, une altérité intime où les forces du monde rayonnent. Mieux peut-être : la création plonge dans la fécondité comme atmosphère selon un unisson-de-création qui se prolonge dans le spectacle esthétique où le soi est atmosphérisé à la mesure du monde ressenti. La création est la manière qu’a l’artiste de sentir, et donc d’exaucer le désir natal d’une communion cosmique. De façon tout à fait étonnante, dans l’acte de la création, l’artiste devient lui-même, il conquiert son style singulier en le mettant en œuvre — bref, il naît au monde comme une vie singulière — et, simultanément, créer, c’est dénaître par conjuration de la finitude — selon la formule que vous citiez, donc par suspension de la séparation existentielle au profit d’un unisson au sein de la création, c’est-à-dire selon l’atmosphère de fécondité qui en procède. Il n’y a pas deux mouvements — l’un d’ipséisation et l’autre d’atmosphérisation — car c’est en créant selon un certain style, donc en advenant comme un artiste singulier, qu’il baigne dans le monde en exauçant le désir d’inimité cosmique (ce qui justifie aussi la réflexion sur création et nostalgie). L’expérience créatrice est dès lors l’occasion d’un ravissement, bien qu’il soit inséparable des affres du travail, l’exigence étant pour l’artiste d’être à la hauteur du monde qu’il cherche à faire éclore.
Ch. B. : J’aimerais pour terminer notre entretien vous questionner sur un autre versant de votre ouvrage. À partir du §21 (Partie 3, ii. Vivre natalement), vous proposez une réflexion sur l’expérience amoureuse, laquelle vous conduit à interroger la différence des sexes. Après bien des précautions oratoires salutaires — il est question « de rompre avec les approches idéologisées qui s’en tiennent à la différence entre le sexe masculin qui pénètre et le corps féminin pénétré », « [il] s’agit de ne pas ériger l’érection et la pénétration en paradigme implicite de l’acte sexuel[19] », il y a lieu de se désoler du « déni impressionnant de l’érotique féminine[20] », il faut se libérer « d’une perspective hétéro-centrée[21] » —, ne retombez-vous pas dans les travers que vous dénoncez, 1/ en interrogeant la sexualité à partir de la sexualité hétérosexuelle[22], 2/ en comprenant cette sexualité à partir de la dualité homme pénétrant/femme pénétrée — soit depuis la pénétration —, 3/ en identifiant le sexe (femelle/mâle) avec le genre (féminin/masculin) — la « masculinité », c’est-à-dire le mâle, est reconduit à la « virilité », c’est-à-dire au masculin ; le « féminin », c’est-à-dire la femelle, est reconduite à la « féminité », c’est-à-dire au féminin —, 4/ et en essentialisant les genres : « la masculinité est une façon d’exister cette dynamique qui oscille entre la tendresse de l’intimité et l’aventureuse virilité » ; « le féminin est une certaine manière d’allier la féminité et la tendance voyageuse des désirs qui parcourent le corps de l’amant ou de l’amante[23] » ?
Fr. J. : Il s’agissait d’aborder simultanément le phénomène érotique et la question du masculin et du féminin depuis le phénomène de la naissance. Ce phénomène possède en effet une puissance heuristique décisive en matière anthropologique, conjurant l’alternative ruineuse entre un universel humain abstrait et ses particularités dites empiriques. Or, la phénoménologie — et plus largement la philosophie —, éprise de l’universel, s’attache précisément à une eidétique perdant la facticité de l’existence. Il est vrai que Husserl lui-même se montre beaucoup plus nuancé, ce qu’atteste l’inflation des problèmes génératifs dans son œuvre (Claudia Serban y insiste remarquablement). Mais l’essentiel est ici que le phénomène de la naissance situe d’emblée en deçà de l’alternative entre le transcendantal et l’empirique, ce qui suppose de faire l’archéologie de notre existence : l’empirique n’est plus mystérieusement accolé au transcendantal, il participe de son devenir, si bien que, répétons-le, cette conceptualité est insatisfaisante, elle est marquée par un dualisme intenable. Voilà pourquoi il s’impose d’édifier une anthroponatalogie, les déterminations concrètes de l’humain — qui sont des nataux — adviennent progressivement et potentialisent l’ouverture au monde, elles viennent gonfler le transcendantal, le flanquer de facettes nouvelles. Or, le masculin et le féminin relèvent de cette archéologie qui se situe aux antipodes de tout essentialisme, et ils se cristallisent durant l’enfance. Par ailleurs, la dynamique de notre existence témoigne de la polarité signalée de l’intime et de l’aventureux, étant entendu qu’il y a aussi de l’aventureux à creuser l’intime et que toute l’exploration du monde engage une intimisation. La différence masculin-féminin s’inscrit dans cette oscillation, elle n’a rien de figé, et les femmes témoignent aussi bien d’une dynamique d’intimisation que d’une érotique aventureuse dans les caresses, les baisers ou encore les mouvements de pénétration auxquels elles peuvent s’adonner. Quant aux hommes, ils sont toujours susceptibles d’être portés par une érotique caressante, par un effleurement sensuel où l’aventureux peut également se glisser dans l’intimité d’un mouvement. Autrement dit, la description ne se moule pas selon les catégories du féminin et du masculin comprises préalablement, celles-ci sont au contraire retravaillées depuis le mouvement éclosif de notre existence. Il ne s’agit pas en effet d’ériger la pénétration en paradigme implicite de l’érotique ni toutefois de méconnaître que le sexe masculin est pénétrant et le sexe féminin enveloppant d’abord, et voilà pourquoi l’érotique phénoménologique réfère la différence masculin-féminin à cette différence charnelle. Une double restriction s’impose néanmoins. D’une part, cette différence est subordonnée à la dynamique natale évoquée, oscillant de l’intime à l’aventureux, qui caractérise aussi bien les hommes que les femmes, leur sexe accentuant de façon privilégiée l’une ou l’autre de ces tendances, sans que cette accentuation n’implique une prescription. Ce qui conduit à notre seconde remarque : l’érotique engage tout le corps, traversé par ces tendances qu’il peut réaliser diversement (selon des sensualités plurielles), et l’érotique féminine est une figuration singulière de la polarité existentielle. Il est vrai en revanche que j’envisage l’érotique depuis une sexualité hétérosexuelle, mais une phénoménologie de la naissance pourrait tout à fait nourrir une réflexion sur l’homosexualité, d’autant qu’elle met en évidence la plasticité de l’humain.
Le péril encouru par certaines options théoriques contemporaines est de nihiliser le corps, de céder aux facilités du neutre. Or, le corps n’est pas rien, il doit toutefois être ressaisi selon une archéologie de la naissance, ce qui revient à élargir et à dynamiser les notions du féminin et du masculin, sans gommer leur stylistique corporelle. On le voit, le corps n’est pas le fil conducteur de cette érotique, ni de l’anthropologie philosophique prise dans son ensemble, les traits du corps étant diversement enrôlés par les tendances natales. Il est tout à fait vain néanmoins d’abandonner les concepts du féminin et du masculin, et il est possible de les saisir sans nulle essentialisation (en outre, je n’use pas de la distinction mâle/femelle que vous mentionnez dans votre question). Par ailleurs, Dufrenne — qui est ma seule source ici — met lui-même sur la voie d’une érotique phénoménologique[24], il manque toutefois largement son inscription dans une anthroponatalogie, la vie érotique étant une façon de naître au monde comme tel et de s’ipséiser à la mesure — paradoxalement — de l’intimité conquise avec un autre. Cette phénoménologie découvre le sens de l’Éros dont les palpitations puisent dans notre élan natif vers le monde qui s’exauce largement dans l’érotique, mais c’est aussi la puissance propre de l’art, de la philosophie et de la politique d’une autre manière.
***
[1] Frédéric Jacquet, Vie et monde. Une philosophie de la naissance, Paris, Hermann, coll. « De visu », 2023, p. 15.
[2] Et Henri Michaux écrit à propos de l’enfant : « Téter, embrasser le monde et puis dormir » (Les Commencements, Paris, Fata Morgana, 1983, p. 37).
[3] Selon la formule d’Henri Lefebvre, qui s’interrogeait à ce propos.
[4] Emmanuel Levinas, De l’existence à l’existant [1947], Paris, Vrin, 2004, p. 98 et p. 102. Il écrit : « L’impossibilité de déchirer l’envahissant, l’inévitable et l’anonyme bruissement de l’existence se manifeste en particulier à travers certains moments où le sommeil se dérobe à nos appels. On veille quand il n’y a plus rien à veiller et malgré l’absence de toute raison de veiller. Le fait nu de la présence opprime : on est tenu à l’être, tenu à être. On se détache de tout objet, de tout contenu, mais il y a présence » (ibid., p. 109). Ou encore : « Le frôlement de l’il y a, c’est l’horreur » (ibid., p. 98). Pour la différence capitale avec Heidegger, voir p. 102. Il nous faudrait aborder la réduction phénoménologique telle que la pratique Levinas, c’est-à-dire dans sa figure hyperbolique : ce n’est plus l’être au monde qui caractérise le sujet dont l’individuation consiste alors dans le rapport entre l’existence et l’existant (voir aussi Le Temps et l’autre [1946-1947], Paris, Puf, 1998, p. 24-38). C’est là précisément ce qu’une phénoménologie de la naissance conteste, mais une analyse plus précise s’imposerait, la pensée de Levinas étant d’une extrême subtilité : nous le développerons ailleurs (voir aussi la note 6 ici même).
[5] Nous ne cédons nullement à ce qu’Emmanuel Falque appelle le « tournant irénique de la phénoménologie » (Hors phénomène. Essai aux confins de la phénoménalité, Paris, Hermann, coll. « De Visu », 2021, p. 13-14, et « Hors phénoménologie ? L’hypothèse d’une extra-phénoménalité », Alter. Revue phénoménologique, Hors-série, 2023, p. 193-196) ; une phénoménologie de la naissance fait droit aux différentes figures du négatif (Vie et monde y insiste, certes furtivement), mais le trauma ne saurait livrer la vérité de l’humaine condition ni le secret de l’ontologie. Cette optique s’avère unilatérale, mettant l’accent exclusivement sur l’horreur de l’être, suivant Levinas, ou sur sa résistance inassimilable. Cette ontologie de la noirceur — qui manque aussi le sens cosmique de la Nuit (voir notre « Phénoménologie de la nuit », essai à paraître dans un recueil consacré à L’Œil et l’oreille de Mikel Dufrenne dirigé par Charles Bobant) — oublie que nous participons du monde, qu’il nous est accordé. Penser selon la naissance situe en deçà de cette distinction entre une ontologie de l’inassimilable et une « phénoménologie enjouée » (« Hors phénoménologie ? L’hypothèse d’une extra-phénoménalité », art. cit., p. 193) : naître, c’est exister dans la différence à l’égard du monde, qui se donne dans l’étrangeté, mais c’est aussi participer du monde, et donc faire l’épreuve d’une intimité avec sa puissance éclosive sans laquelle nul ne saurait vivre.
[6] Une seconde différence majeure à l’égard des analyses effectuées par Emmanuel Falque en découle, et c’est l’idée d’un « noyau de solitude » qui nous apparaît problématique : nous ne nions pas qu’il faille sortir du « privilège absolu de l’altérité sur la solitude » (« Hors phénoménologie ? L’hypothèse d’une extra-phénoménalité », art. cit., p. 214), sans pourtant la penser comme un noyau, une « écorce infrangible et impossible à concasser » (ibid., p. 214-215 ; Hors phénomène, op. cit., p. 393-451 ; voir Levinas, Le Temps et l’autre, op. cit., p. 21 : « On peut tout échanger entre êtres sauf l’exister. Dans ce sens, être, c’est s’isoler par l’exister. Je suis monade en tant que je suis. C’est par l’exister que je suis sans portes ni fenêtres, et non pas par un contenu quelconque qui serait en moi incommunicable. »). Que nul ne puisse sentir ou vivre à ma place, accomplir mon œuvre d’exister, est une évidence qui, cependant, n’implique pas que nos vies soient impartageables. Ou plutôt, s’il est vrai que, comme l’écrit en outre Levinas — dans la lignée duquel s’inscrit Emmanuel Falque —, « je ne suis pas l’Autre », il ne l’est pas que « [j]e suis tout seul » (Le Temps et l’autre, op. cit., p. 21). Au contraire, la naissance d’un soi s’effectue sur fond d’une communication originaire et naître à soi suppose l’éveil d’une intimité partagée, qui est aussi une cosmo-intimité : nos analyses le montrent ici même. On le comprend, ce n’est dès lors pas un hasard si Levinas décrit le phénomène de la maternité — dans Autrement qu’être et au-delà de l’essence (publié d’abord en 1974, rééd. Paris, Le livre de Poche, 1990, p. 121-122, p. 176-187) — sous la figure de l’otage. Il manque à nouveau la dynamique de co-naissance en quoi cette relation consiste, à savoir l’éveil de l’enfant selon le portage qui est aussi un éveil de la mère à la maternité dans son ambivalence, d’ailleurs à géométrie variable. Elle est en effet marquée par l’épreuve d’une pesanteur charnelle, susceptible d’être ressentie comme un fardeau existentiel, mais la maternité peut également instiller le sentiment d’une légèreté expansive et d’une communion avec la puissance éclosive du monde. Il est en tout cas symptomatique que le mouvement de co-naissance propre à la maternité échappe à Levinas, ainsi que son historicité : naître au monde, c’est devenir capable de monde au singulier et pouvoir dès lors porter une autre vie dans sa fragilité qui, de ce fait, s’éveille à son tour et s’engage en cette voie relationnelle. Notre phénoménologie de la tendresse, doublée d’une éthique de la fragilité, le développe, et plus largement une pensée de la civilisation en découle.
[7] Frédéric Jacquet, « La vie végétale — Une éclosion aérocosmique », in Esquisses phénoménologiques, Bucarest, Zeta Books, 2021, p. 188, note 14.
[8] Notons que Jean Vioulac pense d’une manière originale la différence anthropologique, et opère admirablement un diagnostic sur l’époque. Une confrontation avec son œuvre devrait toutefois avoir lieu : nous ne définirions pas l’homme en tant que néganthrope (voir notamment Métaphysique de l’Anthropocène. Nihilisme et totalitarisme, Paris, Puf, 2023, p. 11 sq.). Cette caractérisation nous semble unilatérale, perdant l’impulsion cosmo-intime qui est aussi celle des hommes et que découvre une phénoménologie de la naissance. De cette différence découle une divergence quant à ce qui pourrait nous libérer du nihilisme.
[9] Frédéric Jacquet, Vie et monde, op. cit., p. 55.
[10] Après des remarques fort élogieuses, précisant que ma thèse « excède largement le cadre d’un travail strictement historique et constitue un authentique ouvrage de philosophie », Renaud Barbaras écrivait dans le « Rapport sur la thèse de doctorat » relatif à Vie et existence : « Je voudrais engager la discussion avec vous sur le terrain où vous l’engagez avec moi, qui est celui des contours qu’il faut donner à une phénoménologie de la vie digne de ce nom. Je veux vous dire que certaines de vos objections et suggestions, qui se basent sur mon livre de 2008 [il s’agit des objections que j’adressais à Introduction à une phénoménologie de la vie], anticipent des développements que vous ne pouviez connaître puisqu’ils s’ébauchent dans mes deux derniers livres, tout récents [L’Ouverture du monde. Lecture de Jan Patočka, Chatou, La Transparence, 2011, et La Vie lacunaire, Paris, Vrin, 2011], et seront élaborés de manière systématique dans le prochain [Dynamique de la manifestation, Paris, Vrin, 2013]. En vous répondant, je rends évidemment hommage à l’acuité de votre lecture mais je clarifie aussi certaines de mes positions et peux ainsi, en retour, clarifier certains de vos présupposés » (p. 1 et p. 3). Et Renaud Barbaras indiquait le grief qu’il adressait à Vie et existence, et qui tient à « l’hypothèse d’une dissolution cosmique, autre nom (un peu surprenant) de ce qu’il [Patočka] appelle quant à lui expulsion ». Or, ajoutait-il, sur le plan du monde, « rien […] ne permet de comprendre la scission dont procède la subjectivité ». Autrement dit, Renaud Barbaras me reprochait de confondre le niveau « métaphysique » de la réflexion avec le « niveau cosmologique » (« Rapport sur la thèse de doctorat », p. 4). Sa critique consonne avec celle qu’il énoncera dans sa Préface à mon ouvrage sur Patočka (voir la note 12 ici même), l’aporie venant selon lui de ce que la séparation dont il est question demeure dans ma perspective inscrite dans le mouvement du monde. La tâche était bel et bien de dépasser à la fois le dualisme et le monisme dogmatiques, et c’est très précisément ce que permet une phénoménologie de la naissance. Ce sont les analyses barbarasiennes qui restent en vérité tributaires d’un présupposé massif (en 2011 et 2013, comme en 2016) ; en l’occurrence, elles cèdent à un travers dualiste (sous la figure de la distinction entre cosmologie et métaphysique) impliquant une mystique de l’événement. En 2019, Renaud Barbaras renverse à nouveau la perspective, élabore une philosophie de l’appartenance, mais il perd cette fois la possibilité de penser toute différence qualitative, réduite à une variation de degré (ou d’amplitude). Au contraire, une philosophie de la naissance se situe d’emblée en deçà de ce double péril en dépassant l’opposition entre processus et événement, la naissance est l’éclosion d’un événement qui marque l’événement d’une éclosion.
[11] Par conséquent, ce n’est pas en suivant un « geste d’ensemble » barbarasien que j’en suis venu à un approfondissement métaphysique de la phénoménologie. Et d’ailleurs, c’est une voie constitutive d’un certain pan de la phénoménologie qui rassemble Fink, Patočka et Dufrenne, Merleau-Ponty aussi, jusqu’à un certain point. L’élaboration d’une phénoménologie de la naissance m’a permis toutefois de tracer un chemin singulier qu’aucun d’eux n’avait parcouru. Dans « L’archéologie de la finitude. Renaud Barbaras et Mikel Dufrenne » (in Surpuissance et finitude. Renaud Barbaras aux limites de la phénoménologie, dir. A. Dufourcq et K. Novotny, Paris, Vrin, à paraître en 2023), tout en menant une confrontation entre Dufrenne et Barbaras (montrant que la lecture téléologique de l’œuvre dufrennienne est partiale et réductrice), je reviens de façon détaillée sur les apories propres à Introduction à une phénoménologie de la vie, mais je ne pouvais alors qu’esquisser la voie qui est la mienne, celle d’une phénoménologie de la naissance, dépassant leur perspective respective.
[12] Renaud Barbaras écrit dans sa Préface à Patočka. Une phénoménologie de la naissance (Paris, CNRS Éditions, 2016) que la naissance, en tant qu’elle est une séparation qui conserve l’appartenance, ne saurait se confondre avec « l’ouverture de la distance corrélationnelle » qui n’est donc pas de « l’ordre de la naissance ». Il doute même que cette « séparation qui conserve l’appartenance » soit « pensable » (p. xi). Or, tel est justement la tâche d’une philosophie de la naissance. Voir aussi, à ce propos, la conclusion de mon ouvrage intitulé L’Énergie de l’être. Métaphysique et phénoménologie dans l’œuvre de Mikel Dufrenne, Paris, Les Éditions des Compagnons d’humanité, coll. « Bibliothèque des temps présents », 2023.
[13] Outre L’Appartenance, Renaud Barbaras emploie à nouveau ce concept dans « La tâche de la phénoménologie » (Alter. Revue phénoménologique, Hors-série, 2023, p. 27).
[14] Frédéric Jacquet, Vie et monde, op. cit., p. 162.
[15] Ibid., p. 171 sq.
[16] Ibid., p. 167.
[17] Ibid., p. 263.
[18] Ibid., p. 264.
[19] Ibid., p. 298.
[20] Ibid., p. 299.
[21] Ibid., note 41 p. 300.
[22] « D’abord le sexe masculin peut sembler aventureux par sa pénétration du corps féminin, les femmes apparaissent elles-mêmes davantage vouées à l’enveloppement, leur corps enserrant le sexe masculin » (ibid., p. 300).
[23] Idem.
[24] Et puisque vous m’interrogiez sur l’œuvre de Renaud Barbaras, pour prévenir cette fois une question sur l’érotique qu’il déploie dans son livre de 2016 — Le Désir et le monde —, précisons que mon livre de 2014 (Naître au monde. Essai sur la philosophie de Mikel Dufrenne, Milan, Mimésis, 2014) fixait déjà le cap. En outre, ni Dufrenne ni Barbaras ne perçoivent qu’une dynamique natale est à l’œuvre dans l’érotique, le premier s’en approche il est vrai, mais n’en fait pas le fil conducteur de ses descriptions, ce qui change en vérité beaucoup la donne.








