Frédéric Berland, professeur de philosophie à la Légion d’Honneur à Saint-Denis, est un jeune homme enthousiaste, doté d’une impressionnante érudition, ne pouvant laisser qu’un souvenir marquant à quiconque l’aurait croisé. C’est pourquoi son ouvrage consacré à Descartes1 dans la nouvelle collection « aimer la philosophie » dirigée par Ugo Batini et Guillaume Tonning apparaît comme un texte fort singulier parmi les études cartésiennes ; plein de verve, voire d’exaltation, il propose un Descartes néoplatonicien de bout en bout, pensé à partir des textes hermétiques d’une Renaissance finissante mais innervant l’âge classique sur le point d’éclore, passant outre toutes les interprétations qui avaient bien souvent distingué le Descartes scientifique du Descartes métaphysicien afin de ne plus voir dans le cartésianisme qu’une certaine forme de spiritualisme pensée dans la continuité de Brunschvicg.
A : Le projet interprétatif
Afin de comprendre l’enjeu du livre et les intentions de l’auteur, nous allons longuement citer l’auteur en vue de comprendre plus précisément le dessein de cet inclassable ouvrage :
« Ce n’est donc pas sans crainte que nous nous avançons nous-mêmes sur la scène des études cartésiennes afin d’imaginer notre propre fable, un Descartes à notre mode. Pour le dire en une phrase, notre perspective, qui était encore dominante au début du XXè siècle, est celle du spiritualisme de Brunschvicg, qui n’hésita pas à s’engager dans une voie qu’il est possible de qualifier, malgré les réserves qu’il put formuler à l’égard de ce terme, de néocartésienne. Si ce courant interprétatif a quasiment disparu aujourd’hui au profit d’une lecture soit scolastique, soit matérialiste de Descartes, un tel point de vue nous semble néanmoins toujours philosophiquement fertile en ce qu’il nous permet de saisir l’unité d’une pensée en nous aidant à comprendre comment s’y articulent le rationalisme le plus strict où s’annonce le positivisme français sans pourtant se réduire à un atomisme naturaliste, et une philosophie de la conscience où la question de la liberté nous propose de cheminer en direction de ce que nous nommerons la puissance de l’esprit. Cette puissance, à partir de laquelle s’établit en nous et sans nous la frontière entre le fini et l’infini, constitue la trace au sein du Moi de l’impersonnel dont il procède et auquel, dans le même mouvement il se convertit.
L’inflexion néoplatonicienne de ce geste dont nous tenterons de mettre en évidence ce qui a pu la motiver dans les textes où elle apparaît de manière plus nette, pourrait ainsi nous offrir le moyen de comprendre dans quelle mesure Descartes fut un relais crucial dans la transmission des problèmes de la création continuée, de la causa sui, de la liberté d’indifférence et de l’union de l’âme et du corps. »2
Séduisante par son audace, rassurante par ses prédécesseurs3, une telle proposition interprétative n’a aucune raison d’être refusée a priori ; néanmoins, elle doit tout de suite amener à comprendre que l’ouvrage ne constitue pas, à proprement parler, une présentation de la pensée cartésienne mais bien plutôt une interprétation de celle-ci selon le « mode » de Frédéric Berland, comme le dit fort bien l’auteur. En outre, l’ouvrage ne saurait être destiné aux débutants : il présuppose une connaissance certaine des thèses néoplatoniciennes – notamment celles de Proclus – ainsi que des problèmes mathématiques se posant à l’aube du XVIIè siècle.
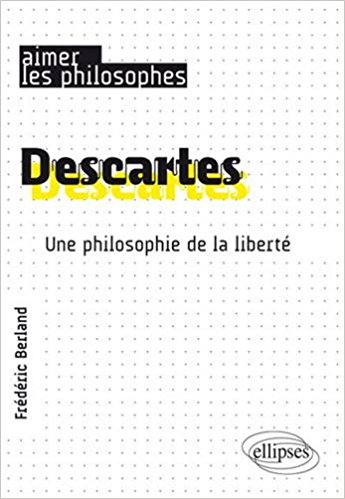
C’est pourquoi, en dépit de l’indéniable brio de l’ouvrage, on peut se demander s’il s’inscrit dans la bonne collection car cette dernière envisage de présenter sous forme didactique les grandes philosophies, et non de livrer une interprétation érudite de celles-ci. Il s’agit donc d’un essai au sens le plus noble du terme, et non d’un ouvrage d’initiation à la pensée cartésienne, qui fera le bonheur du cartésien averti mais non celui de l’étudiant de licence ou de classes préparatoires qui voudrait découvrir la pensée cartésienne.
B : Néoplatonisme cartésien ou interprétation néoplatonicienne de Descartes ?
Une première analyse doit être menée de la méthode observée par l’auteur ; le fait est que Descartes est avare de références et que, quelle que soit la tradition à laquelle on souhaite le relier, il est toujours difficile d’y trouver de solides preuves textuelles. Ne se réclamant de presque personne, Descartes avance en effet fièrement, gommant systématiquement tout élément permettant de l’inscrire dans une antériorité explicite. C’est pourquoi toute interprétation historique du texte cartésien ne peut s’effectuer qu’à partir des concepts mobilisés par l’auteur, concepts dont une généalogie ou une recherche génétique permet, éventuellement, de retracer une provenance plus ou moins certaine.
Faute, donc, de preuves textuelles en faveur d’une structuration néoplatonicienne de la pensée cartésienne à partir de Plotin, Proclus ou Ficin, Frédéric Berland est obligé de supposer un certain environnement intellectuel à partir des maigres indices qu’offre le texte cartésien. Il s’appuie par exemple, et dès le départ sur les Observations, et rappelle qu’il s’inspire de la Magie Naturelle de G. Della Porta que Beeckman affirme avoir lu avec Descartes (AT X, 347) ; ce dernier mentionne d’ailleurs l’intérêt des deux amis pour la Philosophie occulte de Corneille Agrippa qui avait fondé à Avignon et Paris une association dont fera partie Lefèvbre d’Etaples, le plus grand humaniste français du XVIè, et qui écrira les Éléments de musique, traité néoplatonicien. Saluons à cet égard l’auteur pour le rappel de ce fait, bien trop souvent occulté dans l’examen des sources cartésiennes.
Frédéric Berland établit également des correspondances entre certains termes cartésiens et certaines expressions se trouvant également chez les auteurs néoplatoniciens. Tel est par exemple le cas pour la sagesse comparée à une lumière solaire, pour la Mathesis Universalis ramenée à Proclus et à ses Études sur la Providence, ou encore aux notions d’ordre et de mesure déjà présentes chez Plotin.
Arrêtons-nous quelques instants sur cette dernière remarque, et regardons le texte de Plotin : alors que ce dernier vise à justifier contre les gnostiques une certaine forme d’amour du monde sensible en tant que lié aux réalités intelligibles, il veut établir que « le monde reçoit quelque chose de là-bas »4 Menant alors une réflexion sur les sons sensibles, il y voit une certaine manifestation des sons intelligibles, et conclut en ces termes :
« En vérité, si quelqu’un a vu une beauté heureusement disposée sur un visage peut être transporté dans l’intelligible, qui alors sera assez paresseux d’esprit et imperturbable pour voir toutes les beautés que contient le monde sensible, toute la symétrie qui y règne, cet ordre grandiose et la forme que les astres, malgré leur distance, rendent visible, sans s’apercevoir dès lors, saisi d’un pieux respect, que de telles merveilles viennent d’autres merveilles ? Par conséquent, il n’a su ni comprendre les choses d’ici ni voir les réalités de là-bas. »5
Que Plotin évoque la symétrie et l’ordre grandiose des réalités sensibles reflétant les réalités intelligibles pour contrer les gnostiques dévalorisant la matière est une chose, que cela puisse être mis en relation avec l’ordre et la mesure au sens cartésien du terme en est une autre. On voit ici poindre une première difficulté : qu’un lexique puisse être commun n’implique pas nécessairement que le sens contenu en lui soit identique. En effet, l’ordre et la mesure ne sont chez Descartes rien d’autre que des marques de la connaissance de l’esprit, pas des propriétés de l’intelligible manifestées dans le sensible. A cet égard, il nous semble donc que si Descartes partage avec Plotin certains mots en matière d’ordre et de mesure, il n’en partage pas la conceptualité ce qui rend, sur ce point précis, le rapprochement discutable.
Il en va de même pour la notion de Mathesis universalis ; non seulement, les récentes recherches remettent en cause son importance voire sa présence au sein des Regulae mais, de surcroît, à supposer que Descartes l’ait réellement mentionnée, encore faudrait-il justifier pourquoi elle serait dans son esprit plus procléenne qu’aristotélicienne, Aristote ayant employé au moins deux fois l’expression dans la Métaphysique. Or, si l’on est sûr que Descartes a lu et connu les œuvres d’Aristote, il est sans doute plus douteux qu’il ait médité les écrits de Proclus, si bien que l’on ne voit pas bien comment garantir que l’hypothétique présence de la mathesis universalis signifie quoi que ce soit de spécifiquement néoplatonicien.
De manière générale, nous retrouvons la difficulté mentionnée précédemment : comment déterminer une parenté entre deux pensées, comment prouver que telle pensée doit quelque chose à une pensée qui l’a précédée ? En l’absence de mentions explicites, seul peut encore jouer l’ordre conceptuel : mais cet ordre ne saurait se ramener à la présence d’un simple lexème, dont rien ne prouve la charge conceptuelle commune. De ce fait, il nous faut préciser la manière dont nous apparaît le livre de Frédéric Berland : non pas une étude du néoplatonisme présent chez Descartes, mais bien plutôt une interprétation néoplatonicienne de Descartes, proposant de faire comme si l’ensemble de la pensée cartésienne pouvait se lire sous l’angle du néoplatonisme sans que celui-ci ne soit néanmoins prouvable par les sources ni les emprunts.
C : De quoi la « monstruosité » de la quarte est-elle le nom ?
Un élément séminal de l’interprétation que propose F. Berland tient au Compendium Musicae que l’auteur rattache à la tradition néoplatonicienne et à Agrippa ; celui-ci avait fondé à Avignon et Paris une association dont fera partie Lefèvre d’Etaples, le plus grand humaniste français du XVIè, et qui écrira les Éléments de musique, traité néoplatonicien. Or, pour le coup, nous savons que Descartes le connaissait au moins par Beeckman, grâce à une lettre de janvier 1630 adressée à Mersenne :
« Mais je vous jure que du temps que ce personnage se vante d’avoir écrit de si belles choses sur la Musique, il n’en savait que ce qu’il avait appris dans Faber Stapulensis [nom latin de Lefèvre d’Etaples], et tenait pour un grand secret de savoir que la quinte était comme de 2 à 3, et la quarte de 4 à 5, et n’aurait jamais passé plus outre […]. »6
Nous sommes une fois encore face à une difficulté : que Descartes connaisse, au moins indirectement, Lefèvre d’Etaples est un fait avéré ; mais en même temps, le ton persifleur qu’il adopte pour en parler laisse entendre qu’il ne saisit justement pas l’importance pour le néoplatonisme d’inspiration pythagoricienne la si décisive question de la quinte, soit le rapport 3/2. Ainsi que l’a magistralement établi Jean-Noël Duhot dans un ouvrage remarquable, L’énigme platonicienne7, la pensée platonicienne mais aussi le néoplatonisme font de la quinte et du rapport 3/2 la clé voire le code même des mystères de l’Univers. Que Descartes ironise envers ce rapport et envers ceux qui croient y voir un « grand secret » semble indiquer que l’une des clés centrales du néoplatonisme lui échappe.
Il est vrai que Frédéric Berland ne cherche pas tant à montrer que Descartes reprend l’héritage pythagoricien et néoplatonicien des secrets de la quinte qu’à indiquer ce qui lui semble être le lieu précis de sa singularité, à savoir faire de la musique le lieu de l’entrelacement de l’âme et du corps. Par le truchement d’Archytas de Tarente – que Descartes connaissait peut-être par la médiation de La Ramée, et dont il cite la très célèbre colombe dans les Cogitationes Privatae8 –, F. Berland propose d’interpréter le Compendium comme la reprise de la question du rapport entre l’intelligible (mathématique) et le sensible (physique) sous l’angle du rapport de l’âme au corps. Pourtant, il est d’usage de considérer que Descartes en reste à l’aspect physique et au rapport du son à la totalité. « C’est en ce sens, rappelle l’auteur, que l’ouvrage de Descartes est souvent présenté comme pionnier dans la mesure où il serait le premier théoricien à purger complètement l’harmonie de sa croyance mystique dans la puissance des nombres, afin d’orienter la musique vers l’origine la plus fidèle du phénomène sonore et de sa physique. »9 Toute l’interprétation de F. Berland, consistant à montrer que se joue quelque chose de plus que la question physique du son, va se situer dans la dévalorisation cartésienne de la quarte au profit de la quinte. Il est vrai que Descartes affirme qu’ « au nombre 4 la quarte naît immédiatement de l’octave ; ainsi est-elle comme un monstre de l’octave, défectueux et imparfait. »10 Et Descartes d’ajouter, au sujet de la quarte : « Cette consonance est la plus malheureuse de toutes, et n’est jamais utilisée dans les airs sinon par accident et avec le secours des autres. »11.
Tout le problème est de rendre compte de la raison pour laquelle Descartes voit dans la quarte une « monstruosité » et, pour ce faire, F. Berland convoque à nouveau Proclus et le Commentaire sur le Timée, opposant l’esprit et le corps à travers l’opposition du diatonique et du chromatique, l’enharmonique présidant à l’union de l’âme et du corps, et à l’harmonie cosmique. Bien que Descartes n’utilise guère ce vocabulaire et ne développe pas explicitement ce thème, l’auteur considère qu’il « est possible d’interpréter la « monstruosité » et « l’ombre » de la quarte dans la perspective de cette oscillation entre deux pôles : celui de l’esprit et celui de la matière. »12. Aussi stimulante soit cette interprétation métaphysique de l’appréhension cartésienne de la quarte destinée à montrer que les enjeux fondamentaux de la métaphysique cartésienne sont déjà présents en 161913, nous pourrions émettre deux réserves : la première tient au fait que la question de la quarte est une question obsédante de la Renaissance, comme en témoignent les écrits de Zarlino, de Salinas, mais aussi de Papius, si bien qu’il paraît un peu hasardeux de lester une question presque circonstancielle d’un poids métaphysique procléen ; la seconde dérive du texte lui-même : Descartes décrit en effet une expérience sur un luth par laquelle lui est révélée empiriquement la supériorité de la quinte sur la quarte, ce que confirme du reste Beeckman dans son journal (cf. AT X, 52). De ce fait, si l’interprétation de l’auteur est séduisante, elle semble peu probable au regard des circonstances historiques et du cadre en partie empirique de la réflexion cartésienne.
En revanche, il nous semble juste de relier la question des passions à celle de la musique. « Si nous débutons par la théorie musicale de Descartes, c’est que nulle part ailleurs dans son œuvre le contraste entre la clarté physico-mathématique et l’obscurité du domaine des passions n’est saisi de manière plus vive. »14 Mais nous nous permettons d’émettre à nouveau une réserve lorsque ce lien se trouve référé par l’auteur à l’orphisme de Descartes, nous y voyons plutôt la position de Descartes au sein des discussions renaissantes liées au fameux Ut Musica poesis et à la détermination d’une esthétique musicale, ainsi que l’a montré Frédéric de Buzon15.
En somme, nous ne pouvons que saluer la manière dont l’auteur restitue l’importance de la Renaissance dans la formation de la pensée cartésienne, mais nous demeurons sceptique face à la convocation de traités procléens pour rendre compte de ce qui s’explique fort bien par le contexte renaissant et les discussions qui en sont nées.
D : Le problème de la création
Le projet de F. Berland est donc de relire Descartes en montrant que par le néoplatonisme notamment procléen, l’ensemble de la pensée cartésienne se trouve contenue dès le départ dans les premiers écrits, de telle sorte que les grands thèmes cartésiens ne soient jamais que le déploiement de cette intuition néoplatonicienne première. A cet égard, il se trouve contraint de tout référer à un sens néoplatonicien, depuis la mathesis universalis jusqu’à la question des quintes et des quartes, en passant par le problème de l’amour. « Si nous insistons sur cette origine procléenne de la mathesis universalis, c’est qu’elle va nous permettre de mieux saisir l’unité et la cohérence du rationalisme cartésien qui, loin de se dévoyer lorsqu’il fera intervenir les notions de causa sui, de création continuée, de libre création des vérités éternelles ou de providence, ne fera que déployer la systématicité du projet néoplatonicien. »16
Or si nous sommes tout à fait convaincu par l’idée d’une présence d’éléments néoplatoniciens au sein de la pensée cartésienne, ainsi que nous avons nous-même tenté de le défendre à la suite de Thierry Gontier dans Descartes et la précarité du monde, nous doutons que ces éléments fassent système : à cet égard, la question de la création nous paraît interdire la systématicité du néoplatonisme au sein de l’œuvre cartésienne, en ceci que jamais ce dernier ne raisonne, d’une part, selon la conceptualité de la création ex nihilo et que, d’autre part, jamais ne se trouve convoquée chez Descartes la notion de « région de dissemblance » chère aux néoplatoniciens. Si nous reconnaissons donc volontiers avec l’auteur l’importance de la « puissance immense » divine, que nous appelons pour notre part l’ Ens ut potentia qui structure les écrits cartésiens, et qui réfère explicitement à la conceptualité néoplatonicienne en général et plotinienne en particulier, il nous semble que Descartes en tire des conclusions non néoplatoniciennes ; pour le dire autrement, d’un point de départ conceptuel plotinien, Descartes parvient à un résultat très singulier, irréductible au néoplatonisme, réhabilitant la notion de création comme peut-être jamais aucun philosophe ne le fit.
Cette difficulté se trouve dans la gêne que rencontre l’auteur face à la libre création des vérités éternelles : bien que cela s’origine dans l’immense puissance divine, il n’en demeure pas moins que cela débouche sur un acte créateur ex nihilo dont le néoplatonisme ne peut rendre compte à lui seul. Afin de ne pas avoir à assumer la pleine positivité de la création ex nihilo, l’auteur est contraint de réduire la libre création des vérités éternelles à un outil de combat stratégique contre l’analogie et l’univocité, pour n’en retenir que la charge négative : « Ainsi, ce que Descartes refuse à travers sa conception des vérités éternelles, c’est tout ce qui pourrait conduire à une analogie entre l’être de l’homme et celui de Dieu. Cette critique de l’univocité participe d’une critique plus globale de toute dérive intellectualiste. »17. Il n’est pas certain que cette charge polémique épuise le sens de la création des vérités éternelles : cette thèse sert positivement à différencier radicalement Dieu comme créateur volontaire, de tout ce qu’il a créé, à introduire une rupture absolue entre la volonté divine créatrice et la création, rupture totalement étrangère au néoplatonisme qui, non seulement est une pensée de la continuité mais qui, de surcroît, nie toute forme de volonté au fondement de la « création » ; en somme, il nous semble que Descartes utilise une arme néoplatonicienne – l’incommensurable puissance divine – pour la retourner contre le néoplatonisme, et ainsi montrer l’absurdité de la continuité entre Créateur et création, fût-elle éternelle et immuable comme le sont les vérités mathématiques, mais aussi la nécessité de référer la création à une Volonté.
En revanche, nous ne pouvons qu’approuver le rappel de l’inscription néoplatonicienne de la « création continuée » que l’on trouve déjà chez Maître Eckhart ; mais nous ne comprenons pas pourquoi l’auteur évoque la création continuée de Plotin ou Denys, chez qui ces notions sont absentes ; quand bien même pourrait-on penser le passage de l’Un à l’Être chez Plotin selon le lexique de la création, il ne s’agirait en rien d’une création ex nihilo et cette création ne serait pas « continuée » au sens cartésien du terme. Par ailleurs, il y a chez Thomas d’Aquin et Suarez des traces de cette notion de « création continuée », qu’il aurait peut-être fallu citer afin de dialectiser l’origine exclusivement néoplatonicienne du concept.
E : La puissance de l’esprit et l’amour
Cette défense d’une systématicité du néoplatonisme formant le projet cartésien va se heurter à deux autres difficultés que Frédéric Berland va affronter avec beaucoup d’opiniâtreté : la première tient à la mienneté de la pensée, au « je pense » affirmant que c’est bien moi qui pense, qui suis le sujet d’une pensée qui est mienne et que je maîtrise ; cela constitue un élément profondément non néoplatonicien en ceci qu’il n’y a pas de thématisation de ma pensée dans le néoplatonisme. La seconde tient à la volonté au sens cartésien qui renvoie au choix et à l’élection, sens totalement étranger au néoplatonisme pour lequel la volonté désigne prioritairement l’adhésion à la nécessité, la conformité à la nature même des choses, et secondairement la force de celui qui est source de son acte, de son energeia, donc la force de celui que ne vient contraindre aucune nature extérieure (cf. Traité 39). Bref, la subjectivité cartésienne, si profondément incompatible avec le néoplatonisme, pose problème et la thèse de l’auteur ne peut être cohérente qu’à la condition de relativiser, voire de nier, sa présence au sein des écrits cartésiens, entreprise à laquelle s’attèlent les quatre derniers chapitres dans des passages relativement difficiles mais qui constituent à n’en pas douter le sommet spéculatif du livre.
Alors que faire ? Relativiser l’étendue de la subjectivité, mais aussi arracher la liberté de la volonté à la seule question du libre-arbitre, si étrangère à Plotin et à Proclus et finalement parvenir à une certaine impersonnalité de l’esprit à travers sa psuissance. Nous ne pouvons pas ici reproduire dans le détail les analyses complexes de l’auteur mais nous pouvons en indiquer la logique en partant de la fin : l’objectif est de parvenir à établir que l’on a un « débordement impersonnel de la puissance de l’esprit »18, débordement impersonnel qui va être progressivement conquis à partir d’un examen assez original de l’infini.
Comment en effet procéder ? Dire qu’il y a une forme d’impersonnalité de l’esprit, c’est dire que d’une certaine manière se joue par la puissance de l’esprit quelque chose en moi qui m’échappe profondément tout en m’animant. Pour établir cela, l’auteur va montrer qu’il y a comme un prius de la connaissance, et que ce prius est la volonté : avant même de connaître quoi que ce soit, je dois vouloir connaître, puis vouloir douter. Cette primauté du vouloir nous paraît incontestable, ainsi que l’avait d’ailleurs fort bien établi Nicolas Grimaldi dans de très belles pages19. Or, si la volonté est première et, par ailleurs, elle est infinie, alors en elle se joue un élément central de notre propre limitation, elle aussi relevée par Grimaldi : si la volonté est infinie, elle nous place à distance de nous-mêmes, « et nous fait prendre conscience de ce que nous sommes par le manque de ce que nous avons à être. Autant que l’idée de Dieu, nous pouvons donc considérer l’infinité de notre volonté comme l’horizon transcendantal sur le fond duquel se découpe la finitude de ce que nous sommes. »20
Mais, au-delà de ce manque voire de cette finitude que révèle la volonté en tant qu’infinie, se creuse ainsi une sorte d’écart paradoxal du fait même que je veuille : en voulant, d’un côté, je m’apparente à Dieu par l’infinité de ma volonté, mais je m’en écarte également du fait même par la puissance infinie que je ne possède pas. Vouloir, c’est donc être dépassé deux fois par deux formes d’au-delà le premier au-delà est divin, et renvoie à la puissance incommensurable de Dieu. Quoique toutes deux infinies, la volonté divine est infiniment plus puissante que celle de l’homme. Le second au-delà est négatif et s’éprouve dans la liberté d’indifférence lorsqu’il est impossible de déterminer la meilleure option. Ainsi l’ego rencontre-t-il deux limitations, l’une absolue face à l’infinie puissance divine, l’une négative par sa propre impuissance au regard de la connaissance de la meilleure option. L’indifférence divine qui était donc l’expression de la puissance devient expression de la faiblesse chez l’homme.
Mais il faut aller plus loi et se demander qui veut, et ce que signifie vouloir au regard du sujet. Si je dispose en moi d’une volonté infinie, alors au sens propre cette volonté n’est pas vraiment ma volonté, en tant qu’elle est l’universelle image de Dieu ; à cet égard, note l’auteur, il est possible que la volonté excède le champ du sujet et devienne « une puissance de connaître dans l’excès du représentatif. »21 En ouvrant la volonté à une « puissance de connaître », Berland défait le lien entre volonté et libre-arbitre – qui menaçait son interprétation néoplatonicienne – et tisse un thème néoplatonicien rapprochant le vouloir du connaître. N’étant pas uniquement faculté de choix, elle devient « comme une puissance qui me fait connaître de la même manière l’idée de Dieu et l’idée que j’ai de moi-même. »22.
Mais encore faut-il en tirer les conséquences : si la volonté comme infinie est puissance de connaître, et si l’ego est fini, alors cette connaissance n’est pas celle de ce dernier. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une connaissance représentative, réfléchie et médiatisée par l’objet mais bien plutôt d’une connaissance qui outrepasse l’ego et qui semble instaurer un rapport intuitif d’ordre impersonnel. C’est pourquoi Berland va être amené à détruire la médiation et la réflexion pour imposer les droits de l’intuition : « L’idée d’infini sur laquelle repose toute la philosophie de Descartes est au centre d’une expérience absolue qui dépasse toute subjectivité et met en question tout discours. »23 De là cette série de conclusions qui permettent de contourner le « je pense » et, partant, de lever la difficulté initiale : « Ce que met à jour Descartes c’est ainsi un fond infondé de l’âme qui est aussi bien Un au-delà de l’être que le Moi impersonnel au-delà des représentations subjectives, voire le point de convergence de ces deux pôles de l’esprit. La philosophie de Descartes doit ainsi se comprendre comme un abandon des images extérieures qui entravent la connaissance de soi. »24 Bref : « L’idée d’infini ne renvoie donc à aucune objectivation, mais au contraire n’est que l’ouverture à un autre mode de pensée qui, tout en étant non théorique et non représentatif, n’est néanmoins pas pour autant exclusivement pratique. »25
Cette construction est extrêmement stimulante et soulève à nos yeux de très justes questions, notamment celle de savoir qui dispose exactement d’une volonté infinie et donc qui peut faire l’expérience de l’infini par le truchement du vouloir. De même qu’il y a chez Kant une impersonnalité de la raison, justifiant la défiance envers la particularité dans le cadre pratique, de même il y a sans doute chez Descartes quelque chose comme une impropriété de l’ego autour de ce qui concerne l’infini, et ce n’est pas le moindre des mérites de l’auteur que de problématiser cela. En revanche, nous sommes moins convaincu par cette espèce de connaissance « amoureuse » intuitive que décrit l’auteur, et qui découle de son choix herméneutique lui imposant de réduire l’écart entre le Créateur et la création ; l’amour comme forme de connaissance intuitive que thématise le dernier chapitre a des résonances néoplatoniciennes et introduit la continuité que réclame le néoplatonisme. Mais il ne semble pas compatible avec la logique même du cartésianisme qui ne parvient à la connaissance de Dieu que par la médiation de l’idée qui, elle-même, possède une réalité objective dont on voit mal comment elle pourrait se soustraire à l’objectivation.
Conclusion
Nous n’avons pas abordé tous les traits de cet ouvrage extrêmement riche et surprenant de part en part ; ce n’est assurément pas un livre d’introduction à la pensée cartésienne, mais bien plutôt un commentaire très spéculatif, révélant le brio autant que l’érudition de son auteur. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, plusieurs analyses nous paraissent très discutables, et la volonté de systématiser le néoplatonisme au sein du cartésianisme ne nous paraît pas tenable, ne serait-ce qu’en vertu de l’importance de la rupture fondamentale qu’opère Descartes entre le Créateur et la création. De surcroît, bien que Descartes ait sans doute eu très vite un certain nombre d’intuitions existentielles ou métaphysiques – à cet égard, Alquié saisit à nos yeux des choses très profondes –, il est peu probable que tout le programme cartésien soit contenu en germe dans L’abrégé de musique, qui nous semble être bien plus explicable par une série de circonstances que par l’intuition condensée d’un système philosophique.
Néanmoins, cet ouvrage appartient à cette catégorie rare de livres surprenants, stimulants, irritants même, un peu comme put l’être l’étude de Jean Wahl sur le rôle de l’instant dans la pensée de Descartes. S’y laisse contempler la puissance herméneutique du commentateur imaginant une cohérence systématique qui, à défaut d’être toujours convaincante, ne laisse pas d’être admirable. Si certains passages nous semblent franchement indéfendables, notamment concernant la Physique – autant on peut avec Einstein rendre grâces à Descartes d’avoir entrevu la consistance de l’espace, autant il semble impossible de réhabiliter les Vortex comme le fait l’auteur –, bien d’autres soulèvent de vrais problèmes très rarement aperçus ou établissent des analogies fécondes, suscitant la réflexion. Sachons donc gré à cet ouvrage d’ouvrir des pistes, de stimuler la réflexion et plus encore l’imagination.
- Frédéric Berland, Descartes. Une philosophie de la liberté, Paris, Ellipses, 2016
- Ibid., p. 11
- Songeons ici aux études de Pierre Magnard, Jean-Claude Margolin, André Robinet, puis Emmanuel Faye, Thierry Gontier sur les liens entre la Renaissance et Descartes.
- Plotin, Traité 33, § 16, 29, Traduction Richard Dufour, Paris, GF, 2006, p. 231
- Ibid., p 232
- Descartes, Lettre à Mersenne, janvier 1630, AT I, 110-111
- Jean-Joël Duhot, L’énigme platonicienne, Paris, Kimé, 2017
- AT X, 230
- Descartes, une philosophie de la liberté, op. cit., p. 19
- AT X, 105
- Ibid., 107
- Ibid., p. 21
- « L’intuition cruciale qui justifie ce détour par la théorie musicale tient tout entière dans cet entrelacement de l’intelligible et du sensible qui se déploie depuis les « nombres sonores » jusqu’à la relation de l’âme et du corps. Toute la philosophie de Descartes serait ainsi contenue en germe dans le problème que pose cette relation. » (p. 20)
- Ibid., p. 18
- Frédéric de Buzon, « Harmonie et passions. Remarques sur les musicologies de Descartes et Mersenne », in L’esprit de la musique, Paris, 1992, p. 121-126
- Ibid., p. 38
- Ibid., p. 55
- Ibid., p. 146
- cf. Nicolas Grimaldi, L’expérience de la pensée dans la philosophie de Descartes, Paris, Vrin, 2010, p. 108
- Nicolas Grimaldi, Six études sur la liberté et la volonté, Paris, Vrin, 1988, p. 18
- Descartes, une philosophie de la liberté, op. cit., p. 117
- Ibid.
- Ibid., p. 133
- Ibid., p. 146
- Ibid., p. 146








