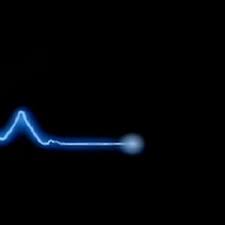Françoise Dastur a fait paraître récemment Figures du néant et de la négation entre orient et occident aux Belles Lettres (collection « encre marine »)1. L’ouvrage se donne pour tâche de remettre en question l’européocentrisme de la philosophie de langue française, d’« accomplir un décentrement par rapport à la pensée européenne » (p. 23) et de défendre une « pensée sans frontières », pour « s’interroger sur cette pensée du néant et de la négation qui traverse aussi bien l’Orient que l’Occident » (p. 29). L’enquête prend l’œuvre de Heidegger pour « référence majeure » et sa pensée « comme point de départ » (p. 29 et 31), parce qu’elle serait pure de tout européocentrisme. L’auteur commence par justifier ce choix dans l’« ouverture » de l’ouvrage, avant de présenter plusieurs pensées du néant marquantes et singulières ou caractéristiques, qu’il appelle pour cette raison des « figures » et qu’il associe à des regroupements de philosophes, issus de la philosophie grecque (Parménide, Gorgias et Pyrrhon), de la tradition bouddhiste (Nāgārjuna et Nishida), de la tradition allemande (Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche) et de la phénoménologie (Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Maldiney).
Dans l’avant-propos, l’auteur dénonce l’européocentrisme de la philosophie de langue française (en particulier l’oubli de l’Inde), auquel elle assigne pour origine « la tradition positiviste française ». Il retrouve la trace de la croyance à la supériorité de l’identité européenne successivement chez Valéry, Husserl, Sartre, Levinas et Merleau-Ponty. Françoise Dastur critique cette illusion de supériorité, en s’appuyant sur l’histoire-monde ou histoire globale, qui connecte les unes aux autres les différentes histoires nationales, afin de reconstituer « le passé commun de l’histoire » (p. 20). Elle justifie la référence à Heidegger par le projet de ce dernier : déconstruire l’histoire de l’ontologie et ainsi de dépasser la métaphysique occidentale, ce qui explique son intérêt pour l’Orient, en particulier le taoïsme et la pensée japonaise. Heidegger valorise l’Occident, qui naît avec la philosophie grecque, mais il critique l’Europe, associée à la métaphysique, qui a oublié l’être. L’Europe doit prendre conscience de cet oubli et se comprendre comme un destin, donc devenir Occident. Celui-ci ne peut pas retourner à son commencement grec, mais l’Europe devrait « s’ouvrir aux rares autres grands commencements » de la pensée (Heidegger, « Terre et ciel de Hölderlin », 1959), qui ont chacun leur propre histoire. Heidegger nous invite donc à dépasser la pensée grecque, « matrice de l’Occident », et à nous ouvrir à l’Orient. Ce qui ne signifie pas adopter le mode de pensée indien, chinois ou japonais, mais entrer en dialogue avec des expériences de pensée qui se trouvent « en dehors de cette invention grecque qu’est la philosophie »2
L’ontologie et la déconstruction de son histoire
Si François Dastur fait débuter son enquête sur le néant par la référence à celui qui passe pour LE penseur de l’être par excellence, c’est que Heidegger a été conduit très tôt à l’idée d’une « ontologie négative ». C’est d’abord la notion de différence ontologique qui la conduit à la conclusion qu’on ne peut penser l’être que comme néant, avant qu’il ne remette en cause cette notion, à partir du tournant (Kehre) des années 30, parce qu’elle dérive d’une interrogation portée sur les étants et leur étantité et risque, de ce fait, de nous faire oublier que l’être est radicalement autre que l’étant. Heidegger insiste alors sur le retrait ou le refus comme dimension de l’être. Puisqu’il n’est pas substance, ni un sujet, l’être ne peut « se donner qu’à travers le déni de soi-même » (p. 40). L’être est différent de l’étant, mais pas réellement distinct de lui, simplement quand l’être se retire, il « se change lui-même en l’étant […] les étants adviennent à la présence ». Loin d’être négatif, le néant est « plus étant que tout étant », parce qu’il est l’ « ébranlement de l’Etre lui-même » (Heidegger, Beiträge zur Philosophie) et pour ainsi dire le moteur de l’Etre. En ce sens, le néant se déploie comme co-appartenance (ou « co-propriation », Ereignis) de l’homme et de l’être.
Lorsque Heidegger nous invite à penser « de façon encore plus grecque ce qui a été pensé de façon grecque » (Acheminement vers la parole), il veut en réalité constituer ce qu’il appelle dans son dernier séminaire une « phénoménologie de l’inapparent », qui a pour tâche de « voir ce qui n’apparaît pas », comme les Présocratiques ont tenté de le faire. Cette phénoménologie prend en vue le fait insigne que pointait Parménide en soulignant que l’étant est, autrement dit « l’entrée en présence inapparente de l’étant » (p. 44). Le néant, c’est avant tout cette lethè, cette « occultation abyssale d’où surgit tout et à laquelle tout retourne » (p. 44).
L’auteur éclaire ensuite la nature de la relation de Heidegger aux Grecs et sa conception « non linéaire » de l’histoire, qui explique son ouverture aux cultures non-européennes. Néanmoins, le dialogue de Heidegger avec l’Orient est indirect et différé, puisqu’il ne peut s’effectuer qu’à l’aide des acquis de la tradition européenne, sur la base d’un dialogue préalable avec les Grecs. Ce qui signifie que, pour l’instant, il s’agit seulement de se préparer au dialogue avec l’Orient. La suite livre quantité de détails sur les relations de Heidegger successivement à la Chine, à l’Inde et au Japon, qui témoignent du réel intérêt du philosophe pour l’Orient.
Être et non-être dans la pensée grecque
La première « figure » aborde la question de l’être et du néant dans la pensée grecque, en particulier chez Parménide, Gorgias et Pyrrhon. Françoise Dastur note que l’être parménidien ne se révèle à l’homme que de façon négative (comme inengendré, impassible, immobile, etc.), ce qui est « une situation semblable à celle de la théologie négative qui ne peut énoncer que ce que Dieu n’est pas » (p. 63). Pour Parménide, la « pensée de l’être et de l’absolu » ne peut « se dire que de manière négative » (p. 64). François Dastur s’appuie alors sur la présentation du Poème par Jean Beaufret, qui considère que ce qui advient dans le Poème, c’est « la transcendance elle-même de l’étant vers son être au sens verbal » 3 Ici « l’épreuve du néant fait […] partie de l’expérience de l’être même » (p. 65). Pourtant choisir l’être revient selon Parménide à exclure immédiatement la possibilité du néant. Finalement l’être parménidien se révèle inséparable des apparences : il est « l’être de l’apparaître » et n’est donc « pas autre chose que les apparences », à la façon dont, pour Kant, chose en soi et phénomène sont deux manières de se rapporter à un même objet.
Gorgias, qui répond à Parménide, dépend de la tradition sophistique, que Heidegger valorise, contrairement à Platon, et qu’il considère dépendante du cadre de pensée des présocratiques, pour lequel être signifie présence et vérité signifie non-occultation – cette ouverture qui seule permet, pour l’homme Grec, l’apparition des phénomènes. Mais Gorgias ne semble pas parvenir à penser l’« occultation primordiale de laquelle émergent les étants » (p. 74). Ignorant que « l’être ne peut se dire sous la forme propositionnelle », il travestit la pensée de Parménide en la transcrivant « en une série de propositions logiques » (p. 77). Là où le Poème traduit la vision de « ce qui demeure inapparent dans la phénoménalité, l’être en tant qu’il se retire pour laisser être l’étant », Gorgias, lui, ne voit pas cette co-appartenance de l’occultation et de la non-occultation. Ce qui fait la supériorité de Parménide, c’est donc qu’il pense « l’être comme autre de l’étant » (p. 79).
Pour ce qui concerne Pyrrhon, François Dastur fait de sa rencontre avec gymnosophistes de l’Inde, qui étaient probablement des Jaïns, l’origine du scepticisme lui-même, en tant que « nouvelle attitude philosophique ». Elle souligne également la ressemblance entre les sâdhus de l’Inde et Diogène de Sinope, dont un élève, Onésicrite, a d’ailleurs accompagné Pyrrhon en Inde, à une époque où elle comptait « de nombreux courants athées et matérialistes, opposés à la doctrine des Vedas », à savoir le jaïnisme, le bouddhisme et le chārvāka, un matérialisme athée. L’auteur souligne les affinités entre le pyrrhonisme et la doctrine jaïniste de la non exclusivité des points de vue (anekāntavāda), qui est une sorte de relativisme. 4
Bouddhisme et négativité
La « figure III » est certainement la plus originale de l’ouvrage, en tout cas celle qui est le plus résolument tournée vers l’Orient, parce que celui-ci se révèle avoir davantage remis en cause la notion d’être que la tradition grecque, scepticisme compris. Après une brève présentation du bouddhisme, ainsi que quelques rappels historiques et définitionnels concernant les religions de l’Inde, l’auteur soutient l’hypothèse d’une origine indienne de la démocratie5 et justifie l’usage de l’expression « philosophie indienne » (p. 98) par la référence à l’art de l’argumentation pratiqué par les écoles de pensée hindoue et bouddhistes. « L’apport le plus fondamental de la pensée indienne » résiderait néanmoins dans l’invention du zéro qui a peut-être été, comme la valorisation du vide et de la vacuité en général, la conséquence de « l’importance accordée à la méditation en Inde et tout particulièrement dans le bouddhisme […] alors que dans l’Occident grec et chrétien, le néant, assimilé au mal, doit être conjuré » (pp. 99-100).
Françoise Dastur rapproche Nāgārjuna de Pyrrhon, parce que son rejet de toute thèse et de tout point de vue rappelle la démarche sceptique et la pratique de l’épokhè. Elle évoque la rencontre entre le bouddhisme et la culture hellénistique qui eût lieu dans les royaumes fondés par Alexandre le Grand et ses successeurs, puis oppose l’ontologie de l’hindouisme à la démarche proprement phénoménologique de l’Abhidharma (la troisième section du Canon bouddhique), qui implique le « même rejet de l’ontologie » que celui qui « est à l’origine de l’épokhè pyrrhonienne et sceptique comme de la « mise entre parenthèses » » husserlienne. La conception nāgārjunienne de la vacuité ne serait que la radicalisation de « cette préoccupation exclusivement phénoménologique ». À l’opposition ontologique de la réalité substantielle et de l’apparence, Nāgārjuna substitue la distinction purement sémantique entre « deux niveaux de signification ou de compréhension », à savoir le plan de la vérité conventionnelle et le plan de la vérité ultime (p. 105). L’idée que la vacuité est ineffable et la remise en cause la croyance aux mots et à la grammaire rapprochent Nāgārjuna de Nietzsche et de Heidegger. Ce dernier rejoint le bouddhisme dans la tentative de « faire venir le silence à la parole », afin que le dire soit « en même temps un taire » (p. 107). 6
Après avoir brièvement évoqué le zen, dont elle souligne également la méfiance envers le langage, Françoise Dastur présente les concepts d’« expérience pure » et de « néant absolu » chez Nishida Kitarô, fondateur de l’école de Kyoto. Pour Nishida, l’homme qui atteint l’Eveil est le « lieu » de « l’éveil à soi du monde », d’une façon analogue à celle par laquelle le Dasein heideggérien est le « lieu de la compréhension de l’être » (Sein und Zeit). François Dastur analyse les reproches de Nishida envers Husserl et Heidegger, puis établit un parallèle entre son intérêt pour certains mystiques occidentaux et la façon dont Heidegger s’est tourné vers Angélius Silesius. Comme la langue japonaise localise chaque chose dans une place (basho) déterminée, « le mode de pensée japonais » se fonde sur la recherche de la cause de la relation des choses à l’environnement. L’analyse de la notion de « lieu du néant absolu » et la référence à celle d’« ainséité » (tathatā) achèvent ce parcours, au terme duquel l’être heideggérien se révèle en définitive analogue à la vacuité bouddhiste.
Du « Rien » kantien à la négativité hégélienne
Par la suite, Françoise Dastur étudie la pensée du néant chez Kant et Hegel. Elle commence par souligner la proximité entre le néant divin chez Maître Eckhart et la vacuité chez Nāgārjuna, puis relève l’influence d’Eckhart et de Jacob Boehm sur l’idéalisme allemand, deux auteurs qui pensent également une sorte de fond sans fond et un néant indéterminé. Après avoir montré comment Herder a réhabilité l’Orient, contre l’« universalisme abstrait de Lumières », et s’est révélé davantage ouvert que Kant à des cultures et des civilisations non-européennes, Françoise Dastur remarque, à la suite de Michel Hulin, que « Hegel fut le premier à « historiciser l’Orient » », mais non sans le réduire à un moment primitif ou archaïque du développement de l’Esprit absolu. Hegel reste prisonnier d’une hellénophilie, en partie partagée par Kant, qui déterminera la réactivation de la question du rien et du négatif.
Conduit à la question du négatif en raison de la nature critique de son enquête, Kant ne parvient cependant pas à sortir de « l’hypothèse de la re-présentation, du re-praesentare, qui fait de l’homme celui qui présente les choses une deuxième fois », après que Dieu les eut créées. Au contraire, Husserl pense la co-présence du sujet et de l’objet et la non séparabilité de l’être et de l’apparaître. Néanmoins en considérant l’objet transcendantal non comme une chose ou un étant, mais plutôt comme une « manière qu’a le monde ou l’être de se retirer », selon l’interprétation de Gérard Granel, Kant semble avoir eu le « pressentiment de la différence ontologique » et avoir pensé authentiquement le néant. 7 Au contraire, Hegel semble consacrer l’oubli de l’être et c’est ce que lui reproche Heidegger : Hegel ne s’interroge pas sur l’origine de la négativité, qu’il ne considère pas comme problématique.
Le nihilisme : Schopenhauer-Nietzsche-Heidegger
Après avoir rappelé l’origine du concept « nihilisme » et l’histoire de ses significations, Françoise Dastur élucide l’interprétation qu’en donne Nietzsche, puis fait retour sur l’influence du pessimisme de Schopenhauer sur ce dernier et sur les rapports de Schopenhauer à la pensée indienne, à une époque où l’Allemagne a su « sortir de l’européocentrisme » et de la « grécomanie » (p. 158-159). Françoise Dastur décrit l’origine de cette « Renaissance orientale », en retraçant les étapes qui ont jalonné l’émergence progressive des études indiennes, puis précise les sources de la connaissance que Nietzsche avait des philosophies orientales. Détaillant ses rapports au bouddhisme, elle indique qu’il le valorise par rapport au christianisme, mais qu’il l’oppose à la manière d’être grecque et au dionysiaque ; qu’il le juge nihiliste ; enfin qu’il lui préfère le brahmanisme. Le bouddhisme trouverait son origine dans la faiblesse de la volonté, caractéristique de la décadence. A la délivrance bouddhique, Nietzsche substitue l’Eternel Retour, qui est la forme suprême du nihilisme et il attend « un nouveau brahmanisme, qui surpasserait ainsi l’ancien » (p. 169).
Heidegger, lui aussi veut surmonter le nihilisme, mais la définition qu’en donne Nietzsche lui paraît insuffisante, parce qu’elle reste liée à la métaphysique de la subjectivité. L’être n’est pas un en-soi séparé de l’homme : l’homme participe à l’être, qui n’est lui-même rien d’autre que « la manière qu’il a de se tourner vers l’homme et de se dispenser à lui » (p. 171). Ce faisant, l’homme participe au néant et au nihilisme. Celui-ci est au fond l’oubli de l’événement de la différence entre être et étant. Mais pour Heidegger, il ne s’agit pas de « dépasser le nihilisme vers une affirmation de l’immanence », ni d’abandonner la métaphysique, plutôt d’assumer le nihilisme, s’approprier la confusion du néant (donc de l’être) avec le rien et recomprendre la métaphysique « sur un nouveau fondement à partir d’un retour à son fondement » (p. 175).
Le néant, le négatif et la phénoménologie
Dans la dernière « figure », Françoise Dastur indique que Husserl a connu la pensée indienne à travers la lecture de Schopenhauer, qu’il a eu des contacts avec le Japon et qu’il s’est vivement intéressé à certaines écritures bouddhiques (celles du Suttapitaka), dont il a recensé une traduction allemande. Elles contiennent selon lui une religiosité non pas transcendante, mais « transcendantale » à proprement parler. 8 Husserl met « le bouddhisme sur le même plan que la phénoménologie transcendantale » et compare et le Bouddha à Socrate. Néanmoins pour lui il n’y a pas de philosophie ni de science indienne ou chinoise : c’est seulement en Grèce que l’idée d’une science universelle a pu naître. Le père de la phénoménologie valorise les Grecs qui ont mis en question la notion d’être, notamment dans le scepticisme antique. C’est la raison pour laquelle Françoise Dastur approfondit ses relations au scepticisme et sa conception de l’épokhè, avant d’analyser le concept d’angoisse et le rapport entre d’une part la négation logique et d’autre part la « négation comme comportement » dans la pensée de Heidegger. Pour ce dernier, le vrai discours (poétique ou philosophique) sur le néant peut tout à fait être contradictoire d’un point de vue logique : « le problème de la négation et de son origine devient ce qui permet de légitimer les droits d’un autre type de pensée que celui de l’objectivisme et du naturalisme » (p. 196). Il est donc possible de refonder la métaphysique, indépendamment de la logique traditionnelle. La « Figure V » s’achève par l’étude de la façon dont la pensée heideggérienne du néant a été reçue et reprise, en France, par Levinas, Sartre, Merleau-Ponty et Maldiney.
Heidegger : la biffure de l’être et la phénoménologie de l’inapparent
La conclusion de l’auteur commence par dresser un récapitulatif des trois étapes majeures de l’évolution de la pensée de Heidegger concernant le néant et la négation. Elle note que la façon dont Heidegger pense la phusis, en s’appuyant notamment sur Héraclite, est proche de la notion bouddhiste de coproduction conditionnée (Pratityasamutpâda) et que sa conception des « mortels » rappelle l’enseignement du Bouddha selon lequel l’homme est impermanent, donc dépourvu de soi (p. 214). Françoise Dastur se tourne également vers le taoïsme pour éclairer l’expérience de ce que Heidegger appelle le monde, l’expérience de la co-appartenance de la terre, du ciel, des dieux et des mortels, parce que cette expérience se refuse à l’Europe, comprise comme « puissance de domination technique et industrielle » (p. 215), alors que le Tao te King, lui, nommerait clairement ces quatre régions du « Cadran » Geviert et leur coappartenance.
C’est sur la figure bouddhiste de Nāgārjuna que s’achève l’ouvrage, dont la conclusion compare la bodhi à l’« éveil pour l’appropriement (Ereignis) » dont parle Heidegger, qui consiste à faire retour, grâce au mode de pensée tautologique (« l’appropriement approprie »), vers « là où nous sommes toujours déjà, écrit Françoise Dastur, et où a lieu de manière inapparente […] la venue à la présence en tant que telle » (p. 216). L’éveil pour l’Ereignis est indissociable d’un « éveil hors de l’oubli de l’être » (Heidegger, « Temps et Etre »), qui consiste à assumer cet oubli comme notre héritage commun, plutôt que de chercher à le dépasser ou le transcender. Cette assomption (Verwingund) rappelle le rejet, par Nāgārjuna, de l’opposition entre saṃsâra et nirvâna, qui ne se distinguent que par « la manière donc chacun s’oriente par rapport à eux » (p. 218). A la façon dont le philosophe indien refuse à la vacuité elle-même toute existence autonome, Heidegger considère que le dépropriement est « le phénomène le plus originel […] le fond sans fond de l’être, son abîme (Ab-grund) », puisqu’il est le cœur de l’appropriement, de même l’occultation est le cœur de l’alètheia (p. 218). Françoise Dastur associe les « mortels » dont parle Heidegger, qui ont renoncé à la connaissance de l’absolu, à l’Eveillé qui demeure volontairement dans le saṃsāra, autrement dit le « bodhisattva », terme qui eut d’ailleurs pu être heureusement traduit par « l’être (sattva)-pour-l’Eveil (bodhi). Enfin la pensée tautologique, c’est-à-dire le retour vers là où nous sommes, par la saisie du « processus inapparent qui est à l’origine de tout apparaître », rappelle la vacuité de tous les phénomènes, inexprimable « par le langage, si ce n’est au moyen d’un usage paradoxal ».
Méthode et traitement des sources
Dans Figures du néant et de la négation, l’auteur livre peu de renseignements sur la méthode qu’il utilise. Celle-ci relève plus d’une démarche comparative heuristique que d’une étude comparée des sources textuelles occidentales et orientales. L’auteur semble donc vouloir d’abord mettre la pensée de Heidegger et de philosophes apparentés en regard de certaines philosophies orientales. Néanmoins il suggère aussi, parfois, l’existence d’un fonds de sagesse commun indo-européen, sans tenter pour autant de le restituer en tant que tel. Seule la pensée de Heidegger fait l’objet d’analyses comparatives, celle des autres philosophes donne plutôt lieu à une histoire de la réception de la pensée orientale en Occident, ou parfois à celle de la pensée occidentale en Orient.
Le lecteur pourra regretter l’absence de bibliographie et de certaines références qui auraient été pourtant utiles[Par exemple, pour la comparaison entre Heidegger et Nāgārjuna : Joseph S. O’Leary, Philosophie occidentale et concepts bouddhistes, P.U.F., « Collection de métaphysique », Chaire Etienne Gilson. [Cf. notre recension. Pour la comparaison entre Nietzsche et le bouddhisme : Robert G. Morrison, Nietzsche and Buddhism, A study in nihism and ironic affinities, Oxford University Press, 2002).[/efn_note]. Inversement, certaines références semblent peu fiables, comme La volonté de puissance, attribuée à Nietzsche. Le traitement des sources doit également faire l’objet de certaines réserves. Leur étude ne prétend certes pas être historique et philologique, mais avant tout philosophique et herméneutique. Qu’on ne s’attende donc pas à trouver une argumentation fondée sur une analyse philologique minutieuse, car ce n’est pas la priorité de l’auteur. Le peu de cas fait à la méthode historico-critique le conduit souvent à considérer l’ensemble des sources d’un point de vue synchronique et parfois à décontextualiser certaines citations ou à effacer leur histoire rédactionnelle, lorsqu’il ne passe pas indifféremment d’une école de pensée à une autre9. Les références de certaines citations sont trop vagues (« dans un fragment de 1887 […]. Et l’année suivante, il précise », p. 164) ou parfois pas du tout indiquées (p. 165, p. 168, ou encore p. 180, en ce qui concerne la comparaison entre Socrate et Bouddha établie par Husserl)10 Le Milindapañha est considéré comme « un des livres canoniques du bouddhisme » (p. 103), alors qu’il n’est ni canonique, ni extracanonique, mais paracanonique.
Les sources s’étalent de l’Antiquité grecque ou indienne à l’époque contemporaine, en cohérence, certes, avec le parti pris en faveur de l’histoire globale (ou l’histoire-monde, histoire connectée), une « nouvelle manière, non européocentrée, d’écrire l’histoire » (p. 20), issue des travaux de Kenneth Pomeranz. L’auteur se rallie également à la conception non linéaire de l’histoire que propose Heidegger, comprise comme histoire de l’oubli de l’être en Occident, sans néanmoins s’interroger sur l’existence éventuelle de cet oubli dans la pensée orientale. Il y a bien eu pourtant un certain oubli de la vacuité, par exemple chez les premiers bouddhistes chinois, qui ne comprenaient cette notion qu’à travers des concepts taoïstes, tels que le concept de wu (« non-existence »).
Lorsqu’il indique que Gorgias « transcrit le « poème » parménidien en une série de propositions logiques », l’auteur évoque « tout un appareillage logico-technique » (p. 77), sans néanmoins expliciter ou préciser davantage sa nature. Il semble tenter de concilier, tant bien que mal, l’hypothèse d’une telle transcription déformante avec la symétrie qui fait du Traité du non-être « l’image dans le miroir » du Poème, comme l’a bien vu Barbara Cassin. A chacun alors de juger si Gorgias manque d’apercevoir la profondeur d’un poème qui porterait sur la co-appartenance de l’occultation et de la non-occultation, ou bien si, au contraire, il comprend adéquatement un discours qui a peut-être une autre signification que celle-là seule que lui donne Heidegger.
François Dastur attribue à Parménide la paternité de la métaphore du chemin, qu’elle érige laconiquement en « métaphore fondatrice de l’Occident » (p. 60). Cette affirmation massive reprend vraisemblablement à son compte le travail de Bruno Snell, cité peu après11 Snell a pourtant montré que la métaphore était déjà présente chez Homère ! Et pour lui « c’est Hésiode (Travaux, 287 sq.) qui a établi et rendu célèbre l’image du chemin ». Si Françoise Dastur s’accorde avec lui sur la nouveauté de la pensée parménidienne, elle ne saisit néanmoins pas l’occasion de souligner l’importance de l’image du chemin en Orient, qu’il s’agisse du sentier (magga) bouddhiste ou de la voie (dao) taoïste. Pas plus qu’elle ne semble apercevoir l’origine indo-européenne de l’image (pourtant évoquée pp. 62, 63 et 68) du char guidé par les déesses, par laquelle s’ouvre le Poème de Parménide.
En guise de méthode comparative, l’auteur se contente essentiellement de ressemblances, d’analogies et de parallélismes plus ou moins contextualisés, d’une façon qui peut paraître souvent réductrice : les concepts ou les auteurs comparés sont « en concordance » (p. 216), « en consonance » ou « semblable[s] » (p. 219), « tout proches » l’un de l’autre (p. 218, cf. p. 70), « dans une certaine proximité, en dépit de l’écart qui les sépare » (p. 211). En somme, l’auteur paraît s’enfermer dans un comparatisme analogique qui laisse peu de place au comparatisme différentiel, auquel seule la conclusion fait une allusion dont chacun aura le loisir d’évaluer la profondeur : « proximité, certes, mais dans l’écart, la diversité des voies, propre à la finitude et à l’historialité humaines, demeurant entre Orient et Occident, heureusement irréductible… » (p. 219).
A plusieurs reprises, l’auteur fait l’effort louable de livrer un certain nombre de précisions historiques, qui s’accompagnent aussi, malheureusement, de quelques imprécisions, manifestement involontaires. Victime d’ancestraux contresens, pourtant dénoncés par André Bareau il y a déjà maintenant 30 ans, Françoise Dastur fait naître le Bouddha à « Lumbini » (p. 83) et non pas à Kapilavastu ! Confondant le pāli avec le dialecte māgadhi, elle le tient à tort pour « la langue que parlait le Bouddha […] une des langues populaires ou prâkrit parlées en Inde à cette époque » (p. 95).
Gérard Granel aurait publié un article (« Le Chinois de Königsberg ») en… 1787 (p. 129) et Schopenhauer serait l’héritier de penseurs allemands « du début du XXe siècle » (p. 158).
L’usage de l’expression « théologie négative » est malheureux, puisqu’il n’y a pas une « théologie négative », seulement une via negativa, une voie apophatique qui intervient à l’intérieur d’un processus que Denys dit le Pseudo appelle la « théologie mystique ». Quant à la révolution introduite par Kant en philosophie, elle ne consiste pas à supposer que le sujet « tourne autour des objets » (p. 124), puisque Kant se réfère aux « premières idées de Copernic », qui concernent le mouvement diurne (journalier) de la terre, c’est-à-dire sa rotation autour de son propre axe et non pas son mouvement annuel autour du soleil. Il ne s’agit donc pas de décentrement, de destituer la terre de sa position centrale, mais d’attribuer le mouvement apparent à l’observateur plutôt qu’au ciel observé, comme Kant attribue la règle de l’objet à la connaissance plutôt que la règle de la connaissance à l’objet.
Les traductions utilisées sont parfois datées, notamment dans le cas de Nietzsche. Si les traductions personnelles ou modifiées ne sont pas arbitraires, mais au contraire pertinentes au regard de la théorie démontrée, certaines posent néanmoins problème, lorsqu’elles ne font pas sens (« nos langages occidentales », p. 105), ou lorsque leur choix fait fi de toute critique interne, comme quand le titre de « Bouddha » devient un prénom (p. 180 et 219) ou quand le pāli majjhimā-paṭipadā est traduit par « voie du milieu » (p. 96), alors qu’il le serait bien mieux par « voie modérée », « voie moyenne » ou « voie de la modération ». 12 Le plan de l’ouvrage n’est pas des plus éclairants. On se demandera ce qui précisément ordonne la succession des « figures » du néant étudiées, si ce n’est leur ordre chronologique. Au cours de ce voyage, l’être heideggérien aura été rapproché aussi bien de la vacuité nāgārjunienne, du néant nishidien et du brahman des Upanishads que du Dao chinois, au prix d’assimilations hâtives entre des doctrines parfois contradictoires, dont l’incompatibilité est généralement ignorée. Le concept de śūnyatā aurait mérité une étude encore plus approfondie, d’autant que sa référence est l’un des arguments forts de l’auteur. La référence à la critique bouddhiste de la notion de sujet, indissociable d’une méfiance certaine envers le langage, laisse globalement de côté le bouddhisme ancien. Pourtant l’analyse du terme papañca aurait certainement permis, d’une part, de compléter l’analyse de l’usage paradoxal du langage dans le Zen et le Madhyamaka, d’autre part, de dégager toute la spécificité de la démarche du bouddhisme ancien.
Nietzsche et le bouddhisme
Comme la figure de Nietzsche ne donne pas lieu à une véritable analyse comparative avec le bouddhisme, l’auteur ne dit pas que Nietzsche a entretenu avec le bouddhisme un singulier rapport d’« affinités ironiques », en croyant s’opposer à une pensée en réalité profondément apparentée à la sienne, comme l’a bien vue Robert G. Morrison. L’intérêt de Nietzsche pour le bouddhisme, rappelle Morrison, « était centré sur ce qu’il considérait être un parallèle historique direct entre l’Inde à l’époque du Bouddha et l’Europe de son propre milieu »[C’est nous qui soulignons. Cf. Robert G. Morrison, Nietzsche and Buddhism, A study in nihism and ironic affinities, Oxford University Press, 2002.[/efn_note]. Mais ce qui distingue le bouddhisme ancien de Nietzsche, c’est une critique élaborée du perfectionnisme moral et de l’idée de pratique, d’exercice, de technique supposés élever à une individualité supérieure ; une remise en cause radicale de la notion d’autorité spirituelle ; enfin et surtout l’exposé d’une distinction phénoménologique aussi essentielle que cruellement absente de l’ouvrage de Françoise Dastur, à savoir : la différence entre, d’une part, la concentration (samādhi) fabricatrice d’extases (jhāna) illusoires et asservissantes, et d’autre part la vigilance minutieuse, source d’une connaissance directe et sapientiale (vipassanā, paññā). Sans cette différence, il est impossible de comprendre ce qui fait l’originalité du bouddhisme non seulement par rapport à la philosophie de Nietzsche, mais aussi par rapport au mysticisme et à la phénoménologie. Le mysticisme, auquel renvoie souvent Françoise Dastur, semble entièrement fondé sur la concentration, alors que la phénoménologie semble reposer essentiellement sur la vigilance. Le Bouddha, lui, prône le recours aux deux procédés, qui ne sont efficaces qu’associés. Le Bouddha et Nietzsche ont peut-être visé le même but : l’expérience de l’éternité dans l’instant présent, l’épreuve de ce que Dorian Astor conçoit comme une conscience cosmique de « portée universelle », suprahistorique, inactuelle 13. Mais Nietzsche semble n’avoir aperçu dans le bouddhisme que sa pars destruens, sa dimension négative, éliminative ou abolitive (la lutte contre l’épuisement), ce qui l’empêche de penser sa présence à la modernité autrement que comme nihilisme doux, c’est-à-dire sans révolte, sans volonté de vengeance ni ressentiment. On pourra regretter que Françoise Dastur ne distingue pas suffisamment ce « bouddhisme européen », indifférent aux différences de confession, de ce que serait l’application effective de la discipline bouddhique à l’époque moderne.
Phénoménologie et méditation
Françoise Dastur manque de rapprocher explicitement l’épokhè de la méditation bouddhiste. Des liens éclairants ont pourtant été souvent établis à cet égard, notamment par Nathalie Depraz. Françoise Dastur voit l’importance, chez Husserl, de la passivité et de la réceptivité, puisqu’elle indique que, pour Heidegger, le vrai discours sur le néant suppose l’épokhè de l’angoisse, qu’elle identifie à la modification de neutralité husserlienne, laquelle n’est pas une action, mais « l’expérience même de ce qui par principe ne peut pas être pris en compte par l’interprétation technique de la pensée » (p. 194). 14 Or la condition de cette neutralisation semble être une attitude vigilante que le Bouddha et Husserl conçoivent tous les deux comme une activité paradoxale, puisqu’elle est aussi bien réceptivité, inaction, bref : passivité. Pour le bouddhisme, l’attention (sati) n’est pas le résultat d’un effort volontaire de concentration, mais elle n’est pas non plus le laisser-être, le lâcher-prise ou l’abandon de soi, parce que la passivité totale est impossible, sauf à sombrer dans la négligence et la torpeur. La vigilance est plutôt le résultat d’une activité conscientielle réduite à son minimum, d’un effort cognitif minimal, celui, inéliminable, consistant simplement à connaître ce qui apparaît tel que cela apparaît, ce qui désactive la génération des processus physiques et mentaux (sankhāra), c’est-à-dire les forces actives engagées par la volition, mettant fin alors à la construction d’une réalité conditionnée. De la même façon, pour Husserl la neutralisation des processus thétiques est à la fois « abstention pure » et inspectio mentis, c’est-à-dire une façon d’investir en esprit le processus qu’il s’agit de neutraliser, de le garder présent pour la conscience. Mais même les expressions « se figurer simplement par la pensée » ou « se-« transporte-par-la-pensée »-dans-l’agir » connotent encore un « « faire » (Tun) volontaire » pourtant inutile, qu’il faut donc éliminer. Expérience et jugement identifie le degré inférieur de l’activité du Je à sa réceptivité dans l’éveil de l’attention, c’est-à-dire dans l’orientation-vers qui simultanément accueille en soi ce qui lui est pré-donné (Expérience et jugement, § 17-18) – à la manière, mutatis mutandis, dont la passivité de l’intuition sensible est selon Maïmon le résultat de la diminution à l’infini de l’activité absolue de « l’entendement infini ». 15
Voir l’invisible
Le parti pris heideggérien de l’auteur le conduit le plus souvent à éviter la question de l’éthique, pourtant centrale dans les philosophies orientales qu’il convoque. Il n’évoque pas non plus la Gelassenheit, qui aurait pourtant pu être mise en regard des jhânas bouddhistes, en particulier des extases de l’absence de forme (arûpajjhânas, les absorptions méditatives impersonnelles dans un objet sans forme matérielle), à commencer par « la sphère où rien n’est » (akiñcaññâyatana), dans laquelle la conscience elle-même n’est plus perçue, et surtout la paradoxale « sphère où il n’est ni perception ni-perception » (nevasaññânâsaññâyatana), qui est le jhâna le plus profond et le plus subtil. Rappelons qu’à mesure que le moine parcourt les différents jhânas, « la vacuité s’accentue, le temps s’évide et la continuité s’estompe », comme l’écrit Silburn dans Instant et Cause. Il n’est peut-être pas besoin d’aller chercher plus loin pour comprendre la véritable origine de la dialectique nāgārjunienne ! Du reste, le bouddhisme est passé maître dans l’art de distinguer différents types de vacuité – le bouddhisme tibétain énumérant jusqu’à 18 sortes de vide !16 Mais en définitive, le choix du bouddhisme, parmi les philosophies orientales, comme terme de comparaison principal avec la pensée de Heidegger a de quoi étonner, attendu que celui-ci s’est, comme Nietzsche, davantage intéressé au brahmanisme, pourtant opposé au bouddhisme à bien des égards et seulement évoqué brièvement dans l’ouvrage. Difficile cependant de comprendre comment Heidegger peut à la fois assimiler « l’éclaircie » au brahman des Upanishads et vouloir assumer l’oubli de l’être plutôt que le dépasser ou le transcender, d’une façon comparable, selon Françoise Dastur, à celle par laquelle Nāgārjuna « reprochait aux écoles brahmaniques » de distinguer le saṃsāra du nirvāṇa, et préférait identifier l’Eveil lui-même au douloureux cycle des renaissances (p. 218, c’est nous qui soulignons).
Ce qui se dessine dans l’ouvrage de Françoise Dastur, on le voit, c’est moins la description phénoménologique de l’expérience de l’inapparent, telle qu’on peut la trouver par exemple dans l’Abhidamma, qu’une conception de l’être comme principe métaphysique qui serait fons et origo de la réalité : l’adèlothès, l’« occultation abyssale d’où surgit tout et à laquelle tout retourne » (p. 44), « cette obscurité ou occultation primordiale de laquelle émergent les étants » (p. 74). Or si cette perspective convient assez bien au mysticisme nishidien et au discours oraculaire de Heidegger, elle correspond peu à la vacuité nāgārjunienne et encore moins à la conception theravâdine de la négativité, que Françoise Dastur passe étrangement sous silence. Ici, l’absence d’une analyse détaillée de la nature du nibbāṇa dans le bouddhisme ancien se fait cruellement sentir. Elle aurait permis pourtant de voir dans le nibbāṇa un absolu non substantiel, sans qualité perceptible, bien que susceptible d’être ponctuellement objet de conscience, et que le Bouddha distingue explicitement du néant. S’il se trouvait dans le bouddhisme une pensée de la co-appartenance de l’occultation et de la désoccultation, elle se trouverait d’abord dans cette identification paradoxale de l’Illumination (bodhi) à l’Extinction (nibbāṇa), de l’Eveil à la Cessation (nirodha). Bien plus, le Bouddha propose un nihilisme actif et volontaire qui n’est pas une thèse sur l’être, mais une maxime méthodologique, un outil pour la pratique, utilisé de façon stratégique après avoir été purifié de la croyance à l’identité. 17
Heidegger et le taoïsme
Approfondir la signification des concepts taoïstes de « Voie » dao et de « non-existence » wu, dont la référence est centrale dans l’ouvrage de Françoise Dastur, aurait là aussi permis de mieux saisir ce qui les distinguent de l’être heideggérien ou de la vacuité bouddhique. Mais Françoise Dastur ne précise pas à quelle signification du concept de wu se rapporte le néant heideggérien. Or dans le taoïsme, wu a signifié tantôt l’absence d’êtres particularisés (« il n’y a pas »), tantôt « la source infinie de toute finitude », tantôt la synthèse du il y a et du il n’y a pas, « la négation de leur antinomie » 18
L’ouvrage de François Dastur n’emporte pas la conviction, d’abord parce que sa problématique n’est pas complètement unifiée et explicitée, ensuite parce qu’elle ne démontre pas sa pertinence. L’auteur tente d’analyser certaines figures, occidentales et orientales, du néant et de la négativité, vraisemblablement dans l’objectif de libérer la philosophie française d’un européocentrisme ruineux pour la pensée, ce qui expliquerait la référence à Heidegger. Le risque est alors de nous faire croire que nous serions en présence d’une seule et unique « pensée du néant et de la négation qui traverse aussi bien l’Orient que l’Occident » (p. 28). Ici, le comparatisme heuristique semble laisser la place à l’hypothèse d’une sagesse commune indo-européenne, dont les bouddhistes, les Présocratiques et finalement Heidegger seraient les héritiers, sans que cette hypothèse soit pour autant explicitée ou prise comme objet de démonstration. L’auteur tente, tant bien que mal, de laver Heidegger du reproche de grécomanie, de justifier son refus d’un dialogue direct avec l’Orient et même d’en faire un penseur privilégié du dépassement de l’européocentrisme ; mais il semble impossible de dissimuler certains présupposés aussi massifs qu’ininterrogés chez Heidegger, comme l’idée que la pensée ne peut être renouvelée que par la pensée qui a la même origine et que « la conversion de la pensée a besoin de l’aide de la tradition européenne ». 19 Espérons que l’auteur trouvera, contrairement à Heidegger, un meilleur moyen de libérer la philosophie de son européocentrisme et de dépasser la métaphysique occidentale que ce vieux principe grec (empédocléen), selon lequel le semblable n’est connu que par le semblable. 20
- Françoise Dastur, Figures du néant et de la négation entre Orient et Occident, Paris, les Belles Lettres, coll. Encre Marine, 2018
- Pour Heidegger, on ne peut pas penser l’Ereignis avec l’aide du grec, car « avec l’Ereignis, ce n’est plus grec du tout » (Heidegger, « Séminaire du Thor », 1969).
- Cf. Parménide, Le Poème, présenté par JJ. Beaufret, Paris, éd. PUF, coll. « Epiméthée », 1955, réed. 1984.
- Pour l’anekāntavāda, les multiples aspects du réel ne peuvent pas « être saisis par la perception humaine, ce qui implique qu’il est impossible de se réclamer de la vérité absolue » (p. 84).
- Françoise Dastur souligne que Mahâvira et Gautama ont profondément remis en cause la conception hiérarchique de la société, ce qui suggère que la démocratie ne trouve pas son origine en Grèce, comme l’indique également le fait que « de longues traditions de discussion publique ont existé dans différentes parties du monde, ce qui fut également le cas en Inde » (p. 92).
- La vérité ultime inclut la vérité conventionnelle d’une façon qui rappelle celle par laquelle, d’après Heidegger, la logique du silence (la « sigétique ») « inclut la logique de l’étantité qui est toujours aussi une logique de la fondamentalité et de la prédication » (p. 107).
- Cf. Gérard Granel, « Le Chinois de Königsberg » (publié en 1987 ; cf. Ecrits logiques et politiques, Paris, Galilée, 1990).
- « Ce ne sont que les formes les plus hautes de l’esprit philosophique et religieux de notre culture occidentale que l’on peut mettre en parallèle avec le bouddhisme », cf. E. Husserl, Aufsätze und Vorträge 1922-1937, Husserliana XXVII, The Hague, Kluwer, p. 125 sq..
- Par exemple : Françoise Dastur estime qu’est naturellement compréhensible la mise en rapport de « la pensée du néant divin chez Eckhart [avec] des thématiques apparentées que l’on peut trouver dans le bouddhisme, comme celle de la vacuité chez Nagarjuna, ou dans l’hindouisme, comme celle du neti neti » (pp. 120-121).
- Françoise Dastur pense vraisemblablement à deux manuscrits de Husserl écrits en 1920 : Ms. B I 2/88-94 et hua XIV, N°9, § 6. Husserl voit dans le Bouddha et Socrate deux “archi-phénoménologues” (Ur-phänomenologe).
- Cf. Bruno Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Enstehung das europaïschen Denkens bei den Greichen, Göttingen, 1975.
- Le français « moyen » dérive de la même racine que le pāli majjhimā. Se situer entre les extrêmes, au « milieu » d’eux, c’est encore se déterminer par rapport à eux et donc en déprendre, les accepter ou les inclure, comme par compromis. Or il s’agit bien plutôt de les éviter, de rejeter totalement et l’hédonisme et l’ascétisme, de se situer en dehors du nihilisme passif et de l’éternalisme, dans la mesure où ces extrêmes sont vulgaires et non-bénéfiques. La Voie n’est ni l’un ni l’autre des extrêmes et, en leur absence, il n’y a pas non plus de voie médiane. La voie ne contient rien qui soit emprunté à la recherche du plaisir d’une part, ni à l’auto-mortification d’autre part, ni qui se situerait au « milieu » d’eux. A la différence des extrémités, comme celles d’un bâton, qui reste liées entre elles, ces extrêmes sont en effet totalement incompatibles et dissociés. De fait, nous serions bien en peine de dire précisément en quoi pourrait constituer une attitude située à mi-chemin de l’hédonisme et de l’ascétisme ! Par exemple la « parole juste », qui est un des facteurs du Chemin, n’est pas une parole qui serait ni trop blessante, ni trop flatteuse, mais une possibilité entièrement nouvelle.
- Dorian Astor, Nietzsche, La détresse du présent, éd. Gallimard, coll. « Folio Essais », 2014, p. 487 Cf. [notre recension.
- Dans les Ideen I (§ 109), Husserl écrit que la modification de neutralité « n’ »agit » (leisten) pas, elle est pour la conscience tout le contraire d’une action (Leistens) : elle en est la neutralisation ».
- Husserl appelle d’ailleurs « attention négative » l’affection du pré-donné, qui précède l’orientation du regard (De la synthèse active).
- Cf. Alexandra David-Neel, « Le vide dans le bouddhisme tibétain », in Le vide. Expérience spirituelle en Occident et en Orient, éd. Deux océans/Hermès, 1981.
- Bien que le nihilisme soit classé parmi les « vues fausses », il est malgré tout adopté et utilisé de façon stratégique sur le chemin de l’Eveil ! Il a en effet l’avantage de prévenir l’attachement à l’existence et le refus de l’inexistence (Tipiṭaka, Samyutta Nikāya, III, 55). Il s’agit donc d’adopter le point de vue nihiliste sans s’y attacher, en abandonnant la croyance au moi qu’il suppose. Cf. Sébastien Barbara, Comprendre le Buddha, éd. Max Milo, coll. « Essai graphique ».
- Sylvain Auroux, La pensée chinoise, éd. PUF, coll. « Quadrige », Paris, 2017, p. 186. Les deux aspects du Dao, la luminosité (Yang) et l’obscurité (Yîn), rappellent l’occultation et la désoccultation heideggériennes ; mais le Dao a des affinités toutes particulières avec l’occultation, sous la figure de la féminité et de la maternité, en tant qu’il est la source et l’origine imperceptible du monde sensible. C’est précisément dans cette mesure-là que Lao zi l’associe à la vacuité et à cette faiblesse qui constitue la véritable force, celle de la « spontanéité naturelle » (ziran), à laquelle le taoïste se remet par une attitude de « non-agir » (wuwei) proche de la Gelassenheit heideggérienne. Quant au vide wu, souvent synonyme du Dao, il ne se réduit pas à la négativité, puisqu’il est « la forme du sans forme », c’est-à-dire qu’il transcende la négativité, en incluant le pôle opposé. Pris dans une « dialectique des contraires, le vide attire le plein [… il est] ce qui conjoint négation et affirmation dans une synthèse totalisante : le vide est à la fois positif en tant que contenant, matrice, puissance d’acte, et négatif en tant qu’insaisissable jamais atteint ». Considéré comme non-être, le wu n’est pas le néant, mais l’« indétermination infinie, le continu qui échappe à tout dénombrement, où l’on ne peut distinguer aucune partie » (p. 185).
- « Sans doute l’appel le plus impression du XXe siècle aux Grecs a-t-il été lancé par Heidegger » (Dorian Astor, Nietzsche. La détresse du présent).
- Empédocle fondait sa théorie des effluves sur le principe selon le semblable est connu par le semblable. Cf. Platon, Timée, 45 b. Pour Aristote, la faculté de percevoir n’existe pas en acte, mais est en puissance ce qu’est l’objet perceptible en entéléchie, et c’est cet objet qui l’actualise. Il en va de même pour le rapport entre le noûs et les noêta. C’est un des thèmes essentiels de la psychologie aristotélicienne, passé dans la philosophie scolastique. Cf. De Anima. II, 5 et III, 3.