Albrecht Dürer (1471-1528) est sans aucun doute un des artistes les plus emblématiques de la Renaissance allemande et un des graveurs les plus célèbres de l’humanité. Natif de Nuremberg, il fut de son vivant le premier artiste à échapper à l’anonymat et à faire l’objet d’une admiration unanime, à tout le moins pour ses gravures, tant sur cuivre que sur bois. A cela s’ajoutent les connaissances hermétiques de l’auteur qui se laissent percevoir notamment dans la très célèbre gravure Melancolia où figurent une échelle, un carré magique, et la fameuse date de 1514. Ce n’est donc pas un hasard si Françoise Bonardel, Professeur à la Sorbonne, mais surtout spécialiste de l’hermétisme et de l’alchimie, vient de consacrer un ouvrage de 300 pages1 à l’auteur de Melancolia, mêlé de réflexions érudites et de souvenirs intimes.
A : La figure du Chevalier
Ce qui frappe à la lecture de cet ouvrage est d’abord l’importance accordée à la figure du chevalier. Nous savons que dans ce qu’il est convenu d’appeler la série Meisterstiche comprenant Mélancolia, Le chevalier, la mort et le diable et Saint Jérôme dans sa cellule, figure, sous différentes formes, le chevalier, auquel Françoise Bonardel va consacrer l’essentiel de son attention.

Celui-ci est d’abord rencontré à travers Luther qui, aimant à utiliser des images guerrières pour ranimer le courage spirituel des chrétiens, se trouve convoqué pour interroger le sens de ce chevalier. Le chevalier serait-il un chrétien luthérien, prêt à prendre les armes en symbole de la force de sa foi ? Mieux encore, Luther comme Erasme, ne cesse de citer comme ennemis la chair, le diable et le monde : or, précisément, une des gravures met en scène le chevalier, la mort et le diable. Il est vrai que manque la chair comme telle, mais de manière générale, suggère l’auteur, Luther dut être sensible au fait que Luther ait restitué à la figure rhétorique du Miles christianicus tout son éclat. C’est pourquoi, F. Bonardel n’hésite pas à affirmer qu’à la question de Luther « Mais à quoi sert-il que Dieu soit Dieu, s’il n’est pas un Dieu pour toi ? » résonne en écho « l’œuvre entière de Dürer »2 car chaque chose de son œuvre « paraît tenir sa stature et sa force intérieure d’une droiture qu’il faut bien dire éthique ; et tant l’ « humanité » qui s’en dégage tient moins à l’approfondissement d’une subjectivité humaine éprise d’elle-même qu’à la conscience aiguë dont l’artiste semble avoir doté chaque créature, prête à répondre un jour de son existence devant Dieu. »3
Pour autant, et c’est là sans conteste une des réussites de l’ouvrage, l’auteur ne se contente pas d’une démarche de type purement iconographique où il s’agirait de retrouver dans les symboles d’une gravure des sources intellectuelles précises ; les choix formels se trouvent eux aussi convoqués pour livrer leur signification et la gravure du Chevalier se trouve ainsi sommée de livrer le sens de sa singulière construction spatiale et perspective. « A-t-on par contre suffisamment remarqué que dans cette gravure, presque totalement dépourvue de perspective géométrique, les quatre plans qui néanmoins s’échelonnent devant le regard – Chevalier, Mort, rochers, citadelle au loin – cèdent de fait la place à une autre perspective, latérale celle-là, dont le spectateur ne décèle l’existence qu’en suivant le regard du Chevalier ? Tel pourrait bien être l’esprit de l’épopée ressuscité dans cette gravure par Dürer : suggérer qu’il n’est d’horizon véritable qu’au regard d’une force intérieure capable d’en soutenir la pure mais inquiétante possibilité. Figuration de la concentration extrême, et réunissant de surcroît la plupart des défauts stylistiques parfois reprochés à Dürer (…). »4 dont l’écrasante profusion ici incontestable. Il n’est pas certain que le sens d’une perspective latérale possède un sens autre que métaphorique, mais l’essentiel est ailleurs : Françoise Bonardel nous invite à comprendre que le sens de l’œuvre ne naît pas uniquement de ce qui est représenté mais s’enracine également dans la manière dont le thème est représenté, c’est-à-dire dans la forme de l’œuvre. A cet égard, la volonté de traduire l’intériorité spirituelle à partir d’une étude de la perspective et du regard du chevalier nous semble plus convaincante encore que le lien effectué avec Luther, reposant somme toute sur de simples conjectures.
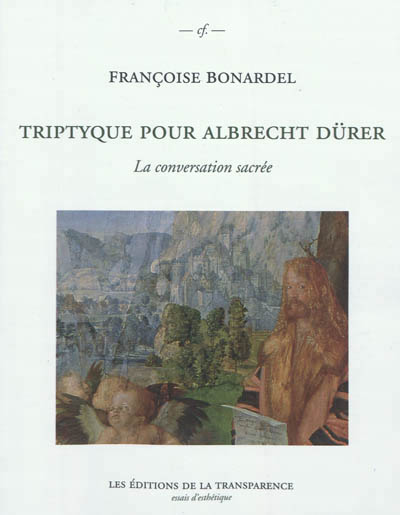
Au-delà de la gravure centrale du Chevalier entouré de la mort et du diable, F. Bonardel cherche à créer un réseau au sein duquel rayonnerait la figure du chevalier, à partir de l’étude d’autres gravures. Ainsi est-ce le cas du Cavalier surpris par la mort, œuvre à notre connaissance très rarement citée et que nous avons découverte dans l’ouvrage, sans d’ailleurs trouver confirmation de son attribution à Dürer ailleurs que dans ce livre, œuvre donc à laquelle l’auteur consacre de fort beaux passages. Interprétant la dialectique du regard porté vers le haut et la chute imminente, l’auteur en vient à s’interroger ainsi : « Mais le symbole est le même puisque gît à terre ce qui l’a fait trébucher. Jamais avec autant de virtuosité que dans ce dessin Dürer n’a saisi « sur le vif » l’intervention subreptice de la Mort, en cet instant éblouissant où, le trépas accidentel devenant fatalité, il n’est plus pour le cavalier qu’à subir les effets mortels d’une série de causes échappant à sa volonté. C’est donc bien de fatalité qu’il s’agit ici, orchestrant l’accident, et non d’une mort éminemment prévisible puisque attachée comme son ombre à tout être vivant. Si l’on ne peut exclure que la Mort offre au Chevalier/cavalier de 1513 le visage de la fatalité, s’adresse-t-il au vivant par nature menacé, ou à l’homme cuirassé en quête d’aventure et d’identité ? »5
Un peu plus tard, ce seront Nietzsche et Wagner qui seront convoqués pour toujours interroger davantage cette énigmatique figure du chevalier, à la fois luthérienne et guerrière, pleine d’intériorisation spirituelle et d’expressivité belliqueuse.
B : Chevalier et Mélancolie
Naturellement, toute étude de Dürer impose de passer par la question de la mélancolie. L’auteur propose à cet égard de rattacher indirectement la figure du chevalier à un tel état. « Affectant l’être en son entier, l’état mélancolique appelle une approche elle aussi globale dont les trois gravures de Dürer invitent à explorer les différentes facettes. Or, si Le chevalier n’est pas à l’évidence une figuration de l’état mélancolique en tant que tel, génialement dépeint dans Melancolia I ; et si le héros de la gravure n’a donc pas en tant qu’homme « sa place parmi les mélancoliques », ce scénario aux allures martiales ne laisse pas moins entrevoir à quelle profondeur et entre quels partenaires se joue la partie guerrière, rencontre sur son chemin les émissaires du destin le condamnant à retrouver dans cet étroit défilé son indépendance : qu’il passe inexorablement ou qu’il semble figé, et comme suspendu, le temps ne reste-t-il pas toujours le complice de la Mort et du Diable ? »6 On le voit, l’auteur reste prudente, et ne conclut jamais que par de précautionneux points d’interrogation. Les liens proposés procèdent d’une habitude qu’a sans doute contractée F. Bonardel en travaillant sur l’hermétisme, lequel invite fréquemment à ne jamais isoler les éléments et à toujours en penser les possibles relations. Ici, ce sont le temps, la mélancolie, la mort et le chevalier qui doivent être simultanément pensés comme appartenant tous à la même série. Le chevalier, sans être affligé par la mélancolie comme telle, peut à chaque instant en être la victime, car le temps auquel il fait face constitue la certitude de l’imminence de la mort et la tentation de perdre l’espérance, brèche par laquelle s’introduirait immédiatement le diable.

Construisant cette pensée relationnelle, Françoise Bonardel peut alors radicaliser son analyse initiale et faire du Chevalier lui-même une des figures de la mélancolie. S’appuyant d’abord sur la présence du chien, que la tradition relie à la mélancolie à cause de la prédominance de la rate au sein de son organisme, l’auteur extrapole ensuite à la figure même du Chevalier, emportée par l’expérience mélancolique générale : « Plus encore : si la proximité du sublime et du sinistre caractérise la mélancolie propre à l’home de génie, toujours sur le fil du rasoir entre dépression et exaltation, entre mort et transfiguration, alors le Chevalier donne bien à voir une figuration inédite de l’expérience mélancolique dont ces éléments saturniens n’épuisent évidemment pas la teneur propre, très différente de celle de Melancolia I où Panofsky disait reconnaître « la concentration fanatique d’un esprit qui a véritablement saisi un problème, mais qui, dans le même temps, se sent incapable de le résoudre ou de s’en débarrasser ». »7
En identifiant les éléments saturniens présents dans la gravure du Chevalier, Françoise Bonardel révèle ainsi que la lecture luthérienne ou, plus généralement, d’une vie active chrétienne, ne suffit pas à épuiser le sens de cette gravure aux significations multiples. C’est donc dans un dialogue avec la très célèbre analyse de Panofsky que s’engage l’auteur, dialogue destiné à clarifier le rapport entre les trois gravures de la série meisterstiche. Panofsky avait suggéré que chacune des trois gravures symbolisât les trois types humains conceptualisés par Ficin, soient l’imagination, la raison et la contemplation. « Les fondations sur lesquelles l’idée de Dürer s’est élevée, c’est Ficin, bien entendu, qui les a jetées, écrivait Panofsky. »8 A cela, Françoise Bonardel adresse une bien étrange objection ou, pour être plus précis, une objection inattendue : une telle lecture gommerait ce que chaque gravure peut avoir de singulier, écrasant chacune d’entre elles sous un sens global occultant. « Ne voir dans ces trois gravures que l’illustration de trois types de vie – active, contemplative et intellectuelle – conduit donc presque inévitablement à minorer la portée de chacune d’entre elles et plus encore de leur éventuelle trilogie, faute d’un dénominateur vraiment commun susceptible d’en montrer « l’unité spirituelle » véridique. Or, s’il s’agit bien dans l’esprit de Dürer, lecteur de Marsile Ficin et de Corneille d’Agrippa, d’une figuration de la triple vie offerte aux hommes, la signification d’une telle triplicité change selon qu’on se contente d’y voir un choix possible entre trois types d’activité générant trois types d’hommes, ou l’expression d’une trinité inhérente à chaque homme dont âme, corps et esprit, imagination, raison et intelligence noétique ne sauraient être dissociées (…). »9
La critique est donc double et pour le moins acrobatique : la thèse de Panofsky manquerait à la fois le sens général du triptyque en ne dégageant pas le fil conducteur, et en même temps le sens singulier de chacune des gravures en les écrasant sous ce sens général pourtant dénoncé comme absent. L’idée de Bonardel consiste alors à ne plus dissocier imagination raison et contemplation et les rassembler pour en faire cela même qui est exprimé simultanément dans chacune des trois gravures sous l’angle de la concentration. Celle-ci devient le choix herméneutique de l’auteur qui s’oppose ainsi au découpage des types de vie proposé par Panofsky : « ce sont là d’abord, malgré la diversité des décors et des situations où sont dépeints les personnages, trois figures de la concentration extrême nécessaire à une juste appréhension de soi-même et des risques encourus dans la fréquentation du monde. »10
C : Pour qui l’auteur écrit-elle ?
Cet ouvrage, centré autour de la figure du Chevalier, propose donc un parcours intéressant et stimulant dans l’œuvre de Dürer. Toutefois, plusieurs remarques pourraient être faites quant à la manière dont l’enquête se trouve menée.
Premièrement, et c’est peut-être là le plus ennuyeux, à plusieurs reprises le lecteur peut avoir l’impression de ne pas très bien identifier le lieu où veut l’emmener l’auteur. Pis encore, la nécessité de plusieurs chapitres, en particulier ceux constituant la troisième partie intitulée « Venise », est parfois introuvable. Cela semble s’expliquer par le sens même de la rédaction de cet ouvrage qui, précisément, obéit bien moins à une nécessité objective reposant sur une lacune herméneutique autour de Dürer qu’à une nécessité purement subjective, inscrite dans les désirs de l’auteur. « Il en est de certaines œuvres d’art comme des quelques êtres dont nous pourrons un jour affirmer qu’ils ont véritablement fait route avec nous, affirme F. Bonardel au début de l’ouvrage. Le besoin n’en est que plus fort de se retourner sur une si exceptionnelle fidélité, et de s’interroger sur une constance devenue si coutumière qu’elle en vient à occulter l’éclat d’une présence demeurée pourtant inégalée : pourquoi cette œuvre-ci plutôt que celle-là ? »11 En d’autres termes, il s’agit là d’un parcours très personnel, dont il n’est pas certain qu’il cherche toujours à emporter le lecteur sur sa route, préférant parfois – notamment, redisons-le, en troisième partie – établir une plaisante discussion entre l’auteur et elle-même, destinée à sa seule satisfaction.
La conséquence de cette démarche peut-être trop personnelle se fait sentir dans l’excessive érudition qui parcourt le texte ; un nombre incalculable de digressions occulte le sens central de la démarche et noie le propos dans un ensemble trop important de références littéraires annexes, dont l’utilité paraît bien faible. Alors que l’on s’attendrait à croiser Dürer et ses commentateurs, on rencontre plutôt une myriade de références sans grand rapport avec l’objet de l’ouvrage, à la fois trop nombreuses et trop peu analysées. Citons ainsi la page 37 où se croisent, outre Dürer, Rimbaud, Oswald Spengler et Heinrich Wölfflin, aucun ne faisant l’objet d’analyses approfondies, chacun apparaissant donc là sans raison réelle. Tout cela a pour effet de rendre le livre parfois confus et déstructuré : l’auteur bavarde et nous fait certes partager le plaisir de sa conversation mais elle sembler oublier que si elle publie cet ouvrage, c’est afin de rencontrer un public pour lequel il eût été bon de davantage construire la logique même de son enquête. Il ne s’agit pas pour nous de dire que tout est confus mais simplement de signaler que bien des passages auraient gagné à être allégés afin de mieux indiquer les problèmes poursuivis et mieux asseoir les thèses défendues.
Mieux asseoir les thèses défendues disions-nous, car force est de constater que bien des analyses s’achèvent sur une interrogation. Paradigmatique à cet égard est l’étude consacrée aux sabliers et au temps. Dans chacune des trois gravures de la série figure en effet un sablier où l’écoulement du temps est à chaque fois strictement identique. Comment comprendre cela ? La réponse de l’auteur fait preuve d’un excès de prudence qui jette un trouble : « Identiquement présent dans les trois gravures, écrit F. Bonardel, le sablier où le temps semble suspendu plus encore que fuyant, ne pourrait donc trouver sa seule raison d’être dans Melancolia I où il ne paraît en effet mesurer que « la durée vide » propre à l’abattement mélancolique, et non « le temps rempli par l’action ». De quelle nature est plutôt ce vide temporel que le sablier par trois fois « mesure », à l’aune d’un autre étalon, faut-il croire, que celui imposé par la chronologie ? »12 Le texte ne tranche pas. Dans le même chapitre, l’auteur affronte le fait que Dürer ne représente presque jamais Saint Georges en action ; loin de donner une interprétation résolue, elle sembler rester hésitante face à la signification à y apporter : « Est-ce à dire que Dürer, brodant très librement sur ce thème traditionnel, ne se soit au fond jamais senti l’âme d’un tel combattant, ou qu’il ait été gêné par le scénario même de l’affrontement ? »13 Ces interrogations permanentes qui, certes, traduisent la probité de l’auteur, contribuent en même temps à une impression d’inachevé ou d’impossibilité de conclure qui s’accompagne d’une certaine frustration pour le lecteur, comme si l’auteur exposait à voix haute ses propres doutes, sans apporter de véritables solutions.
Conclusion
En dépit des réserves formulées ci-dessus, il nous faut dire que cet ouvrage présente bien des mérites. Il permet d’abord de transmettre une passion, celle de Dürer, que l’auteur rend communicative. Le charme qui émane de ces gravures patiemment disséquées se transmet au lecteur de bonne volonté qui veut en savoir plus et s’enthousiasme devant le génie créatif et formel de Dürer. Telle n’est pas la moindre des qualités de ce livre que de rappeler la grandeur de Dürer. Ajoutons également que le style de l’auteur a quelque chose d’élégant, de travaillé et semble même parfois viser quelque effet stylistique ce qui en rend la lecture plutôt agréable. Le travail d’éditeur est remarquable, de la qualité du papier à celle de la langue, l’ensemble étant particulièrement soigné.
Il s’agit donc d’une belle étude, quoique parfois confuse et peu claire, consacrée à l’énigmatique figure du Chevalier chez Dürer dont l’auteur, en spécialiste de l’hermétisme, se plaît à traquer les sens cachés et nous invite à penser les gravures de Dürer de manière relationnelle et systématique, l’ensemble donnant sens à la partie sans jamais écraser cette dernière. Françoise Bonardel sait conserver de l’hermétisme une méthode d’analyse tout en en laissant de côté le contenu, permettant ainsi à qui n’est pas familier de ces questions-là de s’y retrouver pleinement.
- Françoise Bonardel, Triptyque pour Albrecht Dürer. La conversation sacrée, La Transparence, 2012
- Ibid., p. 89
- Ibid.
- Ibid., p. 106
- Ibid., pp. 165-166
- Ibid., p. 177
- Ibid., pp. 185-186
- Erwin Panofsky, Klibansky et Saxl, Saturne et la mélancolie, Traduction Fabienne Durand-Bogaert et Louis Evrard, Gallimard, 1989, p. 541
- Bonardel, op. cit.,, p. 195
- Ibid., p. 195
- Ibid., p. 7
- Ibid., p. 124
- Ibid., p. 134








