Le monde n’est plus à l’utopie politique
« Nul ne songe plus à une Cité parfaite » (p.17), se désole Francis Wolff 1. Voilà trente ans s’effondrait le mur de Berlin et avec lui les utopies politiques. Est-il seulement possible, aujourd’hui, de les remettre au goût du jour ? Certes, l’humanisme n’a plus le vent en poupe, l’homme s’est brisé en mille morceaux, à telle enseigne qu’on ne sait plus très bien ce qu’il est. Mais si « nous ne croyons plus au salut commun ; ni au salut ni au commun » (p.15), le rêve d’émancipation collective s’est-il pour autant brisé ? Les mouvements de contestation pourraient modérer ce pessimisme. Pourtant, « c’est parce que nous ne croyons plus à la cité juste, ni à la Cité, ni à la Justice, que nous multiplions les foyers de revendication » (p.21). Au contraire, à l’idéal d’émancipation collective s’est substituée « une multiplicité dispersée de désirs » individuels. Alors même que la destination de l’homme était jadis la communauté politique, il apparaît clair qu’aujourd’hui, « nous ne cherchons plus à nous accomplir par et dans la communauté politique et nous n’aspirons plus à nous fondre en elle » (p.21).
Reléguer l’utopie politique au rancart de l’histoire n’est pourtant pas sans risque. Parmi les principaux dangers, le livre pointe les relents identitaires et nationalistes, le repli sur les droits individuels, et plus largement sur la sphère privée. Du même coup, c’est le politique comme affirmation d’un collectif qui est menacé, tout comme l’idée de bien. L’auteur fait le constat d’un abandon de cet idéal, au profit de la recherche d’une situation simplement « moins mauvaise ». Dans chacune des révolutions récentes, les peuples ne se sont pas rebellés pour un bien, mais contre un mal. Plus personne ne semble donc rien attendre de la puissance publique : nous serions tous, en quelque sorte, devenus libéraux. « Nous attendons de l’Etat qu’il nous permette de vivre sans lui [et qu’il] nous rende moins inégaux tout en nous laissant tous indépendants, de lui et des autres » (p.21). F. Wolff s’emploie précisément à étudier les nouvelles utopies individualistes que sont le transhumanisme et l’animalisme, et pointe leurs contradictions qui peuvent se résumer ainsi : en insistant sur les droits personnels, elles ont oublié la question de l’égalité, pourtant primordiale. En tournant le dos à l’humanisme, elles ont abandonné l’idéal d’un « nous » commun. Or, si ces les conséquences qu’impliquent ces deux utopies sont dangereuses, le concept d’utopie, lui, doit être sauvé, sans quoi l’humanité se prive des forces de progrès que contient la pensée politique, et se condamne soit au présentisme, soit à la nostalgie. Pour ce faire, il convient de reformuler l’humanisme classique avec des termes aptes à résonner avec notre temps, aptes à raisonner notre temps. Cela, le livre le fait en promouvant le concept de « cosmopolitisme », le seul capable de porter l’humanisme comme un absolu.
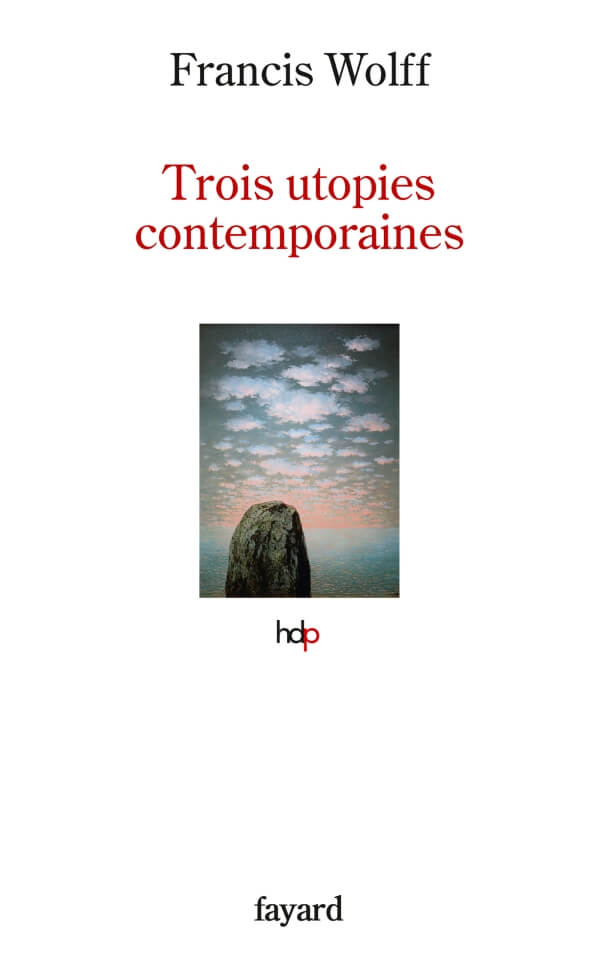
Le langage au service de l’utopie
Spécialiste de philosophie antique, l’auteur fait sien dans son introduction le mot fameux du sophiste Protagoras, dans le dialogue éponyme de Platon : « l’homme est la mesure de toute chose ». Si la citation peut surprendre au vu de l’acribie de Platon pour ceux-ci, le même Platon n’a eu de cesse de rappeler la nécessité d’un discours persuadant ceux dont les passions l’emportent sur la raison. Faire révérence, sans révérence, aux Anciens, c’était déjà le projet de F. Wolff dans Penser avec les Anciens. Sur ces considérations, les premières pages du livre distinguent l’utopie théorique (des prémices de la modernité jusqu’à Marx) et l’utopie en acte. Alors que l’utopie théorique se borne à des buts précis (bousculer les consciences, stimuler l’imaginaire, ouvrir le champ des possibles), l’utopie en acte, quant à elle, voit sa réalisation effective se retourner contre son principe même – le cas d’école étant le communisme, dont les exemples historiques ont été pour le moins décevants. C’est la bonne fortune passée du « nous » qui a, paradoxalement, précipité sa dévaluation, tant le communisme, tel qu’il a été mis en œuvre à tout le moins, a ébréché sa crédibilité. Symétriquement, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a subi de nombreux coups de boutoir, en particulier de la part du marxisme, lequel dénonçait son caractère purement formel, non suivi d’effet.
La méthode de F. Wolff, celle de l’identification et de la classification conceptuelle, est la même que celle déjà employée dans Dire le monde (PUF, 2004) et Notre humanité (Fayard, 2010). Ici, l’auteur identifie trois types d’utopies : la première est « au-delà » de l’humanisme (c’est le transhumanisme), la deuxième est « en-deçà » de l’humanisme (c’est l’animalisme), la troisième est « suprahumaiste » (c’est le cosmopolitisme). Le défaut des deux premières utopies est précisément qu’elles ne sont utopies que de nom, par homonymie : elles invitent moins à vivre en un autre lieu qu’à être un autre, c’est-à-dire à oublier l’idée d’humanité. Chacune des trois parties du livre est dédiée à l’étude, comme le titre l’indique, d’utopies contemporaines (transhumanisme, animalisme, cosmopolitisme). Chaque partie du livre obéit à une même structure et décrit le contexte d’apparition de chaque utopie, en exprime les doutes quant à leur portée effective et en propose un bilan critique. Afin d’établir ce bilan, F. Wolff privilégie un instrument conceptuel parfaitement heuristique, à savoir une distinction entre une éthique de la première personne, une autre de la deuxième personne et une dernière de la troisième personne. Plus précisément, chaque éthique est distinguée à l’aune de la « position du bien » visé par celui qui agit. Le sujet peut agir soit en vue de son propre bien (ce qui fait du sujet à la fois l’agent et le bénéficiaire de l’action) ; soit en vue du bien d’autrui (auquel cas le sujet, comme l’agent moral est séparé du bénéficiaire, le patient moral) ; soit en vue du bien de tiers quelconques. Aussi la finalité d’une éthique de la première personne, laquelle vise son propre épanouissement, se distingue-t-elle de celle de la deuxième personne qui vise la générosité, et de l’éthique de la troisième personne qui vise la justice.
Contre le transhumanisme, éthique du « je »
Le transhumanisme, en tant qu’il vise l’amélioration indéfinie des capacités physiques, intellectuelles et morales de l’homme, est représentatif d’une éthique de la première personne. Il n’y est en aucune façon question d’un salut commun, mais plutôt « du salut de chacun pour soi ». Loin de se préoccuper d’une quelconque communauté, cette utopie n’a d’intérêt que pour « la puissance des puissants ». Avant d’attaquer le transhumanisme, le livre reconnaît la validité de son fonds scientifique. Le progrès technique, en particulier biomédical, a sans conteste permis d’allonger l’espérance de vie et d’améliorer les conditions d’existence des hommes. Cela étant, cette utopie va trop loin lorsqu’elle prétend libérer l’être humain de ce qui fait son animalité, à savoir, par exemple, la naissance, la douleur, les divers handicaps et pathologies, le vieillissement et la mort. Son utopisme tient précisément à ce qu’il propose à l’humanité de sortir de sa condition pour s’améliorer continûment, à dépasser ses limitations, d’où la faveur contemporaine des discours sur l’humanisation de la machine.
Toutefois, rétorque F. Wolff, jusqu’aujourd’hui, aucune machine n’a eu mal aux dents, pour la simple et bonne raison qu’elle ne saurait avoir d’expérience en première personne, n’ayant pas à proprement parler de corps. Certes, toute machine peut accomplir le programme que l’être humain y a introduit, mais sans pour autant le vivre, et, en conséquence, sans le dire. Si le transhumanisme est chimérique, c’est en raison de ses postulats fallacieux. Il présuppose en effet que le fonctionnement de l’esprit humain s’apparente à celui d’un ordinateur : il pourrait donc être reproduit sous forme informatique. Cela est néanmoins impossible, précise F. Wolff, l’écart entre l’homme et la machine tenant à son animalité même. Par ailleurs, il anticipe l’objection selon laquelle les machines accomplissent des prouesses toujours plus stupéfiantes – par exemple, battre l’homme à plates coutures aux échecs. Pour autant, relève F. Wolff, le propre de l’homme n’est pas d’être programmé pour jouer aux échecs, mais d’accomplir une quantité quasi infinie de tâches mentales, ce grâce à sa capacité continue d’apprentissage. Or, cette plasticité connaturelle à l’homme est l’autre nom de son animalité. « C’est en cela que nous ne sommes pas des machines : notre humanité est une fonction de notre animalité, qui est elle-même un ensemble de fonctions de la vie et du vivant comme tel ». C’est pourquoi, bien qu’à l’évidence la pensée ne saurait être sans le cerveau, elle « n’est pourtant pas dans le cerveau. [Elle] est un rapport au monde » (p.52). Cela étant, quand bien même on admettrait avec F. Wolff qu’il existe des structures naturelles de la pensée, rien n’empêche cependant de penser qu’elles soient bien dans le cerveau, celui-ci étant en quelque sorte « pré-câblé » pour la vie en société. Il serait, en conséquence, permis de lui objecter ce que Daniel Andler nomme « la fausse dichotomie entre un naturalisme antihumain et un humanisme antinaturaliste » 2.
Contre l’animalisme, éthique du « tu »
On l’a vu, F. Wolff dénonçait, dans le cas du transhumanisme, la prétendue libération de l’être humain. Symétriquement, il dénonce, au sujet de l’animalisme, tel qu’il est promu par les associations de véganisme, dont certaines particulièrement médiatiques (comme L214), la prétendue libération des animaux. Selon cette doctrine, l’humanité ne devrait plus utiliser les animaux, ni les produits qui en sont dérivés – l’homme devant rompre avec son passé de prédateur, sinon de bourreau. Le livre prend bien soin de distinguer les militants de la bientraitance animale – idéal qui est tout sauf utopique – des révolutionnaires abolitionnistes qui considèrent que le règne animal constitue le nouveau prolétariat du capitalisme contemporain, avec lesquels le livre ferraille. L’animalisme, tel qu’il est défini par F. Wolff, a donc peu à voir avec les préoccupations welfaristes en vue du bien-être animal. Il est au fond un abolitionnisme qui nourrit en son sein une violente critique à l’encontre de l’humanisme, accusé d’anthropocentrisme, voire d’ethnocentrisme occidental – cette dépréciation est d’ailleurs le fait d’auteurs renommés, tels Bruno Latour ou Philippe Descola.
Le paradoxe animaliste peut être résumé en ces termes : c’est au nom de l’égalité que l’abolition de la propriété animale est invoquée, alors même que l’inégalité est la règle régissant les rapports entre prédateurs et proies au sein du règne animal. F. Wolff s’emploie à cet égard à relever les contradictions au sein du projet animaliste. La première est d’ordre anthropocentrique : « si nous sommes si proches des autres animaux, pourquoi devrions-nous nous soucier d’eux et cesser de nous conduire comme eux, en animaux ? » (p.92) De fait, « seul un être bien différent des autres animaux est capable de conduites morales. Et on est obligé de conclure : nous ne sommes pas des animaux comme les autres, justement parce que nous nous sentons des obligations par rapport aux autres animaux » (p.92). C’est la raison pour laquelle les hommes ne peuvent faire communauté morale avec les animaux : par essence, la justice ne pourrait y régner. S’il n’y a pas de communauté animale, c’est « parce que les intérêts des uns et des autres sont antagoniques ; la vie des uns s’alimente nécessairement de la vie des autres » (p.102). Puisque penser un « nous » implique d’être humain, nos devoirs envers les animaux doivent se résumer en une éthique du soin. Au contraire, « nous n’avons pas le devoir d’abolir toutes les souffrances des animaux de la planète ni d’empêcher toute prédation – ce serait contraire à la vie animale elle-même » (p.106). Si l’utopie transhumaniste était « anthropocentrée », l’utopie animaliste est en conséquence « zoocentrée »; si la première « prétendait élever la puissance de l’homme jusqu’au ciel, celle-là veut mettre à terre sa volonté de puissance » (p.66).
Toutefois, F. Wolff ne nie pas nos devoirs envers animaux – relatifs, a-t-il tôt fait d’ajouter, pour les distinguer des devoirs absolus vis-à-vis des hommes – devoirs qui consistent en leur, et qui impliquent qu’à l’aune des Lumières, nous luttions contre leur chosification. L’erreur consiste précisément dans l’absolutisation de ces devoirs. Les animalistes ont le tort d’investir le vocable de la lutte contre l’esclavage ou de l’émancipation féminine pour vanter la « libération » animale. En libérant les animaux, les parangons de l’animalisme pensent libérer l’ensemble des asservis, de la même façon que la libération du prolétariat devait permettre celle de l’humanité tout entière. Ce télescopage historique autorise un beau chiasme sous la plume de l’auteur : « l’animalisme n’est pas une radicalisation de la protection animale, c’est une animalisation de la radicalité » (p.74). Est-ce à dire que pour les animaux, point de salut ? Bien au contraire, nous dit F. Wolff, c’est par l’humanisme que nous pourrons proposer un traitement éthique des animaux. Si l’humanité constitue bel et bien une espèce biologique, ses membres sont avant tout des personnes qui « forment une communauté morale de droits et de devoirs réciproques et absolus » (p.103). Dans le cadre humaniste, nous avons des devoirs envers les animaux, mais des devoirs relatifs, relevant d’une éthique de la troisième personne, et répondant à la question qui suit : « Quel type de traitement est juste selon le type d’animal, le type de relation que nous avons avec lui et donc le type de communauté implicite que nous formons avec lui ? » (p.106).
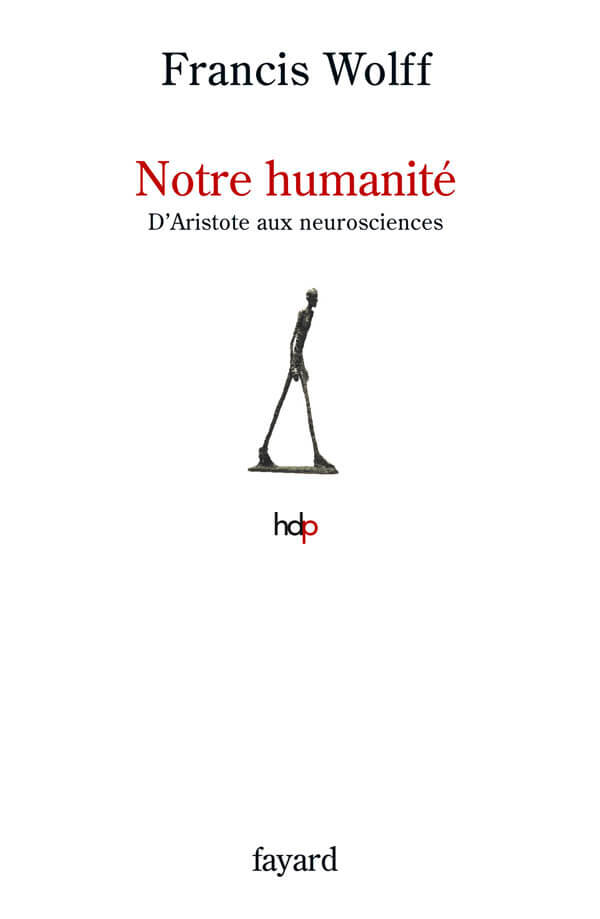
Pour le cosmopolitisme, éthique du « il »
Afin de réhabiliter l’humanisme, F. Wolff s’appuie sur la philosophie des Lumières, en particulier sur son rationalisme. C’est bien la raison, par essence transhistorique, qui doit prémunir le philosophe de tout retour en arrière (animaliste) ou de tout futurisme (transhumanisme). Le lecteur serait tenté d’objecter à l’auteur qu’en revenir à une telle conception serait quelque peu suranné ; objection que le livre a tôt fait d’anticiper. Le transhumanisme, en effet, renoue lui-même avec une tradition plus ancienne encore, à savoir avec le mobilisme héraclitéen, ayant pour corollaire un progrès technique où l’homme court à sa perte ; tandis que l’animalisme, fondé sur un immobilisme parménidien, s’attache trop à l’animalité de l’homme et s’interdit de penser l’humanité pour elle-même.
La méthode de ce chapitre sera simple : le fondement de l’humanisme, afin de prévenir l’écueil essentialiste, devra être susceptible d’évolution dans ses modalités ; mais son essence, en elle-même, devra être pérenne, pour éviter tout constructivisme. Cette méthode appelle à une redéfinition de l’humanisme comme incessante autoconstitution d’un « nous », qui réside dans ce qui est commun à l’ensemble de l’humanité, à savoir le langage. L’être humain est avant tout « un être parlant », activité sans cesse actualisée, c’est-à-dire, pour reprendre le langage d’Aristote cher à l’auteur, passant sans cesse de la puissance (qui définit l’activité de parler) à l’acte (qui la rend effective). « Il a en effet pour spécificité d’utiliser un langage (logos) qui ne permet pas seulement l’expression des émotions ou des passions (comme chez les animaux simplement sociaux) mais bien l’affirmation ou la négation de valeurs (bien et mal, justice ou injustice) et donc le dialogue ». Dès lors, quelles conséquences politiques tirer de l’humanisme ? La réponse de F. Wolff est simple : un « cosmopolitisme de la paix ». Ici, l’auteur s’oppose explicitement à L’Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique de Kant.
Si nous voulons poser un droit véritablement universel, c’est-à-dire un droit qui refuse toutes les différences, alors deux conséquences en découlent : d’une part, ce droit doit s’émanciper de la géographie des nations et à tout le moins lutter contre leur séparation antagoniste, d’autre part ce droit cosmopolitique n’est énonçable que par un seul être vivant : l’homme. Pour ce faire, si Kant n’est pas parvenu – ou n’a pas voulu – prévenir l’humanité de l’idée selon laquelle certains êtres humains pouvaient lui demeurer étrangers, c’est parce qu’il maintient dans son projet des frontières. Or, selon F. Wolff, les seules frontières acceptables sont celles de l’humain, « animal politique » selon la définition d’Aristote, essentiellement « parlant ». Dans l’optique des Lumières telle qu’elle est formulée par Kant, le cosmopolitisme se propose d’assurer la paix universelle et, en vue de cela, d’énoncer les conditions d’accueil des étrangers. Or ces dernières, dans le corpus kantien se cantonnent à une simple hospitalité qui, en l’occurrence, n’est pas un droit d’accueil, mais un droit de simple visite : la citoyenneté du monde n’en est que minimale. Le tort de Kant, selon F. Wolff, est de se refuser à supprimer les frontières – prétextant que les hommes, eu égard à de leur nature, ne peuvent vivre qu’à l’intérieur de cités. Kant s’éloigne à grands pas de l’utopie et, après avoir abandonné l’idée d’un État mondial, se contente de défendre une fédération d’États libres – ce qui est tout sauf utopique, à preuve que l’Union européenne rend ce projet effectif, du moins pour partie.
Un propos in prima persona
Le propos de F. Wolff est d’autant plus remarquable qu’il ne s’écarte, à aucun moment, du contexte dans lequel il se formule, de la situation dans laquelle il prend place. L’auteur s’exprime in prima persona, et s’il mobilise les outillages conceptuels que lui fournissent ses devanciers, il ne se cache pour autant à aucun moment derrière leur autorité. Ce point n’est pas de petite importance, comme en atteste la fin de l’ouvrage et la distance que F. Wolff prend avec le cosmopolitisme de Kant – distance respectueuse mais non moins franche. Loin de se contenter de vaines ratiocinations, le livre est un plaidoyer humaniste. Son écriture, fluide, polémique et incisive, permet d’aborder nombre de thèmes essentiels, amenées à rencontrer un large public, et sert un propos à la fois exigeant et accessible, apte à éclairer les dilemmes éthiques de notre temps. Le style ne brille jamais au détriment de l’argumentation hic et nunc, la philosophie étant ici le lieu où action et éthique se composent, se confondent ; et malgré les menaces que l’auteur pointe, il n’en demeure pas moins, en définitive, résolument optimiste.








